30.08.2013
BAUDELAIRE, L’ANTI-POÈTE DES MIDINETTES
Ce que j’aime chez Baudelaire (1821-1867), c’est qu’il est aux antipodes de l’image vulgaire que les midinettes se font du Pohèèète, ce « synonyme noble de nigaud » comme dit le Dictionnaire des idées reçues. Tous les clichés puérils que gobent les pétasses qui ramènent la Poésie à une zolie évocation des fleurs et des petits zoiseaux, Baudelaire en a pris rageusement le contrepied [1].
 Le Pohèèète est beau, jeune, séduisant, ses cheveux longs flottent dans le vent : — regardez la photo de Baudelaire par Carjat.
Le Pohèèète est beau, jeune, séduisant, ses cheveux longs flottent dans le vent : — regardez la photo de Baudelaire par Carjat.
Le Pohèèète a un côté un peu « hippie » ou « baba-cool », une tenue négligée, un style naturel ; il vit dans la spontanéité et l’improvisation permanente : — Baudelaire était un dandy, très attentif à sa mise et sa toilette, un peu maniéré, affectant des manières très distinguées et une politesse cérémonieuse. Il prisait par-dessus tout la propreté, le luxe et l’artificiel. Croire, parce qu’il a été condamné par la justice bourgeoise pour outrage à la morale publique, qu’il était une sorte de gauchiste crasseux, c’est commettre le même contresens monumental que les Belges : « Toutes ces canailles-là m’ont pris pour un monstre, et quand ils ont vu que j’étais froid, modéré et poli, – et que j’avais horreur des libres penseurs, du progrès et de toute la sottise moderne, ils ont décrété (je le suppose) que je n’étais pas l’auteur de mon livre… » [2]. Par ailleurs, Baudelaire n’a pas cessé de lutter contre sa tendance à la paresse et la procrastination. Dès 1846, il conseille aux écrivains de travailler à heures fixes, l’inspiration devant venir comme le sommeil et l’appétit [3]. Ses journaux intimes, pas seulement la série Hygiène, sont remplis de conseils et d’admonestations morales, pour se pousser à un travail régulier qui lui rapporterait la gloire et l’argent. La prière, l’examen de conscience, la confession, jouent un rôle très important pour lui [4].
Le Pohèèète aime la nature, la campagne, les fleurs, le printemps, les petits oiseaux : — Sauf dans sa jeunesse, Baudelaire détestait la nature et tout ce qui est naturel. Il prisait l’artifice (notamment chez une femme, qui selon lui n’est jamais assez coiffée, maquillée, habillée, parfumée, ornée de bijoux) [5]. Il n’aimait que les villes et a tiré son inspiration du Paris moderne [6]. Sa saison de prédilection était l’automne [7]. Quand il lance une invitation au voyage, c’est pour célébrer les Pays-Bas, pays artificiel s’il en est, plein de digues et de canaux, où l’attirent les intérieurs riches avec leurs plafonds, leurs miroirs, leurs meubles luisants (mais où il n’a jamais mis les pieds) [8].
Le Pohèèète aime les animaux : — Plusieurs témoignages font état de mauvais traitements de Baudelaire envers les animaux, notamment les chats. Le plus sérieux est celui de Judith Gautier, la fille de son ami Théophile, qui rapporte qu’elle a aperçu un jour Baudelaire suivre un chien perdu dans la rue pour faire exprès de lui marcher sur la queue : voir texte reproduit en note, avec deux autres [9]. Du reste il considérait que les « conversations intimes avec les animaux, chiens, chats, etc », doivent, tout aussi bien que les « amours pour les femmes », être rapportées à la postulation vers Satan, « ou animalité », qui est une « joie de descendre », en balance dans l’homme avec l’invocation à Dieu [10].
Le Pohèèète aime les enfants, ces êtres innocents et purs : — Baudelaire n’a jamais marqué d’intérêt pour les enfants (contrairement à Hugo, par exemple). Il en disait : « Ça dérange les papiers et ça poisse les livres » [11]. Parmi ses mystifications favorites, il adorait vanter un plat en le jugeant « tendre comme de la cervelle de petit enfant », comparaison qu’il aimait aussi appliquer aux noix fraîches [12]. Dans « Le joujou du pauvre », un des rares textes qu’il leur a consacrés, on voit deux enfants, un riche et un pauvre, fascinés par un rat, que le pauvre s’amuse à torturer dans sa boîte [13] : on est loin de l’image de l’enfant innocent, et plus proche de l’enfant « pervers polymorphe » ! Le désir de paternité semble ne l’avoir jamais traversé, bien au contraire : le poème XXVII des Fleurs du mal dépeint une femme de plus en plus minérale, célébrant dans le dernier vers « la froide majesté de la femme stérile ». On sait aussi que, dans sa jeunesse, Baudelaire avait envisagé un recueil poétique qui se serait appelé Les Lesbiennes.
Le Pohèèète aime la jeunesse, l’enthousiasme, le mouvement, la nouveauté, la modernité : — Baudelaire abhorrait la jeunesse en général et celle de son temps en particulier [14]. Il détestait les effusions lyriques, la poésie de Lamartine et Musset [15], posait au cynique froid, aimait les artistes cérébraux et calculateurs comme Poe et Gautier, et aspirait à une sorte de contemplation immobile d’objets statiques : « Je hais le mouvement qui déplace les lignes » [16]. Il invente certes la notion de modernité, mais c’est pour y voir une moitié de l’art, indissociable de son autre moitié, l’intemporel [17]. Rappelons aussi qu’il était très doué en vers latins et qu’il a même inclus un poème latin dans Les Fleurs du mal. De façon cohérente, il faisait de la connaissance du latin un critère de jugement littéraire [18].
Le Pohèèète respire la joie de vivre et il chante l’entrain, le bonheur, la douceur : — Baudelaire a été miné toute sa vie par un tempérament dépressif qu’il appelait « spleen » [19]. Il a fait une tentative de suicide en 1845, et en 1861 se dira encore « depuis assez longtemps au bord du suicide » [20]. Il est le poète du mal, du péché, de la violence. Il décrit une humanité corrompue, marquée par Satan, prenant plaisir à souffrir et à faire souffrir. Son inspiration est volontiers morbide, attirée par le bizarre, la misère, le répugnant, la maladie, la vieillesse, la bêtise [21]. Relire « Au lecteur », poème liminaire des Fleurs du mal, qui en donne la note générale : l’homme aime le mal, et s’il ne se voue pas complètement à lui, c’est par faiblesse.
Le Pohèèète dit oui à la vie, il s’émerveille en permanence de la beauté des choses, sa conscience de l’harmonie universelle le pousse à adhérer au monde tel qu’il est : — Baudelaire avait un implacable pouvoir de négation. Il a glorifié le reniement de saint Pierre au nom d’une sorte d’insatisfaction générale du monde, dans un poème dont le substitut Ernest Pinard demanda la censure pour atteinte à la morale religieuse : « Certes, je sortirai, quant à moi, satisfait / D'un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve ; / Puissé-je user du glaive et périr par le glaive ! / Saint Pierre a renié Jésus… il a bien fait ! » [22]. Hypersensible à la bêtise de ses congénères et à la laideur de son temps, Baudelaire aimait à prendre le contrepied des opinions courantes. Son goût du paradoxe et son esprit de contradiction étaient si virulents que nombre de ses contemporains ont cru qu’il n’avait aucune opinion sincère, se contentant par principe de s’opposer à la majorité pour se singulariser [23].
Le Pohèèète a le cœur pur comme Jésus, il n’est qu’amour : — Baudelaire est marqué par Sade [24] (ainsi que par Joseph de Maistre, penseur radicalement hostile aux Lumières, à la pensée libre, à l’idée de la bonté originelle de l’homme). Son œuvre est remplie d’imprécations furieuses contre les bourgeois, contre les Belges, contre ses ennemis personnels. Il injurie George Sand avec rage : humaniste, féministe, idéaliste et socialiste, elle incarne tout ce qu’il abomine ! [25]. Sa poésie est assez violente. Il invoque Satan, consacre des poèmes à la haine, au masochisme, au goût du Néant, au spleen, au guignon, à une charogne, à la douleur, à l’horreur, à un assassin, à la prostitution, au mal de vivre, aux passions destructrices, à la débauche, à la mort… [26].
Le Pohèèète vit dans le bleu, il ne voit que des anges autour de lui : — Baudelaire croyait à l’existence du diable, ou tout au moins « d’une force méchante extérieure à l’homme » le poussant à commettre certaines actions mauvaises [27]. Voir aussi la préface des Nouvelles histoires extraordinaires, où il reconnaît cette idée chez Edgar Poe [28].
Le Pohèèète parle toujours avec son cœur, car il n’y a de poésie que du cœur : — Baudelaire déteste cette idée d’une « poésie du cœur », qui lui inspire une diatribe enflammée dans un article de critique. Il y a là pour lui une erreur fondamentale. Qu’on puisse considérer comme un poète un bon bourgeois qui brille par ses vertus domestiques et humaines le met en fureur [29]. Et dans une lettre, il le dit de manière encore plus brutale : « À propos du sentiment, du cœur, et autres saloperies féminines, souvenez-vous du mot profond de Leconte de Lisle : "Tous les Élégiaques sont des canailles" » [30].
Le Pohèèète est avant tout un dévot de l’AAAmour, qu’il chante comme nul autre : — Baudelaire considère que « l’amour, c’est le goût de la prostitution » [31]. Il compare l’acte d’amour à une torture ou à une opération chirurgicale, car il consiste à faire le mal, le mal étant source de toute volupté [32].
Le Pohèèète est un grand romantiiique, il nourrit toute sa vie une grande passion pour une princesse : — Pendant une brève période, et non sans entretenir d’autres relations parallèles, Baudelaire a idéalisé en vers Apollonie Sabatier, une demi-mondaine aux nombreux amants à qui Théophile Gautier envoya une célèbre lettre pornographique. Il s’en est désintéressé aussitôt après avoir couché avec elle. Il a entretenu une longue liaison tumultueuse avec une demi-prostituée mulâtre, qui le tenait par les sens et lui dévorait son argent (Jeanne Duval). Il l’a plusieurs fois rejetée, conscient qu’elle pourrissait sa vie et entravait son travail créateur [33].
Le Pohèèète est galant avec les femmes, il les idéalise, et en particulier les jeunes filles, qu’il voit comme des créatures douces et angéliques : — Baudelaire était d’une misogynie féroce. Il trouvait les femmes imbéciles, à jamais incapables de toute pensée élevée ou religieuse. Il voit en la femme un être « naturel, c’est-à-dire abominable » [34], ou encore une « esclave vile, orgueilleuse et stupide » [35]. Il soulignait en outre « la nécessité de battre les femmes » [36]. Quant aux jeunes filles, il les tenait en exécration : « La jeune fille épouvantail, monstre, assassin de l’art. La jeune fille, ce qu’elle est en réalité. Une petite sotte et une petite salope ; la plus grande imbécillité unie à la plus grande dépravation » [37].
 Le Pohèèète a des mœurs pures, il a un côté diaphane, éthéré, il plane au-dessus des contingences matérielles, inaccessible aux appétits triviaux : — Baudelaire fréquentait les bordels, où il attrapé la syphilis. Il était aussi toxicomane : il a essayé le hachiche et consommé de l’opium jusqu’à la dépendance pendant quinze ans, il a célébré le vin et le tabac. Sa forte consommation de vin et d’opium n’a pas manqué de lui détraquer la santé [38], d’autant qu’il passait une bonne partie de ses journées dans les cafés. Toute sa vie, il a dû se débattre dans les ennuis d’argent et fuir ses créanciers, logeant dans des chambres misérables ou des hôtels de basse catégorie. Entre 1856 et 1861, il a abondamment pratiqué avec son ami et éditeur Poulet-Malassis la « navette », dite maintenant « cavalerie », c’est-à-dire l’accumulation frauduleuse d’emprunts. Une large moitié de sa correspondance est envahie par des considérations pécuniaires, donnant l’impression qu’il était en permanence tenaillé par le souci de ses dettes et de ses échéances [39]. Il incriminait le « guignon », mais on peut aussi penser avec Sartre qu’il a choisi sciemment cette vie de marginal. Les photos des dernières années le montrent précocement vieilli, notamment une photo de Charles Neyt, en 1864 ou 65 (43 ou 44 ans, ci-contre), que le poète a dédicacée à son ami Poulet-Malassis, où il est couvert de cheveux blancs, ce que confirment des témoins [40].
Le Pohèèète a des mœurs pures, il a un côté diaphane, éthéré, il plane au-dessus des contingences matérielles, inaccessible aux appétits triviaux : — Baudelaire fréquentait les bordels, où il attrapé la syphilis. Il était aussi toxicomane : il a essayé le hachiche et consommé de l’opium jusqu’à la dépendance pendant quinze ans, il a célébré le vin et le tabac. Sa forte consommation de vin et d’opium n’a pas manqué de lui détraquer la santé [38], d’autant qu’il passait une bonne partie de ses journées dans les cafés. Toute sa vie, il a dû se débattre dans les ennuis d’argent et fuir ses créanciers, logeant dans des chambres misérables ou des hôtels de basse catégorie. Entre 1856 et 1861, il a abondamment pratiqué avec son ami et éditeur Poulet-Malassis la « navette », dite maintenant « cavalerie », c’est-à-dire l’accumulation frauduleuse d’emprunts. Une large moitié de sa correspondance est envahie par des considérations pécuniaires, donnant l’impression qu’il était en permanence tenaillé par le souci de ses dettes et de ses échéances [39]. Il incriminait le « guignon », mais on peut aussi penser avec Sartre qu’il a choisi sciemment cette vie de marginal. Les photos des dernières années le montrent précocement vieilli, notamment une photo de Charles Neyt, en 1864 ou 65 (43 ou 44 ans, ci-contre), que le poète a dédicacée à son ami Poulet-Malassis, où il est couvert de cheveux blancs, ce que confirment des témoins [40].
Le Pohèèète est humble, respectueux, chaleureux :— Baudelaire affectait un air froid et cynique. Il s’est fait une légende d’excentrique, en multipliant toute sa vie les provocations les plus incongrues pour choquer ses contemporains. Il s’est teint les cheveux en vert, ou se les est complètement rasés, pour le pur plaisir d’attirer l’attention sur lui. Un jour qu’il arrivait en retard dans une société, il lança : « Pardon, je suis en retard, je viens de gamahucher ma mère » [41]. (Aux âmes candides, rappelons que « gamahucher » signifie pratiquer un cunnilingus). Ses contemporains lui ont dailleurs beaucoup reproché ce goût de l’épate, qui aura contribué à discréditer ses écrits, où l’on voyait du chiqué, des outrances gratuites, des horreurs complaisamment étalées dans le seul but de répugner et scandaliser [42]. C’est à se demander s’il n’a pas fait exprès d’être mal compris [43].
Le Pohèèète est un être bon, généreux, charitable, il se dévoue sans cesse pour les autres : — Baudelaire était irascible, hargneux, méprisant, prodigue de sarcasmes envers les « vilaines canailles » [44]. Vindicatif, il ruminait des pamphlets haineux contre ceux dont il avait à se plaindre (Villemain, le journal Le Siècle, les Belges, etc). Il détestait l’idée de se rendre utile à la collectivité [45] et se moquait de l’humanitarisme de Victor Hugo en déclarant : « Je me fous du genre humain, et il ne s’en est pas aperçu » [46]. Il était pris de crises de violence, il frappait sa maîtresse Jeanne Duval : « en vérité je suis enchanté qu’il n’y ait aucune arme chez moi ; je pense aux cas où il m’est impossible d’obéir à la raison, et à la terrible nuit où je lui [ai] ouvert la tête avec une console » [47]. Il rêvait d’assassiner son beau-père qu’il détestait, le général Aupick, brillant militaire qui fit le bonheur de sa mère et dont la belle carrière se termina par des postes d’ambassades prestigieuses [48].
Le Pohèèète aime le travail d’équipe, il entraîne ses compagnons, il est solidaire des autres Pohèèètes avec qui il œuvre collectivement : — Baudelaire est un indécrottable individualiste. Il déteste l’idée d’écrire en collaboration ou de devenir chef d’école : « Je ne connais rien de plus compromettant que les imitateurs et je n’aime rien tant que d’être seul » [49].
Le Pohèèète communie naturellement avec les autres qu’il comprend de l’intérieur, son âme ductile et empathique épouse à merveille l’âme de quiconque : — Baudelaire ne sort jamais de lui-même [50]. Il a conçu des dizaines de projets de romans ou de drames, il n’en a jamais écrit un seul, incapable de se projeter dans un personnage fictif différent de lui. Toute son œuvre est totalement personnelle : le « je » des Fleurs du mal ou du Spleen de Paris, c’est toujours lui-même, comme est aussi lui-même Samuel Cramer, le héros de sa seule nouvelle, La Fanfarlo, écrite dans sa jeunesse. S’il a traduit assidûment Edgar Poe, c’est parce qu’il a reconnu en lui une âme-sœur, ayant les mêmes pensées voire les mêmes phrases que lui [51].
 Le Pohèèète n’a pas de frontière, il aime les étrangers autant que ses compatriotes : — Baudelaire a écrit des pages d’une violence incroyable sur les Belges, sur lesquels il vomit un mépris et une haine qui le feraient aujourd’hui qualifier de raciste. Il les voyait proches du singe et du mollusque, leur reprochant d’être stupides, brutaux, sales, grégaires, laids, contrefaits, incultes, insensibles à la Beauté, féroces, maladroits, dépourvus de goût, impudiques, grossiers, vaniteux, lourds, cancaniers, petits, conformistes, lents, paresseux, malhonnêtes, avares, envieux, médisants, barbares, incultes, impies, prétentieux, corrompus, philistins, etc [52]. Il préconise non pas l’invasion de la Belgique (car son annexion ne ferait qu’augmenter le nombre de sots en France), mais la razzia, razzia de toutes les œuvres d’art qui ne sauraient appartenir légitimement aux Belges, puisqu’ils n’y comprennent rien [53]. Par ailleurs, il semble bien qu’il ait été résolument islamophobe [54]. Faut-il croire qu’il fût aussi antisémite ? On trouve dans Mon cœur mis à nu un fragment très déconcertant : « Belle conspiration à organiser pour l’extermination de la Race Juive. / Les Juifs, Bibliothécaires et témoins de la Rédemption » [55].
Le Pohèèète n’a pas de frontière, il aime les étrangers autant que ses compatriotes : — Baudelaire a écrit des pages d’une violence incroyable sur les Belges, sur lesquels il vomit un mépris et une haine qui le feraient aujourd’hui qualifier de raciste. Il les voyait proches du singe et du mollusque, leur reprochant d’être stupides, brutaux, sales, grégaires, laids, contrefaits, incultes, insensibles à la Beauté, féroces, maladroits, dépourvus de goût, impudiques, grossiers, vaniteux, lourds, cancaniers, petits, conformistes, lents, paresseux, malhonnêtes, avares, envieux, médisants, barbares, incultes, impies, prétentieux, corrompus, philistins, etc [52]. Il préconise non pas l’invasion de la Belgique (car son annexion ne ferait qu’augmenter le nombre de sots en France), mais la razzia, razzia de toutes les œuvres d’art qui ne sauraient appartenir légitimement aux Belges, puisqu’ils n’y comprennent rien [53]. Par ailleurs, il semble bien qu’il ait été résolument islamophobe [54]. Faut-il croire qu’il fût aussi antisémite ? On trouve dans Mon cœur mis à nu un fragment très déconcertant : « Belle conspiration à organiser pour l’extermination de la Race Juive. / Les Juifs, Bibliothécaires et témoins de la Rédemption » [55].
Le Pohèèète est un grand voyageur : — Dans toute sa vie d’adulte, Baudelaire n’a pratiquement jamais quitté Paris. Quand il va faire des séjours à Honfleur, c’est pour se réfugier chez sa mère. Il a résidé quelques semaines à Châteauroux en 1848 et quelques mois à Dijon début 1850 [56], mais pour y occuper un emploi journalistique vite avorté : rien de touristique ! Son séjour en Belgique, en 1864-1866, est dû à des espérances lucratives qui seront déçues et déchaîneront sa colère. En 1841, à 20 ans, ses parents lui trouvent une place sur un bateau allant de Bordeaux à Calcutta pour lui changer ses idées. Mais ce voyage l’ennuie, et pendant toute la traversée, il ne fraye pas avec les autres passagers ni participe à la vie du bord, préférant rester enfermé dans sa cabine à lire Balzac. Il ne verra jamais l’Inde : arrivé à la Réunion, il décide de s’en tenir là et de revenir en France par un autre bateau [57]. Le lecteur des Fleurs du mal aura noté que, dans les deux tercets des « Hiboux », petite allégorie didactique, le besoin de changer de place est vu comme un « châtiment » : il faut rester immobile comme eux. Avec une ampleur impressionnante, le poème final du recueil, « Le voyage », fait l’accablant bilan de « l’amer savoir, celui qu’on tire du voyage » : partout l’humanité, semblable à elle-même, souffre et fait souffrir. Les décors exotiques les plus dépaysants abritent partout la même chose : « Du haut jusques en bas de l’échelle fatale, / Le spectacle ennuyeux de l’éternel péché », car « le monde, monotone et petit, aujourd'hui, / Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image : / Une oasis d'horreur dans un désert d'ennui ! ». Dès lors, à quoi bon sortir de chez soi ? « Faut-il partir ? rester ? Si tu peux rester, reste ; / Pars, s’il le faut » [58]. Le voyage n’est qu’une vaine tentative d’échapper au Temps, et le désir de trouver une satisfaction est toujours frustré : « Ô le pauvre amoureux des pays chimériques ! ». L’ailleurs est une illusion. Il n’y a qu’un seul véritable départ, et c’est la Mort.
Le Pohèèète est libre, étranger à toutes les institutions : — La justice du Second Empire a condamné Baudelaire pour six poèmes, mais celui-ci n’était pas du tout un rebelle et n’eût rien demandé de mieux qu’une sinécure officielle [59]. Il a tenté de se présenter à l’Académie française et d’obtenir la direction d’un théâtre public subventionné, l’Odéon. Il a même espéré la Légion d’honneur ! [60]. Il a sollicité à plusieurs reprises des subventions ministérielles [61] et en a quelquefois obtenu.
 Le Pohèèète aime ses frères humains, il est pour la charité, la fraternité, les droits sacrés de l’humain : — Baudelaire, qui disait que Joseph de Maistre lui avait appris à raisonner [62], est pour la peine de mort, contre la démocratie, pour le trône et l’autel. Un témoin rapporte qu’ « en matière politique, il avait pour devise "le pape et le bourreau" et niait les résultats des révolutions "qui avaient eu, disait-il, pour corollaire, le massacre des innocents" » [63]. Lui-même écrit que « les peuples adorent l’autorité », ajoutant avec son sens du paradoxe : « le trône et l’autel, maxime révolutionnaire » [64]. Il célèbre le soldat à l’égal du poète et du prêtre, « savoir, tuer et créer » étant les seules activités respectables [65]. La multitude vile lui paraît bonne pour l’écurie, taillable et corvéable ; dailleurs il voit « le peuple amoureux du fouet abrutissant » [66]. Il prie pour voir un jour le choléra exterminer les Belges [67]. C’est un aristocrate dans l’âme, un coriace misanthrope [68] ; il jouissait de sa mauvaise réputation et rêvait de devenir une sorte de paria universel [69].
Le Pohèèète aime ses frères humains, il est pour la charité, la fraternité, les droits sacrés de l’humain : — Baudelaire, qui disait que Joseph de Maistre lui avait appris à raisonner [62], est pour la peine de mort, contre la démocratie, pour le trône et l’autel. Un témoin rapporte qu’ « en matière politique, il avait pour devise "le pape et le bourreau" et niait les résultats des révolutions "qui avaient eu, disait-il, pour corollaire, le massacre des innocents" » [63]. Lui-même écrit que « les peuples adorent l’autorité », ajoutant avec son sens du paradoxe : « le trône et l’autel, maxime révolutionnaire » [64]. Il célèbre le soldat à l’égal du poète et du prêtre, « savoir, tuer et créer » étant les seules activités respectables [65]. La multitude vile lui paraît bonne pour l’écurie, taillable et corvéable ; dailleurs il voit « le peuple amoureux du fouet abrutissant » [66]. Il prie pour voir un jour le choléra exterminer les Belges [67]. C’est un aristocrate dans l’âme, un coriace misanthrope [68] ; il jouissait de sa mauvaise réputation et rêvait de devenir une sorte de paria universel [69].
Le Pohèèète est un prophète, un serviteur du Vrai, un héraut du Bien, il enseigne les peuples, il est utile à la société, son art a une valeur morale : — Baudelaire refuse nettement cette idée bourgeoise. Il se moque de « Hugo-sacerdoce » et vomit le clan Hugo qui met la littérature au service de l’imbécile et détestable idéologie du progrès [70] ; le moralisme démocratique des Misérables l’a révulsé [71]. Il dénonce « l’hérésie de l’enseignement » en art : la poésie « n’a pas la Vérité pour objet, elle n’a qu’Elle-même ». Cette confusion des ordres ne peut que la faire tomber dans le plus détestable prêchi-prêcha [72]. Il y a du Parnassien chez ce romantique de seconde génération (il a d’ailleurs dédié les Fleurs du mal à Théophile Gautier à qui il a aussi consacré deux études très louangeuses, et admirait Leconte de Lisle à qui il était lié).
Le Pohèèète est progressiste, il croit que l’humanité marche vers un avenir radieux : — Baudelaire déteste par-dessus tout l’idéologie du Progrès. Il croit que l’homme, marqué par le péché originel, sera toujours une brute sauvage [73]. Il vomit ses contemporains et considère son temps comme une époque d’avilissement croissant, à cause de la civilisation commerciale et industrielle. Indifférent à l’amélioration des techniques, il prophétise même que « le monde va finir », en raison de « l’avilissement des cœurs » et des âmes entraîné par le développement du progrès et du lucre [74]. Il a une aversion particulière pour Le Siècle, journal d’opposition au Second empire, organe de l’opinion républicaine, progressiste, voltairienne, anticléricale [75]. Il admire Edgar Poe, et voit un frère en ce réactionnaire qui comme lui « lâche à torrents son mépris et son dégoût sur la démocratie, le progrès et la civilisation » [76].
Le Pohèèète est un être d’intuition, de sensations, d’affects, il n’est pas très intelligent : — Baudelaire était un des hommes les plus intelligents de son temps, comme en témoignent facilement ses écrits. Il a admiré, traduit et préfacé La Genèse d’un poème d’Edgar Poe, texte où celui-ci explique que son poème « Le Corbeau », loin d’être issu d’une visitation divine ou d’une inspiration mystérieuse, procède au contraire d’un calcul hyper-concerté d’effets minutieux : le poète résout un problème rhétorique comme si c’était un problème mathématique, avec la même logique rigoureuse que le détective Auguste Dupin résout une énigme. « Un peu de charlatanerie est toujours permise au génie, et même ne lui messied pas », approuve Baudelaire [77], ravi que le poète soit cyniquement présenté comme un artisan laborieux et savant plutôt que comme une pythie en proie au délire prophétique. C’est dans le même état d’esprit qu’il fait l’éloge de Théophile Gautier.
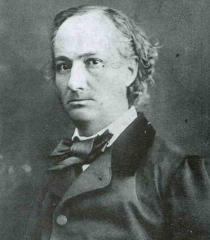 Le Pohèèète écrit avec son âme, il n’est pas très attentif à la forme, il dédaigne de corriger son orthographe : — Baudelaire avait le culte de la perfection formelle, il était soucieux des moindres détails de ses textes, méticuleusement attentif à chaque virgule. Ainsi écrit-il à un éditeur : « Je vous avais dit : supprimez tout un morceau, si une virgule vous déplaît dans le morceau, mais ne supprimez pas la virgule ; elle a sa raison d’être. / J’ai passé ma vie entière à apprendre à construire des phrases, et je dis, sans crainte de faire rire, que ce que je livre à une imprimerie est parfaitement fini » [78]. Plus encore, il mettait une obsession de pion dans l’application de l’orthographe, et méprisait ceux qui la maltraitaient. On dirait aujourd’hui qu’il y a en lui un côté « nazi de la grammaire » ou « ayatollah de l’orthographe » [79].
Le Pohèèète écrit avec son âme, il n’est pas très attentif à la forme, il dédaigne de corriger son orthographe : — Baudelaire avait le culte de la perfection formelle, il était soucieux des moindres détails de ses textes, méticuleusement attentif à chaque virgule. Ainsi écrit-il à un éditeur : « Je vous avais dit : supprimez tout un morceau, si une virgule vous déplaît dans le morceau, mais ne supprimez pas la virgule ; elle a sa raison d’être. / J’ai passé ma vie entière à apprendre à construire des phrases, et je dis, sans crainte de faire rire, que ce que je livre à une imprimerie est parfaitement fini » [78]. Plus encore, il mettait une obsession de pion dans l’application de l’orthographe, et méprisait ceux qui la maltraitaient. On dirait aujourd’hui qu’il y a en lui un côté « nazi de la grammaire » ou « ayatollah de l’orthographe » [79].
Le Pohèèète est un rêveur, il aime les choses nébuleuses, c’est l’homme du sentiment et non pas du raisonnement : — Baudelaire est autant un essayiste qu’un poète. Les trois quarts de son œuvre sont constitués de textes argumentatifs : articles critiques et essais. Ce qu’on appelle ses « journaux intimes » s’apparente moins à un journal quotidien d’épanchements qu’à un recueil d’aphorismes, d’une tonalité âpre, cruelle, furieuse, vengeresse. Son jugement artistique est d’une sûreté exceptionnelle : proclamant le génie de Wagner en musique et de Delacroix en peinture, saluant Poe, Flaubert, Balzac, Chateaubriand, Laclos, Stendhal, il ne se trompe presque jamais dans la louange ni dans le blâme, qu’il est capable de justifier avec précision. Dans le domaine de l’observation des mœurs et de la réflexion philosophique (voire politique), ses réflexions sont toujours aigües et stimulantes, éclatant en formules ardentes, en « fusées » qui n’ont pas fini de nous éclairer.
Eh oui, ce poète était aussi un moraliste. On pourrait lui appliquer ce mot de Villiers de l’Isle-Adam, qui l’admirait beaucoup : « La différence entre un poète et un rimeur, c’est qu’un poète est aussi un philosophe ». Il n’est que d’ouvrir les œuvres de Baudelaire pour voir les maximes se présenter en foule. J’en ai réuni une copieuse sélection dans cet article connexe.
Remarque finale : Comme l’aura compris le lecteur avisé, cet article propose de voir Baudelaire sous un certain angle. Il n’entend pas donner un portrait complet et objectif du poète, dont la riche personnalité ne manquait pas de contradictions. Il serait donc vain de m’opposer quelques faits ou textes contraires à ma thèse pour la nuancer : je les connais. Ayant cherché à pulvériser une image naïve et fausse conçue par l’ignorance et la bêtise, j’ai nécessairement dû charger un peu trop la barque dans l’autre sens. Il me suffit que ce que j’ai dit soit vrai, même si ça n’englobe pas tout ce qui est vrai. J’assume la partialité qui en résulte, et laisse au lecteur le soin d’ajouter quelques contrepoids pour parvenir à l’équilibre.
[1] Pour connaître la vie et la personnalité de Baudelaire, les sources de base sont, en plus bien sûr des deux volumes de ses œuvres complètes en Pléiade, les deux volumes de sa correspondance dans la même collection, le petit volume Baudelaire devant ses contemporains, 10/18 n°364/365, 2ème trimestre 1967 (recueil de témoignages rassemblés par W.T. Bandy et Claude Pichois, ébauche d’un Corpus baldelarianum exhaustif qui serait bien utile), et la biographie de référence : Baudelaire, par Claude Pichois et Jean Ziegler, Julliard, 1987 (3ème édition : Fayard, 2005).
[2] Lettre à Narcisse Ancelle, 13 octobre 1864, Correspondance Pléiade tome II p. 409. Comparer avec ce que Sainte-Beuve avait écrit à l'occasion de la malheureuse candidature à l'Académie : « Ce qui est certain, c’est que M. Baudelaire gagne à être vu, que là où l’on s’attendait à voir entrer un homme étrange, excentrique, on se trouve en présence d’un candidat poli, respectueux, exemplaire, d’un gentil garçon, fin de langage et tout à fait classique dans les formes. » (« Des prochaines élections à l’Académie », article paru dans Le Constitutionnel du 20 janvier 1862, repris dans Nouveaux Lundis, tome I, 1863, éd. M. Lévy, p. 401-402).
[3] « Conseils aux jeunes littératures », § 6, tome II p. 18. Malheureusement Baudelaire n’était guère capable de suivre ce genre de conseils, d’où une existence passée tout entière sous le signe du remords et du mécontentement de soi.
[4] Les sections V, VI et VII de Hygiène, en particulier, seraient à citer entièrement (tome I p. 671-673). Contentons-nous de deux lignes : « Travail immédiat, même mauvais, vaut mieux que la rêverie. / Une suite de petites volontés fait un gros résultat ». On lit aussi dans Fusées, XIII, 20 (p. 662) : « Un peu de travail, répété trois-cent-soixante-cinq fois, donne trois-cent-soixante-cinq fois un peu d’argent, c’est-à-dire une somme énorme. En même temps la gloire est faite. / De même, une foule de petites jouissances composent le bonheur ».
[5] Lire surtout l’ « Éloge du maquillage », dans Le Peintre de la vie moderne, XI (Pléiade, tome II, p. 714-718) et aussi « Les bijoux » (Les Épaves, VI ; tome I p. 158).
[6] Voir les dix-huit poèmes de la section « Tableaux parisiens » des Fleurs du mal de 1861.
[7] « Causerie » (LV), « Chant d’automne » (LVI), « Sonnet d’automne » (LXIV), etc.
[8] « L’invitation au voyage » (LIII), vers 15-26. C’est encore plus net dans la version en prose du poème (Le Spleen de Paris, XVIII, Pléiade tome I p. 301-303).
[9] Voici ce texte peu connu, tiré du Second rang du collier. Souvenirs littéraires, Juven, circa 1903, p. 60-63. Je l’ai allégé pour le concentrer sur le cœur de l’anecdote du chien. On se demande ce que les éditeurs attendent pour republier les trois tomes des fort intéressants mémoires de Judith Gautier, très précieux sur la vie littéraire de la seconde moitié du XIXe siècle. (Et tant qu’on y est, on peut aussi rêver d’une réédition des souvenirs en sept tomes de Juliette Adam…) : « D'une fenêtre du premier, je regarde dans la rue. […] Quelqu'un marche pourtant, au loin, venant de l'avenue de Neuilly : un homme, qui s'avance lentement et d'une allure singulière. […] Un chien marche devant l'homme, un assez grand chien à longs poils et horriblement crotté. […] Pourquoi l'homme marchait-il si près de ce chien, qui n'avait pas l'air d'être son chien ? / Tout à coup, la distance diminuant, je reconnus le promeneur : c'était Charles Baudelaire. Il venait chez nous, certainement, mais quelle idée avait-il ? Que lui avait fait ce vulgaire toutou, qui ne le voyait même pas ? / Je crus comprendre que Baudelaire cherchait à lui marcher sur la queue, non pas dans une méchante intention, mais, sans doute, pour jouir de la surprise et de la frayeur de l'animal, pour voir ce qu'il ferait. Il le vit !… / Le promeneur ayant réussi à presser, du bout de son pied, la pointe de la queue du chien, celui-ci poussa un hurlement de peur, mais aussitôt il se retourna et se jeta sur l'homme, qui tomba en pleine boue jaune ! Par bonheur, les représailles ne furent pas poussées plus loin : le chien détala, retournant vers l'avenue. […] [Il arrive chez les Gautier, où il fait nettoyer ses habits. Théophile l’interroge, inquiet d’apprendre que son ami a été attaqué par un chien :] / "Mais quelles raisons ce chien avait-il de t'en vouloir ? Les animaux sont logiques et n'agissent pas sans raisons, comme les bipèdes. Avais-tu escaladé les clôtures confiées à sa garde, pour enlever quelque bourgeoise ? – Cet animal était dans son droit : je l'avais offensé, en lui marchant sur la queue, exprès. Mais je suis très humilié, parlons d'autre chose". / Décidément, je ne saurai jamais pour quelle raison ce grand poète s'était acharné à jouer un mauvais tour à ce pauvre chien des rues. Peut-être ne le savait-il pas lui-même ; ou seulement avait-il cherché à se ménager une entrée originale, en racontant son aventure : il aimait beaucoup n'être pas ordinaire et causer de l'étonnement. [Suivent deux autres anecdotes illustrant ce comportement excentrique]. » — Autre témoignage, celui du journaliste Adrien Marx : « Je dînais avec lui régulièrement dans une taverne de la rue Bréda, habitée par un chat noir. […] Il n’était pas rare qu’après la régalade il ne saisît l’animal par la queue et l’élevant en l’air ne lui arrachât les poils de ses moustaches avec une joie qui tenait du délire. […] Une autre fois il faillit se faire dévorer la main au Jardin des Plantes par un lion au nez duquel il avait présenté un cigare ». (« Une figure étrange », paru dans L’Évènement, 14 juin 1866, article recueilli dans Indiscrétions parisiennes, Faure, 1866, p. 215). — Un autre témoin, Maxime Rude, raconte que Baudelaire se plaisait à réveiller les chats en les caressant à rebrousse-poil : « J’ai été obligé de m’interposer, certain jour, pour le tirer d’une lutte très animée avec un gros chat rouge de l’avenue de Clichy » que le poète avait agacé à l’étalage d’un fruitier (Confidences d’un journaliste, Sagnier, 1876, p. 168-169). — La justice moderne ne censurerait pas certaines pièces des Fleurs du mal, en revanche elle serait impitoyable pour ces maltraitances envers animaux. Baudelaire, s’il vivait aujourd’hui, ne serait pas considéré avec une indulgence agacée comme un bohème excentrique, mais avec horreur comme un fou dangereux à condamner, enfermer et guérir. Les pages Facebook « Pour interdir Beaudelaire, le pseudo-poète qui torture les animaux » ou « Pour vengé le chien de l’avenue de Neuilly et écrasé Baudeler à coup de talon jusqu’a se que la mort sen suive » recueilleraient des centaines de milliers de jaimages.
[10] Mon cœur mis à nu, XI, 19 (Pléiade tome I p. 683).
[11] Mot rapporté par Maxime Rude, Confidences d’un journaliste, Sagnier, 1876, p. 168.
[12] Cette plaisanterie des cervelles d'enfant se trouve par exemple dans la page citée à la note précédente, dans l’Histoire anecdotique et critique de la presse parisienne. 1857 et 1858 de Firmin Maillard, éd. Poulet-Malassis et de Broise, 1859, p. 117-118, ainsi que dans une importante lettre de Jules Troubat (le secrétaire de Sainte-Beuve) à Eugène Crépet datée du 16 août 1886 (et publiée par Jacques Crépet dans le Bulletin du bibliophile de février 1946, p. 62-63). Colportée aussi par d’innombrables plumitifs qui la connaissaient par ouï-dire, c’est l’un des constituants les plus fameux de la légende du poète provocateur, qui lui a porté beaucoup de tort de son vivant et après sa mort : non pas évidemment qu’on l’ait pris pour un cannibale, mais parce qu’on a vu en lui un adolescent attardé, un poseur pathétique cherchant à tout prix à attirer l’attention sur lui. Ces blagues puériles ont fait écran entre son œuvre et ses contemporains, et paradoxalement masqué ce qu’il avait de singulier : « Son originalité, qui était grande, se trouvait souvent atténuée par le mal qu’il se donnait pour la faire ressortir », avance Maxime Du Camp, observateur avisé et dédicataire du « Voyage » (Souvenirs littéraires, éd. Aubier, 1994, p. 394). Ceux qui s’intéresseraient au topos de Baudelaire se pourléchant de cervelles d’enfants peuvent lire l’étude en cinq volets qu’Antonio Dominguez Leiva, un chercheur spécialiste de la culture de la cruauté, a publiée sur son blogue en avril-mai 2011, et qui rassemble les principaux échos de cette histoire.
[13] Le Spleen de Paris, XIX, Pléiade tome I p. 304-305.
[14] Voir notamment la préface aux Martyrs ridicules de Léon Cladel (tome II p. 182-187) : « La Jeunesse, dans le temps présent, m’inspire, par ses défauts nouveaux, une défiance déjà bien suffisamment légitimée par ceux qui la distinguèrent en tout temps. J’éprouve, au contact de la Jeunesse, la même sensation de malaise qu’à la rencontre d’un camarade de collège oublié, devenu boursier, et que les vingt ou trente années intermédiaires n’empêchent pas de me tutoyer ou de me frapper sur le ventre. Bref, je me sens en mauvaise compagnie » (p. 182). Une page qui a dû enchanter Pierre Desproges, s’il l’a lue…
[15] « Infâme petit lyrique ! » était l’injure dont il aimait à rabrouer son ami Philoxène Boyer, au témoignage d’Asselineau (dans l’appendice VIII de Charles Baudelaire, étude biographique par Eugène Crépet, Vanier-Messein, 1906, p. 294-295).
[16] « La beauté » (Fleurs, XVII, vers 7 ; tome I p. 21). Relire le poème en entier et le mettre en rapport avec la célébration récurrente de la femme froide, dans les vers finaux de « Je t’adore à l’égal de la voûte nocturne… » (XXIV), de « Avec ses vêtements ondoyants et nacrés… » (XXVII), de « Une nuit que j’étais près d’une affreuse Juive… » (XXXII), de « Je te donne ces vers afin que si mon nom… » (XXXIX), de « Sonnet d’automne » (LXIV), etc ; on retrouve encore ce motif dans « Le chat » (XXXIV), mais je ne prétends pas faire un inventaire exhaustif. Il est vrai que le thème de la femme qui danse est tout aussi récurrent ; cependant il s’agit toujours d’une danse lente et lascive, dont le caractère régulier a quelque chose d’hypnotique et non pas d’excitant. Pour la contemplation immobile et paresseuse, voir par exemple « La vie antérieure » (XII), « La géante » (XIX), « Parfum exotique » (XXII), « Semper eadem » (XL), etc. Plus explicite encore, « Les Hiboux » (LXVII), qui transmettent une condamnation péremptoire de tout déplacement : « Leur attitude au sage enseigne / Qu’il faut en ce monde qu’il craigne / Le tumulte et le mouvement ; / L’homme ivre d’une ombre qui passe / Porte toujours le châtiment / D’avoir voulu changer de place » (tome I p. 67) : Baudelaire, précurseur de la critique barrésienne du déracinement ! — De manière générale, on a beaucoup sous-estimé le côté parnassien de ce grand admirateur de Théophile Gautier (le « poète impeccable » à qui sont dédiées Les Fleurs du mal), de Théodore de Banville et de Leconte de Lisle (dont « J’aime le souvenir de ces époques nues… », Fleurs, V, est si parent). C’est aussi qu’on se fait une fausse idée du Parnasse, en y voyant le contraire du romantisme, alors qu’il en est une des branches essentielles, et pas la plus tardive : Hugo publie Les Orientales en 1829 et Gautier Mademoiselle de Maupin en 1835. Ranger Baudelaire parmi les symbolistes, comme le font certaines histoires de la littérature depuis les années 20, est une ânerie : le symbolisme éclot en 1886, vingt ans après sa mort. Les symbolistes se sont réclamés de lui, mais il n’aurait guère apprécié leur obscurité ni leur témérité formelle. On me permettra de trouver Baudelaire, ce poète classique très attaché à la prosodie traditionnelle, beaucoup plus proche de Heredia (dont Les Trophées, qu’on lit si mal, sont tout entier consacrés à l’emprise du Désir et de la Mort), que des hallucinations de ce voyou de Rimbaud, que des abstractions byzantines de Mallarmé ou même que des langueurs arythmiques de Verlaine. Du reste, il a eu le temps de rejeter tout celà par anticipation, trois semaines avant sa mort cérébrale : venant de recevoir l’étude que le tout jeune Verlaine lui a consacrée, il écrit à sa mère le 5 mars 1866 : « Il y a du talent chez ces jeunes gens ; mais que de folies ! quelles exagérations et quelle infatuation de jeunesse ! Depuis quelques années je surprenais, çà et là, des imitations et des tendances qui m’alarmaient » (Correspondance, tome II p. 625).
[17] « La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable » (« Le Peintre de la vie moderne », IV ; tome II p. 695). Baudelaire n’a rien d’un néopathe, d’un jobard moderniste qui s’extasie devant tout ce qui est actuel. Il est attentif aux salons de peinture de son temps, mais toujours avec un discernement critique éclairé par la connaissance des maîtres anciens. Il glorifie Delacroix mais c’est parce qu’il est digne des « Phares » que sont Rubens, Léonard, Rembrandt, Michel-Ange, Puget, Watteau et Goya (Fleurs, VI). Il célèbre Constantin Guys, mais prise par-dessus tout « la note éternelle, le style éternel et cosmopolite » qu’il relève chez Chateaubriand et Edgar Poe, ainsi qu’Alphonse Rabbe (Fusées, XII, 18 ; tome I p. 661).
[18] Les vers latins étaient sa matière de prédilection au collège, où il a obtenu trois fois le premier prix de sa classe à Louis-le-Grand, et des récompenses au Concours général : 1er accessit en classe de troisième, 2ème prix en seconde. (On a retrouvé trois compositions scolaires de Baudelaire en vers latins : Pléiade tome I p. 226-235). Le poème latin inclus dans les Fleurs est la pièce LX, « Franciscae meae laudes » (tome I p. 61-62). Observons au passage que, dans ce poème d’amour à une mystérieuse Françoise, qui semble relever d’une inspiration spirituelle proche des pièces du cycle d’Apollonie Sabatier, le vers 21 présente un double sens obscène : « Quod debile, confirmasti », c’est-à-dire, « ce qui était faible, tu l’as affermi ». Les vers 25-30 présentent aussi des connotations scabreuses : « Revigore à présent mes forces, / Doux bain par de suaves / Odeurs parfumées ! / Ondule autour de mes reins, / Ô ceinture de chasteté, / Mouillée par une eau séraphique ». Comme dit Boileau, « le latin dans les mots brave l’honnêteté »… (Art poétique, chant II vers 175). — Parlant de Thomas De Quincey, il s’attarde avec admiration sur sa formation en langues anciennes et sa maîtrise du grec (tome I p. 446) ; parlant d’Hégésippe Moreau, il dit qu’avoir appris le latin permit à celui-ci « d’écrire sa langue un peu moins mal que tous ceux qui n’ont pas eu le malheur » d’avoir un pédagogue féru d’humanités classiques (tome II p. 159). À l’inverse, l’ignorance des langues anciennes est un des innombrables éléments à charge contre les Belges (Pauvre Belgique !, XIV ; tome II p. 873) : Baudelaire s’alarme que Victor Duruy veuille « faire de la France une Belgique » en y diminuant l’importance des études latines, dont il résulterait forcément la « haine de la poésie ». Preuve a contrario : le peintre Félicien Rops, admirateur d’Horace, de Baudelaire et de Barbey, homme « charmant, le seul Belge connaissant le latin et sachant causer en français » (XXIX, tome II p. 951). Un article universitaire de Corinne Saminadayar-Perrin, paru dans Romantisme en 2001 (n°113 p. 87-103), a étudié l’influence du latin sur le style de Baudelaire.
[19] Les quatre poèmes des Fleurs du mal intitulés « Spleen » (LXXV-LXXVIII) sont bien connus. Ils sont à lire en relation avec les poèmes voisins : « La cloche fêlée » (LXXIV), « Obsession » (LXXIX), « Le goût du néant » (LXXX) et d’autres du recueil comme « La muse malade » (VII), « Le mauvais moine » (IX), etc. Pour prendre la mesure de la dépression qui a accompagné Baudelaire pendant la majeure partie de sa vie, et sans que l’évaluation en soit faussée par la transmutation poétique, on lira par exemple la lettre à sa mère du 30 décembre 1857, dont voici le début : « Certainement, j'ai beaucoup à me plaindre de moi-même, et je suis tout étonné et alarmé de cet état. Ai-je besoin d'un déplacement, je n'en sais rien. Est-ce le physique malade qui diminue l'esprit et la volonté, ou est-ce la lâcheté spirituelle qui fatigue le corps, je n'en sais rien. Mais ce que je sens, c'est un immense découragement, une sensation d'isolement insupportable, une peur perpétuelle d'un malheur vague, une défiance complète de mes forces, une absence totale de désirs, une impossibilité de trouver un amusement quelconque. Le succès bizarre de mon livre et les haines qu'il a soulevées m'ont intéressé un peu de temps, et puis après celà je suis retombé. Vous voyez, ma chère mère, que voilà une situation d'esprit passablement grave pour un homme dont la profession est de produire et d'habiller des fictions. – Je me demande sans cesse : à quoi bon ceci ? À quoi bon celà ? C'est là le véritable esprit de spleen. – Sans doute, en me rappelant que j'ai déjà subi des états analogues et que je me suis relevé, je serais porté à ne pas trop m'alarmer ; mais aussi je ne me rappelle pas être tombé jamais si bas et m'être traîné si longtemps dans l'ennui. Ajoutez à celà le désespoir permanent de ma pauvreté, des tiraillements et les interruptions de travail causées par les vieilles dettes (soyez tranquille, ceci n'est pas un appel alarmant fait à votre faiblesse. Il n'est pas encore temps, POUR PLUSIEURS RAISONS, dont la principale est cette faiblesse et cette paresse que j'avoue moi-même), le contraste offensant, répugnant, de mon honorabilité spirituelle avec cette vie précaire et misérable, et enfin, pour tout dire, de singuliers étouffements et des troubles d'intestins et d'estomac qui durent depuis un mois. Tout ce que je mange m'étouffe ou me donne la colique. Si le moral peut guérir le physique, un violent travail continu me guérira, mais il faut vouloir, avec une volonté affaiblie ; – cercle vicieux. » (Correspondance Pléiade tome I, p. 437-438). Quelques années plus tard, à Bruxelles, une importante lettre de confidence à Mme Paul Meurice fera aussi état d’un mal-de-vivre permanent. J’en extrais le passage le plus significatif : « Non, je vous l’assure, je n’ai aucun chagrin très particulier. Je suis toujours de mauvaise humeur (c'est une maladie, celà), parce que je souffre de la bêtise environnante, et parce que je suis mécontent de moi. Mais en France, où il y a moins de bêtise, où la bêtise est plus polie, je souffrais aussi ; — et quand même je n’aurais strictement rien à me reprocher, je serais également mécontent, parce que je rêverais de faire mieux. Ainsi, que je sois à Paris, à Bruxelles, ou dans une ville inconnue, je suis sûr d’être malade et inguérissable. Il y a une misanthropie qui vient, non pas d’un mauvais caractère, mais d’une sensibilité trop vive et d’un goût trop facile à se scandaliser » (lettre à Mme Paul Meurice, 3 février 1865, Correspondance tome II p. 448).
[20] Lettre à Auguste Poulet-Malassis, 20 mars 1861, Correspondance tome II p. 135. Même idée quelques semaines plus tard : « Chaque minute me démontre que je n’ai plus de goût à la vie », aussi le suicide est-il « une idée non pas fixe, mais qui revient à des époques périodiques » (lettre à sa mère, 6 mai 1861, Correspondance tome II p. 151).
[21] Je pense bien sûr à « Une charogne » (XXIX), aux « Sept vieillards » (XC), aux « Petites vieilles » (XCI), aux « Aveugles » (XCII), mais aussi au « Désespoir de la vieille » (Le Spleen de Paris, II), à « Un plaisant » (ib., IV), aux « Veuves » (ib., XIII), à « La corde » (ib., XXX), aux « Bons chiens » (ib., L), etc. Au chapitre de ce goût pour le bizarre et l’impur, ajoutons que Baudelaire a pris pour maîtresses successives deux prostituées d’une autre race, la mulâtresse Jeanne Duval, et avant elle une Juive, Sara la Louchette, qui lui inspira les poèmes XXV : « Tu mettrais l’univers entier dans ta ruelle… » et XXXII : « Une nuit que j’étais près d’une affreuse juive… » des Fleurs, ainsi qu’un beau poème de jeunesse : « Je n’ai pas pour maîtresse une lionne illustre… » (tome I p. 203-204) dont Serge Reggiani récitait les trois derniers quatrains avant de chanter « Sarah » de Georges Moustaki.
[22] Les Fleurs du mal, CXVIII : « Le reniement de saint Pierre », vers 29-32, Pléiade tome I p. 122.
[23] Dans une lettre à Sainte-Beuve, Baudelaire avoue à la fois son goût impénitent pour le jeu de masque, et son esprit de contradiction systématique : « Un de nos grands amusements [avec Poulet-Malassis], c’est quand il s’applique à faire l’athée, et quand je m’ingénie à faire le jésuite. Vous savez que je peux devenir dévot par contradiction (surtout ici), de même que, pour me rendre impie, il suffirait de me mettre en contact avec un curé souillon (souillon de corps et d’âme) » (lettre du 30 mars 1865, Correspondance Pléiade tome II p. 491). Quelques années plus tôt, on lisait, dans un projet de préface aux Fleurs du mal : « J’ai un de ces heureux caractères qui tirent une jouissance de la haine et qui se glorifient dans le mépris. Mon goût diaboliquement passionné de la bêtise me fait trouver des plaisirs particuliers dans les travestissements de la calomnie. Chaste comme le papier, sobre comme l’eau, porté à la dévotion comme une communiante, inoffensif comme une victime, il ne me déplairait pas de passer pour un débauché, un ivrogne, un impie et un assassin » (Pléiade tome I p. 185). Voilà qui justifie l’intéressant témoignage d’Émile Leclercq, romancier réaliste belge qui le fréquenta « presque chaque soir » pendant l’hiver 1864-65 dans un cercle littéraire bruxellois : « Tout son succès de littérateur et de causeur […] était contenu dans un seul mot : contradiction. En peinture, sentant que le mouvement moderne emporte vers le naturalisme, il s’exaltait en parlant de David et de son école. En littérature, la forme et l’étrange étaient tout pour lui. Il n’avait ni convictions, ni sens commun, ni enthousiasme sincère. Il posait pour l’homme religieux, et sa vie, qu’il racontait sans vergogne, protestait tout entière contre le mysticisme dont il faisait étalage » (article paru dans Le Libre examen, 10 septembre 1867, et repris dans Gustave Charlier, Passages, Bruxelles, La Renaissance du livre, 1947, p. 162). Claude Pichois s’amuse à remarquer dans sa biographie que Baudelaire lance des plaisanteries faciles contre la propreté de Bruxelles, lavé à grands seaux d’eau mêlée de savon noir : « Et si Bruxelles avait été sale ? » (p. 511). Baudelaire a décrété une fois pour toutes que la France, que la Belgique, que son époque étaient abominables : par conséquent, il fait feu de tout bois en jugeant détestable tout ce qu’il voit, quoi qu’il voie. Et il en rajoute afin de bien passer pour un pestiféré, remettant lui-même en circulation les calomnies dont il s’était plaint à son arrivée en Belgique, comme le remarque encore Pichois (p. 515).
[24] Voir Georges Blin, Le Sadisme de Baudelaire, José Corti, 1948.
[25] Deux feuillets de Mon cœur mis à nu (XVI-XVII, 26-27 ; tome I p. 686-687) sont remplis de sarcasmes haineux et grossiers contre la femme Sand : « Elle est bête, elle est lourde, elle est bavarde ; elle a dans les idées morales la même profondeur de jugement et la même délicatesse de sentiment que les concierges et les filles entretenues. […] Que quelques hommes aient pu s’amouracher de cette latrine, c’est bien la preuve de l’abaissement des hommes de ce siècle. […] Elle a de bonnes raisons pour vouloir supprimer l’Enfer. […] Elle est surtout, et plus que toute autre chose, une grosse bête ; mais elle est possédée. […] Je ne puis penser à cette stupide créature sans un certain frémissement d’horreur. Si je la rencontrais, je ne pourrais m’empêcher de lui jeter un bénitier à la tête ».
[26] Il suffit de parcourir la table des matières des Fleurs du mal pour repérer à quels poèmes je fais allusion : la plupart des titres sont trop explicites pour que j’aie besoin de les énumérer. Leur ajouter « Les deux bonnes sœurs » (CXII), méconnu mais tellement représentatif, ou « Réversibilité » (XLIV) dont le dernier quintile constitue un antidote bien tardif aux quatre précédents, ainsi qu’ « Une charogne » (XXIX) : l’idéal n’est souvent qu’une fragile échappatoire pour conjurer la terrible prégnance du spleen. Pour la haine, en plus du « Tonneau de la haine » (LXXIII), il y a aussi « Duellum » (XXXV), ou même le dernier quatrain de « L’homme et la mer » (XIV). Pour le masochisme, ceux qui ignorent tout du grec doivent apprendre que « L’héautontimorouménos » (LXXXIII) signifie : le bourreau de soi-même. Très symptomatique aussi, « L’idéal » (XVIII) : « Ce qu’il faut à ce cœur profond comme un abîme, / C’est vous, Lady Macbeth, âme puissante au crime ». Ne pas oublier non plus les six pièces condamnées, qui ne sont pas reproduites dans toutes les éditions modernes, notamment « Femmes damnées » et « Les métamorphoses du vampire » ; ni les pièces de l’édition posthume de 1868, notamment « Épigraphe pour un livre condamné », « Madrigal triste », « Le rebelle », « L’avertisseur », « Le couvercle », « Le gouffre », « L’examen de minuit ». Dans Le Spleen de Paris, on retiendra surtout (comme pièces inspirées par le Mal) « La chambre double » (V), « Le fou et la Vénus » (VII), « Le mauvais vitrier » (IX), « À une heure du matin » (X), « Le gâteau » (XV), « Le joueur généreux » (XXIX), « Le tir et le cimetière » (XLV), « Perte d’auréole » (XLVI), « Assommons les pauvres ! » (XLIX). Notons par ailleurs qu’un des plus importants livres parus ces dernières années sur son œuvre s’intitule Baudelaire, violence et poésie. Il s’agit de la thèse de doctorat de Jérôme Thélot (Gallimard, 1993).
[27] Lettre à Flaubert du 26 juin 1860, Correspondance Pléiade tome II p. 1379.
[28] « Notes nouvelles sur Edgar Poe », II (Pléiade tome II p. 322-323).
[29] Dans son étude de 1859 sur Théophile Gautier, § III (Pléiade tome II p. 115).
[30] Lettre à Narcisse Ancelle, 18 février 1866, Correspondance Pléiade tome II p. 611. Toute cette importante lettre est à lire. C’est là qu’on trouve notamment une fameuse déclaration où Baudelaire avoue qu’il a mis dans Les Fleurs du mal, « ce livre atroce », tout son cœur et toute sa haine, si bien qu’une protestation officielle, selon laquelle celà ne serait que de l’art pur et de la comédie, serait à prendre pour un mensonge de couverture (p. 610). Juste avant, il a défini sa poésie comme « une poésie profonde, mais compliquée, amère, froidement diabolique (en apparence) ». À la fin, il dresse une liste des auteurs du XIXe qu’il exclut de son dégoût général de son temps : « Excepté Chateaubriand, Balzac, Stendhal, Mérimée, Vigny, Flaubert, Banville, Gautier, Leconte de Lisle, toute la racaille moderne me fait horreur. Vos académiciens, horreur. Vos libéraux, horreur. La vertu, horreur. Le vice, horreur. Le style coulant, horreur. Le progrès, horreur. Ne me parlez plus jamais des diseurs de riens » (p. 611). Cette liste est tout-à-fait remarquable, non seulement parce qu’il n’y a pas une seule erreur (pas un seul auteur ignoré par la postérité, même si Théodore de Banville n’est pas au même niveau que les autres, quoiqu’il commence à revenir), mais aussi parce qu’elle exclut tous les romantiques trop personnels, ceux qui donnent dans l’effusion sentimentale, les populaires « saligauds comme Béranger et Musset » (p. 610), ceux dont on pourrait dire, comme Gide de J. Guéhenno, qu’ils « parlent du cœur comme d’autres parlent du nez » (le mot se trouve dans un « Billet à Angèle » publié le 25 décembre 1937 dans la revue La Flèche, qui n’a pas été repris dans un volume de Gide à ma connaissance. Mais Jean Guéhenno a publié l’ensemble des pièces de la controverse qui l’opposa à Gide à cette époque, à propos du communisme, en appendice à son Journal d’une révolution. 1937-38, Grasset, 1939. La phrase se trouve page 235).
[31] Fusées, I,1 (Pléiade tome I p. 649). Voir aussi Mon cœur mis à nu, XXV, 45 (p. 692).
[32] Fusées, III,3 (tome I p. 651 et 652) et XI, 17 (p. 659). Lire aussi Mon cœur mis à nu, XXX, 54 (p. 695) qui fait de l’amour un malentendu dans lequel « ces deux imbéciles sont persuadés qu’ils pensent de concert », alors que « le gouffre infranchissable, qui fait l’incommunicabilité, reste infranchi ». Relire aussi « À celle qui est trop gaie » (Les Épaves, V), poème de l’amour sadique, dont les deux dernières strophes rendent un son étrangement contemporain à l’ère du « barebacking » (chevauchée à cru) : chose encore plus étrange, Baudelaire a ajouté à ce poème condamné une note où il repousse le « sens sanguinaire et obscène » que les juges y auraient découvert. Or ni le réquisitoire du substitut Pinard ni le libellé du jugement ne font état de cette « interprétation syphilitique » ! : Baudelaire n’aurait-il affecté de l’écarter que pour mieux la signaler ?
[33] Lire en particulier une lettre de Baudelaire à sa mère, datée du 27 mars 1852, où l’on trouvera une page d’une rare violence contre Jeanne Duval, dépeinte comme une idiote bornée et acariâtre, incapable de le comprendre et de l’aider, soucieuse uniquement de l’exploiter et le domestiquer, multipliant les infidélités, les vexations et les tracasseries (Correspondance Pléiade tome I p. 193). D’où ce constat : « Jeanne est devenue un obstacle, non seulement à mon bonheur, ceci serait bien peu de chose ; moi aussi je sais sacrifier mes plaisirs, et je l’ai prouvé ; – mais encore au perfectionnement de mon esprit ». Un an plus tard il confirmera que cette « ignoble créature » l’a fait fuir, car elle « le faisait tellement souffrir, par sa ruse, par ses criailleries, par ses tromperies » (lettre à sa mère du 26 mars 1853, tome I p. 211). Hélas, la résolution de rupture ne tiendra pas longtemps, et cette dernière lettre met aussi en avant les dons d’argent qu’il continue à lui faire et la culpabilité qu’elle lui inspire. Baudelaire ne réussira jamais à trancher cet attachement fatal. Le 8 décembre 1848, déjà, il la désignait à sa mère comme « une pauvre femme qu’ [il] n’aime depuis longtemps que par devoir », justifiant ensuite par une obligation morale « cette singulière liaison, où [il n’a] rien à gagner, et où l’expiation et le désir de rémunérer un dévouement jouent le grand rôle » (tome I p. 154). Cet esprit de charité, dont il se sera maintes fois justifié, a sans doute joué un rôle, et non moins un certain masochisme. La gratitude qu’il met en avant dans ces lettres doit être exagérée pour adoucir l’hostilité de sa mère, car au fil des années les dettes morales et financières qu’il avait contractées envers Jeanne au début de leur liaison ont été très largement inversées par tout ce qu’il a versé dans ce tonneau des Danaïdes. Si on n’est pas encore convaincu du rôle néfaste de Jeanne pour Baudelaire, on considérera aussi cette lettre que la mère du poète, sept mois après la mort de celui-ci, a envoyé à l’ami fidèle qui s’occupait d’une édition posthume des œuvres complètes. Certes, le jugement d’une mère est le plus partial qui soit, et on ne le prendra donc pas pour argent comptant. Mais Mme Aupick dit s’appuyer sur des documents, et celà donne à songer : « La Vénus noire l’a torturé de toutes manières. Oh ! si vous saviez ! Et que d’argent elle lui a dévoré ! Dans ses lettres, j’en ai une masse, je ne vois jamais un mot d’amour. Si elle l’avait aimé, je lui pardonnerais, je l’aimerais peut-être ; mais ce sont des demandes incessantes d’argent. C’est toujours de l’argent qu’il lui faut, et immédiatement. Sa dernière en avril 1866, lorsque je partais pour aller soigner mon pauvre fils à Bruxelles, lorsqu’il était dans de si grands embarras d’argent, elle lui écrit pour une somme qu’il faut qu’il lui envoie de suite. Comme il a dû souffrir à cette demande qu’il ne pouvait satisfaire ! Tous ces tiraillements ont pu aggraver son mal et pouvaient même en être la cause » (lettre de Mme Aupick à Charles Asselineau, 24 mars 1868, publiée dans Charles Baudelaire, étude biographique, par Eugène Crépet, revue et mise à jour par Jacques Crépet, Léon Vanier éd. / A. Messein succ., 1906, Appendice VI, p. 267).
[34] Voici le morceau entier : « La femme est le contraire du Dandy. / Donc elle doit faire horreur. / La femme a faim, et elle veut manger. Soif, et elle veut boire. / Elle est en rut, et elle veut être foutue. / Le beau mérite ! / La femme est naturelle, c'est-à-dire abominable. / Aussi est-elle toujours vulgaire, c'est-à-dire le contraire du Dandy ». (Mon cœur mis à nu, III, 5 ; Pléiade tome I p. 677).
[35] Les Fleurs du mal, CXXVI : « Le voyage », VI, vers 89 (Pléiade tome I p. 132). Et aussi : « J’ai toujours été étonné qu’on laissât les femmes entrer dans les églises. Quelle conversation peuvent-elles tenir avec Dieu ? » (Mon cœur mis à nu, XXVII, 48 ; tome I p. 693). Relire aussi « Les yeux des pauvres » (Le Spleen de Paris, XXVI) et « Portraits de maîtresse » (ib., XLII).
[36] Mon cœur mis à nu, XXXVIII, 68 (Pléiade tome I p. 701). Relire aussi « La femme sauvage et la petite-maîtresse » (Le Spleen de Paris, XI) et « Le galant tireur » (ib., XLIII). Au surplus, Maxime Du Camp rapporte cet échange : à un Duc qui avait dit : « De tous les êtres créés la femme est l’être le plus charmant », Baudelaire riposta : « Monsieur le Duc, je ne partage pas votre opinion ; les femmes sont des animaux qu’il faut enfermer, battre et bien nourrir » (Souvenirs littéraires, ch. XVIII, éd. Aubier, 1994, p. 392).
[37] Mon cœur mis à nu, XXXIII, 60 (Pléiade tome I p. 698). Au chapitre de la misogynie, impossible de passer outre ce bilan, remarquable par son ton péremptoire : « Pour résumer toutes mes pensées en une seule, et pour te donner une idée de toutes mes réflexions, je pense à tout jamais, que la femme qui a souffert et fait un enfant est la seule qui soit l’égale de l’homme. Engendrer est la seule chose qui donne à la femelle l’intelligence morale. Quant aux jeunes femmes sans état et sans enfants, ce n’est que coquetterie, implacabilité et crapule élégante » (lettre à sa mère, 27 mars 1852, Correspondance Pléiade tome I p. 193-194).
[38] Lire Les Paradis artificiels. Pour le tabac, rajouter le poème « La pipe » (LXVIII), et pour le vin, les cinq poèmes de la section « Le vin » (CIV-CVIII). Relire aussi « Enivrez-vous » (Le Spleen de Paris, XXXIII). De nombreux témoignages font état d’une forte consommation de vin chez le poète, par exemple celui de Maxime Du Camp, selon lequel Baudelaire, invité chez lui en 1852, déclara qu’il ne buvait que du vin et ne supportait pas la vue de l’eau, avant de vider deux bouteilles de rouge en une heure (Souvenirs littéraires, ch. XVIII, éd. Aubier, 1994, p. 394). Baudelaire lui-même signale à sa mère, le 26 mars 1853, que « cette abominable existence et l’eau-de-vie […lui] ont gâté l’estomac pour quelques mois » (correspondance tome I p. 214). On pourrait facilement multiplier les documents corroborant l’idée d’une dégradation précoce de sa santé par les abus d’excitants divers, en particulier l’alcol. On peut même se demander si, dans ses dernières années, c’est-à-dire passé 40 ans (1861), Baudelaire n’était pas devenu impuissant. Une anecdote rapportée par Léon Cladel (publiée par Félicien Champsaur dans sa notice sur celui-ci dans Les Hommes d’aujourd’hui, n°2, vers 1878), et qui peut dater de 1861 ou peu après, dit qu’une femme très belle avait fait une cour assidue à Baudelaire, jusqu’à obtenir de se faire inviter chez lui avec Cladel. « La femme devient lascive » et se déshabille. Cladel s’éclipse, mais « il n’avait pas fermé la porte qu’il entend Baudelaire, vieux et usé, dire : Rhabille-toi » (Baudelaire devant ses contemporains, III, 2, p. 132). Et ce fragment de Mon cœur mis à nu (XXXIX, 70), autour de 1863, ne doit-il pas se lire comme un aveu implicite ? : « Plus l’homme cultive les arts, moins il bande. […] La brute seule bande bien, et la fouterie est le lyrisme du peuple » (Pléiade tome I p. 702). Jules Vallès émet aussi l’hypothèse d’une « incapacité physique » avec les femmes, mais de façon gratuite et pour y voir la cause de la « corruption littéraire » de Baudelaire, ce qui est stupide (Pléiade Vallès, tome I p. 975).
[39] En introduction à la Correspondance de Baudelaire, Jean Ziegler propose un historique de sa fortune (p. LXIII-XC) ; et dans la biographie qu’il a cosignée avec Claude Pichois, une bonne partie du chapitre VIII, le chapitre X et le chapitre XXII sont entièrement consacrés à l’examen de sa situation financière. Il est difficile, en lisant celà, de ne pas ressentir une indignation très bourgeoise contre ce panier-percé qui s’est créé une vie de chien par sa seule faute. Entre 1839 et 41, alors qu’il est bachelier mais encore mineur, il commence déjà à accumuler de lourdes dettes. À sa majorité en avril 1842, il entre en possession de l’héritage de son père, soit environ 100 000 francs, ce qui correspond très approximativement à 300 000 euros. En l’espace de dix-huit mois, il en croque la moitié en prodigalités diverses : logement et meubles luxueux, vêtements, maîtresses, grande vie. Alarmée, sa famille va mettre le holà. À l’été 1844, un conseil de famille le dessaisit de la jouissance de son patrimoine : il sera désormais sous la tutelle judiciaire de Me Narcisse Ancelle, notaire de Neuilly (et maire de la ville entre 1851 et 1868), brave homme plutôt compréhensif avec qui les rapports seront jusqu’au bout amicaux voire affectueux. Néanmoins Baudelaire considérera cette tutelle comme une infamie insupportable (et pourtant il n’a rien fait ni pour s’y opposer ni ensuite pour s’en libérer, alors que des recours judiciaires étaient possibles). Mais même placé sous tutelle, Baudelaire n’était pas, ou n’aurait pas dû être, un miséreux. Avec un minimum d’austérité, il aurait pu mener une honnête existence de rentier déchargé de soucis matériels et libre de tout son temps. En effet, Ancelle lui versait une pension de 2400 francs par an, tirée des rentes de son capital (diminuée à 2100 F en 1856 et 1900 F en 1861, suite à des prélèvements dans le capital pour rembourser des dettes). Or c’était tout-à-fait suffisant pour vivre, surtout pour un célibataire : un sous-chef de bureau dans un ministère gagnait à l’époque entre 2000 et 2700 francs par an, et un chef de bureau, en fin de carrière, le double. En janvier 1841, son frère, petit magistrat marié de 36 ans, lui écrivait ne gagner que 1500 francs ! (voir Correspondance tome I p. 732) Mais cette rente n’était pas l’unique source de revenus du poète. Les tableaux récapitulatifs fournis par Jean Ziegler permettent de calculer qu’entre 1845 et 1863 inclus (jusqu’à son départ en Belgique), Baudelaire aura touché : 1°) 41 400 F de la pension Ancelle ; 2°) 15 600 F de prélèvements sur son capital ; 3°) 3450 F de subventions ministérielles (biographie 1987 p. 487) ; 4°) 20 000 F d’aides de sa mère (p. 488) ; 5°) environ 10 000 F de droits d’auteur : 4800 pour ses traductions de Poe, 900 pour ses livres, 5100 pour ses articles et parutions dans des journaux (p. 497). Soit un total de 90 500 F en dix-neuf ans : un peu moins de 4800 F par an en moyenne, le salaire d’un chef de bureau au ministère ! Rappelons qu’en 1851, le député Jean-Baptiste Baudin s’est fait tuer sur une barricade « pour 25 francs par jour », soit 9125 F par an : seulement le double. À qui fera-t-on croire qu’on ne pouvait pas vivre décemment avec la moitié du revenu d’un député, à une époque où un ouvrier, pour douze heures de travail par jour 300 jours par an, gagnait environ 500 F, dix fois moins ? On est vraiment accablé à l’idée que Baudelaire aura toute sa vie mangé de la vache enragée, alors même qu’il percevait de quoi vivre confortablement. Il aurait suffi qu’il eût moins des goûts de luxe, qu’il réduisît son fastueux budget vestimentaire, qu’il ne dépensât pas ce qu’il n’avait pas encore… Mais allez donc demander à un poète de bien gérer ses comptes ! Ses ailes de géant l’empêchent de marcher… On comprend néanmoins que Pichois et Ziegler, finalement, donnent raison à Sartre, lequel prétendait, dans un petit essai pourtant très injuste et en quelque sorte anti-poétique (1947), que Baudelaire avait choisi sa vie de poète maudit : « On ne doit pas prétendre : ‘Il n’a pas eu la vie qu’il méritait’. Baudelaire a mérité, il a voulu mériter sa vie » (p. 143). À maintes reprises en effet, on le voit accepter le sort qui lui est fait, voire créer délibérément les circonstances qui lui empoisonnent l’existence. Et celà jusqu’au séjour en Belgique, dont Gautier disait plaisamment et justement : « Il reste à Bruxelles où il s’ennuie, pour le plaisir de dire qu’il s’y est ennuyé ! » (biographie 1987 p. 515).
[40] Ainsi l’a vu vers 1861 Philibert Audebrand, chroniqueur que W.T. Bandy et Cl. Pichois considèrent comme fiable : « Vieilli, fané, alourdi, bien qu’il fût toujours maigre, l’excentrique, avec des cheveux blancs et une figure toujours rasée, ressemblait moins à un poète des voluptés amères qu’à un prêtre de Saint-Sulpice » (Un café de journalistes sous Napoléon III, Dentu, 1888, p. 295).
[41] Goncourt, Journal, 11 avril 1863 (éd. Bouquins, tome 1 p. 955). L’hôte chez qui Baudelaire a lancé cette insanité pourrait être, d’après Jules Vallès, le sculpteur Auguste Clésinger, le gendre de George Sand.
[42] Sur la légende de Baudelaire en général, voir le dossier documentaire rassemblé par W.T. Bandy et Cl. Pichois dans le chapitre V de Baudelaire devant ses contemporains, p. 207-279. Il faut surtout lire l’article de Jules Vallès paru dans La Situation le 5 septembre 1867, soit cinq jours après la mort de Baudelaire, que Vallès avait maintes fois croisé depuis 1852 dans les cafés fréquentés par la bohème littéraire parisienne. Ce texte (Pléiade Vallès, tome I p. 971-976) est au plus haut point révélateur : il montre quelle totale fermeture d’esprit peut manifester un auteur engagé à gauche, et comme le militant est incapable de comprendre le dandy. Dans cet article imbécile, voire « ignoble » selon les amis de Baudelaire dont Asselineau, le très surfait romancier de Jacques Vingtras se comporte comme un simple échotier qui ramasse tous les ragots qui passent à sa portée, doublé d’un petit juge qui s’arroge le droit d’expédier en enfer ceux qui ne partagent pas ses principes. Vallès ne s’intéresse qu’à l’homme Baudelaire (ou plutôt qu’à l’image publique de l’homme) et ne consacre pas une phrase à son œuvre, dont on se demande s’il la connaît autrement que de réputation, ce qui est tout de même fâcheux quand on parle d’un écrivain. Il le voit avant tout comme un cabotin avec un côté prêtre, un « forçat lugubre de l’excentricité » qui se sera donné bien du mal pour pas grand-chose : « il se condamna à un rôle pour lequel il n’était pas fait, et qui l’écrasa ! ». Pur tartuffe littéraire, poseur pour cénacles et histrion pour brasseries, ne croyant peut-être même pas en son génie, Baudelaire était un type assez méprisable : « rien qu’un égoïste qui travaillait péniblement sa gloire et qui ne souffrait pas, mais jouissait des douleurs des autres, parce qu’elles pouvaient l’inspirer et aider sa muse menacée de stérilité ». Obnubilé par son vain désir d’attirer l’attention sur lui, ce raté s’est trompé de vocation : « il eût dû n’être jamais qu’un traducteur, lui qui ne savait ni inventer ni voir, et qui, à court d’idées, à bout de ressources, pour conquérir au moins la réputation d’originalité, fourbut son imagination et affola sa sensibilité ». Alors oui, Vallès répète plusieurs fois qu’il le plaint, « ce fanfaron d’immoralité » qui se sera autodétruit par orgueil. Plaintes de crocodile, aimerait-on dire, tant on sent la jubilation méchante qu’il met à dépeindre la déchéance finale du poète paralysé au « sourire de fou », jurant avec « le grognement idiot du désespoir ». Tartuffe lui-même, Vallès souligne qu’il « ne veut point insulter ses cendres », mais le verdict tombe : « il n’était pas le poète d’un enfer terrible, mais le damné d’un enfer burlesque ». Quant à son destin posthume, il est plié : « Il eut une minute de gloire, un siècle d'agonie : aura-t-il dix ans d’immortalité ? À peine ! ». Le plus que ses admirateurs peuvent espérer, c'est qu'un jour, « un curieux ou un raffiné logera ce fou dans un volume tiré à cent exemplaires, en compagnie de quelques excentriques crottés. Ne demandons pas plus pour lui : il ne mérite pas davantage ». Merci, Monsieur Vallès, pour ce remarquable exercice de crétinisme littéraire, et ce moment d’intense rigolade. Six pages pour étaler votre bassesse et votre cécité, ça valait le coup.
[43] Il est frappant de constater à quel point les contemporains qui ont croisé Baudelaire ont tous vu en lui un farceur qui surjouait l’originalité. Même quand ils lui reconnaissaient un talent remarquable, ils se déclaraient consternés par son histrionisme d’adolescent voulant à tout prix attirer les regards sur lui. Un exemple parmi bien d’autres : « Il connaissait parfaitement la langue et la prosodie françaises, et ses vers sont admirables, si on n’y cherche que l’imprévu et l’éclat dans la forme. Mais là encore, il fait les plus grands efforts pour arriver à n’être point banal, sans s’apercevoir qu’il ne parvient qu’à la boursouflure. Il s’était enfermé dans un système et il avait eu assez de caractère pour n’en point sortir. Aussi, bien qu’il ait vécu et travaillé sans sincérité aucune, son œuvre et sa vie ne manquent point d’individualité. Le Baudelaire naturel avait disparu pour faire place à un personnage artificiel qui jouait bien son rôle et ne se démentait sans doute que quand il était seul en face de son Créateur » (Émile Leclercq, article paru dans Le Libre examen, 10 septembre 1867, et repris dans Gustave Charlier, Passages, Bruxelles, La Renaissance du livre, 1947, p. 163). On pourrait trouver trente textes analogues à celui-ci. Même chez ses amis, et même quand ils avaient un vrai sens littéraire : Maxime Du Camp, Sainte-Beuve, Gautier, on trouve des propos concordants. Une telle unanimité inquiète et fait naître des réflexions troublantes sur l’écart entre l’image anthume d’un écrivain et son image posthume. Baudelaire a été vu de son vivant non pas comme un grand écrivain promis au panthéon de la littérature, mais comme un m’as-tu-vu excentrique. Osons le dire : comme une sorte de Jean-Edern Hallier. Mais alors, se pourrait-il à l’inverse que Jean-Edern Hallier ait été non pas un bouffon de l’âge télévisuel, mais une sorte de Baudelaire de notre temps ? Ce n’est pas sûr, mais apriori rien ne l’exclut, et surtout pas son art de défrayer la chronique par des provocations de plus en plus dérisoires et pathétiques. Malraux et Montherlant aussi ont été vus comme des mythomanes et des esbroufeurs, et après tout ce n’était pas entièrement faux, mais qu’importe : leur œuvre est là. Finalement il est possible qu’il y ait quelque chose de foncièrement factice dans l’œuvre de Baudelaire, qui pourrait procéder non pas d’une inspiration "naturelle", mais d’un dessein concerté, sa personnalité elle-même ayant été en quelque sorte auto-forgée en réaction à son milieu. C’est le moment de se souvenir d’une idée souvent citée de Sainte-Beuve : « Tout était pris dans le domaine de la poésie. Lamartine avait pris les cieux, Victor Hugo avait pris la terre et plus que la terre. Laprade avait pris les forêts. Musset avait pris la passion et l’orgie éblouissante. D’autres avaient pris le foyer, la vie rurale, etc. Théophile Gautier avait pris l’Espagne et ses hautes couleurs. Que restait-il ? Ce que Baudelaire a pris. Il y a été comme forcé » (texte intitulé « Petits moyens de défense tels que je les conçois » que Sainte-Beuve remit à Baudelaire au moment du procès des Fleurs du mal ; publié dans Charles Baudelaire, étude biographique d’Eugène Crépet, Vanier-Messein, 1906, Appendice III, p. 229-230). Autrement dit, Baudelaire aurait procédé à une sorte d’étude de marché avant de choisir sa thématique, non sans corriger légèrement sa stratégie d’écriture ensuite, au fil des années. (Il va sans dire qu’il s’agit là d’une mercatique transcendantale, et non pas d’un vulgaire plan commercial à la Marc Levy : l’objectif n’était pas la vente d’un maximum d’exemplaires mais la gloire la plus stellaire). Car il n’y a pas de littérature sans posture : publier un livre, c’est ipso facto choisir une position dans la République des lettres, et chaque nouveau livre est soit une façon de s'y incruster soit une tentative de se déplacer un peu. En songeant au parallèle de Flaubert et de Baudelaire (nés la même année), je relève que la personnalité du premier s’est fixée beaucoup plus précocement : dans ses lettres de 1844-1846, il est déjà totalement lui-même, alors que Baudelaire donne encore dans un "naturisme" qu’il va bientôt renier totalement, sans parler de son socialisme jusqu’en 1848. Les idées de Baudelaire ont évolué en vingt ans et il n’est pas difficile de trouver chez lui des textes contradictoires. Du reste, le meilleur reproche qu’on pourrait faire à cette étude, c’est d’accorder une importance disproportionnée au dernier Baudelaire, celui des années 1860, alors que le grand poète est plutôt celui des années 1850, sa veine créatrice étant presque tarie après 1861. Mais cette instabilité est cohérente avec l’idée que Baudelaire, « histrion véridique de lui-même » (comme Mallarmé le dira de son ami Villiers de l’Isle-Adam) se serait pour ainsi dire construit lui-même au fil de son existence, forçant son tempérament plutôt que laissant celui-ci se développer spontanément. On touche là à des distinctions d’autant plus invisibles qu’elles n’ont aucune importance. Encore une fois, ce qui compte, c’est l’œuvre : si « Réversibilité » ou « Le goût du néant » ou « Danse macabre » ou « Madrigal triste » n’étaient pas dûs à un authentique dépressif pervers, mais à un simple poseur qui chercherait à épater le bourgeois, en quoi celà rendrait-il ces poèmes moins beaux et moins saisissants ? Les mauvais écrivains sont pour la plupart d’une sincérité totale, eux, et c’est justement pourquoi ils ne parviennent pas à s’arracher au témoignage pour s’élever au roman. L’auteur de « L’amour du mensonge » (Fleurs, XCVIII) ou des « Fenêtres » (Spleen, XXXV) avait au contraire compris que l’art est affaire d’illusion et non de vérité. J’emprunterai la conclusion à Gabriel Matzneff : en littérature, « l’insincérité est le grief imbécile par excellence » (Maîtres et complices, Lattès, 1994, p. 162), lequel l'a peut-être trouvée dans les Carnets de Montherlant (Carnet XXXIV, Pléiade Essais p. 1251-1252) : « quand le talent est indéniable, de quoi accuser ? Accuser d'insincérité, qui est jouer sur du velours, puisque la sincérité ne se prouve pas ».
[44] Il le reconnaissait lui-même : « Du reste, je dois avouer que depuis deux ou trois mois, j’ai lâché la bride à mon caractère, que j’ai pris une jouissance particulière à blesser, à me montrer impertinent, talent où j’excelle, quand je veux. Mais ici [en Belgique], celà ne suffit pas, il faut être grossier, pour être compris. – Tas de canailles ! – et moi qui croyais que la France était un pays absolument barbare, me voici contraint de reconnaître qu’il y a un pays plus barbare que la France ! » (lettre à Narcisse Ancelle, 13 octobre 1864, Correspondance Pléiade tome II p. 409). Évoquant dans la Morale du joujou les personnes ultra-raisonnables et anti-poétiques, il confesse aussi que chaque fois qu'il pense à elles, il « sen[t] toujours la haine pincer et agiter [s]es nerfs » (Pléiade tome I p. 586).
[45] « Être un homme utile m’a paru toujours quelque chose de bien hideux » : Mon cœur mis à nu, VI, 9 ; Pléiade tome I p. 679. Ou : « Être un grand homme et un saint pour soi-même, voilà l’unique chose importante » (ibid., XXVIII, 51 ; tome I p. 695).
[46] Lettre à Édouard Manet, 28 octobre 1865, Correspondance tome II p. 539. Baudelaire commente l’envoi personnalisé des Chansons des rues et des bois. Il a parfaitement compris que « jungamus dextras », la dédicace de Hugo sur la première page, « ne veut pas dire seulement : donnons-nous une mutuelle poignée de main », mais aussi « unissons nos mains, POUR SAUVER LE GENRE HUMAIN ».
[47] Lettre à sa mère, 27 mars 1852, Correspondance Pléiade tome I p. 193. Dans une autre lettre à la même, le 26 mars 1853, il rappelle au passage qu’il a « assommé » Jeanne (p. 214).
[48] Témoignage fameux d’un de ses amis de jeunesse, Jules Buisson : « En 1848, le 24 février au soir, je le rencontrai au carrefour de Buci, au milieu d’une foule qui venait de piller une boutique d’armurier. Il portait un beau fusil à deux coups, luisant et vierge, et une superbe cartouchière de cuir jaune tout aussi immaculée ; je le hélai ; il vint à moi, simulant une grande animation. "Je viens de faire le coup de fusil ! ", me dit-il. Et comme je souriais, regardant son artillerie tout brillant neuve : "Pas pour la république, par exemple !" — Il ne me répondait pas, criait beaucoup ; et toujours son refrain : il fallait aller fusiller le général Aupick. » (lettre de 1886 à Eugène Crépet, publiée par exemple dans Baudelaire devant ses contemporains p. 96-97 ou dans la biographie de Pichois et Ziegler, éd. 1987, p. 257). Maxime Du Camp prétend qu’un jour Baudelaire, vers 1841, a tenté d’étrangler son beau-père parce que celui-ci venait de le rabrouer en société (Souvenirs littéraires, ch. XVIII ; éd. Aubier 1994, p. 391). Le fait est très peu vraisemblable, mais que Baudelaire ait pu inventer celà pour le raconter à Du Camp est à soi seul significatif.
[49] Lettre à sa mère, 5 mars 1866, Correspondance tome II p. 625.
[50] Au cas où le lecteur de Baudelaire ne s’en serait pas rendu compte, considérer cet aveu : « Foutre, c'est aspirer à entrer dans un autre, et l'artiste ne sort jamais de lui-même » : Mon cœur mis à nu, XXXIX, 70 (Pléiade tome I p. 702).
[51] « Savez-vous pourquoi j’ai si patiemment traduit Poe ? Parce qu’il me ressemblait. La première fois que j’ai ouvert un livre de lui, j’ai vu, avec épouvante et ravissement, non seulement des sujets rêvés par moi, mais des PHRASES, pensées par moi, et écrites par lui, vingt ans auparavant » (lettre à Théophile Thoré, 20 juin 1864, correspondance Pléiade tome II p. 386). Même idée dans une lettre à Armand Fraisse, 18 février 1860 : « et alors je trouvai, croyez-moi, si vous voulez, des poèmes et des nouvelles dont j’avais eu la pensée » (correspondance tome I p. 676). La veille, Baudelaire écrivait à Richard Wagner : « d’abord il m’a semblé que je connaissais cette musique, et plus tard en y réfléchissant, j’ai compris d’où venait ce mirage ; il me semblait que cette musique était la mienne » (p. 673).
[52] Lire Pauvre Belgique !, c’est-à-dire la liasse de notes qu’il a accumulées en vue d’un pamphlet qu’il n’aura pu écrire (tome II p. 819-978), ainsi que la correspondance des années 1864-66. La comparaison du Belge au singe et au mollusque se trouve p. 844 et 845. Dans la lettre à N. Ancelle du 18 février 1866, il donne la clef de ce projet : « un livre passablement sérieux » dont le but sera « la raillerie de tout ce qu’on appelle progrès, ce que j’appelle, moi : le paganisme des imbéciles, – et la démonstration du gouvernement de Dieu » (Correspondance tome II p. 611). Autant les notes prises pour Mon cœur mis à nu eussent pu donner lieu à un livre génial, autant on hésite à croire que Baudelaire eût réussi à élever cet amas de remarques mesquines et haineuses au rang d’une grande œuvre indispensable à la compréhension de la modernité.
[53] Voir Pauvre Belgique !, XXI, tome II p. 919-922.
[54] Dans une lettre à Narcisse Ancelle, il déclare qu’il aimerait adopter une religion orientale pour parachever sa solitude, mais qu’il « méprise trop le Coran » pour que ce soit l’islam (13 novembre 1864, Correspondance tome II p. 421). Et douze ans plus tôt, à Maxime Du Camp : « toutes les fois que je lis des ouvrages des musulmans, je pense au grand mot de de Maistre : à le bien prendre, l’Islamisme n’est qu’une église réformée – ou : une des phases du protestantisme, – ou quelque chose comme celà » (lettre du 9 mai 1852, Correspondance tome I p. 198-199). Connaissant la pensée de Joseph de Maistre, et l’admiration que Baudelaire lui vouait, on doit comprendre que l’assimilation au protestantisme équivaut à une insulte suprême. Du reste, critiquant dans la Morale du joujou (texte paru en 1853) les personnes graves, ultra-raisonnables et anti-poétiques qui n'offrent pas de jouets à leurs enfants, espèce honnie qui l'a fait tant souffrir et qu'il hait, Baudelaire glisse : « Je ne sais pourquoi je me figure qu'elles puent le protestantisme » (tome I p. 586).
[55] Mon cœur mis à nu, XLV, 82 (Pléiade tome I p. 706). Claude Pichois admet que « ce passage n’est pas facile à interpréter » (p. 1511) : ce serait une boutade ironique, à mettre en relation avec l’idée que Dieu est « un scandale qui rapporte » (dernière phrase de Fusées XI, 17 ; p. 660), ce qui lui permet de nous rassurer : « tout antisémitisme est à écarter ». C’est peut-être vite dit. Dailleurs Pichois lui-même, dans sa biographie, remarquant que Baudelaire avait dessiné à Bruxelles une caricature d’un journaliste juif au fort accent germanique, Alexandre Weill, doit constater qu’il « recelait au fond de lui-même, et comme beaucoup de ses compatriotes, une bonne dose de xénophobie et d’antisémitisme » (éd. 1987 p. 527) : là, c’est exagérer dans l’autre sens, car cette caricature est unique, et pas spécialement antisémite : suffirait-il de se moquer une fois du chuintement de Jean-Luc Godard pour être taxé de haine générale des Suisses ?! Entre le Pichois de 1975 et le Pichois de 1987 ont dû se glisser des considérations socio-politiques sans rapport avec l’objet de son travail. Ce qu’on peut dire au minimum, c’est que Baudelaire n’avait rien de droidlomiste et que, s’il avait vécu encore une trentaine d’années avec le caractère et les idées qu’on lui connaît, il aurait sans doute fini très à droite, très anti-républicain et très anti-dreyfusard, à l’instar d’un Edmond de Goncourt (1822-1896). Ajoutons que Baudelaire a écrit début 1856 une lettre amicale et plutôt admirative à Alphonse Toussenel, qui est l’auteur d’un des principaux pamphlets antisémites du XIXe : Les Juifs, rois de l’époque (1847), auquel Drumont rendra hommage. Il est vrai que cette lettre ne parle pas du tout des Juifs, mais de religion et de zoologie mystique : ce disciple de Fourier venait de publier L’Esprit des bêtes. Le monde des oiseaux. Ornithologie passionnelle, ouvrage où Baudelaire reconnaît son idée de l’analogie universelle, tout en en rejetant le progressisme au nom du péché originel (Correspondance tome I p. 335-337).
[56] Sur le mystérieux séjour de Baudelaire à Dijon, lire cette petite étude :http://www.bussy-rabutin.com/442.html.
[57] Ce voyage maritime nous est connu par un témoignage de première main : la longue lettre que le capitaine Pierre Saliz, commandant du Paquebot-des-mers-du-sud, a écrite au beau-père de Baudelaire de Saint-Denis de La Réunion, le 14 octobre 1841, pour le prévenir du retour anticipé du jeune homme qu’on lui avait confié. « Dès notre départ de France, nous avons tous pu voir à bord qu’il était trop tard pour espérer faire revenir M. Beaudelaire soit de son goût exclusif pour la littérature telle qu’on l’entend aujourd’hui, soit de sa détermination de ne se livrer à aucune autre occupation. Ce goût exclusif lui rendait étrangères toutes conversations qui ne s’y rapportaient pas et l’éloignait de celles qui revenaient le plus souvent entre nous marins et les autres passagers militaires ou commerçants », écrit, désolé, le brave capitaine, qui paraît un homme intelligent et ouvert (du reste ses relations avec Baudelaire pendant quatre mois et demi sont restées constamment amicales). Pendant l’escale à l’île Maurice, même attitude anti-touristique, même absence totale de curiosité pour ce monde étranger : « Rien dans un pays, dans une société, tout nouveaux pour lui, n’a attiré son attention, ni éveillé la facilité d’observation qu’il possède ; il n’a eu des rapports qu’avec quelques hommes de lettres inconnus dans un pays où elles occupent une place bien petite, et ses idées se sont fixées sur le désir de retourner à Paris le plus tôt possible. Il voulait partir sur le premier navire pour France ». Cette lettre est reproduite en entier dans la biographie de Pichois et Ziegler (éd. 1987 p. 147-150). Elle est corroborée par la lettre de Mme Aupick à Asselineau, qui en 1868 a retracé la vie de son fils pour son premier biographe (voir Baudelaire devant ses contemporains, p. 55-57).
[58] Ajoutons que quand Baudelaire donne un mot d’ordre de départ, ce n’est jamais « En marche ! » comme Hugo (livre V des Contemplations), mais « Levons l’ancre ! ». À l’inverse de Rimbaud, l’homme aux semelles de vent, Baudelaire est une sorte de vagabond immobile, pour qui voyager signifie contempler passivement le monde à bord d’un navire qui avance tout seul. Le monde ? même pas : la mer, la mer toujours identique à elle-même, la mer, ce « gouffre amer » (syntagme qu’on trouve dans « L’albatros » v. 4, dans « L’homme et la mer » v. 4, dans « Le voyage » v. 44) qui n’est que le reflet du poète : « La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme / Dans le déroulement infini de sa la lame, / Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer. / Tu te plais à plonger au sein de ton image ; / Tu l’embrasses des yeux et des bras, et ton cœur / Se distrait quelquefois de sa propre rumeur / Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. » (« L’homme et la mer », XIV, v. 2-8 ; tome I p. 19). Nouvelle preuve que ce Narcisse ne sort jamais de lui-même !
[59] Il est vrai qu’il a, dans sa jeunesse, été quarante-huitard. Mais à l’âge mûr, il remet à sa juste place cette fièvre révolutionnaire momentanée : « Mon ivresse en 1848. / De quelle nature était cette ivresse ? / Goût de la vengeance. Plaisir naturel de la démolition. / Ivresse littéraire ; souvenir des lectures ». Quelques lignes après, il dit qu’il a accueilli avec fureur le coup d’État du 2 décembre 1851… « et cependant tout s’est pacifié. Le président n’a-t-il pas un droit à invoquer ? / Ce qu’est l’empereur Napoléon III. Ce qu’il vaut. Trouver l’explication de sa nature, et sa providentialité » (Mon cœur mis à nu, V, 8 ; Pléiade tome I p. 679). Cette acceptation du réel par une Providence à la de Maistre est aux antipodes du messianisme de Victor Hugo. À la page suivante, on lit aussi : « 1848 ne fut charmant que par l’excès même du Ridicule. / Robespierre n’est estimable que parce qu’il a fait quelques belles phrases ». Dans une lettre à Nadar du 16 mai 1859, Baudelaire analyse le déclenchement de la guerre d’Italie, admirant cyniquement l’habileté de Napoléon III : « Voilà l’Empereur lavé. Tu verras, mon cher, qu’on oubliera les horreurs commises en Décembre. En somme, il vole à la République l’honneur d’une grande guerre. […] La politique, mon cher ami, est une science sans cœur. C’est ce que tu ne veux pas reconnaître. Si tu étais Jésuite et Révolutionnaire, comme tout vrai politique doit l’être, ou l’est fatalement, tu n’aurais pas tant de regrets pour les amis jetés de côté. Je sais que je te fais horreur ; mais, dis-moi, […] » (Correspondance, tome I p. 579).
[60] La candidature (avortée) à l’Académie est un épisode bien connu de la vie de Baudelaire, documenté par plusieurs lettres et documents extérieurs. (Voir, dans la biographie de Pichois et Ziegler, le chapitre XXI, éd. 1987 p. 442-451). Elle est à l’origine d’une ébauche de pamphlet vengeur contre Villemain, le Secrétaire perpétuel. Pour la direction de l’Odéon, voir la lettre à sa mère du 3 juin 1863 (Correspondance Pléiade tome II p. 302). Pour la Légion d’honneur, voir la lettre à sa mère du 22 août 1858 (Correspondance Pléiade tome I p. 512, et les notes correspondantes).
[61] Voir par exemple, dans le tome II de la Correspondance en Pléiade, une lettre à Jules de Saulx (chef de cabinet du ministre d’État) du 30 décembre 1861 (p. 210-212) ou, début août 1863, trois lettres au Maréchal Vaillant (ministre des Beaux-Arts) et à Victor Duruy (ministre de l’Instruction publique) : p. 309-311.
[62] Hygiène, II, 88 (Pléiade, tome I p. 669). Baudelaire écrit aussi à Alphonse Toussenel : « Et un homme comme vous ! lâcher en passant, comme un simple rédacteur du Siècle, des injures à de Maistre, le grand génie de notre temps, – un voyant ! » (lettre du 21 janvier 1856, Correspondance tome I p. 337). Ailleurs, de Maistre est carrément « ce soldat animé de l’Esprit-Saint » (« De l’essence du rire », II ; tome II p. 526).
[63] Adrien Marx, Indiscrétions parisiennes, Achille Faure libraire-éditeur, 1866 ; ch. XXXI, p. 218 (paru d’abord dans L’Évènement, 14 juin 1866).
[64] Fusées II, 2 (tome I p. 650). Le même feuillet fait l’apologie de l’Église dans une optique très maistrienne : « Le prêtre est immense parce qu’il fait croire à une foule de choses étonnantes ».
[65] Voir en particulier Mon cœur mis à nu, XII, 21 (Pléiade tome I p. 683) ; XIII, 22 (p. 684) ; XIV, 23 (p. 684) ; XXVI, 47 (p. 693). Et aussi : « le vrai saint est celui qui fouette et tue le peuple pour le bien du peuple » (Fusées, VIII, 12 ; ibid., p. 655).
[66] « Le voyage », VI, vers 96 (Les Fleurs du mal, CXXVI ; Pléiade tome I p. 132).
[67] « J'ai erré à travers les méandres d'une Kermesse de rues, et dans les rues du Coin du Diable, du Rempart des Moines, de Notre-Dame du Sommeil, des Six Jetons et de plusieurs autres, j'ai surpris suspendus en l'air, avec une joie vive, de fréquents symptômes de choléra. L'ai-je assez invoqué, ce monstre adoré ? Ai-je étudié assez attentivement les signes précurseurs de sa venue ? Comme il se fait attendre, l'horrible bien-aimé, cet Attila impartial, ce fléau divin qui ne choisit pas ses victimes ? Ai-je assez supplié le Seigneur Mon Dieu de l'attirer au plus vite sur les bords puants de la Senne ? Et comme je jouirai enfin en contemplant la grimace de l'agonie de ce hideux peuple embrassé par les replis de son Styx-contrefaçon, de [son] ruisseau-Briarée qui charrie encore plus d'excréments que l'atmosphère au-dessus ne nourrit de mouches ! – Je jouirai, dis-je, des terreurs et des tortures de la race aux cheveux jaunes, nankin au teint lilas ! » (tome II p. 956). Baudelaire envisageait une telle page pour l’épilogue de son pamphlet contre la Belgique !
[68] Relire « La solitude » (Le Spleen de Paris, XXIII), ou « Les foules » (ibid., XII).
[69] Par exemple : « Si jamais je peux rattraper la verdeur et l’énergie dont j’ai joui quelquefois, je soulagerai ma colère par des livres épouvantables. Je voudrais mettre la race humaine tout entière contre moi. Je vois là une jouissance qui me consolerait de tout » (lettre à sa mère, 23 décembre 1865, Correspondance Pléiade tome II p. 553). Voir aussi une lettre à Narcisse Ancelle du 13 novembre 1864 : « Quand je serai absolument seul, je chercherai une religion […] et au moment de la mort, j’abjurerai cette dernière religion pour bien montrer mon dégoût de la sottise universelle » (ib., p. 421). Et j'ai déjà cité, note 23 : «J’ai un de ces heureux caractères qui tirent une jouissance de la haine et qui se glorifient dans le mépris. Mon goût diaboliquement passionné de la bêtise me fait trouver des plaisirs particuliers dans les travestissements de la calomnie ».
[70] Lire « Anniversaire de la naissance de Shakespeare » (Pléiade tome II p. 225-230), article d’une étonnante actualité où Baudelaire, sous l’anonymat, s’en prend à une entreprise de récupération gaucharde de Shakespeare : en 1864 les républicains, sous l’inspiration de Hugo, célébrèrent le tricentenaire de la naissance du barde anglais par un jubilé dont l’intention, essentiellement politique, n’était que de célébrer la démocratie. Pour Baudelaire, chose remarquable, le romantisme n’est pas à gauche, et le culte du peuple où a sombré Olympio est un dévoiement : « En 1848 il se fit une alliance adultère entre l’école littéraire de 1830 et la démocratie, une alliance monstrueuse et bizarre » (p. 228). Le romantisme, pour lui, ce n’est pas le socialisme, c’est plutôt la doctrine de l’art pour l’art, et c’est au premier plan « le monarchiste Balzac, l’homme du trône et de l’autel », qu’on « travestit » désormais en « homme de subversion et de démolition », ce qui n’est qu’une « supercherie ».
[71] À la sortie de la première partie des Misérables (avril 1862), Baudelaire a publié un article assez jésuitique où, tout en formulant quelques critiques et en gardant ses distances (notamment à la toute fin, où il rappelle que le progrès ne parviendra pas à effacer le péché originel), il parvient à trouver un biais lui permettant de donner une appréciation globalement favorable de ce premier cinquième de l’immense roman (tome II, p. 217-224). En vérité, il écrira peu après à sa mère que « ce livre est immonde et inepte » (lettre du 10 août 1862, Correspondance tome II p. 254). Flaubert a eu exactement la même réaction, qu’il a exprimée dans une lettre à Edma Roger des Genettes de juillet 1862 (Correspondance Pléiade tome III p. 236). Il est dommage que leur aversion de « la crapule catholico-socialiste » leur ait masqué le génie du livre. Mais le plus révélateur est ce propos oral rapporté par Asselineau, qui montre bien l’anti-moralisme de Baudelaire : « Ah ! disait-il en colère, qu’est-ce que c’est que ces criminels sentimentals, qui ont des remords pour des pièces de quarante sous, qui discutent avec leur conscience pendant des heures, et fondent des prix de vertu ? Est-ce que ces gens-là raisonnent comme les autres hommes ? J’en ferai, moi, un roman où je mettrai en scène un scélérat, mais un vrai scélérat, assassin voleur, incendiaire et corsaire, et qui finira par cette phrase : "Et sous ces ombrages que j’ai plantés, entouré d’une famille qui me vénère, d’enfants qui me chérissent et d’une femme qui m’adore, – je jouis en paix du fruit de tous mes crimes !" » (Eugène Crépet, Charles Baudelaire, étude biographique, Vanier-Messein, 1906, appendice VIII, p. 300).
[72] Voir en particulier « Les drames et les romans honnêtes » (p. 38-43), article tout entier consacré à la critique de la littérature moralisatrice, et l’étude sur « Théophile Gautier », § III (Pléiade tome II p. 111-116), où Baudelaire reprend de larges extraits de cet article, ainsi que des « Notes nouvelles sur Edgar Poe » (p. 328 et 333-334). Voir aussi l’ébauche de la « Lettre à Jules Janin » (p. 231-240).
[73] Cette idée apparaît plusieurs fois dans les Journaux intimes ou dans les articles critiques : j’en ai relevé plusieurs occurrences dans mon florilège d’aphorismes. Voir par exemple Fusées, XIV, 21 (Pléiade tome I p. 663) ; Mon cœur mis à nu, IX, 15 (p. 681), XXXII, 58 (p. 697) et XLIV, 80 (p. 705-706) ; ou encore l’étude sur « L’exposition universelle » de 1855 (tome II p. 580-582), section I, où l’argumentation est plus développée mais pas moins virulente : le progrès est une « idée grotesque, qui a fleuri sur le terrain pourri de la fatuité moderne » et qui est paradoxalement un symptôme de décadence, c’est « une absurdité gigantesque, une grotesquerie qui monte jusqu’à l’épouvantable » en raison de sa dimension suicidaire : elle pousse l’homme à se nier lui-même en oubliant de s’améliorer sur le plan moral, le seul qui compte. On ajoutera la lettre à Alphonse Toussenel du 21 janvier 1856, qui déclare que toutes les erreurs modernes « ne sont, après tout, que la conséquence de la grande hérésie moderne, de la doctrine artificielle, substituée à la doctrine naturelle, – je veux dire la suppression de l’idée du péché originel » (Correspondance, tome I, p. 337).
[74] Lire un saisissant morceau de deux pages et demi dans Fusées XV, 22 (tome I p. 665-667). On aurait beau jeu de souligner que les prophéties de Baudelaire ne se sont pas réalisées puisque le monde tient toujours. Il y a au contraire des intuitions exceptionnelles dans ce texte, et pas seulement par l’atrophie spirituelle et la férocité de l’oppression politique qu’il annonce. La perspective d’une humanité entièrement vouée à l’enrichissement matériel, jusque chez le petit enfant « émancipé par sa précocité gloutonne », l’avènement d’un monde où « tout ce qui ne sera pas l’ardeur vers Plutus sera réputé un immense ridicule » et où la justice « fera interdire les citoyens qui ne sauront pas faire fortune », voilà une lucidité impressionnante, surtout si on l’oppose aux délires messianiques de Hugo…
[75] Il y a maintes mentions sarcastiques du Siècle dans les œuvres et la correspondance (par exemple dans la lettre à Charles Asselineau du 13 mars 1856, Correspondance tome I p. 339-340, qui semble annoncer Léon Bloy par sa croyance en la réversibilité spirituelle de la bêtise moderne). Parmi les multiples projets embryonnaires de Baudelaire, les Lettres d’un atrabilaire paraissent, d’après le canevas qui en a été conservé (tome I p. 781-782), avoir été conçues essentiellement comme un pamphlet contre Le Siècle, ses rédacteurs, ses thèmes, ses idées. On y lit notamment : « ma passion pour la Sottise. Utilité des mauvaises lectures ». Ce goût pervers est confirmé dans une lettre à Narcisse Ancelle du 18 février 1866 : « En général l’erreur me cause des crises nerveuses, excepté quand je cultive volontairement la sottise, comme j’ai fait pendant vingt ans pour Le Siècle, pour en extraire la quintessence » (Correspondance tome II p. 611). Nombreux sont les points communs entre Baudelaire et Flaubert : on voit que le premier avait aussi la manie de collectionner la sottise, comme l’auteur de Bouvard et Pécuchet. Dailleurs, qui est le type idéal du lecteur du Siècle, sinon Monsieur Homais ?
[76] « Notes nouvelles sur Edgar Poe », I ; Pléiade tome II p. 321. La section II de cette étude (qui servit de préface aux Nouvelles histoires extraordinaires) est encore une attaque nourrie contre l’idéologie du Progrès, « cette grande hérésie de la décrépitude » à laquelle Baudelaire oppose le constat de la méchanceté naturelle de l’homme, saluant au passage « l’impeccable de Maistre » (tome II, p. 321-328). L’homme dit civilisé est encore plus dépravé et cruel que l’homme sauvage.
[77] Pléiade tome II p. 344.
[78] Lettre à Gervais Charpentier, 20 juin 1863, Correspondance tome II p. 307.
[79] Dans la cinquième de ses lettres conservées, à tout juste 11 ans, il écrit à son demi-frère, qui a 27 ans (et avec qui il cessera plus tard toute relation, méprisant ce bourgeois borné) : « Réellement la peur du choléra te fait oublier la grammaire française ; pourtant je ne veux pas te citer tes fautes, parce que voir le cadet apprendre l'orthographe à l'aîné serait le monde renversé » (lettre à Alphonse Baudelaire, 25 avril 1832, Correspondance tome I p. 7). Il ne s’agit pas là d’une petite insolence d’enfant qui a bien appris sa leçon, car Baudelaire gardera toute sa vie l’obsession d’écrire impeccablement. Six semaines avant sa mort cérébrale, il explique à son tuteur Narcisse Ancelle que « la France a horreur de la poésie » et souligne que « quiconque s’applique à mettre l’orthographe passe pour un homme sans cœur (ce qui est d’ailleurs assez logique puisque la passion s’exprime toujours mal) » (lettre du 18 février 1866, Correspondance tome II p. 610) : remarque aigüe, et combien plus actuelle encore aujourd’hui ! Un mois plus tard, le 20 mars, dans sa toute dernière lettre écrite de sa propre main, il reproche à sa mère d’avoir écrit « inquiète » avec deux « t », non sans ajouter aussitôt une excuse tendrement fallacieuse pour se faire pardonner sa maniaquerie (p. 628). N’y a-t-il pas quelque chose de hautement significatif à voir ainsi sa correspondance, de son tout début à sa toute fin, encadrée par cette lubie peu charitable pour ses correspondants, fussent-ils son frère et sa mère ? Dans la préface aux Nouvelles histoires extraordinaires de Poe, il note en 1857, pour faire comprendre la solitude du génie au milieu de « ce bouillonnement de médiocrités » qu’est la jeune Amérique : « Il y a là-bas comme ici, mais plus encore qu'ici, des littérateurs qui ne savent pas l'orthographe » (tome II p. 320), ce qu’il faut bien comprendre comme un stigmate d’incompétence irrémédiable. Un an avant, dans la préface aux Histoires extraordinaires, il établissait un rapprochement tout-à-fait saisissant entre « l'abolition de la peine de mort et de l'orthographe, ces deux folies corrélatives ! » (tome II, p. 300). Mais le symptôme le plus plaisant de cette religion de l’orthographe, c’est cette boutade consignée dans Mon cœur mis à nu : « Je mettrai l’orthographe même sous la main du bourreau » (XXXVI, 64 ; tome I p. 700). La phrase, qui n’est pas mise entre guillemets, est suivie du nom de Th. Gautier entre parenthèses. Mais comme cette déclaration n’est attestée nulle part dans les œuvres de ce dernier, et qu’on sait, par son gendre Émile Bergerat, qu’il professait une opinion contraire, on peut se demander si Baudelaire a voulu signifier par là qu’il avait entendu la phrase de la bouche de son ami. La parenthèse ne servait-elle pas plutôt à indiquer un propos sur Gautier, que Baudelaire avait conçu et qu’il comptait développer le jour où il reprendrait ce carnet de notes pour le transformer en œuvre ?
16:15 Écrit par Le déclinologue dans Droidlomisme, Littérature et arts, Tableau d'honneur | Lien permanent | Commentaires (27) | Tags : baudelaire, les fleurs du mal, le spleen de paris, pauvre belgique, claude pichois, jean ziegler, théophile gautier, maxime du camp, eugène crépet, flaubert, hugo, edgar poe, littérature, poésie, midinettes, joseph de maistre, narcisse ancelle, leconte de lisle, jeanne duval, poulet-malassis, charles asselineau, mon coeur mis à nu, correspondance pléiade, sainte-beuve, modernité, spleen, jules vallès, émile leclercq, andré gide, femmes, montherlant, alphonse toussenel, pierre saliz, jacques aupick, belges, sartre, jean-edern hallier, orthographe, lova moor |  |
|  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer | |
Imprimer | |  Digg |
Digg |  |
|


