05.04.2018
ANTONIO CALLADO : EXPÉDITION MONTAIGNE, ROMAN AMÉRINDIEN OU ANTI-AMÉRINDIEN ?
Antônio Callado (1917-1997) est un journaliste et écrivain brésilien qui n’a pas vraiment percé en France : à ce jour, il n’a même pas de notice sur le Wikipédia francophone. Dans son œuvre assez riche (une dizaine de pièces de théâtre, neuf romans, cinq reportages) n’ont été traduits que trois romans : Quarup (1967) : Mon pays en croix, Seuil, 1971 ; Sempreviva (1981) : Sempreviva, Presses de la Renaissance, 1985 et A expedição Montaigne (1982) : Expédition Montaigne, Presses de la Renaissance, 1989, aucun des trois n'ayant jamais été repris en format de poche. On aimerait pouvoir lire aussi en français Bar Don Juan (1971), qui a l’air de proposer un regard assez critique sur les intellectuels de gauche sud-américains engagés dans le combat contre les dictatures dans les années 1960. Peut-être les livres de Callado sont-ils trop politiques pour plaire ici et, quoiqu’il ait été fort engagé contre le régime militaire, pas assez alignés sur une certaine bien-pensance idéaliste de gauche ?
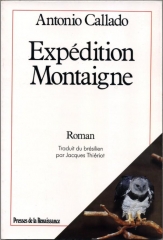 Expédition Montaigne est un mince roman qui raconte, dans le Brésil des années 1970, l’histoire d’un journaliste francophile, gauchiste et anti-occidentaliste, Vicentino Beirão : il rêve de faire naître une vaste insurrection des tribus indigènes, afin qu’elles « mettent les Blancs à genoux » et se réapproprient le territoire du Brésil, dont les Blancs les ont spoliées depuis l’arrivée de Cabral (p. 33). Il s’adjoint la compagnie d’Ipavou, un Indien flemmard, branleur, pochetron, grossier, phtisique, admirateur de la civilisation blanche où il a fait son nid d’oisiveté. Il le surnomme « le dernier des Camaïouras » et monte avec lui « l’expédition Montaigne », dont le but officiel est de le restituer à la communauté des Indiens du Chingou (et le but secret, déclencher la grande guérilla indigéniste). Mais Ipavou ne partage absolument pas ses vues : « Je vais te dire une chose, mec, moi je suis brésilien, vu ?, et je veux que tu te mettes dans le fion cette histoire de communauté d’Indiens chingouanos et tout ce baratin, merde, et avant que j’oublie, va te faire foutre, moi c’est pas mes oignons, t’as pigé ? Quand j’en suis sorti, je crachais tellement ça me débectait, je continue de cracher et cracherai tant que j’aurai du souffle et des poumons, moi mon truc c’est le bitume, mon pote, et je chie dix fois plus sur un Blanc qui veut devenir indien que sur un Indien pourri qui trouve qu’être indien c’est le pied. » (p. 31-32) [1]. Mais Beirão ne se démonte pas et reste les yeux fixés sur son rêve : « Lorsque nous arriverons […], nous aurons enrégimenté la cohorte formidable de ceux qui auront pour mission, avec des haies de flèches, d’investir les villes. Lorsque se produira ton apparition, cette formidable épiphanie, déjà se sera propagé par tout le pays le soulèvement des miséreux… » (p. 34). Tout en désapprouvant totalement les fins de l’expédition Montaigne, et en ne croyant pas une demi-seconde à sa réussite, Ipavou accepte d’y participer car il voit un intérêt purement personnel à retourner dans sa tribu : enlever dans sa cage Ouirouçou, le superbe aigle (ou gavião royal, ou coutoucourim) totémique, qui est l’image obsessionnelle de tous ses rêves.
Expédition Montaigne est un mince roman qui raconte, dans le Brésil des années 1970, l’histoire d’un journaliste francophile, gauchiste et anti-occidentaliste, Vicentino Beirão : il rêve de faire naître une vaste insurrection des tribus indigènes, afin qu’elles « mettent les Blancs à genoux » et se réapproprient le territoire du Brésil, dont les Blancs les ont spoliées depuis l’arrivée de Cabral (p. 33). Il s’adjoint la compagnie d’Ipavou, un Indien flemmard, branleur, pochetron, grossier, phtisique, admirateur de la civilisation blanche où il a fait son nid d’oisiveté. Il le surnomme « le dernier des Camaïouras » et monte avec lui « l’expédition Montaigne », dont le but officiel est de le restituer à la communauté des Indiens du Chingou (et le but secret, déclencher la grande guérilla indigéniste). Mais Ipavou ne partage absolument pas ses vues : « Je vais te dire une chose, mec, moi je suis brésilien, vu ?, et je veux que tu te mettes dans le fion cette histoire de communauté d’Indiens chingouanos et tout ce baratin, merde, et avant que j’oublie, va te faire foutre, moi c’est pas mes oignons, t’as pigé ? Quand j’en suis sorti, je crachais tellement ça me débectait, je continue de cracher et cracherai tant que j’aurai du souffle et des poumons, moi mon truc c’est le bitume, mon pote, et je chie dix fois plus sur un Blanc qui veut devenir indien que sur un Indien pourri qui trouve qu’être indien c’est le pied. » (p. 31-32) [1]. Mais Beirão ne se démonte pas et reste les yeux fixés sur son rêve : « Lorsque nous arriverons […], nous aurons enrégimenté la cohorte formidable de ceux qui auront pour mission, avec des haies de flèches, d’investir les villes. Lorsque se produira ton apparition, cette formidable épiphanie, déjà se sera propagé par tout le pays le soulèvement des miséreux… » (p. 34). Tout en désapprouvant totalement les fins de l’expédition Montaigne, et en ne croyant pas une demi-seconde à sa réussite, Ipavou accepte d’y participer car il voit un intérêt purement personnel à retourner dans sa tribu : enlever dans sa cage Ouirouçou, le superbe aigle (ou gavião royal, ou coutoucourim) totémique, qui est l’image obsessionnelle de tous ses rêves.
L’expédition Montaigne, attelage dépareillé de ces deux seuls personnages, renouvelant Don Quichotte et Sancho Pança, va traverser une partie du Brésil pendant quelques mois, jusqu’au bassin du haut-Chingou. Bien évidemment, ce n’est qu’une randonnée minable et dérisoire. Dans une première phase, l’expédition est plutôt bien accueillie : dans chaque village qu’elle traverse, elle a été précédée par la rumeur médiatique : les habitants affectent d’éprouver de la sympathie pour la cause indienne, et afin de se donner une bonne image à leurs propres yeux, ils versent un petit écot aux deux aventuriers-militants-mendiants, que les autorités accompagnent civilement jusqu’à la sortie du village pour éviter tout incident (p. 42-47) : leur caisse se remplit ainsi grâce à une sorte d’impôt révolutionnaire librement consenti par des populations sous l’emprise de l’idéologie gauchiste (qui pourtant aspire à les déposséder de leurs biens, voire les asservir !). Mais à mesure qu’ils s’enfoncent dans le pays profond, ils s’éloignent de la civilisation, personne n’a entendu parler d’eux, leur baratin fait moins d’effet, Beirão trouve moins de Blancs sensibles aux injustices subies par les Indiens (p. 72-73) mais plus de métis désargentés (p. 77-78), et Ipavou trouve moins de bistrots où rassasier son goût impénitent pour la bière (p. 61). Ils se perdent plus ou moins dans la forêt et Beirão est frappé d’une terrible crise de paludisme (p. 63), qui colore son rêve de guerre indienne d’une nuance délirante (p. 65-66). Un jour ils sont cernés par quatre Indiens dont on pourrait croire qu’ils vont les dévaliser et les tuer. Mais ceux-ci se contentent d’obliger Ipavou à porter à lui seul la totalité du chargement pour en soulager Beirão, et le gratifient aussi d’une bordée d’injures et de quelques bourrades (p. 85-91). Enfin ils arrivent chez les Camaïouras. Mais Ipavou ne ressent que de la nausée devant cette tribu arriérée : « C’est vraiment des merdes, quand je pense qu’ils boivent du cachiri dans des écuelles au lieu de s’envoyer de la cachaça et de la bière glacée, quand je vois ce lac grand comme une mer où ils ont pas été foutus de mettre un bon petit bistrot dans les environs, vraiment ça me débecte ! » (p. 107). De nuit, il assomme Beirão, ouvre la grande cage pour s’emparer d’Ouirouçou, n’étant venu que pour celà, traîne Beirão endormi dans la cage, la referme puis s’enfuit en courant jusqu’à la pirogue qui les a amenés là. Quelques heures plus tard, le sorcier de la tribu, Iéropé, découvre la cage et croit que le rapace s’est métamorphosé en humain. Lui et les habitants du village disposent des rondins et des fagots sous la cage, et y mettent le feu pour la transformer en bûcher (p. 114-118). Beirão meurt brûlé vif, de la main de ces Indiens qu’il voulait libérer, en pensant à Jeanne d’Arc… (p. 121-122). Un chapitre conclusif (p. 123-129) nous apprend qu’Ipavou est ensuite mort dans sa pirogue, couvert de sang, un pécari éventré à côté de lui. On suppose qu’ils ont tous les deux été tués par Ouirouçou perché à la proue, mais ce n’est pas très clair et rien dans le texte ne le confirme.
On voit que cette histoire est magnifique, du fait de son ironie dévastatrice et de sa fin aussi atroce qu’inattendue. Il ne s’agit absolument pas d’un apologue droidlomiste dans la lignée de La Case de l’oncle Tom, pour nous faire prendre en pitié ces angéliques Indiens opprimés par l’odieux racisme des Blancs. C’est même quasiment le contraire : on peut considérer que le journaliste indigéniste est un imbécile grotesque, muré dans son idéologie, aveugle à la réalité jusqu’à son dernier souffle, et que l’Indien est un abruti, perdu lui aussi dans son rêve, et néanmoins affreusement terre-à-terre, triste déchet d’une civilisation aliénante, ou représentant d’une humanité naturellement bornée. Ce récit aurait pu être écrit dans une prose classique et limpide, et peut-être qu’il aurait obtenu ainsi un grand succès comme, dix ans plus tard, Le Vieux qui lisait des romans d’amour de Luis Sepulveda. On aurait eu une parabole très corrosive, une satire cruelle de l’aveuglement idéologique des indigénistes, simple et efficace. Elle aurait pu aussi être tout-à-fait hilarante comme les récits de Roy Lewis, Pourquoi j’ai mangé mon père et La Véritable histoire du dernier roi socialiste. Elle aurait même pu s’élever assez haut en contenant l’ironie et en posant sur les personnages un regard ambivalent à la Kundera, notamment sur Beirão, dont l’auteur aurait montré le ridicule tout en expliquant avec tendresse son idéalisme. Ou pour rester dans la littérature brésilienne, on peut regretter que ça ne ressemble pas plus à L’Aliéniste de Joaquim Machado de Assis (1881), un apologue vraiment remarquable, d’une fort troublante ambiguïté. [2]
Mais ce n’est pas le but que s’est proposé Callado. Le résumé que j’ai proposé est en effet un peu biaisé, et correspond plus à la façon dont j’aurais traité l’histoire qu’à celle qu’a choisie l’auteur. En réalité, le personnage principal n’est pas Vicentino Beirão, mais Ipavou. C’est le point-de-vue de celui-ci qu’adopte le narrateur pour nous parler de l’expédition Montaigne, ce sont ses pensées qu’il nous livre, jamais celles de Beirão [3]. Celui-ci, pourtant bien plus intéressant à mon goût (comme Don Quichotte est un personnage bien plus riche que Sancho Pança), est toujours vu de l’extérieur et nous en savons très peu sur lui, rien de plus que ce qu’il en dit à Ipavou. Malgré les sommaires indications du chapitre 4, on ignore presque tout de la genèse de son projet, et ensuite, on ne voit pas dans quelle mesure la désillusion ricoche sur lui ou le pénètre insidieusement. Son rêve d’insurrection indigéniste contre les Blancs remplit beaucoup moins de lignes dans le roman que l’idolâtrie d’Ipavou envers Ouirouçou, le coutoucourim, qui en constitue un motif récurrent dès la première page. Il y a certes des moments burlesques et savoureux, rabelaisiens, comme lorsque, sur la place d’un village, un dimanche, des dames se laissent échauffer par un groupe d’Indiens nus et en érection (p. 43-47), petite combine très savamment mise au point par un Ipavou émule à son insu de Panurge ; ou comme lorsque Beirão ouvre enfin une boîte qui intriguait Ipavou : elle contient une statuette en bronze de Montaigne, que l’Indien prend pour un saint, mais dont il annonce qu’il la balancera aux piranhas si elle les gêne dans leur pirogue (p. 97-99). Cependant de tels épisodes, peu nombreux, sont moins jubilatoires qu’ils auraient pu l’être, car le point-de-vue d’Ipavou, avec son parler fruste et vulgaire, suscite un effet d’éloignement, de telle sorte qu’on ne peut se sentir pleinement complice du narrateur.
En outre, Callado a jugé que son récit devait être trop mince : il l’a étoffé avec un troisième personnage, Iéropé, le pajé (sorcier et guérisseur) des Camaïouras, qui n’a pas de rapport direct avec l’expédition Montaigne. Sept chapitres sur vingt-trois (les 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) lui sont entièrement consacrés, alternant avec le fil narratif principal. C’est seulement au chapitre 20 que les deux fils se rejoignent, quand Iéroupé découvre Beirão enfermé dans la cage et la transforme en bûcher. Iéropé est un pajé « minable et arriéré » (p. 36), déconsidéré dans sa tribu, et même totalement rejeté depuis qu’il a laissé mourir une Indienne, Maria Jaçanan, en lui refusant de la pénicilline (p. 55). Ruminant ses idées indiennes dans sa solitude, Iéropé bascule dans un délire mystique au chapitre 12, qui va bientôt le persuader qu’il s’est transformé en candirou, un minuscule poisson-chat (p. 83) : il est assailli de pensées torturantes des plus confuses, où le remords d’avoir fait mourir Maria Jaçanan se mêle à l’idée de son dédoublement homme/animal et à ses conceptions religieuses. De même que Beirão s’enfonce dans une forêt brésilienne rétive à ses fantasmes, le lecteur s’enfonce dans un esprit primitif et malade, à peine compréhensible.
Il y a ainsi, en quelque sorte, deux romans dans Expédition Montaigne : le récit satirique d’un projet, inepte et mort-né, d’insurrection indienne déclenchée par un Blanc gauchiste, et une tentative pour nous faire pénétrer dans l’esprit contrasté de deux Indiens qui distinguent mal le rêve de la réalité, Ipavou et Iéropé, l’un presque complètement occidentalisé, l’autre presque pas du tout. Ce second dessein a suscité le style employé tout au long, une écriture très orale, surchargée, grossière, truculente, obscène, filandreuse, cherchant à restituer le monologue intérieur d’esprits primitifs par de longues phrases remplies de tours et détours. Il en résulte une narration pesante, obscure, évoquant vaguement Au cœur des ténèbres de Conrad. Il faut ici saluer le travail du traducteur, Jacques Thiériot, dont on imagine qu’il a été confronté à un portugais très peu académique, très métissé. Mais ce dessein fort ambitieux laisse perplexe. On n’est pas convaincu par la place accordée aux élucubrations de Iéropé, même si c’est une façon indirecte de démasquer les illusions indigénistes et de souligner la vanité totale de l’entreprise de Beirão. Et on l’est encore moins par la conjonction des deux desseins romanesques : le second a complètement saboté le récit de l’expédition, qui aurait été tellement plus agréable et incisif s’il avait été traité sur un mode satirique classique, bien peigné, à l’Anatole France : ce style malicieux nous aurait mis de plain-pied dans l'univers mental de Beirão, ce qui aurait donné plus de portée à sa ridiculisation : en empathie avec lui, nous nous serions sentis atteints par sa disqualification. Alors que là, en nous forçant à adopter le point-de-vue d'Ipavou, le narrateur nous fait d'emblée regarder Beirão de loin : nous ne sommes pas vraiment concernés par lui, donc pas touchés par son échec. Et à l'inverse, quitte à vouloir nous faire pénétrer dans l’esprit des Indiens du Brésil, pourquoi avoir parasité cette entreprise d’ethnographie romanesque par la drôlatique « expédition Montaigne » de l’intellectuel francophile gauchiste, pourquoi ne pas s'être totalement focalisé sur l'univers mental des Camaïouras ? [4]
Et au fait, s’il s’agit de nous communiquer ce que pensent et ressentent les Indiens, est-ce que celà procède d’une démarche amicale ou d’une démarche critique ? On ne peut pas dire qu’Ipavou et Iéropé soient des personnages avec lesquels on ait envie de s’identifier, encore moins des personnages admirables ! Le roman serait-il donc à lire comme une critique des Indiens faite de l’intérieur, un véritable pamphlet contre les Camaïouras et leurs cousins ?? De même que Montaigne avait pris à revers ses contemporains en réhabilitant les cannibales, Callado aurait pris à revers les siens en faisant le procès de ces arriérés qu’ils admirent stupidement ?!? On ne veut pas y croire, et du coup on s’interroge sur la finalité de ce discours para-primitif : nous arracher à notre logos occidental, mais pour nous amener où ? Simple dépaysement gratuit, pur tour-de-force stylistique ??
On referme ainsi ce roman avec un certain malaise : une belle idée, de belles choses, des pages impressionnantes, un style original, une haute ambition, mais quelque chose de mal conçu, mal emboîté et profondément frustrant.
Voici deux échantillons de l’écriture de Callado, pour vous faire une idée de son style :
« Parfois la poitrine d’Ipavou le poignait par trop, comme ce jour-là, cette nuit-là où il avait dégusté le plat de sabre au poste de police militaire de Carmésia, et il n’avait plus devant lui l’horloge aux aiguilles qui se tringlaient ou s’emmanchaient à midi ou à minuit. Et pourtant c’est ainsi, les yeux ouverts, qu’il finit par rêver qu’il était niché entre les serres d’Ouirouçou, sans le moindre souci du monde, car chaque fois qu’il avait mal et gémissait doucement, à cause de la douleur dans sa poitrine ou des coups de sabre, il ne savait pas au juste, Ouirouçou le soulevait un petit peu dans ses serres qui étaient douces, douces comme si Ouirouçou les avait enduites de cires d’abeille pour balancer Ipavou en l’air, mieux qu’un hamac. / Mais ce n’était là que le début d’un beau rêve, Ouirouçou, le coutoucourim, le gavião royal, qui le balançait, le préparait, comme Ipavou le comprit plus tard, à un moment encore meilleur même s’il faisait peur, Ouirouçou qui l’emportait, les yeux ouverts mais endormi, vers les sauts rocheux, les eaux tumultueuses, et alors Ipavou sentit ce qu’il allait encore sentir d’autres fois, mort de sommeil et de fatigue mais trop énervé pour dormir : dans sa poitrine lancina une autre douleur, plutôt une tension forte à faire peur mais bonne, car sa poitrine tout entière, la boîte d’os, c’est-à-dire toutes ses côtes se changèrent en barreaux d’une cage où entra Ouirouçou, la force de l’aigle empanaché, de ses serres, du bec busqué et du pennage d’Ouirouçou. » (p. 19, fin du chapitre 2).
« Iéropé était décidé à en finir avec lui-même, à se tuer, même sachant que, sanctifié, transformé en pot, urne, calebasse de candirous de Maïvotsinim, il était sur le point de gagner la bataille, achever de tout déboîter, faire reculer Foutestaine jusque dans le ventre même de sa mère. Le vieux, ou plutôt le jeune Iéropé, en libérant toutes ces âmes et les incitant à se crêper le chignon, se griffer et se mordre à l’intérieur du crâne de Iéropé et de son hamac, à l’assourdir par mille susurrements, murmures, sifflets et huées, insultes hurlées soudain à son oreille, allait réussir à en finir personnellement avec lui-même avant d’en finir avec Foutestaine, et ce serait la plus grande défaite jamais subie par le peuple camaïoura ! / Iéropé avait beau rechercher l’intercession des fils jumeaux de Maïvotsinim – et souvent même il avait déjà vu le visage de Kwat, le plus jeune des deux –, n’empêche qu’inopinément, comme frappé d’une absence, il perdait la communication et se mettait à entendre le grincement de toutes les âmes qui lui avaient demandé, et à qui il n’avait pas donné, du viroforme, du parégo, de la pénicilline, et qui rameutées par l’autre Iéropé, l’avaient vu soulever la pierre, prendre le flacon et… / — Iéropé, Iéropé, où est ma pénicilline, sale rapiat ? rebouteux voleur de la vie de ma maîtresse, je suis l’âme sans maison, sans corps de Maria Jaçanan ! / Aïe-aïe, jappait, hurlait Iéropé, maigre, noir, réduit, autant qu’il est possible à un homme, aux dimensions du candirou, aiguille des deux mondes, aïe, je n’en ai pris qu’un tout petit peu, dans un moment de ténèbres, je ne dormais plus, j’avais tout le temps mal, je n’avais même plus d’espace pour moi-même, Iéropé, tellement j’avais mal, et alors l’autre, la bouche immonde, ce ricaneur a apparié ma douleur à la douleur de Maria Jaçanan et tous deux nous avons accouché – aïe, non !... Je n’ai pas bu pour me soûler ou m’exciter, je le jure, comme l’a fait mon apprenti Javari le jour où il a bu tout le sirop d’un coup, d’un trait, comme si c’était du cachiri ou du vin de palme, mais je n’en ai pris qu’un tout petit peu, une goutte, une gorgée, je le jure, ça ne m’a fait aucun effet, même que c’était un de ces flacons à remplir d’injection la seringue avant de l’enfoncer dans les fesses, et moi j’ai bu de confiance, j’ai bu, je sais, le foutre de Foutestaine que je ne donnais pas à mes malades, à Maria Jaçanan, que je leur refusais, je sais, je sais, c’est pas la peine de répéter la même chose à longueur de journée, je sais que Iéropé a bu sa foi de pajé, il en a fini avec son astuce et sa sagesse de candirou, l’aiguille qui coud les mondes, ce fétide, ce puant de Maïvotsinim. » (p. 100-101, début du chapitre 18).
____________________________________
[1] Dans le même esprit, un autre passage bien intéressant et bien délectable : « Les Blancs étaient tellement branques ou tellement braques qu’ils croyaient que les Indiens pouvaient leur être supérieurs en quelque chose, putain de leur mère, c’est pareil que les conneries que dégoisait Zéca Chimbioa qui allait jusqu’à dire que les Blancs avaient peur des Indiens parce que chez les Indiens ce qui appartenait à chacun appartenait à tous et que si les Indiens devenaient maîtres du Brésil de nouveau tout serait comme avant et tout le monde très heureux, c’est vous dire la stupidité du Zéca Chimbioa, vous imaginez un Blanc très heureux de voir que les arcs et les flèches appartiennent à tout le monde et les cassaves aussi, merde, qui est-ce qui en veut, de ces saloperies ? Tout était à tout le monde parce que les Indiens n’avaient pas la bière, les amuse-gueule, les petits pâtés, ni l’argent, le fric, vérole, parce que personne ne voulait rien de ce que les Indiens avaient et parce que sur la plage ou sur la rive d’un rio les Indiens ne faisaient que passer leur vie à guetter un navire, attendre l’arrivée d’un bateau de Blancs. » (p. 42-43).
[2] Ce récit assez court, dans l’esprit du Knock de Jules Romains,  mais plus terrible encore, commence comme une balzacienne scène de la vie de province et tourne à l’allégorie politique à la Orwell. La narration, agréable et pleine de surprises, monte progressivement, par une savante gradation, jusqu’à un délire tous azimuts. Ce qui est très fort, c’est que le narrateur garde tout au long un ton calme et une bonhommie souriante, évoque son protagoniste éponyme avec estime, voire sympathie, alors même qu’il le montre commettant des actions de plus en plus impardonnables et de plus en plus horribles. On a ainsi un prototype assez intéressant de savant fou, très inquiétant, d’autant que le narrateur ne s’introduit jamais vraiment dans sa conscience, ce qui empêche de le cerner. J’apprécie beaucoup aussi le fait que la population de la ville soit traitée sans aucune indulgence : l’aliéniste et ses victimes sont renvoyés dos à dos par un narrateur dont la parfaite urbanité dissimule une cruauté impitoyable.
mais plus terrible encore, commence comme une balzacienne scène de la vie de province et tourne à l’allégorie politique à la Orwell. La narration, agréable et pleine de surprises, monte progressivement, par une savante gradation, jusqu’à un délire tous azimuts. Ce qui est très fort, c’est que le narrateur garde tout au long un ton calme et une bonhommie souriante, évoque son protagoniste éponyme avec estime, voire sympathie, alors même qu’il le montre commettant des actions de plus en plus impardonnables et de plus en plus horribles. On a ainsi un prototype assez intéressant de savant fou, très inquiétant, d’autant que le narrateur ne s’introduit jamais vraiment dans sa conscience, ce qui empêche de le cerner. J’apprécie beaucoup aussi le fait que la population de la ville soit traitée sans aucune indulgence : l’aliéniste et ses victimes sont renvoyés dos à dos par un narrateur dont la parfaite urbanité dissimule une cruauté impitoyable.
[3] Sauf, et dans une petite mesure, dans les deux pages qui racontent la mort de Beirão après le départ d’Ipavou (chapitre 22). Même la fin d’Ipavou ne décide pas le narrateur à adopter un point-de-vue omniscient. Les chapitres 21 et 23 sont racontés d’un troisième point-de-vue, après ceux d’Ipavou et d’Iéropé : celui de Javari, un Indien camaïoura, responsable d’un poste indigène au bord du fleuve (et ancien adjoint de Iéropé) : c’est lui qui découvre la pirogue morbide.
[4] Ce nom étant totalement inconnu de l'internet, ainsi que du Dictionnaire des peuples (s.d. Jean-Christophe Tamisier, Larousse, 1998), s'agirait-il d'une invention de l'auteur ? La « note du traducteur », ainsi qu'un texte de Callado donné en postface, semblent prouver que non (p. 132 et 136). Celà n'aurait de toute façon aucune importance, puisqu'on pourrait considérer cette étiquette fictive comme une synecdoque pour l'ensemble des Amérindiens du Brésil, voire du double continent américain. — Notons que cette postface (l'extrait d'une préface donnée par Callado à un livre sur les Indiens du Brésil, en 1978) confirme l'engagement indigéniste de l'auteur : il y déplore le sort réservé aux aborigènes, et l'amputation de leurs réserves par la construction de nouvelles routes. Ce qui rend d'autant plus remarquable qu'il ait pu écrire un roman aussi féroce à l'égard de l'idéologie indigéniste.
08:12 Écrit par Le déclinologue dans Littérature et arts, Livres, Pays étrangers | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio callado, expédition montaigne, mon pays en croix, sempreviva, jacques thiériot, presses de la renaissance, brésil, indiens, indigénisme, montaigne, camaïouras, chingou, don quichotte, sancho pança, gaviao, roy lewis, pourquoi j'ai mangé mon père, la véritable histoire du dernier roi socialiste, le vieux qui lisait des romans d'amour, luis sepulveda, kundera, machado, l'aliéniste, la case de l'oncle tom, droidlomisme, amérindiens, apologue, satire, knock, cabral, colonisation, joseph conrad, au coeur des ténèbres, orwell, dictionnaire des peuples, jean-christophe tamisier |  |
|  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer | |
Imprimer | |  Digg |
Digg |  |
|



Écrire un commentaire