08.04.2018
HERBERT ROSENDORFER : LES SAINTS D'OR, UNE APOCALYPSE DRÔLE ET ACCABLANTE
Voici un roman qui permet de s’interroger sur les contours de ce genre né au XXe siècle qu’est la science-fiction. Si l’on considère qu’Herbert Rosendorfer (1934-2012) n’est pas catalogué comme un auteur de S.-F. (il semble qu’il s’agisse de sa seule incursion dans cet univers [1]), que ce roman est paru dans une collection de littérature générale, que l’auteur fait un usage très sobre des ingrédients du genre (ses extraterrestres ne sont jamais décrits physiquement, on ignore quasiment tout d’eux, ils possèdent un rayon destructeur mais s’en servent rarement), et par-dessus tout que ses extraterrestres sont surtout pour l’auteur un moyen latéral de s’intéresser au comportement de l’humanité, alors Les Saints d’or ou Colomb découvre l’Europe ne relèvent pas de la S.-F. On aurait ainsi une belle illustration, a contrario, de la fameuse définition de Norman Spinrad : « La science-fiction, c’est tout ce qui se publie sous l’appellation de science-fiction. » Mais on n’aurait pas de mal à trouver des classiques du genre, toujours édités dans des collections spécialisées, qui répondent aux mêmes caractéristiques et contiennent très peu voire pas du tout de science et d’inventions techniques extraordinaires ! (par exemple À l’ouest du temps de John Brunner, ou des uchronies comme Pavane de Keith Roberts.) C’est dailleurs pourquoi on utilise parfois le terme plus large d’ « anticipation ». Les Saints d’or ne sont pas un roman de science-fiction au sens populaire du terme (un space opera farci de gadgets merveilleusement sophistiqués, un western inter-galactique), mais c’en est un au sens large, dans la mesure où il raconte la confrontation de l’humanité avec des envahisseurs extraterrestres, et c’est encore plus évidemment un roman d’anticipation, imaginant un de nos avenirs possibles entre la fin du XXe et la fin du XXIe siècles. C’est un apologue qui se contente de postuler que l’humanité n’est pas seule dans l’univers, comme après tout Cyrano de Bergerac ou le Voltaire de Micromégas l’ont fait il y a longtemps.
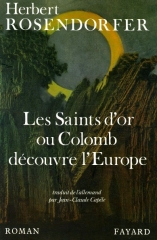 Ce roman publié chez Fayard en 1992, traduit en français par Jean-Claude Capèle, est composé de deux séquences très distinctes. La première (correspondant à la première partie, 16 chapitres, 110 pages) est racontée à la troisième personne par un narrateur extérieur. C’est, autour de l’arrivée de mystérieux O.V.N.I. en Allemagne, une satire très amusante des milieux « alternatifs » allemands, tous ces jobards post-soixante-huitards, écolos, gauchistes, ésotéristes, amateurs d’aliments bios, de médecines douces et de théories stupides, pigeons volontaires pour toutes les fumisteries du « new age ». C’est allègre et amusant, rapide et incisif. Bien qu’on doute de la pertinence du oiseux deuxième chapitre (qui parle de personnages dont il ne sera plus jamais question ensuite), on prend un plaisir un peu sadique à voir ridiculisés à chaque page quelques crétins, mi-dupes mi-escrocs eux-mêmes, qui voient dans l’arrivée des O.V.N.I. la confirmation de leurs délires millénaristes. Il est très bien vu, cet entêtement buté des allumés messianistes à croire que les extraterrestres sont des amis, voire des rédempteurs, venus dans une intention de paix et de fraternité, voire de salut, alors que bien évidemment ce sont des conquérants et des prédateurs, venus pour occuper et exploiter un territoire après avoir exterminé ceux qui le possèdent. Toute cette séquence reste d’une grande actualité. J’apprécie particulièrement ce que j’avais déjà goûté dans le seul bon moment du filme Le Jour de l’indépendance (1996) : une scène, tout-à-fait analogue à celle du filme, où un cortège de hippies et de mystagogues vient au-devant de la base extraterrestre, avec des banderoles : « Bienvenue à vous, les Saints d’or ! », « Amitié ! Amour ! Cosmos ! », « La mystique nous rend libres ! » : dès qu’il s’approche, il se fait entièrement massacrer en trois secondes par un rayon laser (p. 138-140) [2].
Ce roman publié chez Fayard en 1992, traduit en français par Jean-Claude Capèle, est composé de deux séquences très distinctes. La première (correspondant à la première partie, 16 chapitres, 110 pages) est racontée à la troisième personne par un narrateur extérieur. C’est, autour de l’arrivée de mystérieux O.V.N.I. en Allemagne, une satire très amusante des milieux « alternatifs » allemands, tous ces jobards post-soixante-huitards, écolos, gauchistes, ésotéristes, amateurs d’aliments bios, de médecines douces et de théories stupides, pigeons volontaires pour toutes les fumisteries du « new age ». C’est allègre et amusant, rapide et incisif. Bien qu’on doute de la pertinence du oiseux deuxième chapitre (qui parle de personnages dont il ne sera plus jamais question ensuite), on prend un plaisir un peu sadique à voir ridiculisés à chaque page quelques crétins, mi-dupes mi-escrocs eux-mêmes, qui voient dans l’arrivée des O.V.N.I. la confirmation de leurs délires millénaristes. Il est très bien vu, cet entêtement buté des allumés messianistes à croire que les extraterrestres sont des amis, voire des rédempteurs, venus dans une intention de paix et de fraternité, voire de salut, alors que bien évidemment ce sont des conquérants et des prédateurs, venus pour occuper et exploiter un territoire après avoir exterminé ceux qui le possèdent. Toute cette séquence reste d’une grande actualité. J’apprécie particulièrement ce que j’avais déjà goûté dans le seul bon moment du filme Le Jour de l’indépendance (1996) : une scène, tout-à-fait analogue à celle du filme, où un cortège de hippies et de mystagogues vient au-devant de la base extraterrestre, avec des banderoles : « Bienvenue à vous, les Saints d’or ! », « Amitié ! Amour ! Cosmos ! », « La mystique nous rend libres ! » : dès qu’il s’approche, il se fait entièrement massacrer en trois secondes par un rayon laser (p. 138-140) [2].
La seconde séquence [3] correspond aux deuxième et troisième parties (30 chapitres, 190 pages). Changement complet d’histoire, de thème, de ton et même de narrateur. L’histoire est désormais racontée par le fils et neveu des deux sœurs qui étaient au centre de la première partie [4], né le 12 octobre 1992, jour de l’arrivée des O.V.N.I. Il écrit en 2081, alors qu’il est devenu le dernier homme sur Terre, et explique ce qui s’est passé. L’humanité a été victime à la fois d’elle-même et des envahisseurs, dans une fatale convergence des catastrophes (l’expression n’apparaît pas). À partir de la chute du communisme, tout s’est mis à se dégrader : l’épuisement total des ressources naturelles, la pollution, le trou de la couche d’ozone ont dégradé le climat. La forte hausse des températures a entraîné une considérable élévation du niveau des mers (submergeant les littoraux, notamment des pays entiers comme les Pays-Bas et l’Italie, d’où une vague de réfugiés par dizaines de millions dans les pays voisins), une diminution des rendements agricoles, une augmentation des insectes nuisibles. Les guerres civiles font environ 60 millions de morts par an, sans parler des famines. Les gouvernements ont mené la plupart des pays à la faillite. Les États-Unis doivent dissoudre leur police vers l’an 2000, et ne parviennent plus à payer leur armée. Le Tiers-Monde « était à cette époque à peu près mort » (p. 150). L’Afrique est tellement ravagée par le sida qu’en 2002, l’O.M.S. déclare l’ensemble du continent zone de quarantaine et interdit à ses habitants d’émigrer. Deux forces émergent un peu partout : « la vermine du béton et celle de la ouate». La première, c’est « les Barons noirs », ou la mafia de la drogue, qui contrôle ce qu’il reste des gouvernements. La seconde, c’est les bonzes de « l’Église du Verseau », un mouvement fondamentaliste à mi-chemin de la secte et du parti, qui contrôle les esprits avec une doctrine « mi-religion, mi-astrologie, ou encore : mi-méditation, mi-muesli, le tout agrémenté d’une touche nationaliste ». La description de ce retour brutal au Moyen-Âge se trouve surtout pages 148-153, à compléter par les pages 171-174 et quelques paragraphes aux pages 157, 180, 188.
Quand les « Saints d’or », qui n’avaient fait qu’installer quelques bases inertes, envahissent vraiment la Terre le 2 juillet 2004, ils ont donc affaire à une humanité profondément affaiblie et dégénérée, ressemblant « à un malade qui arrive à grand-peine à se tenir sur ses jambes » (p. 171), et à qui des sauterelles ou des fourmis venimeuses auraient pu pareillement asséner le coup-de-grâce (p. 157). Très brutalement, tout s’effondre, plus rien ne fonctionne. Les extraterrestres n’ont ainsi aucun mal à asservir l’humanité, avec l’aide de quelques collabos. Ils la contraignent à travailler pour eux en fabriquant des sabots de bois hollandais (dont on ne saura jamais quel usage ils font), et la payent en la gavant de « treutlings », petits objets qui sont une véritable drogue, provoquant un plaisir addictif jusqu’à l’auto-destruction de celui qui en a abusé (p. 211). Pour échapper à l’anarchie et la violence généralisées, les hommes se sont regroupés en cités fortifiées non loin des bases extraterrestres, mais leur vie est de plus en plus lamentable et barbare, et au fil des années ils ne cessent de diminuer, jusqu’à ce que le narrateur, ultime survivant, écrive ses souvenirs à leur demande, dans un but ethnographique (p. 193-196 et aussi p. 306, 309 et 314).
Les Saints d’or (des êtres immenses : plusieurs dizaines de mètres de hauteur, nacrés, que le lecteur ne parvient pas à s’imaginer visuellement) avaient cependant un point faible, que les hommes ont vite perçu : ils craignent le bruit, et un vacarme continu peut les détruire. Mais les hommes ne cherchent pas à en tirer parti, par désorganisation, par impuissance matérielle et mentale, et surtout parce que jusqu’au bout une bonne partie d’entre eux, aliénés par leur idéalisme, leur bêtise et les treutlings, sont persuadés que les Saints d’or sont des amis, des sauveurs, des rédempteurs, qu’il y a tout à gagner à coopérer avec eux, qu’il faut les servir diligemment (par exemple p. 213 : « Il ne faudrait pas oublier le fondamentalisme du Verseau. Il y avait encore assez de gens prêts à se soumettre simplement parce que Ceux-de-là-bas venaient d’en haut. Du Grand Muesli. » [5]). C’est seulement en 2030 qu’à l’instigation de Burschi, un personnage énigmatique qui ressemble à un champignon (!), des humains décident d’entreprendre une grande campagne pour éliminer les Saints d’or avec des armes sonores. Ils remportent des batailles, mais les Saints d’or lèvent une légion de quelques centaines d’hommes dans la cité où vit le narrateur, et leur confient leurs armes irrésistibles (un « rayon tronçonneur »). Cette légion, qui ne craint pas le bruit, peut aller à la rencontre de l’armée de Burschi et l’anéantir en moins d’un quart d’heure. Cet épisode (p. 246-273) est l’un des plus poignants du livre, d’autant que le narrateur est alors emprisonné (étant soupçonné de complicité avec Burschi) et séparé de la seule femme qu’il ait jamais aimée : il apprend le résultat tragique à sa libération. La cité espérait que les Saints d’or lui témoigneraient une grande gratitude pour sa collaboration salvatrice. En effet : pour éviter toute récidive, les Saints d’or (qui demandent qu’on les appelle les On-ne-peut-plus-vénérables) décident de couper une jambe à tous les mâles vivants et à naître. Un peu plus tard, tous les habitants sont déportés dans un camp d’une vallée alpestre, « déménagement » qui ressemble fort à un génocide (p. 283) et évoque les marches de la mort de l’hiver 1945. La vie des derniers hommes unijambistes, dans leur réserve clôturée de barbelés, devient tellement faible et pitoyable que le narrateur n’a presque plus rien à en dire [6].
J’ai rarement lu un roman aussi déprimant. Le narrateur, qui a presque 90 ans, qui est unijambiste et édenté, qui a vu disparaître tous ses proches et toute l’humanité, qui n’est plus qu’une sorte d’animal en cage, raconte toute cette seconde séquence sur un ton triste et résigné, avec un sentiment de lassitude qui l’empêche d’entrer dans les détails. Je ne sais si c’est grâce au talent de l’auteur, ou parce que je me suis exagérément projeté dans cette histoire, mais j’ai été contaminé par une impression d’accablement : ainsi, le passage de l’anéantissement de l’armée de Burschi (p. 266-267) n’a même pas suscité de colère en moi : j’aurais dû ressentir une certaine forme de rage devant ces ignobles collabos qui ont sauvé les envahisseurs, alors que l’humanité était sur le point de reprendre son destin en main. Mais ce qui précédait avait déjà éteint en moi tout espoir ; j’étais comme anesthésié devant ces humains résignés à leur asservissement, et je n’avais même plus envie de les voir se libérer, je ne faisais plus que subir, au fil des pages, le poids écrasant de leur consentement à l’avilissement et la domination.
Naturellement, des changements aussi extraordinaires dans la société humaine auraient pu donner lieu à des explications très approfondies, qui auraient multiplié la taille du roman par quatre ou cinq. (Ce n’est pas un roman très long, moins que le fait croire son épaisseur de 28 millimètres, due à un papier épais et une typographie aérée : les pages font trente-cinq lignes sur une cinquantaine de caractères. À titre de comparaison, une page de Pléiade fait quarante-trois lignes.) Le narrateur, Menelik Hichter, raconte ce qu’il a vu et entendu, en se contentant des explications indispensables pour l’intelligence de son récit, éludant avec une certaine pudeur ses propres sentiments, si tant est qu’il en ait éprouvé beaucoup. Il y a peu de méditations personnelles sur sa situation, peu de réflexions générales (alors qu’il y avait tant à en faire dans une telle situation !), quasiment aucun chateaubrianisme. Et très peu de descriptions, très peu de lyrisme, presque pas de métaphores : la narration est faite dans un style factuel et précis [7], convenant à un homme qui a tout perdu, et qui sait qu’il n’aura aucun lecteur humain (p. 195). Cette sobriété dans l’exposé pourrait être frustrante, mais elle est étrangement efficace : alors que d’habitude j’aime qu’on m’explique tout de A à Z, qu’on investigue à fond la conscience des personnages, là ce que je lisais me suffisait et, en proie à une sorte de malaise ou de dégoût devant cette déliquescence générale, je n’avais pas envie d’en savoir plus. Le laconisme psychologique suggère bien le vide intérieur des survivants. Dailleurs le narrateur reconnaît qu’il n’a presque pas de cœur (p. 240), qu’il n’est plus qu’une enveloppe vide qui se réduit lentement en poussière (p. 272).
Le changement de ton renforce aussi cette grisaille, par contraste : on s’amusait beaucoup dans la première séquence, plus du tout ensuite. Les effets comiques auraient pu être aussi nombreux dans la seconde séquence que dans la première, mais ils sont devenus rares et assourdis. Par exemple quand, alors qu’il reste quelques dizaines d’humains, le narrateur essaye de chercher des livres pour avoir un vestige de la culture humaine, et qu’il ne trouve qu’un tome des mémoires d’Adenauer et le guide Michelin 1987 de l’Italie (tous deux servant de cales à une machine à coudre [8]), puis seize albums en couleurs sur les derniers championnats du monde de foutebôle (p. 311), on n’a même pas envie de sourire, tant la désolation ambiante est totale. Un peu avant, il avait mentionné qu’un de ses amis, le père Jadelin, grand producteur d’histoires drôles (dont il n’a jamais rapporté une seule [9]), était mort en racontant une dernière blague, mais ne la donne pas, pensant qu’elle était inachevée ou qu’il ne l’a pas comprise : « Elle n’avait pas de chute, et donc ce qui fut probablement la dernière blague de l’humanité se perdit sans un éclat de rire » (p. 304), phrase qui ne contribue pas peu à recouvrir toute la seconde séquence d’un voile de tristesse : même l’humour semble incompréhensible, irrestituable, et finalement disparu.
La seule note dissonante de cette seconde séquence est la passion du narrateur pour Mara, une jeune fille dont il parle souvent dans la troisième partie, alors qu’il ne l’aura vue que deux nuits, quand elle avait onze ans puis sept ans plus tard. En écrivant ces lignes, l’idée me vient que ce personnage pourrait bien n’être qu’un pur fantasme du vieux Menelik, dépourvu de toute réalité, même si cette hypothèse ne m’avait pas traversé à la lecture. De fait, la seconde apparition de Mara est proprement fantastique : le narrateur, dans sa cellule, rêve à elle, puis il voit qu’elle est là. En tant que fille d’un magicien itinérant et magicienne elle-même, elle explique qu’elle a pu ensorceler le gardien. Ils partent prendre du bon temps intime pendant quelques heures, puis il regagne sa cellule tandis qu’elle s’en va rejoindre Burschi (p. 260-263). Mouais… La première rencontre était à peine moins bizarre, et même un peu trouble : le narrateur accueille chez lui le magicien et sa fille pour qu’ils passent la nuit. Il y a un coup-de-foudre réciproque entre lui et cette gamine de onze ans, il la voit sortir nue de son bain, elle vient se coucher dans son lit comme ça, se pelotonnant contre lui, elle lui promet qu’elle reviendra dans sept ans et ils s’endorment (p. 239-242). Je saisis mal le sens de ce double épisode complètement incongru, et la seule chose qui me paraisse évidente, c’est qu’il ne s’intègre pas dans l’ensemble. Cette petite magicienne introduit deux fausses notes dans le récit : on ne comprend la raison ni de cette parenthèse fantastique, ni de cette touche sentimentale. La première fausse note serait-elle là pour discréditer l’ensemble du récit, pour faire naître un doute sur la fiabilité de la mémoire du narrateur et nous amener à croire qu’il y a beaucoup de fariboles dans tout ce qu’il raconte [10] ? (les dernières lignes iraient assez dans ce sens [11]). Mais quel intérêt de démolir ainsi le roman, et par ce biais-là seulement ??! La seconde fausse note, à l’inverse, serait-elle là pour humaniser le personnage de Menelik, pour lui donner densité et crédibilité ? Mais le récit, me semble-t-il, cherche au contraire à peindre une humanité déshumanisée, et montrer un narrateur lui-même atteint par ce vide intérieur rend cette peinture beaucoup plus efficace. Quitte à doter le personnage d’une grande passion amoureuse, il aurait fallu en parler beaucoup plus ! Bref, tout ce qui concerne Mara est une véritable faute littéraire, qui porte doublement atteinte au dessein du livre et aurait dû en être entièrement retirée.
Mais justement, quel est le dessein du livre, quelles leçons peut-on tirer de ce roman apocalyptique ? La clef la plus manifeste est donnée par le sous-titre : « Colomb découvre l’Europe », très vite confirmé par la date anniversaire du 12 octobre 1992 qui voit l’arrivée des O.V.N.I. On commence donc le roman avec l’idée qu’il s’agit d’un pamphlet anti-occidentaliste, où les extraterrestres joueraient le rôle des Européens de la Renaissance, et les Européens de la fin du XXe siècle celui des Amérindiens. Le roman serait fondé sur l’inversion du point-de-vue, et transposerait de façon assez précise l’histoire de la conquête du Nouveau monde avec cinq siècles de décalage, de la même façon que La Ferme des animaux transpose l’histoire de l’U.R.S.S. entre l’avant-1917 et la fin des années 40. Mais non, ça ne colle pas, le parallèle n’est pas du tout suivi. Par exemple, la véritable invasion des extraterrestres a lieu le 2 juillet 2004 : or le 2 juillet 1504 n’est pas une date-pivot de la « Conquista » (à l'instar du 23 avril 1519, jour où Hernan Cortès a débarqué au Mexique, ou du 16 novembre 1532, jour où Francisco Pizarro a capturé l’Inca Atahualpa et remporté la bataille de Cajamarca), elle ne correspond à rien. Ou encore : un important épisode du roman, que j’ai omis ci-dessus, raconte que les Saints d’or sont divisés en deux factions ennemies : les bleus, installés en Europe, et les violets, installés au Brésil. Ils se font la guerre et les violets pénètrent dans l’hémisphère nord. Les hommes les plus hardis de Grand-Menzig, la cité du narrateur, montent une expédition militaire, et grâce à leurs armes sonores, ils parviennent à éliminer les Saints d’or violets en Europe, le 1er janvier 2011 (p. 179-192), avant que les Saints d’or bleus les récompensent en leur distribuant une profusion de treutlings aliénants. Cet épisode n’a aucun équivalent dans l’histoire de la conquête des Amériques. Il faut du reste attendre la fin du roman pour que, p. 296-298, un texte assez étrange de trois pages développe explicitement le parallèle avec Colomb, une sorte de conte qui raconte l’arrivée des Saints d’or exactement comme la traversée de Colomb en 1492. On peut aussi penser que les treutlings sont l’équivalent du vin (mais les peuples amérindiens n’ignoraient pas l’alcol), et que les sabots de bois hollandais, désirés par les extraterrestres, sont l’équivalent de l’or avidement recherché par les Conquistadors. Mais c’est une mauvaise transposition, car un produit manufacturé n’est pas un minerai métallique. Et on ne comprend jamais ce que font les Saints d’or avec les sabots, alors que les Aztèques et les Incas, qui faisaient déjà des bijoux avec de l’or, ont vite compris que les Espagnols en faisaient la base de leur richesse monétaire. Et rien sur le choc microbien… Tout celà est très approximatif ! Et puis, si l’action se passe exclusivement en Europe, et même en Allemagne, on nous dit bien que c’est l’humanité entière qui subit le même sort. Menelik est le dernier humain, pas le dernier Européen.
Le sous-titre n’est donc qu’une indication donnant une vague idée de l’orientation d’ensemble du livre, rien de plus. Il est même trompeur en ce sens qu’il flatte paradoxalement l’ethno-masochisme des Européens, en leur promettant que le livre va les cibler eux seuls, alors que c’est toute l’humanité qui est envahie et peu à peu exterminée. On se dit que, à l’approche du cinq-centenaire de la découverte de l’Amérique (commémoration internationale qui fit autant de bruit que le bicentenaire de la Révolution française trois ans plus tôt, et dont il n’y a pas eu l’équivalent depuis), Herbert Rosendorfer a eu l’idée d’écrire un roman qui mettrait les Européens à la place des Amérindiens, mais que son imagination a vite dérivé, sans se sentir astreinte à suivre le parallèle. Ou alors, pire : c’est son éditeur qui, averti que son prochain roman, à paraître en 1992, racontait l’invasion de la Terre par les extraterrestres, lui a imposé de raccrocher ça à Christophe Colomb, de façon à profiter d’une opportunité commerciale. Hypothèse peut-être diffamatoire pour la maison Kiepenheuer & Witsch, de Cologne, mais assez probable pour la version française : chose très rare pour un auteur qui n’est pas une vedette, la traduction a été immédiate, puisque le roman allemand est paru en mars 1992 et sa version française en août. On ne me fera pas croire que la maison Fayard, qui jusqu’alors n’avait publié (l’année précédente) qu’un seul roman de Rosendorfer, quatre ans après la parution originale [12], n’a pas cherché à profiter ici d’un « effet Christophe Colomb », en sortant ce titre, comme par hasard, quelques semaines avant l’anniversaire du 12 octobre.
Une fois écarté le sous-titre, le sens global du roman semble être une sorte de procès fait à l’humanité, cette espèce « bête, irrésolue et paralysée ; divisée et dégénérée » (p. 157). C’est elle-même qui s’est fichue dans le pétrin avant l’arrivée des extraterrestres ; et quand ceux-ci sont arrivés, elle leur a facilité la tâche par sa bêtise phénoménale en les prenant pour des « saints d’or », en collaborant avec eux, en acceptant la servitude, en se gavant de treutlings. Il semble y avoir chez l’auteur une coriace misanthropie : à plusieurs reprises revient l’idée que l’humanité mérite d’être éliminée, que les Saints d’or rendent service au monde en effectuant cette mission salubre. Ainsi Burschi explique-t-il : « nous nous sommes si mal comportés sur la Terre que c’est elle qui doit être libérée de nous » (p. 208) et « Nous ne sommes que vermine. La vermine du monde » (p. 217), avant d’être relayé par le narrateur : « notre intérêt bien compris, c’est de disparaître de la surface de la Terre » (p. 269). Notons aussi qu’il n’y a aucun personnage vraiment positif dans ce roman. Burschi est une espèce de gnome assez mystérieux, qui pue l’ammoniac à dix mètres de distance, ressemble à un champignon et porte des vêtements couleur poubelle (p. 196) : assurément le plus futé de tous ceux qui apparaissent, mais pas la stature d’un héros. Mara est une fée irréelle. Menelik Hichter, le narrateur, fait preuve de bon sens, mais il se montre bien passif tout au long de ses neuf décennies. Présent aux premières loges du dernier siècle de l’humanité, en relation directe avec les Saints d’or dès l’origine, il n’aura jamais pesé sur le cours des choses. Tous les autres personnages sont des crétins ou des salauds, tous antipathiques, au mieux grotesques, au pire exécrables (à part quelques figures insignifiantes comme, à la fin, le père Jadelin ou le gosse Arthur).
Si l’on creuse un peu, on a du mal à bien situer l’auteur, et celà brouille son message. D’un côté, il a clairement une sensibilité de gauche, comme le suggère ce sous-titre fallacieusement anti-occidentaliste : il insiste à plusieurs reprises sur le désastre écologique causé par l’industrie humaine, il mentionne la responsabilité de l’économie capitaliste entièrement vouée au profit (p. 149), il dote le « muesli » religieux de l’ère du Verseau d’une « touche nationaliste » (p. 151) – ce qui n’est pas très cohérent –, il attribue à l’austérité sexuelle la ruine de l’Église catholique [13], il signale que l’élimination prophylactique des malades du sida est devenue une véritable persécution [14], de telle sorte qu’on brûle les déviants exactement comme on brûlait les sorcières (p. 216-217). On notera aussi que l’islam et l’immigration n’existent pas pour l’auteur. À l’en croire, le chaos ethnico-culturel n’a joué aucun rôle dans l’affaiblissement de l’Europe, puisque les Arabes ni les Turcs ne sont jamais mentionnés dans le roman (non plus que les Juifs). Pourtant, en 1992, quand Rosendorfer a publié son livre, même si le mot « communautarisme » n’était pas employé, les problèmes de l’immigration étaient déjà présents dans tous les esprits d’Europe, comme en témoignent les 14,5% de Le Pen aux présidentielles de 1988 ou l’élection de Jörg Haider au poste de gouverneur de Carinthie en 1989. Mais dans ce roman, c’est le nationalisme et le morcellement des États qui posent problème : la course à l’homogénéité ethnique révèle toujours des minorités et donc de nouvelles dissensions (un passage en ce sens, p. 149, doit avoir été inspiré par l’éclatement de la Yougoslavie). Page 153, il est question de graves troubles causés par « le nombre croissant de réfugiés ». Mais d’après les pages qui précèdent, ceux-ci ont dû fuir des régions submergées par la montée des eaux (et ce sera confirmé p. 161) : il doit donc s’agir d’Italiens et de Néerlandais, ainsi que des Anglais, des Belges, des Français de la façade atlantique ? Page 172, grave dévastation causée par une « bande de réfugiés ». Mais de quelle provenance ? Mystère. Page 174 enfin : « À l’extérieur [de la cité fortifiée], la violence et la peste faisaient rage. Bien sûr, certains réfugiés – il en arrivait toujours plus, car le niveau de la mer ne cessait de monter – fondèrent à leur tour des "villages" semblables, entrèrent même en contact avec nous, mais grosso modo, ils végétaient dans leur coin, d’autant que les Africains, qui arrivaient en nombre toujours croissant, avaient tous le sida et mouraient comme des mouches, non sans avoir auparavant infecté en vitesse quelques personnes. » Ce sera la seule allusion à une invasion extra-européenne. Comme page 150, les Africains ne sont mentionnés ici qu’en tant que malades du sida, et ils ne sont pas de vrais envahisseurs, puisque ces pauvres victimes meurent aussitôt qu’ils arrivent [15]. On voit que l’auteur s’est efforcé au maximum de ne pas donner prise à une récupération extrême-droitière de son apocalypse.
Mais était-ce possible ? Après tout, l’idée que les Africains sont tous sidéens et que l’immigration extra-européenne apporte la peste ne pouvait que plaire à l’électeur de Le Pen en France ou de Franz Schönhuber en Allemagne. Et cette idée d’une mise en quarantaine de l’Afrique, de son blocus migratoire pour raison sanitaire, fantasme absolu de l’extrême-droite, n’est-elle pas à inscrire dans la courte liste des rares tentatives signalées dans le roman pour endiguer l’écroulement ?… L’auteur semble y voir juste un symptôme du chaos général, mais le lecteur s’égare-t-il en se disant : « Bravo ! voilà une mesure salubre » ? Et bien plus encore, c’est l’argument même du roman qui est du pain bénit pour les extrêmes-droites, dont le plus petit commun dénominateur, sans doute, est le rejet de l’immigration. Une histoire qui montre une communauté détruite par des envahisseurs étrangers, qui se moque des imbéciles prenant ces envahisseurs pour des saints pétris d’intentions fraternelles, qui dénonce les collaborateurs de l’ennemi, qui montre l’humanité anéantie par sa passivité, par son individualisme, par les ravages du monde moderne : c’est très exactement ce que l’homme d’extrême-droite adore lire, c’est la plus magnifique confirmation de sa vision du monde. On n’est pas loin de tenir un Camp des saints à l’allemande, version science-fiction ! Certes, certes, les migrants qui envahissent l’Europe, dans la réalité et dans le roman de Raspail, sont des miséreux dont la force réside surtout dans le nombre, alors que les Saints d’or ont sur nous une supériorité incommensurable. Mais comme je l’ai dit au début, l’auteur n’a pas versé dans la science-fiction pure, il s’est surtout attaché à cerner le comportement humain face à des êtres venus d’ailleurs. Dès lors, que ces êtres soient très puissants ou très faibles est secondaire : ce qui compte, c’est que les hommes aveuglés par leurs bons sentiments ouvrent les bras à ceux qui veulent les supplanter, et qu’une société se condamne quand elle accepte l’implantation, en son sein, d’un corps étranger inassimilable. Mon intuition est qu’Herbert Rosendorfer n’est pas du tout un homme d’extrême-droite (contrairement à Jean Raspail), et que c’est à son insu qu’il a commis un apologue allant dans le sens de ses adversaires. Il est plus ou moins parti de l’idée de rendre aux Européens la monnaie de leur pièce de 1492, il a surtout voulu stigmatiser la bêtise humaine… et il ne s’est pas rendu compte qu’il nous offrait une magnifique illustration des conséquences apocalyptiques de la tolérance à l’immigration. Eh oui, il suffit de baisser la garde pour devenir malgré soi un propagateur de la bête immonde ! Quelques instants d’inattention, et hop, on se retrouve à expliquer que l’extrême-droite a fondamentalement raison. Ah là là, ce n’est pas si facile d’être un droidlomiste conséquent !…
Du reste, sans même le tirer jusque-là, le message du romancier est brouillé. D’un côté, disais-je, il y a d’incontestables marqueurs de gauche : la touche écologiste [16], la touche anti-capitaliste, la touche anti-nationaliste, la touche anti-catholique, le déni de l’islam et du chaos ethnique. Mais de l’autre côté, toute la première séquence s’attaque très directement aux écolos libertaires mystagogues du « new age », ennemis de la famille traditionnelle, une engeance gauchiste s’il en est. Après tout, l’auteur aurait pu concentrer sa satire sur les politiciens, les grands patrons, les militaires… Mais non, ce qui est au centre de la première séquence, c’est une bande de givrés : la tante Jessica, une hypocondriaque qui passe son temps à enchaîner les thérapies alternatives, toutes aussi grotesques les unes que les autres ; sa sœur Cornelia (la mère de Menelik), qui s’est improvisée grande-prêtresse des Saints d’or, et se met à parcourir le monde pour prêcher son évangile de mystique du Verseau et de sotériologie extraterrestre ; « Nostradamus-Deux », un escroc dabord amant de la première puis compagnon de la seconde, à l’affût de toutes les dingueries du Nouvel-âge ; et l’entourage de ces trois-là, quelques hommes veules et parfaitement creux. Tout celà est très plaisant à lire d’un point-de-vue réac ou fachiste ! Alors ? que faut-il en penser ? Est-ce que l’auteur a voulu afficher sa liberté d’esprit, prouver qu’il n’était ni borné ni sectaire, montrer qu’il pouvait aussi s’en prendre aux brebis galeuses de son camp ? Ou bien est-ce que c’est sciemment qu’il a voulu laisser un message ambigu, égarer le lecteur, le laisser dans la perplexité quant à son orientation idéologique ? Ou encore, est-ce qu’il a été dépassé par une création trop improvisée, mal pensée et mal maîtrisée, est-ce qu’il n’a pas vraiment réfléchi aux implications politiques de sa fantaisie romanesque ?
En attendant que des éléments accessibles me permettent d’en savoir plus sur l’auteur, c’est pour la troisième hypothèse que j’incline. Car cette confusion idéologique me semble directement liée au grand défaut de ce roman intéressant mais bancal : la mauvaise articulation des deux séquences. On a vraiment l’impression que Rosendorfer a soudé tant bien que mal deux romans très différents. Ce n’est pas la même histoire, pas les mêmes personnages (à part tante Jessica), pas les mêmes thèmes, pas le même ton… Dabord une sottie un peu déjantée, un allègre dézingage des allumés du Nouvel-âge – puis le récit accablé, par le dernier témoin, de l’extinction de l’humanité… Ça ne va pas ! Au début de la deuxième partie, quand il prend la parole à la première personne, Menelik explique qu’il a écrit la première partie grâce au souvenir des témoignages qu’il avait recueillis, d’où l’usage de la troisième personne. Il peut maintenant parler en son nom propre, puisqu’il s’appuie sur ses souvenirs directs (p. 127). Admettons, mais alors pourquoi ce changement de ton, pourquoi avoir adopté cette humeur bouffonne pendant près de cent-quarante pages ? Pourquoi tourner en dérision sa mère et sa tante en racontant ce qu’il n’a pas vu lui-même ? Dans la seconde séquence, la tante Jessica est nettement moins ridiculisée ! C’est tellement discordant que je serais prêt à miser quelques copecs sur l’hypothèse suivante : l’auteur a redécouvert un jour, au fond d’un tiroir, une nouvelle qu’il avait écrite quelques années auparavant, et il a décidé de la transformer en roman en lui greffant une autre idée qu’il venait d’avoir. Un peu comme « A day in the life »… mais sa greffe prend beaucoup moins bien que la chanson des Beatles ! Rosendorfer aurait plutôt dû développer chacun des deux romans pour leur donner leur autonomie, quitte ensuite à les présenter comme les deux volets d’un diptyque.
Bref, pas un chef-d’œuvre, mais un double roman à découvrir, très drôle puis très triste, qui a le mérite de nous faire réfléchir sur l’attitude à adopter face à des envahisseurs indésirables…
_________________________________
[1] Pas tout-à-fait. Cet écrivain (qui n’a même pas encore de notice sur le Wikipédia francophone, malgré ses cinq romans traduits en français, dont l’un deux fois, alors qu’il en a dans les versions bien sûr allemande, mais aussi anglaise, espagnole, italienne, polonaise et russe) avait une imagination débridée qui ne se sentait pas contrainte pas les dures lois de la réalité, ce qui l’amenait parfois à recourir à des procédés fantastiques que l’on considère comme l’apanage de la S.-F. Ainsi dans ce qui semble son chef-d’œuvre, ou son roman le plus coté (le seul qui ait droit à une notice sur le Wikipédia germanophone), Lettres d’un passé chinois (1983), un mandarin chinois du Xe siècle se retrouve dans l’Allemagne des années 1980, brutal transfert temporel, spatial et culturel qui donne lieu à une suite d’observations cocasses dans l’esprit des Lettres persanes de Montesquieu. Il est regrettable que ce roman n’ait pas été traduit en français, d’autant que Rosendorfer lui a donné une suite, Le Grand retournement (1997), dans laquelle le mandarin revient en Allemagne, mais cette fois l’Allemagne réunifiée des années 1990 : le contraste entre son monde et le monde étranger qu’il découvre se double d’un contraste avec le monde étranger qu’il avait une première fois exploré une quinzaine d’années avant. L’un des cinq romans de Rosendorfer traduits en français, Suite allemande (1972), est fondé sur l’idée que le royaume de Bavière n’a pas été aboli en 1918 : il s’agit donc d’une uchronie, genre que l’on englobe assez abusivement dans la science-fiction.
[2] À vrai dire, cette scène se trouve dans la seconde séquence, mais les premiers chapitres de la deuxième partie constituent comme un appendice à la première, dont ils gardent encore le ton satirique. On pourrait dire qu’on n’entre pleinement dans la seconde séquence qu’avec le chapitre 5 (p. 147), qui propose un retour-en-arrière pour expliquer l’affaiblissement de la société humaine entre 1989 et 2004.
[3] J’emploie le mot « séquence », puisque le roman est officiellement divisé en trois « parties ». Mais ce découpage me paraît fallacieux, car il y a une rupture profonde entre la première et le deuxième, alors que la deuxième et la troisième s’enchaînent naturellement. La troisième commence avec l’apparition de Mara et la tentative de révolte armée instiguée par Burschi. Inflexion dans l’histoire, certes, mais s’il n’y avait pas eu ici un changement de « partie », le lecteur n’aurait pas ressenti péniblement l’absence d’une scansion nécessaire.
[4] Ce personnage porte les trois prénoms de Gorbi, Evo et Menelik : excellente trouvaille. Pour comprendre « Gorbi », il faut se souvenir de l’effarante « gorbimania » qui a empreint les pays occidentaux, et en particulier l’Allemagne, dans la seconde moitié des années 80 : le pacifisme était si prégnant que Mikhaïl Gorbatchev y était vu comme une sorte de messie. Evo est le masculin d’Eva : le féminisme qui reconstruit tout, déjà ! Et Menelik est le nom de deux empereurs éthiopiens : africanophilie, tiers-mondisme… Dès 1994, la famille se rend compte que le prénom « Gorbi » a cessé d’être portable, et l’enfant est désormais désigné par son troisième prénom, Menelik (p. 85-86).
[5] Ou déjà p. 156 : « Malgré le massacre de l’échangeur de Brunnthal, il y avait encore un assez grand nombre d’adeptes de l’ère du Verseau qui considéraient les extra-terrestres comme des rédempteurs. Quand on leur parlait du massacre provoqué par les extra-terrestres, ils avançaient comme excuse la taille des Saints d’or, qui entraînait nécessairement une certaine maladresse qu’ils trouvaient bien compréhensible, voire touchante. Mais la plupart des adeptes de l’ère du Verseau et des bonzes d’ouate balayaient d’un geste de la main ce massacre en faisant la réflexion suivante : selon eux, "pour des natures sensibles, la réalité crue n’était pas un argument recevable". » Belle application de la mentalité religieuse : Dans le meilleur des cas, il faut remercier Dieu pour tout ce qui nous arrive d’heureux, mais jamais lui reprocher nos malheurs ; dans le pire des cas, toute réflexion critique, tout examen objectif de la réalité est par principe invalidé, au nom de la supériorité essentielle des effusions mystiques. Ainsi l’esprit religieux, fonctionnant en vase clos, se blinde-t-il contre toute remise en question externe.
[6] Voici les repères chronologiques qu’il nous donne : les Saints d’or envahissent la Terre en juillet 2004 p. 158. On est en 2008 ou 2009 p. 175 ; départ de l’expédition militaire le 1er décembre 2010 p. 184 ; bataille contre les Saints d’or violets le 1er janvier 2011 p. 189 ; contrat avec un Saint d’or le 27 mars 2017 p. 214 ; Menelik est nommé inspecteur des murs le 1er décembre 2019 p. 227 ; rencontre avec Mara en 2023 p. 237 ; année 2030 – qui verra le retour de Mara et de Burschi, l’emprisonnement du narrateur, la guerre perdue contre les Saints d’or et l’amputation de tous les hommes – p. 243 ; déportation hors de Grand-Menzing en novembre 2036 p. 283 ; installation dans une réserve à la mi-décembre 2036 p. 287 ; fin p. 316. La période allant de 2037 à 2081 (presque la moitié de la vie du narrateur !) est donc expédiée en moins de trente pages. La fin n’est pas très cohérente : la tante Jessica meurt p. 313, et il semble que Menelik se mette à écrire aussitôt après, activité qui l’occupe « depuis quelques années » (p. 314). On peut donc supposer que la tante Jessica est morte vers 2075. Or elle est née vers 1960 ou en 1965, puisqu’elle avait « quarante ans bien sonnés » en 2003 (p. 129) et cinquante-quatre ans fin 2019 (p. 227). Il faudrait donc admettre qu’elle est morte à près de 115 ans, ou au moins 110 ??!! (Autre petite inadvertance : p. 86, il faut lire « presque deux ans », et non pas « presque un an », puisque p. 83 il est question de l’automne 1994). Qu’on ne me dise pas que ces contradictions chronologiques ont été introduites volontairement par le romancier afin de montrer que la mémoire du narrateur est floue et peu fiable : car alors il aurait fallu glisser beaucoup plus d’erreurs, et beaucoup plus voyantes.
[7] J’ai trouvé un (très médiocre) compte-rendu des Saints d’or sur un site spécialisé dans « le roman cataclysmique ». Ce n’est qu’un interminable résumé, suivi par un éloge des plus sommaires. Le style paraît à ce lecteur « foisonnant, baroque » !!! Euh…
[8] Une machine à coudre ??!! Une machine à coudre manuelle, alors, car il ne saurait y avoir d’électricité dans cette réserve où sont parqués les derniers hommes, installés dans des tentes (p. 288). Mais p. 193-194, les Saints d’or fournissent à Menelik un ordinateur avec traitement-de-texte pour qu’il puisse rédiger ses souvenirs. Un ordinateur portable ? Non, car p. 314, il a un ordinateur et un portable pour pouvoir écrire aussi dans le jardin. Et p. 193, on lui donnait aussi « du papier »… donc une imprimante ! Il faut croire que la maison que lui ont créée les Saints d’or p. 314 est équipée de prises électriques… On voit à ces petits détails peu cohérents que Rosendorfer n’a attaché que peu d’importance à la crédibilité matérielle de l’univers qu’il a imaginé, préférant se concentrer sur les attitudes humaines.
[9] Page 301, le père Jadelin en commence une, mais il est interrompu par tante Jessica.
[10] A l’avant-dernière page, il émet lui-même des doutes : « Est-ce que tout ce que je note est vrai ? Quelle est la fiabilité de ma mémoire ? Je ne peux m’appuyer sur aucun document, aucun acte authentique ni aucun autre certificat, car tout a été détruit. Je ne peux consulter quiconque, car il n’y a plus personne qui soit plus âgé que moi, le dernier des Mohicans » (p. 315).
[11] Voici le dernier paragraphe du roman, assez déconcertant : « Récemment, j’ai rêvé que Mara était revenue. Elle avait onze ans et disait qu’elle continuait à rêver le monde, que je pouvais être rassuré. Mara était âgée de plusieurs centaines d’années et elle était complètement nue. Elle portait le chapeau rouge puceron de tante Jessica. Dans mon rêve, Mara me dit qu’elle avait cessé de rêver des Saints d’or. Le monde n’est qu’une chimère argentée sortie des rêves de Mara. Je suis rassuré. » (p. 316). Cet excipit me paraît raté. Il suggère plus ou moins que tout ce qui précède n’était qu’une fantasmagorie. Or ce genre de retournement final doit être préparé en amont par de multiples indices, et surtout il doit nous permettre de retomber sur nos pieds en restaurant le monde véritable : ici, il n’y a absolument aucun monde « réel » dans lequel le narrateur puisse revenir, si tout le roman n’était que le rêve de Mara. Je comprends plutôt ces dernières lignes comme une fuite psychologique du narrateur, qui nie une réalité devenue insupportable et se réfugie dans le rêve.
[12] Intitulé Stéphanie ou la vie antérieure. Fayard a ensuite publié Suite allemande (1972) en 1993, Grand solo pour Anton (1976) en 1994, puis L’Architecte des ruines (1969) en 1996, dans une nouvelle traduction, car ce roman avait été traduit dès 1973 chez Stock sous le titre Le Bâtisseur de ruines. Ces quatre autres romans ont l’air bien intéressants. Il faudra que je les lise.
[13] Page 286 : c’est dès la fin du XXe siècle que « l’Église avait commencé à se disloquer. Celà venait du fait que l’Église […] courait deux lièvres à la fois : elle voulait se moderniser tout en maintenant une morale traditionnelle (ou ce qu’elle considérait comme telle). Les choses s’aggravèrent finalement au sujet de la sexualité (à Jean-Paul II, complètement réactionnaire, avait succédé Innocent XVI, le dernier pape […] ; il était encore plus borné que son prédécesseur). Les derniers papes et la Curie postulèrent des codes sexuels que plus personne ne prenait au sérieux et, par là, chassèrent littéralement les croyants de l’Église. Les églises protestantes, luthériennes et évangéliques, avaient pratiquement perdu toute influence avant le tournant du millénaire. À l’époque, elles avaient déjà honte ne serait-ce que de prononcer le mot Dieu ». Postulèrent est une mauvaise traduction : on ne postule pas un code. J’aurais mis « décrétèrent » ou « promulguèrent ».
[14] On relève aussi, page 150, aussitôt après la mise en quarantaine de l’Afrique pour endiguer l’expansion du sida, l’intéressant « Plan Brotmergel » : ce projet « qui, par mesure de sécurité et aussi "en vertu d’une compassion bien comprise, afin d’abréger la vie de ces populations dignes de commisération", prévoyait de couvrir l’ensemble du territoire africain d’un tapis de bombes atomiques et de retourner ensuite tout le sol du continent, fut vivement discuté, mais il échoua finalement parce que même les États-Unis ne parvenaient plus à payer leur armée (de toute façon, à cette époque, à l’O.N.U., on passait son temps à jouer aux cartes) ». Puis le narrateur passe à la suite, sans autre commentaire. Que penser de ce projet ? A priori, le lecteur droidlomiste doit être soulevé d’horreur devant la monstrueuse barbarie de ces militaires facho-ricains, projetant froidement d’éliminer un cinquième de l’humanité pour préserver leur propre sécurité. Mais dans le contexte du récit, le lecteur ne peut-il pas se dire que ce plan était l’une des rares tentatives pour enrayer l’effondrement et sauver ce qui pouvait l’être ? De quoi doit-il s’indigner : de la cruauté de ce projet, ou de ce que la gabegie générale ait empêché de l’exécuter ? Après tout, vu ce qui a suivi, on est bien forcé de conclure que rien n’aurait pu être pire que ce qui s’est passé, de telle sorte que l’anéantissement de l’Afrique – de toute façon condamnée –, à défaut de sauver l’humanité, aurait peut-être amélioré le sort de l’Europe et prolongé sa survie. L’intérêt des romans apocalyptiques est de nous montrer que les solutions extrêmes peuvent êtres salvatrices. Ils placent une civilisation dans une situation de légitime défense : tuer pour ne pas mourir.
[15] L’insistance sur le trou de la couche d’ozone et la surestimation délirante de l’épidémie de sida sont les éléments les plus datés de ce roman paru en 1992. La fixation sur le sida ne laisse pas de paraître curieuse. L’auteur imagine que les Saints d’or en sont eux-mêmes contaminés, lorsqu’ils se mettent à sectionner avec les dents une jambe à chacun des hommes encore vivants. Ils ne parviennent pas à éliminer le virus et agonisent par centaines (p. 281 et 306). « Le virus ou l’agent du sida a peut-être toujours été pour ainsi dire une abomination intergalactique et universelle » se demande Menelik ! (p. 281).
[16] Relevons aussi que le seul personnage qui parvienne à se montrer supérieur aux Saints d’or, Burschi, est une sorte de marginal, un homme de la nature plus qu’un homme de la civilisation, le dépositaire d’un savoir rural ancestral, fin connaisseur des plantes médicinales (p. 197 et 202). Et le fait qu’on le prenne pour un champignon… L’art de survivre passe par la capacité à s’intégrer dans la nature et retrouver une certaine mentalité archaïque !
10:44 Écrit par Le déclinologue dans Déclinologie, Europe, Immigration, Littérature et arts, Livres | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : herbert rosendorfer, les saints d'or, les saints d'or ou colomb découvre l'europe, extraterrestres, ovni, invasion, immigration, science-fiction, suite allemande, uchronie, lettres d'un passé chinois, apocalypse, génocide, extermination, treutlings, légitime défense, sida, new age, alternatifs, écologistes, mystique, rédempteurs, independance day, invasion extraterrestre, jean-claude capèle, anticipation, norman spinrad, christophe colomb, découverte de l'amérique, la ferme des animaux, misanthropie, 12 octobre 1492, ère du verseau, le camp des saints, gorbatchev, mentalité religieuse |  |
|  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer | |
Imprimer | |  Digg |
Digg |  |
|


