06.03.2011
LE FELD-MARÉCHAL VON BONAPARTE, de JEAN DUTOURD (revue critique)
 Le titre vient d'une rêverie uchronique : si la France n'avait pas acheté la Corse en 1768, Napoléon n'aurait pas été Français. Il se fût sans doute engagé au service de l'empereur d'Autriche, se fût forcément fait remarquer, eût obtenu des commandements d'armées et eût fini, au terme de sa carrière, par recevoir le bâton de feld-maréchal, en récompense de ses guerres victorieuses contre les Ottomans, la Russie ou la Prusse.
Le titre vient d'une rêverie uchronique : si la France n'avait pas acheté la Corse en 1768, Napoléon n'aurait pas été Français. Il se fût sans doute engagé au service de l'empereur d'Autriche, se fût forcément fait remarquer, eût obtenu des commandements d'armées et eût fini, au terme de sa carrière, par recevoir le bâton de feld-maréchal, en récompense de ses guerres victorieuses contre les Ottomans, la Russie ou la Prusse.
Mais cette fantaisie romanesque n'occupe que quelques pages dans le livre (p. 143-144, 153-155, 159, 164-168), dont le propos véritable est cerné par le sous-titre, repris de Montesquieu : « Considérations sur les causes de la grandeur des Français et de leur décadence ». Une formule dailleurs trompeuse, car Dutourd ne se penche nullement sur les causes de la grandeur de la France, qui est pour lui la donnée de base de l'histoire européenne avant 1789. Seule l'intéresse la décadence de la France, c'est-à dire sa chute consécutive à la Révolution : on voit qu'il suffit de la situer dans le temps pour l'expliquer. Le Feld-Maréchal von Bonaparte est en quelque sorte le prolongement du Vieil homme et la France, 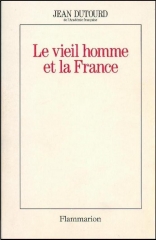 dont il reprend la forme et l'allure, mais ce second volet est très décevant, car la pensée y est consternante par son simplisme et sa fausseté, ne faisant que ruminer une hostilité absolue à la Révolution. Le ton bonhomme rend la lecture de ce livre plus plaisante que celle des Considérations sur la France du comte Joseph de Maistre, mais les deux pamphlétaires rivalisent dans l'absurdité aveugle.
dont il reprend la forme et l'allure, mais ce second volet est très décevant, car la pensée y est consternante par son simplisme et sa fausseté, ne faisant que ruminer une hostilité absolue à la Révolution. Le ton bonhomme rend la lecture de ce livre plus plaisante que celle des Considérations sur la France du comte Joseph de Maistre, mais les deux pamphlétaires rivalisent dans l'absurdité aveugle.
Certes, comme toujours chez Dutourd, moraliste digne de la grande lignée française, on trouvera des observations aigües et suggestives, comme celle-ci : « Il faut se garder de donner un nom aux choses : tant qu'elles n'en ont pas, elles n'existent pas, ou elles existent à peine ; en revanche, sitôt qu'elles sont désignées, décrites, exprimées, cataloguées, fût-ce faussement, on peut tout redouter » (p. 63). Toutefois ces aphorismes lucides appartiennent à l’observation des mœurs. Dès qu'il s'aventure dans le domaine historique ou politique, Dutourd se fourvoie complètement, non seulement dans les principes, mais même dans les faits. Par haine de la cuistrerie, il refuse d'adjoindre à son texte la moindre note en bas de page et ne donne donc jamais la référence de ses citations. Cette fausse élégance est l'alibi de la paresse, car il n'a pas fait l'effort de vérifier ce que lui fournissait sa mémoire : par exemple, il attribue à Wilde une boutade de W.C. Fields (p. 102), il date de 1767 au lieu de 1768 la vente de la Corse à la France (p.143), il croit qu'Ulysse Grant n'a fait qu'un mandat alors qu'il a été réélu en 1872 (p. 112). Il prétend étourdiment qu' « en 1919, on ne refusait rien à la France » (p. 16), comme si on l'avait laissée reprendre la rive gauche du Rhin ou remorceler l'Allemagne par une Rhénanie et une Bavière indépendantes ! Bien plus grave, il croit que Louis XVI n'aurait jamais vendu la Louisiane aux EUA, comme l'a fait Bonaparte en 1803 (p. 108) : c'est oublier que la France avait dû céder la Louisiane à l'Espagne en 1762, et que c'est le Premier Consul qui la récupéra par le traité de San Ildefonso le 1er octobre 1800 ! Et encore ne s'agit-il que de ce qu'un rapide refeuilletage m'a fait sauter aux yeux. Si on regroupait les erreurs à rectifier et les chimères à dissiper, il y aurait peut-être une vingtaine d'interventions à faire. Tout ce qui, sur le plan historico-spéculatif, tient à peu près la route, vient de Bainville. À l'inverse, toutes les considérations spécifiques à Dutourd sur les bienfaits de la monarchie sont presque toujours hautement fantaisistes. Par exemple, sa rêverie sur une « grande Louisiane française vivant côte à côte en bonne intelligence » avec l'Amérique yanquie (p. 110) relève d'un fantasme assez dérisoire : la disproportion démographique était trop énorme. Il suffit de voir comment les États-uniens se sont comportés à l'égard des régions mexicaines qu'ils guignaient : infiltrations de colons, menées subversives, soutien à un parti sécessionniste, absorption de l'état fantoche (Texas), et guerre en bonne et due forme pour les autres, débouchant sur l'annexion (Arizona, Colorado, Californie, Nevada, Nouveau-Mexique, Utah). On ne voit pas pourquoi il en eût été différemment pour une Louisiane française. (Quant à un éventuel soutien militaire de la métropole, il eût sans doute connu, à la fin, le même sort que les autres guerres coloniales.)
Les considérations dutourdiennes tournent entièrement autour de deux idées : a) Tous nos malheurs viennent de la Révolution Française ; b) Il s'en est fallu d'un cheveu que celle-ci n'éclatât pas. Bref, le plus puissant royaume du monde s'est effondré par la seule faute d'un grain de sable dans l'urètre de Cromwell, ah non, à cause de l'incompréhensible apathie de Louis XVI (p. 60), ou de la chaleur de juillet 1789 à Paris, ou du regard perçant du maître de poste de Sainte-Menehould (p. 86), etc.
Il est regrettable que Dutourd n'ait pas médité cette forte pensée de son modèle déclaré (chap. 18 des Considérations de Montesquieu) : 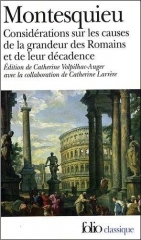 « Ce n’est pas la Fortune qui domine le monde. On peut le demander aux Romains, qui eurent une suite continuelle de prospérités quand ils se gouvernèrent sur un certain plan, et une suite non interrompue de revers lorsqu’ils se conduisirent sur un autre. Il y a des causes générales, soit morales, soit physiques, qui agissent dans chaque monarchie, l’élèvent, la maintiennent, ou la précipitent ; tous les accidents sont soumis à ces causes, et, si le hasard d’une bataille, c’est-à-dire une cause particulière, a ruiné un État, il y avait une cause générale qui faisait que cet État devait périr par une seule bataille. En un mot, l’allure principale entraîne avec elle tous les accidents particuliers. » Mais non, tournant le dos à Montesquieu (et à Thucydide et Polybe avant lui), Dutourd préfère adopter résolument la philosophie de l'Histoire de Pascal, ce maître d'erreurs qui n'a jamais rien entendu à l'Histoire : « Le nez de Cléopâtre est la seule explication du monde. Tout tient toujours à un quart de millimètre de chair au milieu du visage. Il n'y a pas d'autre philosophie de l'Histoire que celle exprimée par Pascal dans une pensée de deux lignes » (p. 86). Du coup, n'importe quoi peut arriver n'importe quand, et si les Français ont été longtemps glorieux, ils n'en ont aucune vanité à tirer, puisque c'est le seul hasard qui leur a fait tirer quelques bons numéros à la loterie des siècles...
« Ce n’est pas la Fortune qui domine le monde. On peut le demander aux Romains, qui eurent une suite continuelle de prospérités quand ils se gouvernèrent sur un certain plan, et une suite non interrompue de revers lorsqu’ils se conduisirent sur un autre. Il y a des causes générales, soit morales, soit physiques, qui agissent dans chaque monarchie, l’élèvent, la maintiennent, ou la précipitent ; tous les accidents sont soumis à ces causes, et, si le hasard d’une bataille, c’est-à-dire une cause particulière, a ruiné un État, il y avait une cause générale qui faisait que cet État devait périr par une seule bataille. En un mot, l’allure principale entraîne avec elle tous les accidents particuliers. » Mais non, tournant le dos à Montesquieu (et à Thucydide et Polybe avant lui), Dutourd préfère adopter résolument la philosophie de l'Histoire de Pascal, ce maître d'erreurs qui n'a jamais rien entendu à l'Histoire : « Le nez de Cléopâtre est la seule explication du monde. Tout tient toujours à un quart de millimètre de chair au milieu du visage. Il n'y a pas d'autre philosophie de l'Histoire que celle exprimée par Pascal dans une pensée de deux lignes » (p. 86). Du coup, n'importe quoi peut arriver n'importe quand, et si les Français ont été longtemps glorieux, ils n'en ont aucune vanité à tirer, puisque c'est le seul hasard qui leur a fait tirer quelques bons numéros à la loterie des siècles...
Croire que tous nos malheurs procèdent de la Révolution est un manichéisme si désolant qu'il décourage la polémique. Croire que la Révolution est un accident absolu, surgi de nulle part plutôt que préparé par des décennies d'Ancien régime, relève soit de l'ignorance soit de la bêtise. Dutourd sait pourtant que Tocqueville a démontré la continuité entre l'Ancien Régime et la Révolution, mais il lui reproche de n'en avoir pas tiré la conclusion que la Révolution était inutile (p. 62-63). Que n'en a-t-il tiré lui-même la conclusion que la Révolution n'était pas un pur accident !
Toute réflexion sur le bilan de la Révolution française est nulle et non avenue si elle ne se fonde pas sur une comparaison avec la grande sœur ennemie de la France, l'Angleterre. Mesurer le mal que la Révolution a fait à la France n'a de sens que si on mesure parallèlement le bien que l'Angleterre a tiré de son autre façon d'accéder à la modernité. Manière de poser le problème qui, du reste, dévoile déjà une partie de la solution : 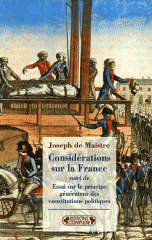 l'Angleterre n'a-t-elle pris qu'un autre chemin pour arriver au même but que nous, ou bien s'est-elle déportée vers une destinée si éloignée de la nôtre qu'elle nous est devenue complètement étrangère ? La réponse est dans la question... Aux petits maistro-maurrassiens actuels qui continuent de croire que la France se porterait infiniment mieux si le descendant de Louis XVI était toujours sur le trône, il faut sans relâche poser la même question : croyez-vous vraiment que la prospérité soit tellement plus enviable, la société tellement plus vivable, les mœurs tellement plus estimables, l'air tellement plus respirable, l'État tellement plus formidable, la créativité tellement plus admirable, dans cette Grande-Bretagne où règne toujours la descendante de George III ? L'avantage de ce pays qui a fait le choix que nous aurions dû faire selon eux est-il à ce point écrasant ? Et avant même de porter un jugement de valeur, qu'en est-il simplement de la différence entre la France républicaine et la Grande-Bretagne monarchiste, deux siècles après la Révolution ? Compte tenu des spécificités culturelles antérieures des deux nations, le maintien de la monarchie a-t-il, depuis deux siècles, donné aux Anglais un visage radicalement autre que celui que la République nous a modelé ?
l'Angleterre n'a-t-elle pris qu'un autre chemin pour arriver au même but que nous, ou bien s'est-elle déportée vers une destinée si éloignée de la nôtre qu'elle nous est devenue complètement étrangère ? La réponse est dans la question... Aux petits maistro-maurrassiens actuels qui continuent de croire que la France se porterait infiniment mieux si le descendant de Louis XVI était toujours sur le trône, il faut sans relâche poser la même question : croyez-vous vraiment que la prospérité soit tellement plus enviable, la société tellement plus vivable, les mœurs tellement plus estimables, l'air tellement plus respirable, l'État tellement plus formidable, la créativité tellement plus admirable, dans cette Grande-Bretagne où règne toujours la descendante de George III ? L'avantage de ce pays qui a fait le choix que nous aurions dû faire selon eux est-il à ce point écrasant ? Et avant même de porter un jugement de valeur, qu'en est-il simplement de la différence entre la France républicaine et la Grande-Bretagne monarchiste, deux siècles après la Révolution ? Compte tenu des spécificités culturelles antérieures des deux nations, le maintien de la monarchie a-t-il, depuis deux siècles, donné aux Anglais un visage radicalement autre que celui que la République nous a modelé ?
Je suis loin de porter un jugement globalement positif sur la Révolution, et à vrai dire je pense aussi que la France eût beaucoup gagné à l'éviter. Mais lui attribuer TOUS nos malheurs, et surévaluer de façon délirante ses conséquences, est tout simplement ridicule. Quoique sa lecture soit divertissante et même stimulante, ce livre montre qu'une thèse pertinente peut être sabotée par de mauvais arguments.
Dutourd est avant tout un esprit littéraire, au bon et au mauvais sens du terme. C'est un contemporain de La Bruyère, de Diderot, de Stendhal, de Flaubert, de France, de Gide. Cela confère à ses livres de moraliste non seulement un grand charme, mais aussi une grande valeur, car c'est un cadeau exceptionnel de la Providence d'avoir fait vivre un esprit aussi caduc parmi nos contemporains : en ouvrant ses livres de chroniques ou de critique littéraire, on peut se faire une idée de ce que les susnommés auraient pensé des évènements et des œuvres de notre temps, délectable anachronisme. Mais, presque toujours, la grande faille de l'esprit littéraire est de ne pas percevoir la large soumission de l'esprit à la matière, c'est-à-dire le poids de l'économie et de la technique dans la marche de l'Histoire. On ne peut guère exiger d'un esprit littéraire qu'il soit aussi imprégné de Fernand Braudel et de Lewis Mumford. Le Feld-Maréchal von Bonaparte en est une magnifique illustration : son auteur croit très sérieusement que la face de la terre eût été radicalement changée sans la Révolution française, comme si le monde actuel résultait plus de celle-ci que de la révolution industrielle, comme si l'empire du capitalisme et de la société de consommation n'était pas assez prégnant pour pouvoir échapper aux institutions politiques d'un pays parmi d'autres. Plus grave, ou plus comique : il va jusqu'à s'imaginer qu' « une France bourbonienne eût sensiblement retardé le progrès des sciences et des techniques » (p. 135). Parce que, bien sûr, dans l'Angleterre des Hanovre et des Saxe-Cobourg, comme dans l'Allemagne des Hohenzollern, le progrès a été incomparablement plus lent que dans la France républicaine... N'est-ce pas pourtant la Révolution qui a guillotiné Lavoisier, arguant qu'elle n'avait pas besoin de savants ?
PS : La présentation du revers de couverture est d'une gigantesque prétention : « C'est le livre le plus incorrect politiquement qui ait été publié depuis deux siècles. Il va à l'encontre de tout ce qui est posé en principe et enseigné tant en France qu'ailleurs. L'auteur passera pour un fou ou un assassin d'idées admises, ce qui est toujours agréable pour un homme de lettres, même si sa marchandise est boïcottée par les bien-pensants ». J'ai trop de sympathie envers Dutourd pour m'appesantir sur cette forfanterie sénile.
Jean Dutourd : Le Feld-Maréchal von Bonaparte, Flammarion, 1996.
09:14 Écrit par Le déclinologue dans Déclinologie, France, Histoire, Littérature et arts, Livres, Réaction nationaliste | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : jean dutourd, france, uchronie, révolution française, oscar wilde, états-unis, romains, thucydide, polybe, ancien régime, wc fields, ulysse grant, louisiane, napoléon, monarchie, joseph de maistre, louis xvi, république, lewis mumford, maurras, bainville, montesquieu, tocqueville, nez de cléopâtre, 14 juillet 1789, autriche, grande-bretagne, angleterre, le feld-maréchal von bonaparte, corse, anachronisme, progrès, décadence, fernand braudel, blaise pascal |  |
|  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer | |
Imprimer | |  Digg |
Digg |  |
|


