01.10.2013
APOLLINAIRE EST À NOUS ! (avec florilège de 12 poèmes peu connus)
La Grande Guerre nous a privés de jeunes écrivains en devenir : Alain-Fournier, Louis Pergaud, Ernest Psichari, Paul Lintier, bien d’autres oubliés, mais aussi d’écrivains confirmés, fauchés au mitan de leur vie, alors qu’ils avaient encore un avenir riche et fécond devant eux. Les premiers qui viennent à l’esprit sont évidemment Charles Péguy, mort à 41 ans en septembre 1914, et Guillaume Apollinaire, mort à 38 ans en novembre 1918. On pense rarement à quel point l’histoire générale, donc l’histoire littéraire, auraient été changées si certains acteurs majeurs n’avaient pas été éliminés prématurément. Par exemple si on fait vivre Apollinaire 76 ans et 4 mois comme Jules Supervielle (1884-1960), celà le fait mourir à la toute fin de 1956, peu après que Gary eut obtenu le Goncourt pour Les Racines du ciel. Et si on lui accorde 88 ans et 3 mois comme Paul Fort (1872-1960), Apollinaire ne serait mort qu’en novembre 1968 ! Imagine-t-on le vieux poète de « Mai » (« Le mai le joli mai en barque sur le Rhin / Des dames regardaient du haut de la montagne / Vous êtes si jolies mais la barque s'éloigne / Qui donc a fait pleurer les saules riverains »…) rimer quelques derniers vers sur l’explosion de mai 68 ? Celà n’a rien d’extravagant : parmi les contemporains et grands amis d’Apollinaire, il y a Pablo Picasso, né seulement un an après lui (octobre 1881), mort… en avril 1973, et resté productif jusqu’au bout. (D’ailleurs Annie Playden, la gouvernante anglaise qui inspira quelques poèmes d’Alcools, notamment « La Chanson du mal-aimé », était née comme lui en 1880, et ne mourut qu’en 1967. Quand on la retrouva en Californie en 1947, elle ignorait tout de ce qu’était devenu ce « Kostro » qu’elle avait fréquenté entre 1901 et 1904). On peut rêver à ce qu'eût pu produire, s'il lui avait été donné une quarantaine d'années de plus, celui dont la dernière phrase aurait été (selon une tradition peut-être embellie) : « Sauvez-moi, docteur, je veux vivre ! J'ai encore tant de choses à faire… ». Parmi ces choses qu'il aurait faites, sans doute de nombreux romans, plusieurs pièces de théâtre, qui sait une autobiographie, et pourquoi pas du cinéma. Et l'aventure de la paternité, qui eût renouvelé son inspiration. Prolifique et touche-à-tout, il avait de quoi devenir une sorte de Picasso de la littérature. Cet avenir virtuel manque à tout jamais aux lettres françaises, et on aime à se le figurer en composant un mélange original de Cendrars, Cocteau et Aragon. Son attirance un peu gobe-mouches pour tout ce qui est nouveau (ses amis André Billy et André Salmon lui reprochaient de se fourvoyer dans l'avant-garde) lui eût fait regarder avec beaucoup de bienveillance les surréalistes, mais ennemi de tout dogmatisme, il eût fini par s'agacer de ces disciples sectaires et tapageurs. On l'imagine volontiers revenir à une forme plus classique et une veine plus traditionnelle, proclamer comme Gide ou Claudel sa pleine confiance dans le Maréchal Pétain en juin 1940, non sans protéger ensuite son ami juif Max Jacob, se faire élire Académicien mais tenter un "nouveau roman" à sa façon, entonner une ode à de Gaulle tout en saluant les jeunes loups de la revue Tel Quel. Mais n'oublions pas que celui dont on parle passait à sa mort pour rien de moins que le chef de file des jeunes écrivains modernes. Supposer qu'il vécût la période suivante de la littérature française, ce n'est donc pas l'ajouter à celle-ci, mais modifier nécessairement celle-ci. Si Apollinaire n'avait pas brusquement désencombré l'horizon, André Breton ne se fût sans doute pas imposé de la même manière, et le surréalisme eût pris une autre couleur. On peut aussi imaginer qu'Alfred Vallette lui eût passé les commandes du Mercure de France, qui fût restée la revue dominante du monde littéraire : la N.R.F. de Rivière et Paulhan n'aurait pas eu la même hégémonie, peut-être même n'eût-elle été que la brillante seconde de son aînée. On voit que bien des uchronies sont possibles, à la mesure de l'importance d'un tel auteur.
On pense rarement à quel point l’histoire générale, donc l’histoire littéraire, auraient été changées si certains acteurs majeurs n’avaient pas été éliminés prématurément. Par exemple si on fait vivre Apollinaire 76 ans et 4 mois comme Jules Supervielle (1884-1960), celà le fait mourir à la toute fin de 1956, peu après que Gary eut obtenu le Goncourt pour Les Racines du ciel. Et si on lui accorde 88 ans et 3 mois comme Paul Fort (1872-1960), Apollinaire ne serait mort qu’en novembre 1968 ! Imagine-t-on le vieux poète de « Mai » (« Le mai le joli mai en barque sur le Rhin / Des dames regardaient du haut de la montagne / Vous êtes si jolies mais la barque s'éloigne / Qui donc a fait pleurer les saules riverains »…) rimer quelques derniers vers sur l’explosion de mai 68 ? Celà n’a rien d’extravagant : parmi les contemporains et grands amis d’Apollinaire, il y a Pablo Picasso, né seulement un an après lui (octobre 1881), mort… en avril 1973, et resté productif jusqu’au bout. (D’ailleurs Annie Playden, la gouvernante anglaise qui inspira quelques poèmes d’Alcools, notamment « La Chanson du mal-aimé », était née comme lui en 1880, et ne mourut qu’en 1967. Quand on la retrouva en Californie en 1947, elle ignorait tout de ce qu’était devenu ce « Kostro » qu’elle avait fréquenté entre 1901 et 1904). On peut rêver à ce qu'eût pu produire, s'il lui avait été donné une quarantaine d'années de plus, celui dont la dernière phrase aurait été (selon une tradition peut-être embellie) : « Sauvez-moi, docteur, je veux vivre ! J'ai encore tant de choses à faire… ». Parmi ces choses qu'il aurait faites, sans doute de nombreux romans, plusieurs pièces de théâtre, qui sait une autobiographie, et pourquoi pas du cinéma. Et l'aventure de la paternité, qui eût renouvelé son inspiration. Prolifique et touche-à-tout, il avait de quoi devenir une sorte de Picasso de la littérature. Cet avenir virtuel manque à tout jamais aux lettres françaises, et on aime à se le figurer en composant un mélange original de Cendrars, Cocteau et Aragon. Son attirance un peu gobe-mouches pour tout ce qui est nouveau (ses amis André Billy et André Salmon lui reprochaient de se fourvoyer dans l'avant-garde) lui eût fait regarder avec beaucoup de bienveillance les surréalistes, mais ennemi de tout dogmatisme, il eût fini par s'agacer de ces disciples sectaires et tapageurs. On l'imagine volontiers revenir à une forme plus classique et une veine plus traditionnelle, proclamer comme Gide ou Claudel sa pleine confiance dans le Maréchal Pétain en juin 1940, non sans protéger ensuite son ami juif Max Jacob, se faire élire Académicien mais tenter un "nouveau roman" à sa façon, entonner une ode à de Gaulle tout en saluant les jeunes loups de la revue Tel Quel. Mais n'oublions pas que celui dont on parle passait à sa mort pour rien de moins que le chef de file des jeunes écrivains modernes. Supposer qu'il vécût la période suivante de la littérature française, ce n'est donc pas l'ajouter à celle-ci, mais modifier nécessairement celle-ci. Si Apollinaire n'avait pas brusquement désencombré l'horizon, André Breton ne se fût sans doute pas imposé de la même manière, et le surréalisme eût pris une autre couleur. On peut aussi imaginer qu'Alfred Vallette lui eût passé les commandes du Mercure de France, qui fût restée la revue dominante du monde littéraire : la N.R.F. de Rivière et Paulhan n'aurait pas eu la même hégémonie, peut-être même n'eût-elle été que la brillante seconde de son aînée. On voit que bien des uchronies sont possibles, à la mesure de l'importance d'un tel auteur.
Le poète du « Pont Mirabeau » [1] reste à découvrir.  Son œuvre est d’une étonnante diversité. Sa plume facile a eu le temps de produire quatre Pléiades : une de poésie et trois de prose (comme Péguy). Son œuvre en prose comprend romans, nouvelles, pièces de théâtre, chroniques et échos, essais et articles sur l’art, sur la littérature générale, sur la littérature érotique, vaste ensemble auquel il faut ajouter plusieurs tomes de correspondance. C'est surtout à sa poésie, et notamment au recueil Alcools (1913), qu’il doit sa gloire. Celà est fort réducteur, et peut-être dû au fait qu’environ les deux tiers de sa production poétique sont posthumes, rassemblés dans des recueils un peu hétéroclites (parmi lesquels je recommande prioritairement les Poèmes à Lou), mais l’hétérogénéité est justement l’une des marques de sa poétique. Cependant il ne donne presque jamais dans l'hermétisme qui est si souvent la norme depuis Mallarmé et les surréalistes : c'est plutôt dans le prosaïsme qu'il s'égare, surtout quand il se laisse séduire par la trivialité du vers libre. Sa poésie, variée de tons et plus encore de formes, contient évidemment beaucoup de déchet – ce qui est la règle chez tous les poètes –, mais aussi des pépites parfois étonnantes. Cette variété est à l’image de l’homme, qui était « pluriel », comme on aime à dire aujourdhui : libertin érotomane et amoureux passionné, rat de bibliothèque et marcheur infatigable, moderniste ouvert à toutes les nouveautés et amateur de vieilleries et de mots archaïques, héritier de la tradition lyrique française et propagateur du cubisme, de l’art nègre et du surréalisme (c’est lui qui invente le mot), âme automnale portée à la mélancolie doublée d’une âme dionysiaque prompte à toutes les exaltations, zélateur de la Rome des Borgia et du pape Pie X, tourné vers son Italie natale et vers la Rhénanie, de physique lourdaud et d’esprit délié… aucun contraste ne lui faisait peur. Je me souviendrai longtemps de cette coruscante définition que j’entendis de la bouche de Pierre Cahné, professeur à la Sorbonne, lors d’une conférence sur Alcools : « Il y a chez Apollinaire un côté élégiaque et un côté pétomane ». À vrai dire, je m’en doutais un peu : quelques années plus tôt, alors que nous étudiions Alcools en classe de 1ère, j’enchaînai par la lecture de son autre grand recueil anthume, Calligrammes (dont le titre est trompeur car, heureusement, il ne contient que fort peu de ces vains amusements graphiques), et je fus sidéré de découvrir, au milieu d’un poème de guerre intitulé « Du coton dans les oreilles », cette formule soigneusement encadrée au milieu de la page par un double rectangle de gros points : « LES CÉNOBITES TRANQUILLES » (Pléiade, Œuvres poétiques, p. 288). Mes camarades et moi en fîmes des gorges chaudes, à la fois consternés et fascinés qu’un grand auteur du Lagarde-et-Michard et de la Pléiade pût se livrer à des facéties plus dignes de nous que de lui. Je ne suis pas sûr que les lycéens d’aujourdhui seraient sensibles à ce contraste, ni qu’il les sortirait de leur torpeur intellectuelle.
Son œuvre est d’une étonnante diversité. Sa plume facile a eu le temps de produire quatre Pléiades : une de poésie et trois de prose (comme Péguy). Son œuvre en prose comprend romans, nouvelles, pièces de théâtre, chroniques et échos, essais et articles sur l’art, sur la littérature générale, sur la littérature érotique, vaste ensemble auquel il faut ajouter plusieurs tomes de correspondance. C'est surtout à sa poésie, et notamment au recueil Alcools (1913), qu’il doit sa gloire. Celà est fort réducteur, et peut-être dû au fait qu’environ les deux tiers de sa production poétique sont posthumes, rassemblés dans des recueils un peu hétéroclites (parmi lesquels je recommande prioritairement les Poèmes à Lou), mais l’hétérogénéité est justement l’une des marques de sa poétique. Cependant il ne donne presque jamais dans l'hermétisme qui est si souvent la norme depuis Mallarmé et les surréalistes : c'est plutôt dans le prosaïsme qu'il s'égare, surtout quand il se laisse séduire par la trivialité du vers libre. Sa poésie, variée de tons et plus encore de formes, contient évidemment beaucoup de déchet – ce qui est la règle chez tous les poètes –, mais aussi des pépites parfois étonnantes. Cette variété est à l’image de l’homme, qui était « pluriel », comme on aime à dire aujourdhui : libertin érotomane et amoureux passionné, rat de bibliothèque et marcheur infatigable, moderniste ouvert à toutes les nouveautés et amateur de vieilleries et de mots archaïques, héritier de la tradition lyrique française et propagateur du cubisme, de l’art nègre et du surréalisme (c’est lui qui invente le mot), âme automnale portée à la mélancolie doublée d’une âme dionysiaque prompte à toutes les exaltations, zélateur de la Rome des Borgia et du pape Pie X, tourné vers son Italie natale et vers la Rhénanie, de physique lourdaud et d’esprit délié… aucun contraste ne lui faisait peur. Je me souviendrai longtemps de cette coruscante définition que j’entendis de la bouche de Pierre Cahné, professeur à la Sorbonne, lors d’une conférence sur Alcools : « Il y a chez Apollinaire un côté élégiaque et un côté pétomane ». À vrai dire, je m’en doutais un peu : quelques années plus tôt, alors que nous étudiions Alcools en classe de 1ère, j’enchaînai par la lecture de son autre grand recueil anthume, Calligrammes (dont le titre est trompeur car, heureusement, il ne contient que fort peu de ces vains amusements graphiques), et je fus sidéré de découvrir, au milieu d’un poème de guerre intitulé « Du coton dans les oreilles », cette formule soigneusement encadrée au milieu de la page par un double rectangle de gros points : « LES CÉNOBITES TRANQUILLES » (Pléiade, Œuvres poétiques, p. 288). Mes camarades et moi en fîmes des gorges chaudes, à la fois consternés et fascinés qu’un grand auteur du Lagarde-et-Michard et de la Pléiade pût se livrer à des facéties plus dignes de nous que de lui. Je ne suis pas sûr que les lycéens d’aujourdhui seraient sensibles à ce contraste, ni qu’il les sortirait de leur torpeur intellectuelle.
Parmi les multiples facettes d’Apollinaire, celle du patriote n’est pas la plus connue, mais pas la moins intéressante. Qu'on relise en particulier sa conférence de novembre 1917 sur L'Esprit nouveau et les poètes. On constatera que, bien qu'il fût assez critique envers les futuristes italiens et que les surréalistes le revendiquassent comme un de leurs maîtres (voir par exemple le chapitre qui lui est consacré dans Les Pas perdus d'André Breton), il était à maints égards plus proche des premiers que des seconds. En effet, cette conférence paraît annoncer un admirateur de Mussolini plutôt que de Staline. Tout au long de ces douze pages (Pléiade, Œuvres en prose complètes, tome II, p. 943-954) courent une glorification immodérée de la France, aux accents hugoliens, une justification du caractère national de l'art et une apologie de l'esprit classique français, fait d'ordre et de devoir. Je voulais en donner quelques citations, mais j'aurais eu du mal à me limiter, et cet article en eût été exagérément gonflé. Je vais plutôt les publier à part dans une prochaine note. Quand Apollinaire prend ses distances avec les futuristes (en particulier dans deux chroniques de février 1912, p. 406-412), on a l'impression d'avoir affaire à une querelle nationaliste : choisissant sa patrie d'adoption contre sa patrie natale, il n'a de cesse que de rabaisser les artistes italiens, en montrant que les artistes français sont à la fois meilleurs, plus précoces et plus avisés.
Ce nationalisme s'est bien sûr exacerbé pendant la Grande guerre : il serait facile, en parcourant les nombreuses chroniques journalistiques publiées alors, d'y relever tous les sarcasmes germanophobes. Mais l'objet de cet article n'est pas d'inventorier les manifestations du patriotisme d'Apollinaire. Je préfère me limiter à trois d'entre elles, antérieures à la guerre, qui me plaisent particulièrement. La première est une phrase glissée dans un article sur le Salon des artistes français : « L'anglomanie, qui est une des folies artistiques de ce temps, se manifeste ici avec plus de timidité que partout ailleurs […] » (L'Intransigeant, 30 avril 1910 ; Pléiade, Œuvres en prose complètes, tome II, p. 187) [2]. L'anglomanie vue comme une folie, quel réconfortant diagnostic ! La deuxième est une chronique du Mercure de France, 16 mai 1914, « Le langage français espagnolisé » (Pléiade, Œuvres en prose complètes, tome III, p. 197-203), où Apollinaire cite copieusement des articles récents sur la corrida, farcis de termes espagnols, afin de se moquer de « la manie de travestir le français en espagnol », après s'être réclamé d'Henri Estienne qui le faisait en 1578 pour le français travesti en italien (et comme Étiemble le fera pour le franglais) : « Remarquez que la plupart des termes espagnols employés dans ces articles pourraient être remplacés par des termes français correspondants. Le paso-doble ne serait-il pas un pas redoublé et ne serait-il pas plus clair de dire l'après-midi au lieu de la tarde ? ». Une leçon utile, à l'heure où le français s'anglicise de plus en plus. Le troisième exemple n'est pas moins actuel que les deux précédents. Un article dans L'Intransigeant du 5 avril 1911, « La Sorbonne est ébranlée » (Pléiade, Œuvres en prose complètes, tome II, p. 1204-1205) rend compte du livre d'Agathon, L'Esprit de la nouvelle Sorbonne. (Il s'agit du pseudonyme d'Henri Massis et Alfred de Tarde, deux maurrassiens dont le livre suivant, Les Jeunes gens d'aujourdhui, aura en 1913 une grande répercussion). Emboîtant le pas à ce pamphlet, Apollinaire s'élève contre une certaine technicisation du savoir, provenant d'Allemagne, qui lui paraît funeste pour la culture. Et voici la fin de ce texte : « Abandonner le grec, le latin, le français même, au profit d'une science illusoire et mesquine, d'un langage hybride sans nerf et sans vertu, aussi plat que la prose dont on se sert dans les autres nations, c'est à celà que l'on pousse les jeunes générations. Qu'on ne s'y trompe point, il ne faudrait pas vingt ans de cette pédagogie pour que la France perdît tout le bénéfice d'une culture générale patiemment acquise et qui lui donne une place à part parmi les nations modernes, comme l'héritière de l'eurythmie que connut la Grèce antique. / Qu'on se tourne délibérément vers l'hellénisme ! Qu'on réapprenne passionnément dans les exemplaires grecs le sens de la beauté que l'on avait oublié, les savants et les marchands ne manqueront pas plus à la France qu'ils ne manquèrent, en Grèce, pendant l'Antiquité, et les soldats naîtront ici d'eux-mêmes pour défendre une terre d'élection ». Certes il y a là beaucoup d'idéalisme, mais cet appel au retour à la Grèce antique est bien remarquable de la part de celui qui lancera au début de « Zone », par provocation : « Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine ». L'Apollinaire jeune moderniste n'est certes pas un mythe, mais il convient de le remettre à sa juste place en le confrontant à l'Apollinaire vieux réac.
Comme on le voit, cet homme né à Rome, fils d’une pute de luxe mi-polono-russe mi-italienne et d’un père inconnu (sans doute un officier italien), sous le nom de Wilhelm Albert Włodzimierz Aleksander Apolinary Kostrowicki (ou Guglielmo Alberto Wladimiro Alessandro Apollinare de Kostrowitzky) est un modèle d’assimilation. Alors que tant d’immigrés se font gloire de garder tel quel leur nom étranger (sous prétexte de fidélité à leurs racines, quel refus d’assimilation proclamé !), lui francisa deux de ses prénoms pour se forger une magnifique appellation française. Alors que tant d’immigrés, plus soucieux de droits que de devoirs, ne demandent la naturalisation que pour obtenir les avantages qui vont avec, lui la gagna par l’engagement militaire avant de la justifier par le sang versé.  Dès août 1914 il demanda à s’engager dans l’armée ; repoussé comme étranger, il renouvela sa demande en novembre 1914, fut accepté et se retrouva sur le front de Champagne en avril 1915. Devenu officier, il sera blessé à la tête par un éclat d’obus en mars 1916, ce qui lui vaudra une citation à l’ordre du régiment, comportant l’attribution de la croix de guerre. L’année d’après, il fera jouer Les Mamelles de Tirésias, sorte de farce aristophanesque et surréaliste qui se veut un plaidoyer burlesque en faveur de la natalité et la repopulation du pays [3]. À sa mort, il est mis en bière dans son uniforme de lieutenant, et les honneurs militaires lui sont rendus de Saint-Thomas-d'Aquin au Père-Lachaise, devant sa mère qui porte son képi à deux galons comme le saint-sacrement. Une historienne spécialiste de la première guerre mondiale, Annette Becker, a consacré un livre à ce combattant à la fois banal et exceptionnel : Apollinaire. Une biographie de guerre, 1914-1918, Tallandier, 2009, dont on lira un aperçu ici.
Dès août 1914 il demanda à s’engager dans l’armée ; repoussé comme étranger, il renouvela sa demande en novembre 1914, fut accepté et se retrouva sur le front de Champagne en avril 1915. Devenu officier, il sera blessé à la tête par un éclat d’obus en mars 1916, ce qui lui vaudra une citation à l’ordre du régiment, comportant l’attribution de la croix de guerre. L’année d’après, il fera jouer Les Mamelles de Tirésias, sorte de farce aristophanesque et surréaliste qui se veut un plaidoyer burlesque en faveur de la natalité et la repopulation du pays [3]. À sa mort, il est mis en bière dans son uniforme de lieutenant, et les honneurs militaires lui sont rendus de Saint-Thomas-d'Aquin au Père-Lachaise, devant sa mère qui porte son képi à deux galons comme le saint-sacrement. Une historienne spécialiste de la première guerre mondiale, Annette Becker, a consacré un livre à ce combattant à la fois banal et exceptionnel : Apollinaire. Une biographie de guerre, 1914-1918, Tallandier, 2009, dont on lira un aperçu ici.
Chose incroyable, Apollinaire a glorifié la guerre dans nombre de ses poèmes recueillis dans les Calligrammes et les Poèmes à Lou. Eh oui, à côté du mal-aimé verlainien, du nouvelliste de L'Hérésiarque et Cie qui manqua de peu le prix Goncourt, du bibliophile spécialiste du "second rayon", du pornographe des Onze mille verges, du journaliste échotier de La Vie anecdotique, inlassable collecteur de petits faits pittoresques, du critique d'art amant de Marie Laurencin et ami du douanier Rousseau qui rendait compte de tous les salons de peinture, du héraut de « l'esprit nouveau » qui passe le relais du futurisme à André Breton, – il y a un Déroulède des tranchées ! On a souvent occulté ou nié cette dimension belliciste pour d’évidentes raisons politiques et morales, mais les textes sont là. Une soixantaine de poèmes évoque la vie du front sans jamais la rabaisser ni la détester, et bien souvent en l’exaltant avec ferveur. Lyrisme amoureux et lyrisme guerrier se mêlent pour composer une étonnante ode à la vie et à la beauté du monde, où même la blessure est célébrée comme une merveille mythologique. On a été tellement habitué par Barbusse, Dorgelès, Duhamel, Céline et quelques autres à associer la guerre de 14-18 avec des images sordides de boue, de crasse, d’enlisement, d’ennui, de gémissements, de cauchemar, – qu’on est tout étonné de voir un poète moderne chanter la splendeur du ciel illuminé par les obus et la joie du combattant soulevée par la bataille. Curiosité, fascination, admiration, émerveillement, enthousiasme, nostalgie du front chez les blessés de l'arrière : autant de mots qu'une vision réductrice et idéologique nous amène à opposer aveuglément, donc faussement, à la rude vie du poilu. Apollinaire, ce moderne qui lisait régulièrement L'Action française, nous aide à retrouver une vision plus complexe et plus nuancée du grand opéra guerrier[4].
Voici par exemple quelques extraits de poèmes, tous tirés du recueil Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916) :
« L’Amour dit Reste ici Mais là-bas les obus
Épousent ardemment et sans cesse les buts
J’attends que le printemps commande que s’en aille
Vers le nord glorieux l’intrépide bleusaille » (« À Nîmes », Pléiade, Œuvres poétiques, p. 211)
« Le ciel est étoilé par les obus des Boches
La forêt merveilleuse où je vis donne un bal
La mitrailleuse joue un air à triples-croches
Mais avez-vous le mot
Eh ! oui le mot fatal
Aux créneaux Aux créneaux Laissez là les pioches » (« La nuit d’avril 1915 », p. 243)
« Tandis que nous n’y sommes pas
Que de filles deviennent belles
Voici l’hiver et pas à pas
Leur beauté s’éloignera d’elles
Ô Lueurs soudaines des tirs
Cette beauté que j’imagine
Faute d’avoir des souvenirs
Tire de vous son origine
Car elle n’est rien que l’ardeur
De la bataille violente
Et de la terrible lueur
Il s’est fait une muse ardente » (« Chant de l’horizon en Champagne », p. 267)
« Ô poètes des temps à venir ô chanteurs
Je chante la beauté de toutes nos douleurs
J’en ai saisi des traits mais vous saurez bien mieux
Donner un sens sublime aux gestes glorieux
Et fixer la grandeur de ces trépas pieux » (« Chant de l’honneur », p. 306)
 Apollinaire a été déclaré officiellement « mort pour la France ». En vérité, il a été emporté par la grippe espagnole le 9 novembre 1918, mais on a considéré que cette mort résultait de son affaiblissement dû à ses blessures de guerre. Cette décision a eu de grandes conséquences pour la destinée de son œuvre, car elle a presque doublé la durée légale du droit d’auteur accordé à ses héritiers : aux 50 ans normaux se sont ajoutées une prime de 30 ans plus la durée intégrale des guerres mondiales traversées, la seconde et aussi la première (mais s’il était mort trois jours plus tard, le 12 novembre ?). Des guerres mondiales qui sont dailleurs curieusement allongées : 6 ans et 5 mois pour la première, 8 ans et 4 mois pour la seconde. Soit un total de presque 95 ans ! Et alors qu’Apollinaire est mort sans enfant ni neveu, ne laissant qu’une veuve épousée six mois plus tôt… Bref, c’est seulement avant-hier, le 29 septembre 2013, que l’œuvre d’Apollinaire est officiellement entrée dans le domaine public et qu’on peut donc la reproduire à volonté.
Apollinaire a été déclaré officiellement « mort pour la France ». En vérité, il a été emporté par la grippe espagnole le 9 novembre 1918, mais on a considéré que cette mort résultait de son affaiblissement dû à ses blessures de guerre. Cette décision a eu de grandes conséquences pour la destinée de son œuvre, car elle a presque doublé la durée légale du droit d’auteur accordé à ses héritiers : aux 50 ans normaux se sont ajoutées une prime de 30 ans plus la durée intégrale des guerres mondiales traversées, la seconde et aussi la première (mais s’il était mort trois jours plus tard, le 12 novembre ?). Des guerres mondiales qui sont dailleurs curieusement allongées : 6 ans et 5 mois pour la première, 8 ans et 4 mois pour la seconde. Soit un total de presque 95 ans ! Et alors qu’Apollinaire est mort sans enfant ni neveu, ne laissant qu’une veuve épousée six mois plus tôt… Bref, c’est seulement avant-hier, le 29 septembre 2013, que l’œuvre d’Apollinaire est officiellement entrée dans le domaine public et qu’on peut donc la reproduire à volonté.
Je propose ici une petite anthologie de beaux poèmes peu connus. Très rétif au vers libre, et assez fermé au modernisme prosaïque de « Zone », dans Alcools 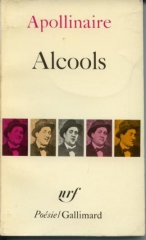 je suis surtout sensible à la veine élégiaque, qui inscrit Apollinaire dans la filiation de Villon, Du Bellay, Lamartine, Hugo et Verlaine, modulant comme eux sa mélancolie en un chant profond inoubliable. J’aurais pu recopier « Le pont Mirabeau », « Clotilde », « Marizibill », « Marie », « L’adieu », « La porte », « Lul de Faltenin », « Signe », « À la santé », « Automne malade », « Cors de chasse », « Vendémiaire » : douze chefs-d’œuvre bouleversants qui suffisent à faire d’Apollinaire un grand poète. Mais le recueil est trop diffusé et ces textes trop illustres pour que je les inflige aux visiteurs de ce blogue. Même chose pour la sublime plaquette Vitam impedere amori, dont les vers sont peut-être les plus poignants d’Apollinaire : elle est imprimée à la suite d’Alcools dans le recueil de la collection « Poésie Gallimard », donc tout aussi répandue. Je préfère donner à découvrir des textes rarement reproduits. Mon choix essaye de montrer la diversité d'Apollinaire : vers mesurés et vers libres, modernisme et tradition, lyrisme amoureux et lyrisme guerrier, exaltation et mélancolie, amour de cœur et érotisme. J'ai reclassé ces douze poèmes dans leur ordre chronologique d'écriture.
je suis surtout sensible à la veine élégiaque, qui inscrit Apollinaire dans la filiation de Villon, Du Bellay, Lamartine, Hugo et Verlaine, modulant comme eux sa mélancolie en un chant profond inoubliable. J’aurais pu recopier « Le pont Mirabeau », « Clotilde », « Marizibill », « Marie », « L’adieu », « La porte », « Lul de Faltenin », « Signe », « À la santé », « Automne malade », « Cors de chasse », « Vendémiaire » : douze chefs-d’œuvre bouleversants qui suffisent à faire d’Apollinaire un grand poète. Mais le recueil est trop diffusé et ces textes trop illustres pour que je les inflige aux visiteurs de ce blogue. Même chose pour la sublime plaquette Vitam impedere amori, dont les vers sont peut-être les plus poignants d’Apollinaire : elle est imprimée à la suite d’Alcools dans le recueil de la collection « Poésie Gallimard », donc tout aussi répandue. Je préfère donner à découvrir des textes rarement reproduits. Mon choix essaye de montrer la diversité d'Apollinaire : vers mesurés et vers libres, modernisme et tradition, lyrisme amoureux et lyrisme guerrier, exaltation et mélancolie, amour de cœur et érotisme. J'ai reclassé ces douze poèmes dans leur ordre chronologique d'écriture.
Avenir
Quand trembleront d’effroi les puissants les ricombres
Quand en signe de peur ils dresseront leurs mains
Calmes devant le feu les maisons qui s’effondrent
Les cadavres tout nus couchés par les chemins
Nous irons contempler le sourire des morts
Nous marcherons très lentement les yeux ravis
Foulant aux pieds sous les gibets les mandragores
Sans songer aux blessés sans regretter les vies
Il y aura du sang et sous les rouges mares
Penchés nous mirerons nos faces calmement
Et nous regardons aux tragiques miroirs
La chute des maisons et la mort des amants
Or nous aurons bien soin de garder nos mains pures
Et nous admirerons la nuit comme Néron
L’incendie des cités l’écroulement des murs
Et comme lui indolemment nous chanterons
Nous chanterons le feu la noblesse des forges
La force des grands gars les gestes des larrons
Et la mort des héros et la gloire des torches
Qui font une auréole autour de chaque front
La beauté des printemps et les amours fécondes
La douleur des yeux bleus que le sang assouvit
Et l’aube qui va poindre et la fraicheur des ondes
Le bonheur des enfants et l’éternelle vie
Mais nous ne dirons plus ni le mythe des veuves
Ni l’honneur d’obéir ni le son du canon
Ni le passé car les clartés de l’aube neuve
Ne feront plus vibrer la statue de Memnon
Après sous le soleil pourriront les cadavres
Et les hommes mourront nombreux en liberté
Le soleil et les morts aux terres qu’on emblave
Donnent la beauté blonde et la fécondité
Puis quand la peste aura purifié la terre
Vivront en doux amour les bienheureux humains
Paisibles et très purs car les lacs et les mers
Suffiront bien à effacer le sang des mains
Le Guetteur mélancolique, Pléiade p. 560-561 [première publication : mai 1903]
Mon destin ô Marie est de vivre à vos pieds
En redisant sans cesse O combien je vous aime
O faible voix ô faible voix qui me trompiez
Je ne sais plus comment on bâtit un poème
[ Tant pis pour moi vos mains sont les fleurs les plus blêmes
Ne me regardez pas mais vous vous occupiez
À capturer vos yeux Oiseaux qui pépiez
De doux regards dans la cage de mon cœur même ]
J’ai trouvé quelquefois des rythmes langoureux
Qui faisaient palpiter tout l’amour sous les feuilles
Et je ne trouve rien que ces vers malheureux
Qui méditent ma mort pourvu que tu la veuilles
Le Guetteur mélancolique, Pléiade p. 586 et 1137 [écrit entre 1907 et 1912]
L’enfer
Un homme a traversé le désert sans rien boire
Et parvient une nuit sur les bords de la mer
Il a plus soif encore à voir le flot amer
Cet homme est mon désir, la mer est ta victoire.
Tout habillé de bleu quand il a l'âme noire
Au pied d'une potence un beau masque prend l'air
Comme si de l'amour – ce pendu jaune et vert –
Je voulais que brûlât l'horrible main de gloire.
Le pendu, le beau masque et cet homme altéré
Descendent dans l'enfer que je creuse moi-même
Et l'enfer c'est toujours : « Je voudrais qu'elle m'aime. »
Et n'aurais-je jamais une chose à mon gré
Sinon l'amour, du moins une mort aussi belle.
Dis-moi, le savais-tu, que mon âme est mortelle ?
Il y a, Pléiade p. 341 [première publication : mai 1912]
Si je mourais là-bas…
Si je mourais là-bas sur le front de l'armée
Tu pleurerais un jour ô Lou ma bien-aimée
Et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt
Un obus éclatant sur le front de l'armée
Un bel obus semblable aux mimosas en fleur
Et puis ce souvenir éclaté dans l'espace
Couvrirait de mon sang le monde tout entier
La mer les monts les vals et l'étoile qui passe
Les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace
Comme font les fruits d'or autour de Baratier
Souvenir oublié vivant dans toutes choses
Je rougirais le bout de tes jolis seins roses
Je rougirais ta bouche et tes cheveux sanglants
Tu ne vieillirais point toutes ces belles choses
Rajeuniraient toujours pour leurs destins galants
Le fatal giclement de mon sang sur le monde
Donnerait au soleil plus de vive clarté
Aux fleurs plus de couleur plus de vitesse à l'onde
Un amour inouï descendrait sur le monde
L'amant serait plus fort dans ton corps écarté
Lou si je meurs là-bas souvenir qu'on oublie
– Souviens-t'en quelquefois aux instants de folie
De jeunesse et d'amour et d'éclatante ardeur –
Mon sang c'est la fontaine ardente du bonheur
Et sois la plus heureuse étant la plus jolie
Ô mon unique amour et ma grande folie
30 janvier 1915, Nîmes.
La nuit descend
On y pressent
Un long un long destin de sang
Poèmes à Lou, XII, Pléiade p. 392-393
Faction
Je pense à toi ma Lou pendant la faction
J'ai ton regard là-haut en clignement d'étoiles
Tout le ciel c'est ton corps chère conception
De mon désir majeur qu'attisent les rafales
Autour de ce soldat en méditation
Amour vous ne savez ce que c'est que l'absence
Et vous ne savez pas que l'on s'en sent mourir
Chaque heure infiniment augmente la souffrance
Et quand finit le jour on commence à souffrir
Et quand la nuit revient la peine recommence
J'espère dans le Souvenir ô mon Amour
Il rajeunit il embellit lorsqu'il s'efface
Vous vieillirez Amour vous vieillirez un jour
Le Souvenir au loin sonne du cor de chasse
Ô lente lente nuit ô mon fusil si lourd
Poèmes à Lou, XXV, Pléiade p. 414 [25 mars 1915]
Ode
Lou Toutou soyez remerciés
Puisque par votre amour je ne suis pas seul
Et je nais de chacune de vos étreintes
Pensée vivante qui jaillit de vous
Lou Toutou je suis votre petit enfant
Je tiens à vous, à Lou par le lien ombilical
Jeté sur la terre de France des Vosges à la mer
Ainsi nous sommes unis par la chair et les tranchées
Nous sommes unis par la vie et par la mort
Bénie soit aussi cette guerre qui m’unit à votre douceur
Avant on ne parlait que de paix
Et l’amour s’en allait peu à peu de nos cœur et de la terre
Aujourdhui, c’est l’amour éperdu où s’accolent
Tous les grands peuples
L’Amour cette guerre
La vraie guerre
Tant de choses nous séparaient
C’était la paix la vilaine paix
Mais nous avons senti tout à coup
Qu’il fallait nous rapprocher nous unir
Pour nous aimer ô noble guerre
Ô noble ô noble amour
Amour sacré qui flamboie et fume
Sur les hypogées tandis que râlent les projectiles
Nous ne combattons point pour conserver la vie
Nous menons l’Amour en grande pompe
Vers la mort
Vers le [seuil] suprême
Où veille la guerrière mort
Ainsi Toutou nous défendons Lou
C’est la grâce, c’est à dire ce qu’il y a de plus rare
Dans l’idée de Beauté
Rien n’est plus noble que ce combat
Esthétique et sublime
Toutou Lou écoutez-moi
Aimez-moi
Poèmes à Lou, LXIV, Pléiade p. 487-488 [2 août 1915]
L'adieu du cavalier
Ah Dieu ! que la guerre est jolie
Avec ses chants ses longs loisirs
Cette bague je l'ai polie
Le vent se mêle à vos soupirs
Adieu ! voici le boute-selle
Il disparut dans un tournant
Et mourut là-bas tandis qu'elle
Riait au destin surprenant
Calligrammes, Pléiade p. 253 [août 1915]
Les neuf portes de ton corps
Ce poème est pour toi seule Madeleine
Il est un des premiers poèmes de notre désir
Il est notre premier poème secret ô toi que j’aime
Le jour est doux et la guerre est si douce S’il fallait en mourir
Tu l’ignores ma vierge à ton corps sont neuf portes
J’en connais sept et deux me sont celées
J’en ai pris quatre j’y suis entré n’espère plus que j’en sorte
Car je suis entré en toi par tes yeux étoilés
Et par tes oreilles avec les Paroles que je commande et qui sont mon escorte
Œil droit de mon amour première porte de mon amour
Elle avait baissé le rideau de sa paupière
Tes cils étaient rangés devant comme les soldats noirs peints sur un vase grec paupière rideau lourd
De velours
Qui cachait ton regard clair
Et lourd
Pareil à notre amour
Œil gauche de mon amour deuxième porte de mon amour
Pareille à son amie et chaste et lourde d’amour ainsi que lui
Ô porte qui mènes à ton cœur mon image et mon sourire qui luit
Comme une étoile pareille à tes yeux que j’adore
Double porte de ton regard je t’adore
Oreille droite de mon amour troisième porte
C’est en te prenant que j’arrivai à ouvrir entièrement les deux premières portes
Oreille porte de ma voix qui t’a persuadée
Je t’aime toi qui donnas un sens à l’Image grâce à l’Idée
Et toi aussi oreille gauche toi qui des portes de mon amour es la quatrième
Ô vous les oreilles de mon amour je vous bénis
Portes qui vous ouvrîtes à ma voix
Comme les roses s’ouvrent aux caresses du printemps
C’est par vous que ma voix et mon ordre
Pénètrent dans le corps entier de Madeleine
J’y entre homme tout entier et aussi tout entier poème
Poème de son désir qui fait que moi aussi je m’aime
Narine gauche de mon amour cinquième porte de mon amour et de nos désirs
J’entrerai par là dans le corps de mon amour
J’y entrerai subtil avec mon odeur d’homme
L’odeur de mon désir
L’âcre parfum viril qui enivrera Madeleine
Narine droite sixième porte de mon amour et de notre volupté
Toi qui sentiras comme ta voisine l’odeur de mon plaisir
Et notre odeur mêlée plus forte et plus exquise qu’un printemps en fleurs
Double porte des narines je t’adore toi qui promets tant de plaisirs subtils
Puisés dans l’art des fumées et des fumets
Bouche de Madeleine septième porte de mon amour
Je vous aie vue ô porte rouge gouffre de mon désir
Et les soldats qui s’y tiennent morts d’amour m’ont crié qu’ils se rendent
Ô porte rouge et tendre
Ô Madeleine il est deux portes encore
Que je ne connais pas
Deux portes de ton corps
Mystérieuses
Huitième porte de la grande beauté de mon amour
Ô mon ignorance semblable à des soldats aveugles parmi les chevaux de frise sous la lune
liquide des Flandres à l’agonie
Ou plutôt comme un explorateur qui meurt de faim de soif et d’amour dans une forêt vierge
Plus sombre que l’Érèbe
Plus sacrée que celle de Dodone
Et qui devine une source plus fraîche que Castalie
Mais mon amour y trouverait un temple
Et après avoir ensanglanté le parvis sur qui veille le charmant monstre de l’innocence
J’y découvrirais et ferais jaillir le plus chaud geyser du monde
Ô mon amour ma Madeleine
Je suis déjà le maître de la huitième porte
Et toi neuvième porte plus mystérieuse encore
Qui t’ouvres entre deux montagnes de perles
Toi plus mystérieuse encore que les autres
Porte des sortilèges dont on n’ose point parler
Tu m’appartiens aussi
Suprême porte
À moi qui porte
La clef suprême des neuf portes
Ô portes ouvrez-vous à ma voix
Je suis le maître de la Clef
Poèmes à Madeleine, Pléiade p. 619-621 [21 septembre 1915]
Le troisième poème secret
Toi dont je répandrai le sang grâce à l’amour ô ma vierge qui allumes la lampe
Ouïs le son profond des canons qui t’acclament et t’accueillent ma reine
Ouïs les cliquetis des épées qui t’appellent ô très belle victime
Toi dont je pénétrerai la chair jusqu’à l’écume ardente où la chair et l’âme se convulsent ensemble
Ouïs le cri terrible de la tempête qui te secoue mon beau vaisseau
Toi dont la croupe libre se balance ainsi qu’un beau vaisseau sur la mer parfumée
Toi, temple dont je serai le prêtre ardent et dévot et farouchement unique
Entends monter le cri d’amour d’une armée qui soupire vers l’amour
D’une armée de fidèles qui n’adorent que le terrible et belliqueux dieu de l’amour
Attols singuliers de la guerre
Coraux de tous les bonheurs
Belles fleurs inécloses
Des aveux de l’espoir
Ô mon tendre amour Madeleine
Un tremblement léger
Mon haleine ton haleine ô Madeleine
Une goutte de pluie par pitié sur notre très cher Amour ô Madeleine
Toi dont la pensée me secoue comme Samson secouait le temple de Dagon
Toi dont les seins cupules adorables se tendent vers moi si loin que je passe sur eux comme sur un pont de roses un pont double de neige au soleil pour venir jusqu’à toi
Imagine les canons tendus terriblement comme mon désir vers l’ennemi
Toi qui es si belle ô beauté que le monde est un socle pour ton apothéose
Envoie-moi tes seins comme des pigeons voyageurs pour me dire ton amour
Non, garde-les plutôt dans le doux colombier et dis-moi le roucoulement des deux colombes aimées
Ô figue mûre et secrète que je désire, dont j’ai faim je ne serai pas un sycophante
Écoute les mots les plus tendres, ô Madeleine, écoute mon oraison Madeleine
Écoute-moi tout près de toi malgré l’éloignement te dire que je t’aime
Ô Fée qui te transformes selon ma volonté en panthère ou en cavale
Toi qui es selon mon désir une divinité ou bien un ange
Toi qui es si je le veux la princesse vierge et lointaine ou la femme ardente ou la reine cruelle
Toi qui es aussi quand je désire ma sœur exquise ou l’adorable esclave
Toi qui es le lys, Madeleine aux beaux cheveux et toi qui es la rose
Toi qui es le geyser, toi qui es la sagesse toi qui es la folie ou l’espoir aux yeux graves
Toi qui es l’univers tout entier j’ai soif de tes métamorphoses
Gui aime Madeleine
Je t’aime ma Madeleine
Je t’aime Gui.
Poèmes à Madeleine, Pléiade p. 624-626 [9 octobre 1915]
L’hiver revient mon âme est triste
Mon cœur ne sait rien exprimer
Peut-être bien que rien n’existe
Hiver de tout hiver d’aimer
Où la peine seule résiste
Et pourquoi donc mon cœur bat-il
Par la tristesse qu’il endure
Toi qui m’attends ô cœur gentil
Ne sais-tu pas que je m’azure
Pour te rejoindre plus subtil
Je suis le bleu soldat d’un rêve
Pense à moi mais perds la raison
Vois-tu le songe qui s’achève
Se confond avec l’horizon
Chaque fois que ton œil se lève
O toi que j’aime éperdument
A qui je pense dès l’aurore
Et tout le jour je vais t’aimant
Et quand vient le soir je t’adore
Poèmes à Madeleine, Pléiade p. 632 [30 octobre 1915]
Merveille de la guerre
Que c'est beau ces fusées qui illuminent la nuit
Elles montent sur leur propre cime et se penchent pour regarder
Ce sont des dames qui dansent avec leurs regards pour yeux bras et cœurs
J'ai reconnu ton sourire et ta vivacité
C'est aussi l'apothéose quotidienne de toutes mes Bérénices dont les chevelures sont devenues des comètes
Ces danseuses surdorées appartiennent à tous les temps et à toutes les races
Elles accouchent brusquement d'enfants qui n'ont que le temps de mourir
Comme c'est beau toutes ces fusées
Mais ce serait bien plus beau s'il y en avait plus encore
S'il y en avait des millions qui auraient un sens complet et relatif comme les lettres d'un livre
Pourtant c'est aussi beau que si la vie même sortait des mourants
Mais ce serait plus beau encore s'il y en avait plus encore
Cependant je les regarde comme une beauté qui s'offre et s'évanouit aussitôt
Il me semble assister à un grand festin éclairé a giorno
C'est un banquet que s'offre la terre
Elle a faim et ouvre de longues bouches pâles
La terre a faim et voici son festin de Balthasar cannibale
Qui aurait dit qu'on pût être à ce point anthropophage
Et qu'il fallût tant de feu pour rôtir le corps humain
C'est pourquoi l'air a un petit goût empyreumatique qui n'est ma foi pas désagréable
Mais le festin serait plus beau encore si le ciel y mangeait avec la terre
Il n'avale que les âmes
Ce qui est une façon de ne pas se nourrir
Et se contente de jongler avec des feux versicolores
Mais j'ai coulé dans la douceur de cette guerre avec toute ma compagnie au long des longs boyaux
Quelques cris de flamme annoncent sans cesse ma présence
J'ai creusé le lit où je coule en me ramifiant en mille petits fleuves qui vont partout
Je suis dans la tranchée de première ligne et cependant je suis partout ou plutôt je commence à être partout
C'est moi qui commence cette chose des siècles à venir
Ce sera plus long à réaliser que non la fable d'Icare volant
Je lègue à l'avenir l'histoire de Guillaume Apollinaire
Qui fut à la guerre et sut être partout
Dans les villes heureuses de l'arrière
Dans tout le reste de l'univers
Dans ceux qui meurent en piétinant dans le barbelé
Dans les femmes dans les canons dans les chevaux
Au zénith au nadir aux 4 points cardinaux
Et dans l'unique ardeur de cette veillée d'armes
Et ce serait sans doute bien plus beau
Si je pouvais supposer que toutes ces choses dans lesquelles je suis partout
Pouvaient m'occuper aussi
Mais dans ce sens il n'y a rien de fait
Car si je suis partout à cette heure il n'y a cependant que moi qui suis en moi
Calligrammes, Pléiade p. 271-272 [décembre 1915]
Tristesse d'une étoile
Une belle Minerve est l'enfant de ma tête
Une étoile de sang me couronne à jamais
La raison est au fond et le ciel est au faîte
Du chef où dès longtemps Déesse tu t'armais
C'est pourquoi de mes maux ce n'était pas le pire
Ce trou presque mortel et qui s'est étoilé
Mais le secret malheur qui nourrit mon délire
Est bien plus grand qu'aucune âme ait jamais celé
Et je porte avec moi cette ardente souffrance
Comme le ver luisant tient son corps enflammé
Comme au cœur du soldat il palpite la France
Et comme au cœur du lys le pollen parfumé
Calligrammes, Pléiade p. 308 [fin 1916]
___________________
[1] On ne sait pas assez qu’il existe un enregistrement de ce célébrissime poème par Apollinaire lui-même. Expérience troublante : Parce qu’Alcools est paru avant 1914, on classerait volontiers Apollinaire parmi les poètes du XIXe siècle, donc avant l’âge des enregistrements sonores répandus par la radio. Après tout, il n’est mort que 51 ans après Baudelaire, 33 après Hugo, 22 et 20 après Verlaine et Mallarmé, alors que Saint-John Perse est mort 57 ans après lui (1975), Aragon 64 ans après (1982), Char et Ponge 70 ans (1988). On écoutera ici cette récitation, d’une authenticité émouvante, même si les poètes ne sont pas forcément les meilleurs interprètes de leurs poèmes.
[2] Cette citation pose un petit mystère. J'ai été amené à elle par un article de Daniel Grojnowski sur le canular de Boronali, « L'âne qui peint avec sa queue », publié dans les Actes de la recherche en sciences sociales en juin 1991, n°88, p. 41-47, repris ensuite dans Aux commencements du rire moderne. L'esprit fumiste, José Corti, 1997, p. 283-298. À la note 11 de cet article, D. Grojnowski dit que le critique d'art Arsène Alexandre signale «l'envahissement de la peinture anglo-saxonne » dans Le Figaro du 30 avril 1910. On peut consulter ce numéro sur Gallica, ce qui permet au passage de constater à quel point la présentation des quotidiens a changé, et comme nos ancêtres d'il y a un siècle pouvaient supporter un texte minuscule et hyper-dense, quand nous ne supportons plus que des articles brefs, dans une mise en page aérée et très illustrée. À part ça l'intellect progresse… Bref, la citation faite par D. Grojnowski est approximative. Arsène Alexandre dit exactement : «C'est de l'envahissement, je ne dirai pas encore de l'invasion, par la peinture anglaise et américaine, que je veux parler ». Il en parle ensuite plus sur le mode du constat que de la plainte, appelant les artistes français à relever ce défi engendré par une mondialisation inévitable. Mais la suite de la note de D. Grojnowski est encore plus étonnante : « Apollinaire, après avoir rendu hommage à la perspicacité d'écrivain d'art d'Arsène Alexandre, regrette à son tour l'anglomanie qui sévit "pour le plus grand dommage du goût français" (L'Intransigeant, 3 mai 1910) », écrit-il. Or je n'ai pas retrouvé celà ! L'article du 3 mai 1910 est reproduit dans le tome II des Œuvres complètes en prose de la Pléiade, p. 192-195 : on n'y trouve pas la citation sur l'anglomanie, ni l'hommage à Arsène Alexandre. En revanche, dans un article du 30 avril (p. 185-188), on tombe sur la citation que j'ai donnée, assez différente de celle de D. Grojnowski (pas de dommage pour le goût français…), mais pas sur l'hommage à Arsène Alexandre, et pour cause puisque les deux articles sont parus le même jour. Grâce à l'index qui figure au tome III de la Pléiade, j'ai passé en revue les mentions d'Arsène Alexandre dans les articles d'Apollinaire : aucune ne correspond à un net hommage à sa perspicacité. (L'article qui en parle le mieux est reproduit au tome II, p. 1303-1304 ; il est paru dans L'Intransigeant le 7 mai 1911). Et pas moyen de vérifier sur l'original de ce journal : une bonne partie de L'Intransigeant a été numérisée sur Gallica… mais pas encore l'année 1910. Jusqu'à preuve du contraire, je suppose donc que D. Grojnowski s'est emmêlé dans ses fiches et que sa note ne mérite aucun crédit.
[3] Extrait de la préface : « J'ai signalé [aux Français] le grave danger reconnu de tous qu’il y a pour une nation qui veut être prospère et puissante à ne pas faire d’enfants, et pour y remédier je leur ai indiqué qu’il suffisait d’en faire » (Pléiade, Œuvres poétiques, p. 867). « Il faudrait un livre tout entier et changer les mœurs. C’est aux gouvernements à agir, à faciliter les mariages, à encourager avant tout l’amour fécond » (p. 868). Déclarations à rapprocher de l'étonnant excipit des Exploits d'un jeune don Juan, le second roman pornographique : « J'espère avoir bien d'autres [enfants] et, ce faisant, j'accomplis un devoir patriotique, celui d'augmenter la population de mon pays » (Pléiade, Œuvres en prose complètes, tome III, p. 1000).
[4] Signalons encore une interviou à SIC, revue de jeunes poètes modernistes dirigée par Pierre-Albert Birot, en août 1916 (Pléiade, tome II, p. 985-987). À la question : « Pensez-vous que la guerre elle-même puisse inspirer des œuvres dignes d'intérêt ? », Apollinaire répond : « Certes et il faut le souhaiter. Il ne faudrait pas qu'une leçon aussi violente fût perdue. Quoi de plus beau du reste que de chanter les héros et la grandeur de la patrie. Quoi de plus beau que d'inspirer de nobles sentiments aux générations à venir, quoi de plus noble qu'en rappelant les expériences de la guerre forcer les gouvernants à ne jamais oublier que nous devons êtres forts si nous voulons exercer librement les arts de la paix et nous élever dans ces arts ». Aussitôt après, il fait preuve d'une belle prescience en évoquant la dimension épique du cinéma.
18:30 Écrit par Le déclinologue dans Littérature et arts, Morceaux choisis des bons auteurs, Tableau d'honneur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : guillaume apollinaire, alcools, vitam impendere amori, calligrammes, il y a, poèmes à lou, poème à madeleine, le guetteur mélancolique, les mamelles de tirésias, grande guerre, mort pour la france, poésie, patriotisme, pierre cahné, le pont mirabeau, déroulède, élégie, l'adieu du cavalier, guerre, merveille de la guerre, tristesse d'une étoile, si je mourais là-bas, les neuf portes de ton corps, le troisième poème secret, mélancolie, péguy, domaine public, les cénobites tranquilles, italie, verlaine, première guerre mondiale, poilus, poésie érotique, aragon, uchronie, mercure de france, futurisme, andré breton, esprit nouveau, arsène alexandre, anglomanie, daniel grojnowski |  |
|  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer | |
Imprimer | |  Digg |
Digg |  |
|


