05.02.2012
RAOUL DE WARREN, /LA BÊTE DE L’APOCALYPSE/ : LE DAN BROWN FRANÇAIS DES ANNÉES 50
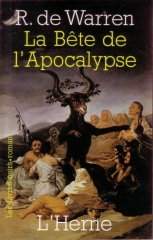 J’ai lu ce roman dans la réédition parue aux éditions de l’Herne en 1978. La couverture empruntée à Goya, le résumé du revers, certains jugements flatteurs faisant de ce livre « le plus grand roman occultiste de la littérature française », et jusqu’au nom de l’auteur, tout m’avait persuadé qu’il devait s’agir d’un roman ésotérique, envoûtant, classieux, explorant les dessous ténébreux de l’Histoire à la lumière d’un grand style capable de sorcellerie évocatoire. Ceci ne fait-il pas rêver ? : « Grâce à la Confrérie des Chevaliers de l’Apocalypse, fondée en 1656, l’histoire de l’Occident n’est plus, depuis deux siècles, qu’une chasse acharnée autant que secrète d’une jeune femme qu’il s’agit d’identifier, chaque fois, à la Grande Courtisane de l’Apocalypse de Saint Jean, et de la mettre à mort rituellement au-dessus du "Grand Abîme" de la baie de Cadix, l’antique Gadès, près des Colonnes d’Hercule, où les anciens situaient la frontière du monde des vivants et des "ténèbres extérieures". [… Dans ce roman], les dernières limites de la provocation sont délibérément dépassées dès le départ, et le récit bascule sans cesse dans cet au-delà de la littérature qu’est la face noire de ce monde et de sa réalité immédiate : prendre connaissance de ce livre revient à glisser hypnotiquement dans les espaces intérieurs du Royaume des Ténèbres ». Hélas, cette présentation éditoriale est outrageusement mensongère, et on se demande si l’auteur de ces lignes publicitaires est un halluciné ou un escroc. L’éditeur n’ayant, par ailleurs, même pas poussé le sérieux jusqu’à signaler que ce livre était une réédition (son originale est de 1956, chez Robert Laffont), on penche plutôt pour la seconde hypothèse…
J’ai lu ce roman dans la réédition parue aux éditions de l’Herne en 1978. La couverture empruntée à Goya, le résumé du revers, certains jugements flatteurs faisant de ce livre « le plus grand roman occultiste de la littérature française », et jusqu’au nom de l’auteur, tout m’avait persuadé qu’il devait s’agir d’un roman ésotérique, envoûtant, classieux, explorant les dessous ténébreux de l’Histoire à la lumière d’un grand style capable de sorcellerie évocatoire. Ceci ne fait-il pas rêver ? : « Grâce à la Confrérie des Chevaliers de l’Apocalypse, fondée en 1656, l’histoire de l’Occident n’est plus, depuis deux siècles, qu’une chasse acharnée autant que secrète d’une jeune femme qu’il s’agit d’identifier, chaque fois, à la Grande Courtisane de l’Apocalypse de Saint Jean, et de la mettre à mort rituellement au-dessus du "Grand Abîme" de la baie de Cadix, l’antique Gadès, près des Colonnes d’Hercule, où les anciens situaient la frontière du monde des vivants et des "ténèbres extérieures". [… Dans ce roman], les dernières limites de la provocation sont délibérément dépassées dès le départ, et le récit bascule sans cesse dans cet au-delà de la littérature qu’est la face noire de ce monde et de sa réalité immédiate : prendre connaissance de ce livre revient à glisser hypnotiquement dans les espaces intérieurs du Royaume des Ténèbres ». Hélas, cette présentation éditoriale est outrageusement mensongère, et on se demande si l’auteur de ces lignes publicitaires est un halluciné ou un escroc. L’éditeur n’ayant, par ailleurs, même pas poussé le sérieux jusqu’à signaler que ce livre était une réédition (son originale est de 1956, chez Robert Laffont), on penche plutôt pour la seconde hypothèse…
L’intrigue de ce roman est tellement complexe qu’elle décourage le résumé. Elle se passe dans l’été 1945. En gros, trois jeunes gens cherchent à comprendre ce qui s’est passé trois ans plus tôt à bord d’un navire qui a été arraisonné par un sous-marin allemand. Ils vont de surprise en surprise, et se rendent compte que ce qui n’était au départ qu’une énigme étrangère à eux, à laquelle ils s’intéressaient par désœuvrement et sympathie pour les victimes, les touche de près, au point qu’on en vient à se demander (et eux-mêmes se le demandent aussi !) non seulement s’ils n’étaient pas à bord du navire fatal, mais s’ils sont les victimes ou bien les coupables !! Le personnage-clef de cette trame obscure est un certain Robert Noir, à la fois chef de secte, cinéaste et espion, en qui le lecteur est amené à voir successivement un malade, un savant fou, un assassin, un héros de la Résistance, un manipulateur, et à nouveau un fou, tout en l’ayant entre temps identifié à l’enquêteur principal lui-même (!!) puis au valet-de-chambre de celui-ci. Tout celà est totalement abracadabrantesque, et on n’y croit pas une seconde.
Le livre empile tellement de données hétérogènes qu’on ne sait pas dans quel genre le placer : c'est tout à la fois un roman historique (tout tourne autour d’un épisode lié au débarquement des alliés en Afrique du Nord, et ça se termine par l’explosion d’Hirochima), un roman fantastique (ça commence comme une histoire de vampire et de possession diabolique, et p. 210-223 on s’oriente vers un cas de dédoublement d’individualité, analogue à Dr Jekyll et Mr Hyde, qui se révèlera une fausse piste), un roman policier (toute la seconde moitié est gouvernée par l’élucidation de deux assassinats), un roman ésotérique (il est fortement question d’une société secrète qui commet plusieurs meurtres rituels, décodables par l’Apocalypse de Jean de Patmos, et qui cherche par-dessus tout à vaincre la Bête de l’Apocalypse en sacrifiant par crucifixion une femme au visage d’ange et au cœur de démon, identifiée comme la Grande Courtisane), un roman d'espionnage (les personnes à bord du bateau sont en mission secrète pour les alliés), un roman à suspense... Dans la première moitié, l’aspect ésotérique prédomine, puisque les personnages sont fortement préoccupés par le constat qu’à cinq reprises (1656, 1703, 1782, 1805, 1942), un bateau appelé La Bête de l’Apocalypse a été coulé au large de Cadix, et, semble-t-il, toujours un 21 octobre et à l’instigation d’un dénommé Blake ou Black ou Noir : on toucherait là un de ces phénomènes occultes prouvant que l’Histoire officielle n’est que l’avers d’une mystérieuse histoire secrète tissée de fils fantastiques. Mais ce décryptage de l’Histoire invisible est vite abandonné par les personnages, qui concentrent leur enquête sur les survivants du dernier naufrage. À la fin, on apprend qu’il s’agissait essentiellement d’une histoire d’espionnage, et que l’aspect ésotérique n’était que de la poudre aux yeux : Robert Noir n’avait fondé cette société secrète fantaisiste que pour servir de paravent à sa mission de renseignement, en lançant les curieux sur une fausse piste. Toutefois l’un des personnages se dit convaincu que, à l’inverse, la secte de l’Apocalypse était toute la vie de Robert Noir, dont les activités d’agent double n’ont été qu’un simple moyen d’accomplir ses desseins apocalyptiques (p. 292) ; mais elle-même étant totalement gagnée aux idées fumeuses de la secte, il est naturel qu’elle refuse de croire à la duplicité du gourou [1]. Cependant, l’annonce du bombardement d’Hirochima, sur quoi se clôt le roman, vient confirmer l’application rigoureuse des symboles de l’Apocalypse à l’époque contemporaine, donc justifier dans une certaine mesure les délires de la secte.
Mais pour donner à cet épilogue la portée qu’il méritait, il aurait fallu de tout autres moyens littéraires. L’aspect roman historique est nul : aucun souci de reconstituer une époque, aucune considération de la couleur temporelle, à part de très neutres et rares allusions à des déportés et des collaborateurs. À aucun moment on ne vient nous rappeler qu’on vit dans cette époque difficile que furent les lendemains de la Libération. On pourrait transposer l’intrigue cinquante ans avant ou cinquante ans après, il n’y aurait rien à changer (à part la dernière page), juste une vingtaine de mots et de dates à modifier. Ce qui m’a le plus frappé dans ce roman, c’est sa médiocrité littéraire. Il est efficace, en celà qu’on le dévore sans reprendre son souffle (j’avoue que je l’ai avalé en moins de 24 heures, ce qui ne m’arrive que rarement), mais il n’a rien de nourrissant. Il va vite, très vite, ne prend jamais le temps non seulement de donner un minimum de vraisemblance réaliste aux évènements qu’il raconte, mais aussi de planter un décor ou de peindre un personnage. Ceux-ci ne sont donc que des noms, dépourvus de la plus mince substance humaine. C’est du roman-feuilleton trépidant, découpé en courtes séquences où les dialogues prédominent largement. En fin de compte, on est là dans la narration standard du frileur à l’américaine. L’habit ne fait pas le moine, et la particule ne fait pas le styliste. Monsieur de Warren a beau être le descendant de nobles jacobites exilés en France en 1692, et un distingué historien de la noblesse française (et même un spécialiste des prétendants au trône de France), il n’en écrit pas moins comme un plébéien, ou pire : comme un yanqui. Son livre est beaucoup, beaucoup plus proche du Code de Vinci de Dan Brown que de l’Isis de Villiers de l’Isle-Adam…
En plus, il ne respecte même pas cette règle élémentaire du roman policier (la règle n°4 de S.S. Van Dine) qui prescrit de ne pas confondre les enquêteurs et les coupables. Pendant de nombreux chapitres, le lecteur suit les pas de Charles de Mordigné et son amie Solange Reynouard, épousant le point-de-vue de ces sympathiques détectives bénévoles qui cherchent à mettre la main sur Robert Noir pour lui faire rendre justice du meurtre sacrificiel de Jacqueline Sérainchamp. Or, aux deux tiers du roman, on apprend que Solange Reynouard n’est autre que Jacqueline Sérainchamp, et que Charles de Mordigné pourrait bien être Robert Noir lui-même !!! [2] Les personnages ont un passé pour le moins obscur… y compris à leurs propres yeux, car on apprend seulement alors qu’ils ont vécu des évènements traumatisants qui les ont rendus plus ou moins amnésiques. Dailleurs, ils ne se connaissent pas depuis si longtemps que ça, et n’ont guère de raison de se faire une confiance aussi absolue (en fait, qu’on se rassure, ils sont innocents l’un et l’autre… et même consanguins !). Le lecteur se sent complètement floué par ce revirement de l’intrigue : le narrateur a abusé de sa confiance en le trompant sur ses personnages. Voilà qui montre l’importance cruciale de la notion de point-de-vue dans une narration. Le point-de-vue interne exige une certaine loyauté. Si on veut qu’un personnage fasse des choses à l’insu du lecteur, alors il ne faut pas que ce soit par le biais de ce personnage que le lecteur découvre l’action. Pendant quelques pages, je me suis demandé s’il ne s’agissait pas d’un procédé délibéré. En effet, il y aurait un beau roman fantastique à faire (d’un fantastique très cérébral), où l’identité des personnages serait constamment brouillée : le narrateur ferait exprès de nous donner de fausses informations sur eux ; trois ou quatre fois dans le roman (pour chacun d’eux), on apprendrait que leur identité n’est pas celle qu’on avait crue, afin de créer un vertige et de suggérer un monde où rien n’est certain, pas même la personnalité des candides par qui on découvrirait ce monde. Tout serait inconnaissable, non seulement la réalité mais aussi le sujet percevant… Or ce n’est manifestement pas le dessein de R. de Warren dans La Bête de l’Apocalypse, et cette façon de trahir le lecteur, en minant la confiance qu’il accordait aux héros, paraît bien la pure maladresse d’un mauvais romancier qui se laisse griser par son goût des renversements de situation.
On se demande dailleurs s’il a écrit son roman à partir d’un plan minutieusement organisé, ou s’il a improvisé sa narration au fur et à mesure. Dans le premier cas, cette interrogation pourrait être flatteuse, car elle prouverait qu’il a néanmoins réussi à suggérer une certaine spontanéité. Mais pour ma part, j’aime les intrigues bien charpentées, qui donnent l’impression d’une construction nécessaire. Ici, on a une suite échevelée de bifurcations ahurissantes, qui laissent pantois… ou hilare. Dans le dernier tiers, les révélations bouleversifiantes, qui apparaissent maintenant non plus à chaque chapitre mais à chaque page, en viennent à faire sourire : non seulement on ne s’en étonne plus, mais on s’en gausse : ah, mais oui, ce pourrait être lui, le coupable ! ou elle ! ou non, cette autre, si innocente ! et pourquoi pas celui-ci, sur qui ne pèse aucun soupçon, ce qui est tellement suspect ! « Les dernières limites de la provocation sont délibérément franchies », vantait l’éditeur : oui, les limites de la bienveillance du lecteur, bafouées en effet sans scrupule. Mais cet outrage se retourne contre l’auteur, car chaque nouveau rebondissement n’est plus accueilli que par un « Ben voyons ! » goguenard. Dans la séquence finale, les principaux protagonistes sont réunis, et vont tour à tour donner leur version de l’affaire, et leur identification du coupable principal : chaque version apporte des compléments décisifs, mais réfute l’axe directeur de la précédente. J’aime cette façon de relire l’ensemble d’une intrigue à la lumière d’un projecteur particulier, qui renouvelle entièrement le sens qu’on avait cru lui attribuer jusque-là. L’inconvénient est qu'au lieu de produire un effet cumulatif, ces versions s’annulent les unes les autres, si bien que la dernière ne paraît pas définitivement supérieure aux précédentes. En outre, chaque épisode de l’intrigue semble rétrospectivement avoir été placé pour justifier l’une des lectures finales, de telle sorte qu’aucune ne donne une explication absolument satisfaisante de tout ce qui précède. Ainsi, on saisit mal pourquoi Solange Reynouard, ou plutôt Jacqueline Sérainchamp, a pu être mise à la porte par le Pr François Gordon quand elle est venue le voir, et côtoyer longuement Victor Griffard alias Robert Noir, alors que tous deux, grands maîtres successifs des Chevaliers de l’Apocalypse, avaient intérêt à la capturer pour la re-sacrifier, puisque le premier crime expiatoire avait échoué. N’accordant aucun intérêt à ses personnages, l’auteur ne s’est même pas soucié de leur faire tirer, à la fin, un bilan humain de leurs aventures : du coup, le lecteur n’est pas incité à se sentir soulagé que les "bons" paraissent innocents : est-il vraiment certain que le traître soit Robert Noir ? L’hypothèse de la culpabilité de Jacqueline Sérainchamp, ou celle de Monique Le Gall, si séduisantes pendant deux pages, sont-elles vraiment insoutenables ? et Philippe Lormel, après tout, qu’est-ce qui empêcherait de lever à son tour un voile sur son passé et de révéler qu’il a menti, qu’il était le traître à bord de La Bête de l’Apocalypse (de mèche avec Patrick Morgan, l’agent de liaison qui apparaît à la fin), ou qu’il est Robert Noir, ou que sais-je encore ? Quand un auteur viole toute les règles de la vraisemblance, les bornes qu’il pose cessent elles-mêmes d’être crédibles : tout devient possible aux yeux du lecteur, y compris ce que la narration a défini comme impossible, puisque celle-ci s’est insolemment auto-démentie à plusieurs reprises. Il n’y a pas de limite au tout-et-n’importe-quoi : un dernier chapitre nous eût-il appris que Robert Noir était en fait l’inspecteur de police et son adjoint dans la secte le juge d’instruction, ou que l’assassiné de la rue Noirot était Charles de Mordigné dont son valet Victor aurait ensuite usurpé l’identité, que nous n’en eussions pas été plus surpris que de ce qu’on nous a raconté auparavant.
Le plus grave, finalement, c’est qu’une fois le roman fini, on ne saisit pas quel dessein s’est proposé l’auteur. Il est évident qu’il a une certaine fascination pour les spéculations ésotériques sur l’Apocalypse, qu’il cite souvent, notamment p. 68-69 où il ne respecte pas le fil du texte, manipulation cavalière dont il a le front de se justifier en note : « Comme dans beaucoup de prophéties, les évènements de l’Apocalypse sont présentés dans le plus grand désordre. Nous avons essayé de rétablir l’ordre logique ». De fait, tout ce qui est dit à ce sujet dans le roman converge vers le cataclysme d’Hirochima, vu comme la réalisation d’Ap 11, 13 et Ap 16,17-18. Néanmoins, le bref aperçu qu’il nous propose de la confrérie des Chevaliers de l’Apocalypse n’a rien de séduisant : une entreprise criminelle menée par des fous dangereux – en particulier Robert Noir, le traître, Edith de Voirac, la déclassée faible d’esprit, François Gordon, le professeur psychopathe –, capables de tuer sadiquement des innocents au nom de leurs élucubrations prophétiques. Alors ? Qu’est-ce que c’est que cette façon de cautionner historiquement les divagations sur l’Apocalypse tout en les discréditant moralement ? L'auteur veut-il sérieusement nous persuader que si sa secte de dingues et de traîtres avait réussi à tuer l'aimable Solange/Jacqueline, ou bien si elle avait mieux identifié la « Grande Courtisane », les États-uniens n'auraient pas lancé une bombe atomique sur Hirochima ? Ou bien plutôt faut-il croire que R. de Warren n’ait cherché rien d’autre qu'à raconter une histoire mouvementée, en se moquant des enjeux qu’il a soulevés d’une façon purement ludique ? Après tout, ces sourires de moquerie que m’inspiraient ces rebondissements abracadabrantesques n’ont-ils pas pu être désirés par l’auteur ? J’en viens à me demander s’il ne s’agirait pas d’une parodie de roman ésotérique,  dans lequel l’auteur ne chercherait qu’à nous amuser, ne prenant pas une seconde au sérieux ni son intrigue, ni ses personnages, ni les visions furieuses de l’aigle de Patmos. Et l'autre grande énigme que pose ce roman est celle-ci : pourquoi les prestigieuses éditions de l'Herne, qui publient très peu de romans et seulement d'un certain niveau (Mircea Eliade, Elizabeth Gaskell, etc), censément remarquables par « l'élégance de la forme », ont-elles inscrit à leur catalogue la série complète des récits de ce qui m'apparaît bien, à en juger par son titre le plus fameux, un médiocre feuilletoniste ? Imagine-t-on Marc Levy aux éditions de Minuit ou Paul-Loup Sulitzer chez José Corti ? Il était mieux à sa place chez Robert Laffont, son premier éditeur. La fascination pour le fantastique a-t-elle offusqué le jugement de Constantin Tacou ? Et comment se fait-il que ce roman, avec deux autres de l'auteur, ait encore été réédité vers 2000 par Les Belles-lettres, dans leur collection de poche fantastique « Le Cabinet noir » ? Il faudra que j'essaye de lire les autres titres de Raoul de Warren.
dans lequel l’auteur ne chercherait qu’à nous amuser, ne prenant pas une seconde au sérieux ni son intrigue, ni ses personnages, ni les visions furieuses de l’aigle de Patmos. Et l'autre grande énigme que pose ce roman est celle-ci : pourquoi les prestigieuses éditions de l'Herne, qui publient très peu de romans et seulement d'un certain niveau (Mircea Eliade, Elizabeth Gaskell, etc), censément remarquables par « l'élégance de la forme », ont-elles inscrit à leur catalogue la série complète des récits de ce qui m'apparaît bien, à en juger par son titre le plus fameux, un médiocre feuilletoniste ? Imagine-t-on Marc Levy aux éditions de Minuit ou Paul-Loup Sulitzer chez José Corti ? Il était mieux à sa place chez Robert Laffont, son premier éditeur. La fascination pour le fantastique a-t-elle offusqué le jugement de Constantin Tacou ? Et comment se fait-il que ce roman, avec deux autres de l'auteur, ait encore été réédité vers 2000 par Les Belles-lettres, dans leur collection de poche fantastique « Le Cabinet noir » ? Il faudra que j'essaye de lire les autres titres de Raoul de Warren.
J’ai trouvé sur le net ce jugement critique, dû à Roger Bozzetto, universitaire spécialiste du fantastique et de la science-fiction, paru dans Fiction n°299 (mars 1979) : « C'est ce qui ressemble le plus à un roman des années de la fin de la guerre, à la fois par le style d'écriture, par les motivations psychologiques et même par l'imaginaire, tout satanique qu'il se veuille [sic]. La très belle jaquette, de Goya, laisse entrevoir de sulfureuses rencontres. Le verso annonce un roman occultiste. Tout est réussi [3] pour un voyage maudit. Peut-être n'avais-je pas assez de clés pour ouvrir les portes interdites, mais j'ai plus cheminé en domaine de roman de mystère/policier/espionnage, qu'autre chose. Le projet, pourtant était fascinant : unir des dates, des lieux, des sacrifices à la venue de l'un des signes de la Bête (Hirochima). Tout ceci retombe à plat, et laisse un parfum de regret. » C’est sévère, mais ça correspond tout-à-fait à mon impression [4] : on croit avoir affaire à un roman historico-ésotérique, et on est déçu de tomber dans un polar, trépidant mais grossier. Il y avait bien autre chose à tirer de cette idée que seuls des initiés savent que la Prophétie est en train de se réaliser… Bref, une lecture captivante pour une nuit d’insomnie, mais un ouvrage de piètre valeur.
[1] Solange/Jacqueline, dont la tirade finale apporte les ultimes révélations, laisse ce point dans l’ambiguïté : « Dans quelle mesure Robert Noir se servait-il des Chevaliers de l’Apocalypse pour assurer le succès de son entreprise de trahison, ou au contraire profitait-il des facilités que lui donnait cette entreprise pour réaliser le vieux rêve de ceux dont il était le Grand Maître, je suis incapable de vous le dire, mais je crois que, pour lui, ces deux activités étaient complémentaires » (p. 309-310).
[2] Ajout de 2017 : Je m'avise que dans le fameux diptyque formé par Le Mystère de la chambre jaune et Le Parfum de la dame en noir (1907-1908), Gaston Leroux a lui aussi violé la règle selon laquelle le coupable ne doit pas être un des enquêteurs, ce qui est certes assez courant (et du reste, Van Dine n'a édifié ses règles qu'en 1928), mais il a aussi eu le culot ou la légèreté de faire mener à son héros, Joseph Rouletabille, une enquête sur des personnages qui lui étaient au départ totalement étrangers, et dont il finit par apprendre que la victime est sa mère et que le coupable est son père !! Cette ahurissante invraisemblance est toutefois atténuée par la séparation en deux volets : les liens familiaux ne sont révélés que dans le second, et on peut lire Le Mystère de la chambre jaune sans être choqué par cette généalogie extravagante que tout-le-monde ignore encore. Ce genre de révélations mélodramatiques me choque, mais ma connaissance superficielle de la littérature policière me les fait peut-être tenir pour plus rares qu'elles ne sont dans un genre voué aux gros effets.
[3] Réussi ?? Sic. Il doit s'agir d'une mauvaise retranscription de « réuni ».
10:30 Écrit par Le déclinologue dans Littérature et arts, Livres | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : raoul de warren, la bête de l'apocalypse, l'herne, goya, apocalypse, saint jean, 1945, hiroshima, robert noir, dr jekyll et mr hyde, da vinci code, dan brown, isis, villiers de l'isle-adam, ss van dine, roman policier, roman d'espionnage, roman historique, roman d'aventures, roman occultiste, secte, roman fantastique, roger bozzetto, ésotérisme, enquête, meurtre sacrificiel, prophétie, grande courtisane, dédoublement, point de vue narratif, suspense, robert laffont, constantin tacou, mircea eliade, elizabeth gaskell, marc levy, éditions de minuit, paul-loup sulitzer, josé corti, christian dedet, esprit, le cabinet noir, les belles-lettres, gaston leroux, joseph rouletabille, le mystère de la chambre jaune, le parfum de la dame en noir |  |
|  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer | |
Imprimer | |  Digg |
Digg |  |
|


