22.02.2015
CITATIONS CHOISIES DE MME DE STAËL
 Germaine Necker (1766-1817), mal mariée à l’ambassadeur de Suède, le baron de Staël-Holstein, est une écrivaine dont les écrits et le rayonnement intellectuel ont ébloui toute l’Europe pendant vingt ans, mais qui est bien oubliée aujourd’hui, malgré les efforts permanents de quelques féministes pour la remettre en selle. Les Goncourt écrivaient : « Le génie est mâle. L'autopsie de Mme de Staël et de Mme Sand auraient été curieuses : elles doivent avoir une construction un peu hermaphrodite. » [1] Grave confusion entre deux femmes bien dissemblables : George Sand est bête à pleurer, mais elle peut avoir quelques talents artistiques ; à l’inverse, Germaine de Staël est nulle comme artiste, mais intéressante comme penseur.
Germaine Necker (1766-1817), mal mariée à l’ambassadeur de Suède, le baron de Staël-Holstein, est une écrivaine dont les écrits et le rayonnement intellectuel ont ébloui toute l’Europe pendant vingt ans, mais qui est bien oubliée aujourd’hui, malgré les efforts permanents de quelques féministes pour la remettre en selle. Les Goncourt écrivaient : « Le génie est mâle. L'autopsie de Mme de Staël et de Mme Sand auraient été curieuses : elles doivent avoir une construction un peu hermaphrodite. » [1] Grave confusion entre deux femmes bien dissemblables : George Sand est bête à pleurer, mais elle peut avoir quelques talents artistiques ; à l’inverse, Germaine de Staël est nulle comme artiste, mais intéressante comme penseur.
Encore faut-il s’entendre sur l’intérêt de sa pensée. Bien que ses deux grands thèmes directeurs, le bonheur et la liberté, soient des plus importants aujourd’hui, elle peine à nous dire des choses qui nous semblent à la fois originales et pleinement actuelles. La faute, en particulier, à son obsession permanente de la vertu, qui revient à chaque paragraphe, et que nous ne supportons plus (cette allergie contemporaine à l’idée de vertu est dailleurs un phénomène fort remarquable sur lequel je reviendrai bientôt). Mme de Staël n’est pas seulement pénalisée par ses phrases lourdes et embarrassées : on pourrait dire qu’elle est victime de l’histoire littéraire. En la lisant, on voit très bien en quoi elle annonce le romantisme, mais on voit très bien aussi en quoi elle raisonne en fille des Lumières. L’esprit ne parvient à la ranger ni dans un siècle ni dans l’autre, et cette impossible catégorisation historique suscite en nous un certain malaise qu’on projette sur elle, qui semble ne pas être parvenue à se trouver ni à s’accomplir au sein d’un ensemble clairement constitué. Mais c’est aussi justement par là qu’elle est intéressante, pour autant qu’on accorde de la valeur à l’intérêt historique : peu d’auteurs nous permettent de comprendre aussi bien qu’elle comment la culture française et européenne est passée d’un monde à l’autre. Faibles par la pensée et médiocres par le style, ses essais restent des témoins incomparables pour expliquer la genèse du romantisme. On y trouve des idées parfois pertinentes, parfois plates, souvent ridicules, mais auxquelles on pardonne leurs torts car elles sont toujours éclairantes. Si elles ne stimulent pas notre pensée, au moins alimentent-elles notre compréhension, et c’est déjà quelque chose. Mme de Staël avait conscience de vivre une époque exceptionnelle, une époque de transition entre deux siècles. Cette époque a été son malheur, car elle l’a empêchée de trouver une identité forte et enracinée. Mais peut-être aussi sa chance, car elle a pu s’en faire l’incomparable porte-parole, alors que dans un grand siècle plein de génies, peut-être bien eût-elle été réduite à l’insignifiance et le plus complet anonymat. Même remarque pour son mode de vie : pendant près d’un quart de siècle, à Paris et à Coppet, et même à Londres en 1813, Mme de Staël a animé un salon littéraire qui a attiré les meilleurs esprits de son temps, et entretenu, par son abondante correspondance, un exceptionnel réseau de sociabilité. Ayant grandi à Versailles alors que son père gérait les finances de la France d’Ancien Régime, et frappée quarante ans plus tard d’une attaque de paralysie à un bal donné par le duc Decazes, le favori de Louis XVIII, elle aura passé toute sa vie au centre de la plus haute et la plus brillante société de son temps, dont le commerce lui aura sans doute énormément apporté. Mais elle n’a jamais pu se détacher de cette cage dorée, et trop souvent on s’irrite de sa mentalité salonnarde, de son obsession de « l’opinion », de l’étroitesse d’un point-de-vue trop social pour être authentiquement singulier. Comme elle est petite, comme elle est enfermée dans son sexe et dans son milieu, en comparaison de son contemporain, l’exceptionnel auteur des Mémoires d’outre-tombe ! Et comme son amant Benjamin Constant est plus profond et plus aigu qu'elle !
En somme, on pourrait dire assez cruellement que Napoléon s’est constamment trompé sur elle : quand, chef d'État, il n’a pas su se la concilier, perdant un pouvoir d'influence qui aurait donné une autre couleur à son règne ; et quand, en exil, il a salué son mérite d'écrivain : « Il est vrai de dire que personne ne saurait nier, qu’après tout, Mme de Staël est une femme d’un très grand talent, fort distinguée, de beaucoup d’esprit : elle restera. »[2] Il voulait dire qu’elle resterait comme un auteur lu et relu : elle ne reste que comme un nom dans l’histoire littéraire. Mais tout le monde ne peut pas en dire autant !
J'ai constitué quatre rubriques : L'âme humaine Les femmes et l'amour Société et politique Arts et littérature
. La destination de l'homme sur cette terre n'est pas le bonheur, mais le perfectionnement. (Germaine de Staël, De l’Allemagne (1810), III, 14 ; éd. G.-F. n°167, 1968, tome II p. 196).
. Rien n'est moins applicable à la vie qu'un raisonnement mathématique. Une proposition en fait de chiffres est décidément fausse ou vraie ; sous tous les autres rapports le vrai se mêle avec le faux d’une telle manière que souvent l’instinct peut seul nous décider entre les motifs divers, quelquefois aussi puissants d’un côté que de l’autre. (Germaine de Staël, De l’Allemagne (1810), I, 18 ; éd. G.-F. n°166, 1968, tome I p. 139-140).
. Corinne : « Il ne faut pas se le cacher, il y a deux côtés à toutes les manières de voir : on peut vanter l’enthousiasme, on peut le blâmer ; le mouvement et le repos, la variété et la monotonie, sont susceptibles d’être attaqués et défendus par divers arguments ; on peut plaider pour la vie, et il y a cependant assez de bien à dire de la mort, ou de ce qui lui ressemble. Il n’est donc pas vrai qu’on puisse tout simplement mépriser ce que disent les gens médiocres, ils pénètrent malgré vous dans le fond de votre pensée. » (Germaine de Staël, Corinne ou l’Italie (1807), XIV, 1 ; Folio n°1632, 1985, p. 368).
. Personne n’avoue le motif personnel de ses opinions. (Germaine de Staël, Corinne ou l’Italie (1807), XIX, 4 ; Folio n°1632, 1985, p. 543). 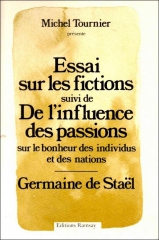
. Les dévots portent le scrupule au fond de leurs pensées les plus intimes ; ils finissent par se faire un crime de ces incertitudes passagères qui traversent quelquefois leur esprit. Il en est de même de tous les fanatismes ; l’imagination a peur du réveil de la raison, comme d’un ennemi étranger qui pourrait venir troubler le bon accord de ses chimères et de ses faiblesses. (Germaine de Staël, De la littérature (1800), II, 6 ; classiques Garnier, 1998, p. 371).
. La superstition se rapporte à cette vie et la religion à l’autre ; la superstition se lie à la fatalité et la religion à la vertu ; c’est par la vivacité des désirs terrestres qu’on devient superstitieux, c’est au contraire par le sacrifice de ces mêmes désirs qu’on est religieux. (Germaine de Staël, Dix années d’exil (1813), II ; éd. Fayard, 1996, p. 285-286).
. Corinne : « Les païens ont divinisé la vie, et les chrétiens ont divinisé la mort. » (Germaine de Staël, Corinne ou l’Italie (1807), IV, 2 ; Folio n°1632, 1985, p. 96).
. La vie ne semble souvent qu'un long naufrage, dont les débris sont l'amitié, la gloire et l'amour. Les rives du temps, qui s’est écoulé pendant que nous avons vécu, en sont couvertes. (Germaine de Staël, Réflexions sur le suicide, 1 ; L. Deconchy, Londres, 1813, p. 20-21 ou Œuvres complètes, tome I, Firmin-Didot, 1836, p. 182).
. Se peut-il que pour jouir d’un tel moment il ait fallu sentir les angoisses de l’enfer ! Pauvre nature humaine ! nous ne connaissons l'infini que par la douleur ; et dans toutes les jouissances de la vie, il n’est rien qui puisse compenser le désespoir de voir mourir ce qu’on aime. (Germaine de Staël, Corinne ou l’Italie (1807), XIII, 6 ; Folio n°1632, 1985, p. 358).
. Cette absence de sommeil rend la vie trop longue ; il n’y a pas assez d’intérêt pour vingt-quatre heures. (Germaine de Staël, lettre à sa cousine Adrienne Necker de Saussure, 13 avril 1816 ; dans Choix de lettres 1778-1817, Klincksieck, 1970, p. 521).
. La comtesse : « On se désintéresse à la fin de soi-même, / On cesse de s'aimer si quelqu'un ne nous aime. » (Germaine de Staël, Sophie ou les sentiments secrets (1786), acte II, scène 8 ; Œuvres complètes, tome II, Firmin-Didot, 1836, p. 338).
. Il n’y a rien de plus amer dans l’adversité que de ne pas pouvoir s’intéresser à soi. (Germaine de Staël, De l’influence des passions (1796), I, 5 ; dans Essai sur les fictions, Ramsay, 1979, p. 153).
. Ce que l'homme a fait de plus grand, il le doit au sentiment douloureux de l'incomplet de sa destinée. Les esprits médiocres sont, en général, assez satisfaits de la vie commune ; ils arrondissent, pour ainsi dire, leur existence, et suppléent à ce qui peut leur manquer encore par les illusions de la vanité ; mais le sublime de l’esprit, des sentiments et des actions doit son essor au besoin d’échapper aux bornes qui circonscrivent l’imagination. L’héroïsme de la morale, l’enthousiasme de l’éloquence, l’ambition de la gloire donnent des jouissances surnaturelles qui ne sont nécessaires qu’aux âmes à la fois exaltées et mélancoliques, fatiguées de tout ce qui se mesure, de tout ce qui est passager, d’un terme enfin, à quelque distance qu’on le place. (Germaine de Staël, De la littérature (1800), I, 11 ; classiques Garnier, 1998, p. 182).
. L'homme se sent si passager qu'il a toujours de l'émotion en présence de ce qui est immuable. (Germaine de Staël, Corinne ou l’Italie (1807), IV, 3 ; Folio n°1632, 1985, p. 101).
. Corinne : « C’est déjà un vif chagrin que de ne plus voir les lieux où l’on a passé son enfance : les souvenirs de cet âge, par un charme particulier, rajeunissent le cœur, et cependant adoucissent l’idée de la mort. La tombe rapprochée du berceau semble placer sous le même ombrage toute une vie ; tandis que les années passées sur un sol étranger sont comme des branches sans racines. » (Germaine de Staël, Corinne ou l’Italie (1807), XIV, 3 ; Folio n°1632, 1985, p. 377-378).
. Voyager est, quoi qu’on en puisse dire, un des plus tristes plaisirs de la vie. […] Traverser des pays inconnus, entendre parler un langage que vous comprenez à peine, voir des visages humains sans relation avec votre passé ni avec votre avenir, c’est de la solitude et de l’isolement sans repos et sans dignité. (Germaine de Staël, Corinne ou l’Italie (1807), I, 2 ; Folio n°1632, 1985, p. 32).
. Corinne : « L'exil est quelquefois, pour les caractères vifs et sensibles, un supplice beaucoup plus cruel que la mort. » (Germaine de Staël, Corinne ou l’Italie (1807), XIV, 3 ; Folio n°1632, 1985, p. 377).
. Ne savait-elle pas que l'amour-propre est ce qu'il y a au monde de plus inflexible ? (Germaine de Staël, Corinne ou l’Italie (1807), IV, 6 ; Folio n°1632, 1985, p. 124).
. Rien n’est si barbare que la vanité ; et comme la société, le bon ton, la mode, le succès, mettent singulièrement en jeu cette vanité, il n’est aucun pays où le bonheur des femmes soit plus en danger que celui où tout dépend de ce qu’on appelle l’opinion, et où chacun apprend des autres ce qu’il est de bon goût de sentir. (Germaine de Staël, De l’Allemagne (1810), I, 4 ; éd. G.-F. n°166, 1968, tome I p. 72). 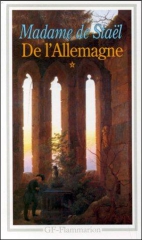
. Quelquefois il lui disait : « Je vous l'avais bien dit. » Singulière manière de consoler ; satisfaction que la vanité se donne aux dépens de la douleur ! (Germaine de Staël, Corinne ou l'Italie (1807), XVIII, 1; Folio n°1632, 1985, p. 508).
. Dans tout pays où il y aura de la vanité, le goût sera mis au premier rang, parce qu'il sépare les classes et qu'il est un signe de ralliement entre tous les individus de la première. Dans tous les pays où s’exercera la puissance du ridicule, le goût sera compté comme l’un des premiers avantages, car il sert surtout à connaître ce qu’il faut éviter. (Germaine de Staël, De l’Allemagne (1810), II, 14 ; éd. G.-F. n°166, 1968, tome I p. 247).
. Corinne : « Quand une fois on a tourné l’enthousiasme en ridicule, on a tout défait, excepté l’argent et le pouvoir. » (Germaine de Staël, Corinne ou l’Italie (1807), IV, 3 ; Folio n°1632, 1985, p. 99).
. Corinne : « Il n’y a rien de si facile que de se donner l’air très moral, en condamnant tout ce qui tient à une âme élevée. Le devoir, la plus noble destination de l’homme, peut être dénaturé comme toute autre idée, et devenir une arme offensive, dont les esprits étroits, les gens médiocres et contents de l’être se servent pour imposer silence au talent et se débarrasser de l’enthousiasme, du génie, enfin de tous leurs ennemis. » (Germaine de Staël, Corinne ou l’Italie (1807), XIV, 1 ; Folio n°1632, 1985, p. 366).
. Il y a quelque chose de triste au fond de la plaisanterie fondée sur la connaissance des hommes ; la gaieté vraiment inoffensive est celle qui appartient seulement à l'imagination. (Germaine de Staël, Corinne ou l’Italie (1807), VII, 2 ; Folio n°1632, 1985, p. 181).
. Corinne : « On a tort cependant de craindre la supériorité de l'esprit et de l'âme ; elle est très morale cette supériorité ; car tout comprendre rend très indulgent, et sentir profondément inspire une grande bonté. » (Germaine de Staël, Corinne ou de l'Italie (1807), XVIII, 5 ; Folio n°1632, 1985, p. 522).
. Les idées nouvelles déplaisent aux personnes âgées ; elles aiment à se persuader que le monde n’a fait que perdre, au lieu d’acquérir, depuis qu’elles ont cessé d’être jeunes. (Germaine de Staël, Corinne ou l’Italie (1807), XIX, 4 ; Folio n°1632, 1985, p. 544).
. Quand on s'est habitué à une vie de distractions, on éprouve toujours une sensation mélancolique en rentrant en soi-même, dût-on s'y trouver bien. (Germaine de Staël, Corinne ou l’Italie (1807), XV, 3 ; Folio n°1632, 1985, p. 401).
. Corinne : « Qui veut être heureux et développer son génie, doit, avant tout, bien choisir l'atmosphère dont il s'entoure immédiatement. » (Germaine de Staël, Corinne ou l’Italie (1807), XIV, 1 ; Folio n°1632, 1985, p. 371-372).
. On ne trouve de bon dans la vie que ce qui la fait oublier ; et si l’émotion pouvait être un état durable, bien peu de philosophes se refuseraient à convenir qu’elle serait le souverain bien. (Germaine de Staël, De l’influence des passions (1796), I, 5 ; dans Essai sur les fictions, Ramsay, 1979, p. 149).
. Il y a tant d’incertitude dans ce qu’on désire, de dégoût dans ce qu’on éprouve, qu’on ne peut concevoir comment on aurait le courage d’agir si […] on savait si positivement le prix de ce qu’on fait, la récompense de ses efforts. Comment exister sans être utile, et se donner la peine de vivre quand personne ne s’affligerait de nous voir mourir ? (Germaine de Staël, De l’influence des passions (1796), I, 5 ; dans Essai sur les fictions, Ramsay, 1979, p. 152).
. Il arrive souvent que les femmes d’un esprit supérieur sont en même temps des personnes d’un caractère très passionné ; toutefois la culture des lettres diminue les dangers de ce caractère, au lieu de les augmenter ; les jouissances de l'esprit sont faites pour calmer les orages du cœur. (Germaine de Staël, Lettres sur les écrits et le caractère de J.-J. Rousseau, seconde préface en 1814 ; Œuvres complètes, tome I, Firmin-Didot, 1836, p. 1).
. La prétendue légèreté des femmes vient de ce qu'elles ont peur d'être abandonnées ; elles se précipitent dans la honte par crainte de l'outrage. (Germaine de Staël, De l’Allemagne (1810), I, 4 ; éd. G.-F. n°166, 1968, tome I p. 72).
. Dans une époque où le mal universel est l’égoïsme, les hommes, auxquels tous les intérêts positifs se rapportent, doivent avoir moins de générosité, moins de sensibilité que les femmes ; elles ne tiennent à la vie que par les liens du cœur, et lorsqu’elles s’égarent, c’est encore par un sentiment qu’elles sont entraînées : leur personnalité est toujours à deux, tandis que celle de l'homme n'a que lui même pour but. (Germaine de Staël, De l’Allemagne (1810), I, 3 ; éd. G.-F. n°166, 1968, tome I p. 65).
. La nature et la société ont déshérité la moitié de l’espèce humaine ; force, courage, génie, indépendance, tout appartient aux hommes. (Germaine de Staël, De l’influence des passions (1796), I, 4 ; dans Essai sur les fictions, Ramsay, 1979, p. 142). 
. Certainement il vaut beaucoup mieux, en général, que les femmes se consacrent uniquement aux vertus domestiques. (Germaine de Staël, De la littérature (1800), II, 4 ; classiques Garnier, 1998, p. 325).
. Le père d’Oswald : « Dans les pays où les institutions politiques donnent aux hommes des occasions honorables d’agir et de se montrer, les femmes doivent rester dans l’ombre. » (Germaine de Staël, Corinne ou l’Italie (1807), XVI, 8 ; Folio n°1632, 1985, p. 467).
. On a raison d'exclure les femmes des affaires politiques et civiles ; rien n'est plus opposé à leur vocation naturelle que tout ce qui leur donnerait des rapports de rivalité avec les hommes, et la gloire elle-même ne saurait être pour une femme qu'un deuil éclatant du bonheur. (Germaine de Staël, De l’Allemagne (1810), III, 19 ; éd. G.-F. n°167, 1968, tome II p. 218).
. La facilité du divorce introduit dans les rapports de famille une sorte d’anarchie qui ne laisse rien subsister dans sa vérité ni dans sa force. Il vaut encore mieux, pour maintenir quelque chose de sacré sur la terre, qu'il y ait dans le mariage une esclave que deux esprits forts. (Germaine de Staël, De l’Allemagne (1810), III, 19 ; éd. G.-F. n°167, 1968, tome II p. 220).
. Le Turc qui renferme sa femme lui prouve au moins par là qu’elle est nécessaire à son bonheur : l’homme à bonnes fortunes […] choisit les femmes pour victimes de sa vanité ; et cette vanité ne consiste pas seulement à les séduire, mais à les abandonner. (Germaine de Staël, De l’Allemagne (1810), I, 4 ; éd. G.-F. n°166, 1968, tome I p. 71-72).
. L’amour est de toutes les passions la plus fatale au bonheur de l’homme. Si l’on savait mourir, on pourrait encore se risquer à l’espérance d’une si heureuse destinée ; mais l’on abandonne son âme à des sentiments qui décolorent le reste de l’existence ; on éprouve, pendant quelques instants, un bonheur sans aucun rapport avec l’état habituel de la vie, et l’on veut survivre à sa perte : l’instinct de la conservation l’emporte sur le mouvement du désespoir, et l’on existe, sans qu’il puisse s’offrir dans l’avenir une chance de retrouver le passé [ou] une raison même de ne pas cesser de souffrir, dans la carrière des passions, dans celle surtout d’un sentiment qui, prenant sa source dans tout ce qui est vrai, ne peut être consolé par la réflexion même. (Germaine de Staël, De l’influence des passions (1796), I, 4 ; dans Essai sur les fictions, Ramsay, 1979, p. 136-137).
. Il n’y a que les hommes capables de la résolution de se tuer qui puissent, avec quelque ombre de sagesse, tenter cette grande route de bonheur [= l’amour] : mais qui veut vivre, et s’expose à rétrograder ; mais qui veut vivre, et renonce, d’une manière quelconque, à l’empire de soi-même, se voue comme un insensé au plus cruel des malheurs. (Germaine de Staël, De l’influence des passions (1796), I, 4 ; dans Essai sur les fictions, Ramsay, 1979, p. 137).
. Rien n’est motivé dans l’amour ; il semble que ce soit une puissance divine qui pense et sent en nous, sans que nous puissions influer sur elle. (Germaine de Staël, Corinne ou l’Italie (1807), XV, 3 ; Folio n°1632, 1985, p. 403).
. L’amour est la seule passion des femmes ; l’ambition, l’amour de la gloire même leur vont si mal, qu’avec raison un très petit nombre s’en occupent. […] Pour une qui s’élève, mille s’abaissent au-dessous de leur sexe, en en quittant la carrière. […] L’amour est l’histoire de la vie des femmes, c’est un épisode dans celle des hommes. (Germaine de Staël, De l’influence des passions (1796), I, 4 ; dans Essai sur les fictions, Ramsay, 1979, p. 142-143).
. Quand on aime et qu'on ne se croit pas aimé, on se blesse de tout, et chaque instant de la vie est une douleur, et presque une humiliation. (Germaine de Staël, Corinne ou l'Italie (1807), XIX, 5 ; Folio n°1632, 1985, p. 552).
. Maintenant la médiocrité toute puissante force les esprits supérieurs à se revêtir de ses couleurs effacées. Il faut se glisser dans la gloire, il faut dérober aux hommes leur admiration à leur insu. (Germaine de Staël, De la littérature (1800), I, 1 ; classiques Garnier, 1998, p. 61).
. Il y a faiblesse dans la nation qui ne s’attache qu’au ridicule, si facile à saisir et à éviter, au lieu de chercher avant tout, dans les pensées de l’homme, ce qui agrandit l’âme et l’esprit. (Germaine de Staël, De la littérature (1800), I, 12 ; classiques Garnier, 1998, p. 188). 
. Politiquement, je crois que les républiques ne peuvent se passer du sentiment qui portait les anciens à se donner la mort ; et dans les situations particulières, les âmes passionnées qui s’abandonnent à leur nature ont besoin d’envisager cette ressource pour ne pas se dépraver dans le malheur, et plus encore peut-être au milieu des efforts qu’elles tentent pour l’éviter. (Germaine de Staël, De l’influence des passions (1796), I, 4, note de bas-de-page ; dans Essai sur les fictions, Ramsay, 1979, p. 137).
. L'éloquence, l'amour des lettres et des beaux-arts, la philosophie, peuvent seuls faire d'un territoire une patrie, en donnant à la nation qui l'habite les mêmes goûts, les mêmes habitudes et les mêmes sentiments. (Germaine de Staël, De la littérature (1800), Discours préliminaire, 3 ; classiques Garnier, 1998, p. 34-35).
. Une nation peut très facilement se contenter des biens communs de la vie, le repos et l’aisance ; et des penseurs superficiels prétendront que tout l’art social se borne à donner au peuple ces biens. Il en faut pourtant de plus nobles pour se croire une patrie. Le sentiment patriotique se compose des souvenirs que les grands hommes ont laissés, de l'admiration qu'inspirent les chefs-d’œuvre du génie national ; enfin de l'amour que l'on ressent pour les institutions, la religion et la gloire de son pays. (Germaine de Staël, De l’Allemagne (1810), I, 6 ; éd. G.-F. n°166, 1968, tome I p. 80).
. Rien n’est moins philosophique, c’est-à-dire rien ne conduirait moins au bonheur, que ce système jaloux qui voudrait ôter aux nations leur rang dans l’histoire, en nivelant la réputation des hommes. […] Il ne faut pas ôter aux grandes âmes leur dévotion à la gloire ; il ne faut pas ôter aux peuples le sentiment de l’admiration. De ce sentiment dérivent tous les degrés d’affection entre les magistrats et les gouvernés. (Germaine de Staël, De la littérature (1800), II, 3 ; classiques Garnier, 1998, p. 320).
. L’abondance factice mais inépuisable du papier-monnaie, le bas prix des denrées, l’humiliation des propriétaires qui en étaient réduits à se condamner extérieurement à la misère, tout faisait croire aux gens de la classe ouvrière que le joug de la disparité des fortunes allait enfin cesser de peser sur eux ; cet espoir insensé doublait les forces que la nature leur a données ; et l'ordre social, dont le secret consiste dans la patience du grand nombre, parut tout-à-coup menacé. (Germaine de Staël, Considérations sur la Révolution française (1816), IIIe partie, chap. XVII ; éd. Tallandier, 1983, p. 309).
. Des milliers d’hommes peuvent-ils se décider d’après leurs propres lumières ! N’est-il pas nécessaire qu’une impulsion plus animée se communique à cette multitude qu’il est si difficile de réunir dans une même opinion ? […] On croit assurer davantage l’indépendance d’un peuple, en s’efforçant de l’intéresser uniquement à des principes abstraits ; mais la multitude ne sépare point, dans ses impressions, les effets des causes, ni les hommes de leur influence sur les faits : elle saisit les idées par les événements ; elle exerce sa justice par des haines et des affections. (Germaine de Staël, De la littérature, II, 3, 1ère édition avril 1800 ; classiques Garnier, 1998, p. 320-321 et variante a).
. De quel droit des hommes qui étaient les instruments d’une autorité factieuse conservaient-ils le titre d’honnêtes gens parce qu’ils faisaient avec douceur une chose injuste ? […] La bienfaisance que l’on peut exercer en détail ne compense pas le mal dont on est l’auteur en prêtant l’appui de son nom au parti que l’on sert. […] Dès qu’on se met à composer avec les circonstances, tout est perdu, car il n’est personne qui n’ait des circonstances. (Germaine de Staël, De l’Allemagne (1810), III, 13 ; éd. G.-F. n°167, 1968, tome II p. 191).
. Aucun homme ne peut produire un grand effet que dans le sens de son siècle, et, si l’on étudie l’histoire de tous ceux qui ont changé la face du monde, on verra qu’ils n’ont fait pour la plupart que s’emparer à leur avantage de la tendance des esprits alors existante. (Germaine de Staël, Dix années d’exil (1813), I ; éd. Fayard, 1996, p. 83). 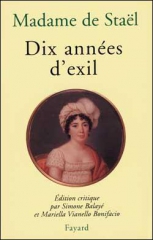
. Quelle est la nation qu’un gouvernement ne peut pas dépraver ? Les choses de ce monde sont arrangées de manière que, dans le cours ordinaire de la vie, il y a presque balance entre les avantages du vice et ceux de la vertu et c’est à la conscience à faire pencher cet équilibre, mais, quand les poids de la balance sont tout à coup augmentés du côté du vice et de huit cent millions pour séduire et de huit cent mille baïonnettes pour faire peur, la majorité des hommes n’est plus de force contre les appas et les terreurs dont on l’environne. (Germaine de Staël, Dix années d’exil (1813), I ; éd. Fayard, 1996, p. 109).
. Savoir mettre dans la tête d’une nation qu’elle est invincible, c’est la rendre telle au moins dans ses propres foyers, car la conquête est un hasard qui dépend peut-être encore plus des fautes des vaincus que du génie du vainqueur. (Germaine de Staël, Dix années d’exil (1813), II ; éd. Fayard, 1996, p. 284).
. Toute institution bonne relativement à tel danger du moment, et non à la raison éternelle, devient un abus insupportable, après avoir corrigé des abus plus grands. (Germaine de Staël, De la littérature (1800), I, 8 ; classiques Garnier, 1998, p. 144).
. Il y a des phrases pour tout, particulièrement dans le français, qui a tant servi pour tant de buts divers et momentanés. (Germaine de Staël, Considérations sur la Révolution française (1816), IIe partie, chap. XIX ; éd. Tallandier, 1983, p. 234).
. La première condition pour écrire, c’est une manière de sentir vive et forte. (Germaine de Staël, De l’Allemagne (1810), II, 1 ; éd. G.-F. n°166, 1968, tome I p. 160).
. Le bon goût en littérature est, à quelques égards, comme l’ordre sous le despotisme, il importe d’examiner à quel prix on l’achète. (Germaine de Staël, De l’Allemagne (1810), II, 14 ; éd. G.-F. n°166, 1968, tome I p. 248). 
. Sans doute, il faut, pour bien écrire, une émotion vraie, mais il ne faut pas qu’elle soit déchirante. Le bonheur est nécessaire à tout, et la poésie la plus mélancolique doit être inspirée par une sorte de verve qui suppose et de la force et des jouissances intellectuelles. La véritable douleur n’a point de fécondité naturelle : ce qu’elle produit n’est qu’une agitation sombre qui ramène sans cesse aux mêmes pensées. (Germaine de Staël, Corinne ou l'Italie (1807), XVIII, 4 ; Folio n°1632, 1985, p. 519).
. Le dégoût de l’existence, quand il ne porte pas au découragement, quand il laisse subsister une belle inconséquence, l’amour de la gloire, […] peut inspirer de grandes beautés de sentiments : c’est d’une certaine hauteur que tout se contemple ; c’est avec une teinte forte que tout se peint. (Germaine de Staël, De la littérature (1800), II, 5 ; classiques Garnier, 1998, p. 357).
[1] Journal, 20-26 août 1857 ; coll. Bouquins, 1989, tome I p. 295.
[2] Mémorial de Sainte-Hélène, 21 octobre 1816 (éd. Flammarion, 1983, tome II p. 454). Il est vrai que, dans les mois précédents, l’Empereur avait essayé de relire Delphine (18 janvier 1816 : tome I p. 357-358) et Corinne (13 août 1816 : tome II p. 187), romans où il a retrouvé avec exaspération la personnalité de l’auteur et qu’il a rejetés avec un jugement très critique. Napoléon est prodigue de confidences sur les manœuvres de Mme de Staël, qui n’a pas cessé d’essayer de le séduire, rêvant de devenir sa maîtresse, sa conseillère, son inspiratrice. Les rebuffades qu’elle a subies relativisent les très dures critiques qu’elle lui adresse tout au long de ses souvenirs inachevés et posthumes, Dix années d’exil (à lire dans l’édition critique parue chez Fayard en 1996, plutôt que dans les précédentes, assez éloignées du manuscrit). Quand elle reproche à Napoléon d’être une créature totalement insensible et dénuée d’humanité, même si on ne savait par ailleurs que ce reproche est absurde, on ne pourrait s’empêcher d’y voir avant tout le dépit de la séductrice, humiliée par un homme imperméable à son charme…
04:00 Écrit par Le déclinologue dans Aphorismes, Mœurs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mme de staël, necker, napoléon, mémorial de sainte-hélène, de l'influence des passions, chateaubriand, romantisme, lumières, cosmopolitisme, liberté, bonheur, vertu, femmes, passions, salons, de l'allemagne, corinne ou l'italie, delphine, réflexions sur le suicide, dix années d'exil, de la littérature, sophie ou les sentiments secrets, essai sur les fictions, amour, vanité, opinion, decazes, lettres sur jean-jacques rousseau, considérations sur la révolution française, benjamin constant, coppet, libéralisme, goncourt, george sand, simone balayé, hommes, mariage, exil |  |
|  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer | |
Imprimer | |  Digg |
Digg |  |
|


