04.12.2013
JULES RENARD, LE MINIMALISTE DE LA MAXIME
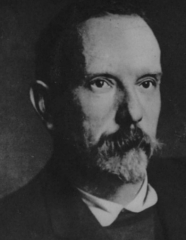 Jules Renard (1864-1910) n’est certes pas un écrivain dans la droite ligne des grandes orientations de ce blogue. Mais s’il fallait n’aimer que des choses homogènes, la vie serait bien pauvre, et l’activité de l’esprit bien restreinte. Du reste, j’ai déjà publié une anthologie des meilleurs aphorismes de La Bruyère, or Jules Renard, qui le prisait fort, en est un des meilleurs héritiers. C’est pourquoi j’ai rassemblé un choix de ses meilleures maximes, pour lesquelles j’ai beaucoup d’admiration.
Jules Renard (1864-1910) n’est certes pas un écrivain dans la droite ligne des grandes orientations de ce blogue. Mais s’il fallait n’aimer que des choses homogènes, la vie serait bien pauvre, et l’activité de l’esprit bien restreinte. Du reste, j’ai déjà publié une anthologie des meilleurs aphorismes de La Bruyère, or Jules Renard, qui le prisait fort, en est un des meilleurs héritiers. C’est pourquoi j’ai rassemblé un choix de ses meilleures maximes, pour lesquelles j’ai beaucoup d’admiration.
Nous n’avons pas affaire à un grand écrivain, et encore moins à un grand esprit. Il est tout-à-fait dépourvu de la moindre imagination, et fermé aux grands sujets : « De toute la vie de Napoléon je ne tirerais pas un drame de cinq minutes » (Journal, 2-2-1902). Vice rebutant chez un journalier, il a un horizon intellectuel terriblement limité. Il est imperméable à la philosophie, voire à toute pensée : « Qu’est-ce qu’un penseur ? Tant qu’il ne m’aura pas donné l’explication de l’univers, je dirai que je me fiche de sa pensée » (Journal, 23-1-1907), idée qui revient plusieurs fois dans son Journal, exprimée avec de légères variations (voir aussi une note du 4-3-1909, où il résiste à Rosny s’efforçant de lui montrer l’intérêt des grands penseurs : « dans un beau vers de Victor Hugo, il y a plus de pensées que dans tel livre de métaphysique »). On connaît encore sa triste boutade : « Nietzsche. Ce que j’en pense ? C’est qu’il y a bien des lettres inutiles dans son nom » (7-7-1906), où hélas l’affectation d’imbécilité n’est peut-être que le masque transparent d’une imbécilité réelle. Cet obsédé du style, maniaque du mot juste et de la formule frappante, s’intéresse bizarrement assez peu au langage : sans attendre de lui qu’il poussât la réflexion sur ce sujet aussi loin qu’un Paulhan, on s’étonne de ne le voir presque jamais consigner une observation sur les mots, sur la grammaire, sur la langue. (Il semble ici partager notre étonnement : « C’est assez singulier qu’aucun de nous ne sache sa grammaire et, pour être écrivain, ne veuille apprendre à écrire » (4-8-1897), mais ramène le problème à une pure technique, comme si les principes mêmes de l’écriture ne méritaient pas d’être questionnés). Ses curiosités littéraires sont aussi incroyablement réduites [1] : il a lu les romantiques dans sa jeunesse avant de les renier (selon la norme de sa génération), il pratique un peu ses contemporains (pas forcément les meilleurs), quelques classiques qu’il reconnaît comme ses modèles (Molière, La Fontaine, La Bruyère), et c’est à peu près tout. Il est imperméable aux symbolistes, qu’il croise rarement, d’où le mot fameux : « Mallarmé, intraduisible, même en français » (1-3-1898). Il n’aime ni le roman ni la poésie. Jamais il ne nous étonne par des lectures inattendues ou des dilections détonnantes (à l’exception de son dieu Hugo, qui est à ses antipodes mais qu’il adore de façon incohérente et un peu puérile). Les littératures étrangères n’existent quasiment pas pour lui. Alors qu’il rejette le patriotisme comme facteur de guerre (14-6-1899), qu’il est dreyfusard (voir son texte de soutien à Zola : 23-2-1898), qu’il s’engagera dans ses dernières années au côté de Jaurès, en littérature il est chauvin comme pas deux : « Je crie à tue-tête que tous les étrangers m’assomment, qu’il peut y avoir de bonnes choses çà et là, mais qu’il n’y en a de parfaites que chez nous, et que je n’aime que la littérature française » (15-11-1896). En tant qu’homme de théâtre, il ne peut ignorer Shakespeare, mais c’est pour confesser que : « Premier aveu : je ne comprends pas toujours Shakespeare. Deuxième aveu : je n’aime pas toujours Shakespeare. Troisième aveu : Shakespeare m’embête toujours » (25-1-1896). Bref, en fait de nourriture intellectuelle, il n’a rien de richement protéiné à nous offrir, seulement quelques maigres légumes acides.
Jules Renard est avant tout un observateur et un styliste, du genre sec. Son champ d’observation est fort étroit. Il y a la vie parisienne bourgeoise, sur laquelle il est assez mordant, mais peu original. Son univers de prédilection est la campagne, et plus précisément son village nivernais de Chitry-les-Mines. Scrutant la nature, les animaux et les paysans, il y trouve un gisement inépuisable de notations, à la fois lucides et tendres. La campagne de Renard n’est pas moins âpre que celle de Maupassant, mais elle se colore progressivement d’une humanité et d’une poésie uniques. Est-ce l’âme de Renard qui s’est projetée sur Chitry, ou est-ce Chitry qui a déteint sur l’âme de Renard ? Mystère de la création littéraire ! Celui-ci était en tout cas conscient qu’il tirait de là le meilleur de son œuvre : « mon village est ma mine d’or », écrivait-il (Journal, 25-11-1901), allant jusqu’à se figurer que ce trou était un abrégé suffisant de l’univers : « dans ce coin du monde qu’est un village, il y a à peu près toute l’humanité » (26-6-1908), – phrase qui montre que ce naturaliste était d’abord un classique, et qui accuse ses limites. Ses conceptions littéraires sont erronées mais (à l’instar de Zola), il ne les a appliquées qu’en partie. L’idolâtrie du « vrai » l’a condamné à la simple retranscription de ce qu’il avait sous les yeux : « l’horreur que j’ai du mensonge m’a tué l’imagination » (6-9-1906), le réduisant à n’être que le chroniqueur de son village : « romancer le paysan, c’est presque faire une insulte à sa misère. Le paysan n’a pas d’histoire, du moins pas d’histoires romanesques » (12-9-1906). À la fin, l’imagination lui fait carrément horreur : « Le naturel, c’est l’amour de la vérité. L’imagination est, en tout, une odieuse corruptrice » (1-2-1909). On peut, comme lui, voir en Chitry un aleph donnant accès au monde entier. Mais on peut aussi préférer un univers littéraire plus large, plus riche, plus varié, plus débridé… Comme tout classique, Renard a la superstition du « mot juste » : « Le mot juste ! Le mot juste ! Quelle économie de papier le jour où une loi obligera les écrivains à ne se servir que du mot juste ! » (22-11-1894), il croit à la transparence de l’écriture : « Le style, c'est l'oubli de tous les styles » (7-4-1891), et à l’adéquation parfaite du fond et de la forme unique qui lui correspond : « les mots ne doivent être que le vêtement, sur mesure rigoureuse, de la pensée » (27-9-1902). Heureusement pour nous, il n’a pas vraiment mis en pratique cette esthétique anti-littéraire, qui menait à la plus ennuyeuse des écritures blanches : son style elliptique se voit très bien, et toutes ses trouvailles drolatiques ou poétiques sont autant de preuves qu’il n’existe pas un réel objectif auquel correspondrait une expression exclusive trouvable par quiconque, mais une infinité de subjectivités qui toutes peuvent choisir l’expression singulière qui leur convient le mieux. Sans doute approuvait-il chaudement le précepte anti-poétique par excellence, tiré de La Bruyère : « Si vous voulez dire : il pleut, dites : il pleut » [2]. Heureusement pour nous, il a préféré écrire : « Pluie, pluie, mouille, mouille, hache l’air, écrase aux vitres tes perles molles » (« La pluie », dans Bucoliques, Pléiade Œuvres, 1971, tome II p. 242).
Son œuvre la plus populaire, Poil de carotte, est devenue un livre pour enfants, fâcheux contresens. 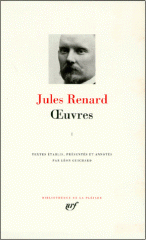 Il ne s’agit pas d’un roman mais plutôt d’un recueil de nouvelles ne formant pas une trame narrative : un ensemble de scénettes indépendantes, juxtaposées sans évolution temporelle, écrites au présent et artistement composées. Peu de livres, sans doute, peuvent donner une impression aussi différente lus à vingt ans d’intervalle : quand on est petit, on n’y voit que le fond, on est ému et bouleversé par ce pauvre enfant en butte aux brimades constantes d’une mère indigne ; une fois qu’on a acquis le sens de la littérature, on n’y voit plus que la forme, on est émerveillé par ces eaux-fortes si travaillées, ces effets de chute si concertés, ces phrases lapidaires qui fuient toute effusion sentimentale. L’art de Jules Renard est un art de miniaturiste. Il excelle à dessiner des « pointes sèches », mais n’essaye même pas de faire autre chose. Toute son œuvre est en effet de la même tenue. Crime de village, Sourires pincés, Coquecigrues, La Lanterne sourde, Le Vigneron dans sa vigne, La Maîtresse, Histoires naturelles, Bucoliques, Nos frères farouches. Ragotte : ces neuf livres, auxquels on peut ajouter le recueil posthume L’Œil clair, sont tous des groupements disparates de pièces brèves, dépassant rarement trois pages et tenant parfois en quelques lignes : nouvelles, dialogues, croquis pris sur le vif, anecdotes, instantanés de la vie parisienne et de la vie rurale, descriptions amusées ou cruelles ou tendres des hommes et des bêtes. Très peu de composition dans ces ensembles : plusieurs pièces sont mêmes passées d’un recueil à un autre ! Renard n’est décidément pas un auteur à œuvre, mais un auteur à page… voire un auteur à phrase. On hésite à considérer comme un roman L’Écornifleur : à l’instar de Poil de carotte, il est fait de scènes indépendantes. Elles ont beau être reliées par une intrigue assez lâche qui progresse sensiblement, l’usage du présent descriptif donne plus l’impression d’une collection d’épisodes que d’un véritable récit. Il n’y a guère que son deuxième livre, Les Cloportes, publié posthume en 1919, qui soit fait d’un tissu narratif continu et puisse donc être considéré comme un roman dans l’acception conventionnelle du terme. Et justement, c’est son plus mauvais livre.
Il ne s’agit pas d’un roman mais plutôt d’un recueil de nouvelles ne formant pas une trame narrative : un ensemble de scénettes indépendantes, juxtaposées sans évolution temporelle, écrites au présent et artistement composées. Peu de livres, sans doute, peuvent donner une impression aussi différente lus à vingt ans d’intervalle : quand on est petit, on n’y voit que le fond, on est ému et bouleversé par ce pauvre enfant en butte aux brimades constantes d’une mère indigne ; une fois qu’on a acquis le sens de la littérature, on n’y voit plus que la forme, on est émerveillé par ces eaux-fortes si travaillées, ces effets de chute si concertés, ces phrases lapidaires qui fuient toute effusion sentimentale. L’art de Jules Renard est un art de miniaturiste. Il excelle à dessiner des « pointes sèches », mais n’essaye même pas de faire autre chose. Toute son œuvre est en effet de la même tenue. Crime de village, Sourires pincés, Coquecigrues, La Lanterne sourde, Le Vigneron dans sa vigne, La Maîtresse, Histoires naturelles, Bucoliques, Nos frères farouches. Ragotte : ces neuf livres, auxquels on peut ajouter le recueil posthume L’Œil clair, sont tous des groupements disparates de pièces brèves, dépassant rarement trois pages et tenant parfois en quelques lignes : nouvelles, dialogues, croquis pris sur le vif, anecdotes, instantanés de la vie parisienne et de la vie rurale, descriptions amusées ou cruelles ou tendres des hommes et des bêtes. Très peu de composition dans ces ensembles : plusieurs pièces sont mêmes passées d’un recueil à un autre ! Renard n’est décidément pas un auteur à œuvre, mais un auteur à page… voire un auteur à phrase. On hésite à considérer comme un roman L’Écornifleur : à l’instar de Poil de carotte, il est fait de scènes indépendantes. Elles ont beau être reliées par une intrigue assez lâche qui progresse sensiblement, l’usage du présent descriptif donne plus l’impression d’une collection d’épisodes que d’un véritable récit. Il n’y a guère que son deuxième livre, Les Cloportes, publié posthume en 1919, qui soit fait d’un tissu narratif continu et puisse donc être considéré comme un roman dans l’acception conventionnelle du terme. Et justement, c’est son plus mauvais livre.
Son théâtre ajoute peu à sa gloire, et presque rien à son œuvre :  théâtre de conversation agréable mais sans génie, ses huit pièces de théâtre ne sont que des piécettes de vingt ou trente pages pour première partie de soirée, sauf deux qui ont une certaine ampleur et atteignent deux actes : Monsieur Vernet, d’après L’Écornifleur ; et La Bigote — c’est-à-dire Mme Lepic, la mère de Poil de carotte —, pièce dont le sujet initial vient d’un chapitre des Cloportes déjà repris dans une page de Coquecigrues. Ces huit pièces ne nous font pas changer d’univers et à peine de style : sept d’entre elles sont directement tirées d’œuvres narratives ou dialoguées, dont elles constituent de simples variations. Seul Le Pain de ménage n’est pas une réécriture d’autres textes.
théâtre de conversation agréable mais sans génie, ses huit pièces de théâtre ne sont que des piécettes de vingt ou trente pages pour première partie de soirée, sauf deux qui ont une certaine ampleur et atteignent deux actes : Monsieur Vernet, d’après L’Écornifleur ; et La Bigote — c’est-à-dire Mme Lepic, la mère de Poil de carotte —, pièce dont le sujet initial vient d’un chapitre des Cloportes déjà repris dans une page de Coquecigrues. Ces huit pièces ne nous font pas changer d’univers et à peine de style : sept d’entre elles sont directement tirées d’œuvres narratives ou dialoguées, dont elles constituent de simples variations. Seul Le Pain de ménage n’est pas une réécriture d’autres textes.
Le style de Jules Renard est fondé sur la sobriété, la précision des termes, et par-dessus tout la netteté du trait. Il vise à une simplicité toute classique, pour mieux mettre en valeur une image saisissante, une trouvaille pittoresque, un éclair poétique, une cocasserie impromptue. Renard croit à la beauté du monde, ou plutôt à la beauté des parcelles du monde, mais plus encore à la capacité d’un langage dégraissé à refléter exactement cette beauté fragmentaire du monde. Il y a chez lui, comme chez La Bruyère, une esthétique du discontinu, un goût pour les arêtes tranchantes et les clausules interrompues, qui cassent la scène pour en ouvrir plus largement les suggestions : « l’infini diminutif » cher à Baudelaire s’obtient par l’éclat, qui suscite plus de rêve que l’œuvre complète délimitant et enfermant l’imaginaire du lecteur. Son pointillisme tend à quintessencier l’observation dans une seule phrase, et s’il avait plus vécu, peut-être eût-il fini par publier un livre composé non plus de pièces brèves d’une à trois pages, mais seulement de phrases isolées. Et dailleurs, si on en retire les anecdotes, c’est justement à cela que ressemble son Journal ! Aussi fait-il partie de ces écrivains dont le travail essentiel consiste dans la suppression, retranchant leurs textes dans une quête presque morbide du squelette sur lequel il n’y aurait plus aucun bout de chair à gratter. « Je ne peux plus relire mes livres, parce que je sens que j’en ôterais encore », disait-il lui-même (Journal, 13-12-1896) ; et aussi : « mon style m’étrangle » (10-1-1898) ; ou encore : « Des plus belles choses que j'admire, je dis encore que c'est trop long » (29-5-1898). Peu perméable aux modes de son temps, il trace son sillon en solitaire, non sans rêver au succès, surtout sur scène. Dans un rarissime moment de triomphalisme, alors que d’ordinaire il se prend pour un raté définitif, le voilà qui se met à croire que l’avenir joue pour lui : « La postérité appartiendra aux écrivains secs, aux constipés » (12-8-1890). Mais il mourra à peu près au moment où Proust se lance dans l’écriture de la Recherche…
Sa meilleure pièce s’intitule Le Plaisir de rompre (1897), et elle pourrait définir sa pratique de l’écriture. Toutefois il semble que Renard ne se soit pas avisé que son titre vaudevillesque pouvait aussi s’entendre comme une définition de son style, voire comme une poétique (sauf peut-être dans cette notation du 25-12-1897 : « Le plaisir, non de rompre, mais d’allonger : voilà leurs pièces en cinq actes », mais c’est juste pour rabaisser ses confrères ; ainsi que dans cette notation tardive du 28-8-1908, où il prétend n’être pas un observateur, ayant peur d’observer : « je refuse de regarder, j’aime mieux rompre »). Là où un Nabokov n’aurait pas raté la correspondance entre l’action des personnages et le style de l’auteur, Renard reste à cent lieues de ce jeu métatextuel, et il est inutile de chercher dans cette piécette en un acte la métaphore de l’écriture renardienne, qui reste celle d’un honnête artisan rural, à la culture limitée et aux idées bornées. Il s’agit d’un marivaudage de qualité, qui fait entendre subtilement la discordance entre le cœur et l’attitude, mais qui ne décolle jamais au-dessus de son sujet. Ces vingt pages, qui se jouent en une demi-heure, nous montrent une rupture ratée, dont l’amertume s’enrobe d’une vaine gaîté : un tragique feutré, étouffé sous les convenances, bon pour l’âge bourgeois. C’est une belle réussite, mais dans un genre mineur. Tirée d’un épisode autobiographique (Renard a-t-il jamais inventé quelque chose ?), elle montre le fond de tristesse sur lequel repose toute l’œuvre de cet humoriste, un humoriste dailleurs assez particulier, dont l’humour très noir n’est pas loin du grotesque triste cher à Flaubert, « le comique qui ne fait pas rire ».
L’œuvre la plus intéressante de Jules Renard est son fameux Journal. Il faut tout-de-suite signaler qu’il est difficile d’en parler de façon certaine, car une veuve abusive a fait de ce chef-d’œuvre l’une des pires publications posthumes de notre histoire littéraire, du moins au XXe siècle [3].
On retrouve dans le Journal les mêmes personnages qui forment le matériau privilégié de son œuvre. Le monde de Balzac brassait des milliers de personnages qui font concurrence à l’état-civil, le microcosme de Renard est une toute petite société à six ou sept personnes : son domestique Philippe et Ragotte la femme de celui-ci, sa voisine Honorine, sa cousine Nanette, le cultivateur et poète rural Ponge (aucun rapport avec Francis ! De son vrai nom, il s’appelait Joseph Morin), Jules Renard lui-même alias Poil de carotte et alias Éloi, son père et sa mère alias M. et Mme Lepic… Même ces derniers, Renard les désigne souvent dans son Journal sous le pseudonyme qu’il leur a attribué dans ses œuvres de fiction ! Rarement la porosité aura été aussi totale entre une œuvre faussement romanesque et un journal intime. Ces deux tiers du Journal que la veuve aurait brûlés, il n’est pas exclu que nous les ayons en bonne partie dans ses autres livres.
Néanmoins ce Journal nous permet de connaître Renard plus intimement que ses œuvres.  C’est pour voir que l’homme a beaucoup de vilains défauts : il est paresseux, vaniteux, envieux, jaloux, petit, égocentrique, hypocrite, impressionné par la réussite et l’argent, avide de renommée. Il se sent médiocre et ramène tout au niveau de sa médiocrité. Il distille en permanence le fiel rance du petit-bourgeois aigri, mécontent de tout parce que mécontent de lui-même. Mais ces défauts, il les voit en toute lucidité et les confesse avec une remarquable humilité, voire une autodérision et un sens de l’humour réjouissants : « Je vois la vie en rosse » (11-10-1905). Du coup, la lecture de son Journal suscite un certain malaise : on ne sait trop s’il faut mépriser ce raté ou admirer son autoportrait sans complaisance [4]. On se sent un peu honteux de le prendre en affection et de regarder avec empathie ce coin de la création vu à travers un tempérament qu’il nous offre. Tantôt on se reconnaît avec résignation dans le miroir qu’il nous tend, tantôt on se révolte : Suis-je donc si méprisable moi aussi ?, a-t-on envie de s'écrier. Ma vie est-elle aussi ennuyeuse que la sienne ? Pour être humain, suis-je moi aussi nécessairement veule, mesquin, égoïste et neurasthénique ! Le Journal de Jules Renard est un magnifique réservoir de bons mots pour briller en société : c’est donc une lecture dont on est aise de se vanter devant ceux qui ne l’ont pas faite. Mais il faut être discret face à ceux qui le connaissent bien : leur avouer qu’on s’y est plongé avec délices, c’est ouvrir une lucarne sur une facette peu reluisante de notre âme. Aux esprits désenchantés, l’humour permet de sauver la face, mais il ne ravale pas cette face sordide. On peut faire éclater de rire ses amis en leur rapportant un bon mot de Renard, par exemple : « Quand je donne un billet de cent francs, je donne le plus sale » (Pléiade p. 476) ou « On gagne à être connu. On perd à être trop connu » (p. 276), mais ce rire sonnera faux, car ils sentiront bien que, derrière la forfanterie de cynisme, il y a un aveu déguisé.
C’est pour voir que l’homme a beaucoup de vilains défauts : il est paresseux, vaniteux, envieux, jaloux, petit, égocentrique, hypocrite, impressionné par la réussite et l’argent, avide de renommée. Il se sent médiocre et ramène tout au niveau de sa médiocrité. Il distille en permanence le fiel rance du petit-bourgeois aigri, mécontent de tout parce que mécontent de lui-même. Mais ces défauts, il les voit en toute lucidité et les confesse avec une remarquable humilité, voire une autodérision et un sens de l’humour réjouissants : « Je vois la vie en rosse » (11-10-1905). Du coup, la lecture de son Journal suscite un certain malaise : on ne sait trop s’il faut mépriser ce raté ou admirer son autoportrait sans complaisance [4]. On se sent un peu honteux de le prendre en affection et de regarder avec empathie ce coin de la création vu à travers un tempérament qu’il nous offre. Tantôt on se reconnaît avec résignation dans le miroir qu’il nous tend, tantôt on se révolte : Suis-je donc si méprisable moi aussi ?, a-t-on envie de s'écrier. Ma vie est-elle aussi ennuyeuse que la sienne ? Pour être humain, suis-je moi aussi nécessairement veule, mesquin, égoïste et neurasthénique ! Le Journal de Jules Renard est un magnifique réservoir de bons mots pour briller en société : c’est donc une lecture dont on est aise de se vanter devant ceux qui ne l’ont pas faite. Mais il faut être discret face à ceux qui le connaissent bien : leur avouer qu’on s’y est plongé avec délices, c’est ouvrir une lucarne sur une facette peu reluisante de notre âme. Aux esprits désenchantés, l’humour permet de sauver la face, mais il ne ravale pas cette face sordide. On peut faire éclater de rire ses amis en leur rapportant un bon mot de Renard, par exemple : « Quand je donne un billet de cent francs, je donne le plus sale » (Pléiade p. 476) ou « On gagne à être connu. On perd à être trop connu » (p. 276), mais ce rire sonnera faux, car ils sentiront bien que, derrière la forfanterie de cynisme, il y a un aveu déguisé.
Le Journal contient beaucoup d’aperçus sur l’humeur de son auteur, mais on est quand même loin d’une introspection psychologique approfondie comme chez Amiel. De temps en temps, quelques jugements littéraires plus ou moins bien venus [5], mais on est loin d’un cahier de lectures comme l’est par moments le journal de Gide. Quelques considérations sur les œuvres en cours, mais superficielles et peu éclairantes : on est loin du Journal des Faux-Monnayeurs de Gide ou des lettres de Flaubert à Louise Colet pendant qu’il écrivait Madame Bovary. Beaucoup d’observations sur la vie rurale, mais on est loin d’une ethnographie méthodique. Beaucoup d’anecdotes sur la vie littéraire, mais on est loin d’une chronique de la république des lettres : dans cette catégorie, Renard est bien moins informé que les Goncourt, Léautaud, Mathieu Galey ou Jacques Brenner. Ses fréquentations sont assez limitées, et excèdent peu un petit cercle où l’on croise de façon privilégiée ses trois grands amis Lucien Guitry, Tristan Bernard et Alfred Capus, ainsi que, moins souvent, Rostand (au début), Barrès, André Antoine, Marcel Schwob, Alphonse Allais, Léon Blum, Catulle Mendès, Paul Hervieu, à la fin les membres de l’académie Goncourt : Léon Daudet, Élémir Bourges, Mirbeau, les Rosny, à la fin aussi Jaurès. Mais il y a peu de choses, finalement, sur la personnalité de ces gens : Renard rapporte des anecdotes et des bons mots, il se soucie peu de les explorer comme un romancier le fait de ses personnages.
On pourrait dire que le Journal de Jules Renard est constitué de trois composants principaux : – des anecdotes, tranches de vie, dialogues ; – des aphorismes ; – des phrases isolées. La frontière entre les deux dernières catégories est parfois floue. Néanmoins, il est certain que le Journal de Renard contient, par centaines, des phrases, ou bouts de phrase, tout à fait dépourvues de l’idée générale ou de l’observation morale qui font l’aphorisme. Ce sont des sortes de photographies verbales, formules valant pour elles-mêmes, souvent purement nominales. Comme un collectionneur de papillons, Renard épingle dans son album une métaphore, une alliance de mots, un calembour, une perception fulgurante, une invention poétique, un éclat de la nature. Voici un échantillon, ramassé au hasard du feuilletage, de ces phrases données pour elles-mêmes : « Les valseurs tournent sur leurs gonds » (Pléiade p. 141) ; « Monter au ciel par une corde de pendu » (p. 158) ; « En tombant, elle montra son derrière, et un chien qui passait se mit à hurler » (p. 175) ; « Barrès, ce jonc coupant » (p. 187) ; « Roman taillé en pleine chair vive » (p. 190) ; « Le ver à soie file un mauvais cocon » (p. 262) ; « La chaleur légère, ailée, d’un feu de bois » (p. 263) ; « Les arbres, moutons de la forêt » (p. 232) ; « Une femme électrique qu’on n’oserait pas toucher du doigt » (p. 411) ; « J’écoute pousser ma barbe » (p. 526) ; « Maintenant, il faut lire entre les lignes du téléphone » (p. 588) ; « L’escargot promène son petit chignon » (p. 769) ; « Tirer sur un sanglier et ne lui tuer que les poux » (p. 741) ; « Après l’orage, une nuit noire, faite de tous les éclairs éteints » (p. 782) ; « Gâteaux fades qui font apprécier le pain » (p. 811) ; « La poussière, ce vent visible » (p. 832) ; « L’eau tremble : on dirait un lac de feuilles d’argent » (p. 836) ; « Petites feuilles, le duvet de la nature » (p. 898) ; « Le léger clapotement d’un cœur qui se fatigue » (p. 901) ; « Cloche : jupe sonore » (p. 918) ; « Les araignées ont fait leurs sciences : fortes études en géométrie » (p. 920) ; « La lanterne : une bougie en prison » (p. 924) ; « Merle noir dans un cerisier blanc » (p. 1049) ; « Colique : le serpent chez soi » (p. 1107) ; « Le mépris d’un lis pour un petit pois » (p. 1118), etc.
De même, dans les Histoires naturelles, sans doute le plus renardien des livres de Renard, certains animaux sont évoqués non pas par une page narrative ou descriptive, mais par une simple phrase qui tend au haïku : « L’araignée. Toute la nuit, au nom de la lune, elle appose ses scellés » (Pléiade Œuvres, 1971, tome II p. 131) ; « Le papillon. Ce billet doux plié en deux cherche une adresse de fleur » (p. 135) ; « L’écureuil. Leste allumeur de l’automne, il passe et repasse sous les feuilles la petite torche de sa queue » (p. 136).
Parler de haïku, c’est avancer l’idée d’un japonisme chez Jules Renard. Les phrases que j’ai citées ne sauraient passer pour des haïkus canoniques, non seulement parce qu’elles ne sont pas construites selon le rythme 5/7/5, mais aussi parce qu’elles ne suggèrent pas directement l’évanescence des choses. Cependant, il me semble que Renard n’a pas méconnu celle-ci, à moins qu’il ne s’agisse que d’un effet de style : ses phrases détachées d’entomologiste finissent par dissoudre l’observateur, comme si ces milliers de petits éclats de monde rendaient impossible toute perception globale, comme si l’univers n’était qu’un nuage fait d’une myriade de minuscules gouttelettes en suspension qu’un coup de vent suffirait à disperser. D’autre part, la fin du Journal rend un son poignant : atteint d’artériosclérose et affaibli, Renard s’est senti vieilli avant l’heure. Il semble avoir accepté (attendu ?) la mort avec plusieurs mois d’avance (il est mort le 22 mai 1910, à 46 ans), voire plusieurs années. Par exemple : « Est-ce que ça va se prolonger longtemps, cette vie-là ? J’aurais pu faire une demi-douzaine de livres de plus, pas un de mieux » (7-4-1909). Dans les dernières semaines, il l’envisage avec fermeté : « Déjà, je prends appétit à me promener dans les cimetières » (10-12-1909, p. 1261), ou bien : « D’ailleurs, j’ai fini. Je pourrais recommencer, et ce serait mieux, mais on ne s’en apercevrait pas. / Il vaut mieux mettre fin » (27-2-1910, p. 1266), ou encore : « Mort de Moréas. Est-ce mon tour ? » (31-3, avant-dernière notation). Cette fin de sage stoïcien amène à considérer rétrospectivement la vie et le Journal de Renard comme une longue ascèse : une sorte de quête tenace de l’effacement du moi, un exercice spirituel impliquant un retrait du monde consenti et assumé, comme si, dès le début, son écriture élusive avait pour aboutissement inéluctable le silence définitif. De la sorte, le japonisme de Jules Renard me paraît excéder largement les pseudo-haïkus des Histoires naturelles : autodiscipline rigoureuse, préférence pour l’implicite et l’allusif, esthétique minimaliste, goût de la miniature, culte de la nature mais célébré par l’attention au détail fugitif plutôt que par l’effusion cosmique, conscience aigüe de l’éphémérité des choses, rejet du sentimentalisme, pudeur, effacement du sujet : autant de traits de l’art et de l’esprit de Jules Renard qui me paraissent si concordants avec l’âme nippone que je serais tenté de définir celui-ci comme le plus grand écrivain japonais de langue française.
Ce japonisme général de Renard n’a-t-il frappé que moi ? Il semble que les littérologues contemporains soient obnubilés par le petit recueil des Histoires naturelles. Dans un colloque de juin 1990, publié à Nevers l’année suivante, je relève un article de Franck Bauer, « Jules Renard japonais ou : les Histoires naturelles sont-elles des haïkus ? ». Ces trente pages ne devaient pas suffire, car une étudiante japonaise, Mayumi Ozeki, a déposé fin 2009 ce sujet de thèse à Lyon-3 : « Le japonisme dans Histoires naturelles de Jules Renard ». Quelle étroite fenêtre ! C’est le Journal, c’est l’œuvre entière qu’il fallait examiner.
Car l’époque où vécut Jules Renard correspond exactement, comme par hasard, à l’âge d’or du japonisme français et européen : les noms de Goncourt, Pierre Loti (Madame Chrysanthème, Japoneries d’automne), Heredia, Claudel, Proust, Van Gogh, Monet, Puccini (Madame Butterfly) suffisent à montrer l’impact du pays du Soleil levant de l’ère Meiji sur notre culture autour de 1900. Il n’est dès lors pas étonnant que le rapprochement ait été fait à l’époque. Ainsi Paul Souday, rendant compte de L’Œil clair dans un article du Temps le 24 décembre 1913, signale-t-il qu’ « il y a chez lui du japonisme et une tendance à la féerie : Jules Renard prête volontiers les apparences ou les intentions de la vie consciente aux objets inanimés ». À la sortie des Histoires naturelles, un certain Marc Legrand avait déjà écrit dans La Fraternité (8 avril 1896) : « Jules Renard est un Japonais, mais il est mieux encore, il est un Japonais ému ».
Toute la question est de savoir si on à affaire à une influence directe et reconnue, comme chez les auteurs et artistes susmentionnés, ou bien à une simple rencontre de hasard, imputable à un certain esprit d’époque. J’incline pour la seconde hypothèse. Son nom n’apparaît pas dans le livre de Michel Butor, Le Japon depuis la France. Un rêve à l’ancre (Hatier, 1995), mais ce petit essai très creux, qui n'ajoute que quelques bavardages à une simple collecte de longues citations, gâche du papier (comme les Improvisations du même auteur) sans prouver grand-chose. Il ne remplace pas une solide thèse universitaire sur le japonisme 1900 en France, qui à ma connaissance n’existe pas en librairie [6], et qui pourrait nous renseigner sur un rapport direct entre Renard et le Japon. Un court passage du Journal nous montre que Renard a été confronté au moins une fois à ce diagnostic de japonisme. Mais toujours aussi fermé à toute pensée conceptuelle, il n’a réagi que par une boutade vaine et décourageante : « Je viens d’écrire que vous êtes un artiste japonais. / — Merci. J’accepte. C’est exact, et ça vexera les Chinois » (28-11-1895, p. 301). Nous voilà à peine plus avancés…
Japonisme d’influence ou para-japonisme de rencontre, Jules Renard a poursuivi avec une obstination inflexible sa quête toute personnelle du sentiment vrai, et cette quête l’a mené à renoncer à tout sentiment, voire à toute expression. Six pages et six mois avant la fin, les notations du 27 novembre 1909 sont particulièrement éclairantes. « Le romantisme, c'est de faire parler les bêtes et de leur faire dire ce qu'on veut. Le réalisme, c'est de se soumettre à leur nature, qui est de ne pas parler » : Soit. Rien de plus exaspérant que l’anthropomorphisme puéril. Mais faut-il pour autant renoncer à dialoguer avec le monde ? Et si on s’aperçoit que la nature de l’homme est de ne pas parler, on le peint aussi comme une bête muette ? Oui, apparemment : « Regarder l’homme en naturaliste, et non en psychologue romanesque. L’homme est un animal qui ne raisonne presque pas » (22-4-1905). — « À partir d'aujourd'hui, toutes mes pensées ont une teinte de mort » : aveu d’une sobriété poignante. Mais ne pouvait-on en dire autant des pensées antérieures à ce jour ? La mort est un thème récurrent depuis le début ! Par exemple : « La mort des autres nous aide à vivre » (5-10-1892, p. 136). — « L'effort qu'on fait pour résister à une émotion poignante, parce qu'on sait qu'elle est fausse » : tout Renard est là, je le crains. Le renoncement à tout par fanatisme de la sincérité. La destruction méthodique du moi au nom d’un principe d’authenticité absolue. Le cœur piétiné par l’esprit. Le minimalisme comme propédeutique au nihilisme. — « L’homme sans cœur, qui n’a eu que des émotions littéraires » : Auto-condamnation définitive. Voilà l’épitaphe sardonique que ce grand contempteur de lui-même aurait pu choisir, dans un ultime sarcasme concluant une série si longue qu’à la fin de son Journal, le lecteur se dit que ces petites flèches empoisonnées qu’il se décochait chaque jour auront été comme les heures du cadran solaire : toutes blessent, la dernière tue [7]. Renard ne prisait que les sentiments vrais, et il n’en détecte aucun en lui. Le voilà prêt à quitter ce monde qui n’est plus qu’une impasse. Un peu avant, il écrivait : « J’arrive à me défier de ma défiance » (27-1-1909). À force de vouloir tout démystifier, prendre le contrepied de tout discours louangeur, désamorcer tout élan d’émotion, il ne pouvait à la fin que se retourner contre lui-même, soupçonner jusqu’à cet « œil clair » jamais assez clair, raturer rageusement ces miniatures jamais assez quintessenciées… Dailleurs, quelques années plus tôt : « Je m’arrête toujours au bord de ce qui ne sera pas vrai » (3-5-1905) : n’était-ce pas en venir un jour à s’arrêter devant la vie, toujours plus ou moins menteuse, et ne plus marcher que vers la seule vérité de ce monde, la mort ? Comment ne pas penser que Renard, comme Roland Barthes (auteur fasciné par le Japon) septante ans plus tard, s’est laissé mourir ? [8]
Je propose sur cette page connexe un choix de plus de quatre-cents-soixante aphorismes de Jules Renard.
______________________
[1] Cette nullité de la culture littéraire de Renard a aussi frappé Paul Léautaud (dont je présente aussi une sélection des meilleurs aphorismes). Celui-ci n'a que très peu aimé le Journal, et en fait une critique très négative dans son propre Journal littéraire, à la date du 9 octobre 1927. Il écrit notamment : « Une chose qui ressort aussi du Journal de Renard, au moins de ce premier volume, c'est une ignorance complète. Aucune vraie culture littéraire. Sorti de ses petites questions de fignolage de style, de trouvailles d'images, de détails artistes, Renard ne savait rien, n'était curieux de rien. On ne le voit pas, à un seul moment, parler littérature comme un écrivain qui la connaît. Il est certain qu'il ne la connaissait pas. En réalité, un écrivain de la même classe que Huysmans, bien qu'il ne l'aimât pas, cantonné dans son petit domaine, amoureux de petites curiosités, et guère plus intelligent » (éd. 1986, tome I p. 2042). Il est amusant de noter que ce reproche pourrait être retourné à Léautaud, qui était pareillement d'une incuriosité littéraire crasse, n'appréciant qu'un type marginal d'écrivains et refusant de lire tous les autres. La paille et la poutre… — Autre jugement très négatif : « Le Journal de Jules Renard, quelle déception ! Quelle réputation usurpée ! En dehors de sa célèbre concision, je ne vois pas bien ce qu'on peut dire en sa faveur. Les mots sont forcés, les pensées plates, les anecdotes insipides, les jugements littéraires le plus souvent bêtes. » (Jacques Julliard, L'Année des fantômes. Journal 1997, Grasset, 1998, notation du 4 avril, p. 120). C'est très injuste pour les aphorismes, qui sont si nombreux à être épatants.
[2] Paul Valéry s’est justement attaqué à ce précepte, qui devait être répandu dans les classes de rhétorique du XIXe, soulignant comme l’expression directe « équivaut à la suppression totale de la poésie » (voir « Propos sur la poésie », dans Variété. Théorie poétique et esthétique, Pléiade, 1957, tome I p. 1372, et aussi « Souvenirs littéraires », dans Variété. Études littéraires, ibid., p. 775-776). Mais La Bruyère ne l’entendait pas comme une règle littéraire, seulement comme un conseil pour la conversation, une règle de civilité. « Que dites-vous ? Comment ? Je n’y suis pas ; vous plairait-il de recommencer ? J’y suis encore moins. Je devine enfin : vous voulez, Acis, me dire qu’il fait froid ; que ne disiez-vous : "Il fait froid" ? Vous voulez m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige ; dites : "Il pleut, il neige". Vous me trouvez bon visage, et vous désirez de m’en féliciter ; dites : "Je vous trouve bon visage". » (Les Caractères, V, 7).
[3] Quand elle découvrit ce journal, plusieurs années après la mort de son mari (qui curieusement n’avait donné aucune consigne ni pris aucune précaution), elle fut choquée d’y découvrir des choses qu’elle ignorait. Dabord opposée à la publication, elle céda aux instances d’un éditeur, autorisant une publication partielle en 1925, allégée de nombreuses coupes. Cette pratique est certes courante, et dailleurs – après peut-être un bref âge d’or de liberté dans les années 70-80 – en plein retour depuis vingt ans, en raison de la judiciarisation croissante de la société : les vivants mis en cause, voire leurs ayant-droits, n’hésitent pas à attaquer l’éditeur quand ils s’estiment diffamés par une publication posthume : d’où les caviardages préventifs, pour obvier à des procès coûteux et pénibles. C’est fâcheux pour les contemporains de la première publication, mais au moins peuvent-ils se dire que cette situation est temporaire et que leurs enfants auront droit à une réédition intégrale. Le problème dans le cas de Jules Renard est que sa veuve, indifférente à la littérature, n’a rien trouvé de plus futé que de brûler le manuscrit ! (ainsi que d’autres documents légués par lui). Le seul texte de référence est donc celui publié en 1925-27. On ne sait pas exactement quelle proportion du Journal a été anéantie : on parle de 3000 pages (manuscrites ou en équivalent imprimé ?), qui représenteraient la moitié ou peut-être les deux tiers de l’ensemble (!!). Le Journal fait 1267 pages dans la Pléiade, mais la « page » étant une unité très flottante, il est difficile de savoir quelle était la taille de la version intégrale. Il y aurait eu 54 cahiers (ou 73 ?), les premiers (combien ?) de 32 pages petit format, les suivants de 300/400 pages grand format, donc environ 16 000 pages manuscrites. En tout cas, si ces « 3000 pages » détruites correspondent à peu près au format de la page Pléiade, elles représenteraient bien environ les deux tiers du total.
À en croire Henri Bachelin (l’ami de Renard qui a établi le texte publié, en collaboration houleuse avec la veuve), et quelques personnes bien informées comme André Billy ou Paul Léautaud, les suppressions auraient surtout été de trois ordres : a) Des vacheries sur ses contemporains. Renard avait la dent assez dure, et même dans le texte publié, il n’épargne pas ses amis. Faut-il croire que la version authentique était un festival permanent de méchanceté, tirant à chaque page une volée de flèches assassines ? L’image de l’homme en serait modifiée… b) Toutes les notations que Renard a réutilisées dans ses autres livres, en particulier sur la vie de son village. C’est la perte la moins dommageable. Les amateurs de génétique textuelle sont frustrés de ne pas pouvoir étudier de près la genèse de ses œuvres, mais les autres se passent aisément de ces ébauches améliorées ailleurs. c) Des confidences sur la vie intime de Renard. André Billy, dans un article du Figaro, repris dans L’Ordre le 16 février 1939, rapporte que quand Mme Renard se décida à ouvrir le Journal, « ce fut pour découvrir avec horreur que Renard y parlait de ses liaisons amoureuses avec une franchise et une liberté totales. Les noms de ses maîtresses s’y inscrivaient en toutes lettres. Mme Renard, qui n’avait dailleurs pas eu beaucoup à se féliciter du sort que lui avait fait son mari et de l’éloignement où il l’avait tenue des milieux parisiens, fut meurtrie, ulcérée, et c’est alors qu’elle détruisit au moins les deux tiers du journal. […] J’accorderai de bon cœur aux défenseurs de Mme Renard que son mari était un drôle de pistolet. Mais le Journal est un bouquin prestigieux et je ne me consolerai jamais que, dans un accès de rage, une femme qui ne péchait certainement pas par excès de largeur d’esprit, en ait détruit les deux tiers ». Paul Léautaud se fait l’écho des accusations de Billy : « Jules Renard avait, en dehors de son ménage, deux ou trois liaisons. Il avait tout noté dans son Journal, même les rendez-vous, avec tous les détails, même les plus vifs, de ses plaisirs amoureux » (Journal littéraire, 27 juin 1939 ; éd. 1986, tome 2 p. 2075), mais il est possible qu’il extrapole son propre cas. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une perte immense. Non seulement elle obère gravement notre connaissance de l’homme Jules Renard, mais elle nous prive d’un document inestimable : des confidences érotiques faites sur un ton simple, sans forfanterie, par un homme foncièrement honnête ne cherchant qu’à dire pour lui-même ce qui a été, ce n’est après tout pas si courant, surtout vers 1900. Une page pour le maintien de laquelle Bachelin dut lutter, celle du 18 octobre 1896 (p. 347-348), nous en donne une idée : Renard y confesse les rêves incestueux que lui inspirait son impudique mère. (Dans un genre voisin, la scène de « demi-viol » à la fin de L’Écornifleur, chap. LII (Pléiade 1970, tome I p. 428-431) est remarquable : sans aucune obscénité, Renard parvient à évoquer de façon très crue un dépucelage mi-forcé mi-consentant).
Mais, autre crime éditorial à peine moins grave que le précédent, il semble que la version publiée soit fort imparfaite. En effet, une feuille, une seule, a survécu à l’autodafé. Or, comme l’explique Léon Guichard dans sa notice de la Pléiade (p. XXIV-XXV), elle révèle que le texte imprimé s’écarte sensiblement de ce qu’a écrit Renard. Le recto contient des notes de travail, qui ont entièrement disparu. Le verso, quand on le compare à l’édition originale, révèle un mot corrigé (« noirs » remplacé par « nègres »), une erreur de lecture (« cuisses jolies » au lieu de « cuisses polies ») et deux omissions dont l’une est d’une phrase entière. En somme, il y a de bonnes raisons de croire que le texte que nous lisons depuis bientôt un siècle ne restitue qu’approximativement le manuscrit. Pour un styliste aussi minutieux que Renard, pesant chaque mot dans des toiles d’araignée, le dommage est irréparable ; et devant une phrase un peu banale, nous nous demandons s’il n’y avait pas une trouvaille d’écriture qui aurait été rabotée. Par ailleurs, Bachelin a remplacé un grand nombre de noms propres par des « il » impersonnels. Pratique courante que le manuscrit permet d’annuler quelques dizaines d’années après la mort de l’auteur… quand le manuscrit a été conservé.
Il reste un mince espoir de découvrir un jour le Journal complet et authentique de Jules Renard : d’après une tradition orale rapportée par André Billy, et à laquelle Léon Guichard donne du crédit, Henri Bachelin en aurait fait établir une copie pour lui, avant que la veuve le brulât. Mais Bachelin est mort en 1941, et rien n’est apparu depuis. Si cette copie a existé, ce qui n’est rien moins que sûr, on peut se demander si elle n’a pas été détruite ou perdue par des héritiers aveugles… Dans son Journal littéraire, à la date du 28 novembre 1927 (éd. 1986, tome I p. 2104-2108), Paul Léautaud rapporte une intéressante conversation entre lui et Bachelin. Pensant au sort de son propre journal, Léautaud se scandalise de la destruction de celui de Renard. « Quel dommage que vous n’ayez pas pris une copie pour vous de tout ce qui a été laissé de côté et que Mme Renard a brûlé ensuite. […] – J’y ai bien pensé, après. Il était trop tard ! ». Il faudrait donc que Bachelin ait menti à Léautaud. Pas impossible, mais… — Il raconte aussi que, quand la publication du Journal a été annoncée, certaines gens, notamment Tristan Bernard, sont venus faire des pressions sur l’éditeur pour supprimer des passages qui pourraient compromettre leur réputation. — Bachelin dit encore que Renard, dans ses dernières années, avait beaucoup changé, ne pouvant plus supporter qu’on ne soit pas de son avis.
De ce désastre irrémédiable (oh ! la race maudite des veuves abusives !…), on peut se consoler partiellement en se disant que, si la mort de Renard nous a privés des deux tiers de son Journal, elle en a peut-être sauvé aussi une notable partie. Car qu’en eût-il fait lui-même, s’il eût vécu 70 ou 80 ans ? Il devenait nettement socialiste dans ses dernières années. Qui sait si, en proie à une fièvre humanitariste, il n’eût pas barré et détruit toutes ses notations misanthropes et misogynes ? On peut l’imaginer prendre le relais d’Anatole France (mort en 1923) et devenir, après le Congrès de Tours, le vieux sage du tout nouveau Parti Communiste avec Romain Rolland, courtisé par les soviétiques et invité à Moscou. Dans ces conditions, célébré nolens volens comme une référence pour les masses populaires, est-ce qu’il n’y eût pas réfléchi à deux fois avant de léguer à la postérité un document où il se peint avec une telle cruauté ? Aurait-il pris le risque d’altérer son image en se dévoilant à ce point paresseux, envieux, médiocre ? Les exemples ne manquent pas d’auteurs qui ont eux-mêmes procédé à des autodafés de journaux, de lettres, voire de romans… À l’inverse, on peut aussi imaginer qu’il se fût un jour attelé à une réécriture intégrale de son Journal, pour le publier anthume comme Goncourt ou Gide. À peu près au milieu, le 14 novembre 1900, il écrit : « Je lis des pages de ce Journal : c'est tout de même ce que j'aurai fait de mieux et de plus utile dans ma vie » (p. 609). Mais ce qui lui inspire ce rare satisfecit, c’est le texte qu’il avait écrit, pas celui qui a été publié…
[4] Jean Cocteau a aussi été frappé par cet aspect, et visiblement c’est le premier sentiment qui a dominé en lui : « Rien de plus triste que le journal de Jules Renard, rien ne démontre mieux l'horreur des Lettres. Il a dû se dire : "Chacun est bas, petit, arriviste. Personne n'ose l'avouer ; je l'avouerai et je serai unique". Il en résulte chez le lecteur propre, et qui goûtait Renard, une gêne insurmontable. / On quitte ce bréviaire de l'homme de lettres, de l'arriviste intègre, avec la certitude que les grenouilles ont trouvé un roi. (Par grenouilles j'entends ce qui s'attrape avec un bout de ruban rouge) ». (Opium, Livre de poche n°13795, p. 24 ; ou Pochothèque, p. 585). Il n’y a pourtant pas que ça dans le Journal !
[5] Comme exemple de ce qui est bien venu, un jugement mitigé sur Léon Bloy, après une lecture du Mendiant ingrat (29 novembre 1900, p. 613-614). Voici le dernier paragraphe de cette page, qui remet à sa place ce vociférateur un peu trop adulé dans la réacosphère, notamment par des gens qui ont à peine ouvert un de ses livres et n’ont pas mesuré combien il ressasse les mêmes obsessions bornées et fatigue son lecteur : « Ses injures sont d'un pauvre. Elles ne portent pas. Appeler quelqu'un idiot, cochon, c'est montrer son propre état d'humeur : ce n'est pas peindre, distinguer un homme d'un autre. Il ne suffit pas d'appeler Barrès "chameau" ».
[6] Pour la période précédente, signalons : Jacques Proust, L’Europe au prisme du Japon, XVIe-XVIIIe. Entre humanisme, Contre-réforme et Lumières, Albin Michel, 1997.
[7] La dernière notation du Journal, la voici : « Je veux me lever, cette nuit. Lourdeur. Une jambe pend dehors. Puis un filet coule le long de ma jambe. Il faut qu'il arrive au talon pour que je me décide. Ça séchera dans les draps, comme quand j'étais Poil de Carotte ». Répugnant relâchement d’un homme malade qui ne se soucie même plus de contrôler son corps et accepte de dormir dans sa pisse. Saisissant retour au point de départ. La boucle est bouclée.
[8] J’ai attendu d’avoir fini mon texte pour lire l’article de Sartre : « L’homme ligoté. Notes sur le Journal de Jules Renard » (1945), repris dans Situations, I : Critiques littéraires, Gallimard, 1947 (coll. Idées n°340, p. 358-381). Comme souvent avec Sartre, on est à la fois ébloui par la pertinence des analyses et exaspéré par la sottise sectaire des jugements. Dans un premier temps, il souligne que Renard « a créé la littérature du silence », et se montre sensible comme moi au caractère autodestructeur et nihiliste de cette pratique littéraire. Sartre explique dabord cette quête du silence chez Renard : « Il recherchait la compagnie pour y montrer sa solitude […]. Il est venu se taire par écrit. […] Ce désir l’eût conduit aujourdhui à rechercher l’autodestruction du langage. […] Il a cru toute sa vie que le style était l’art de faire court. […] Il voulait la concision absolue » (p. 360). Puis il passe à une analyse de son style : « C’est vraiment contre la syntaxe elle-même qu’il en a ; elle paraît à ce paysan un raffinement d’oisif. […] Aux mots seuls est dévolue la mission de rendre les nuances et la complexité de l’idée. Des mots riches dans une phrase pauvre. Il fallait bien en venir là : du silence le mot est plus proche encore que la phrase. L’idéal serait qu’il fût une phrase à lui seul » (p. 361). Cela lui permet d’avancer que Renard n’ayant aucune idée, il n’a rien à exprimer, ce qui en fait paradoxalement un bavard, parlant pour ne rien dire (p. 364).
À partir de là, le philosophe se lance dans une longue analyse critique de toute la poétique renardienne, qui est condamnée d’un bloc pour cause de caducité métaphysique. Renard était victime du positivisme de son temps, de sa croyance en la science, de Taine. Se figurant que la réalité des choses était dans leur apparence, il ne cherchait qu’à les observer le plus précisément possible, mais en restant à leur surface. En somme, Sartre reproche à Renard de n’avoir pas anticipé la phénoménologie ! Il est insupportable de voir une œuvre jugée non pas sur ses résultats, mais sur ses principes, comme si seule une philosophie véridique pouvait donner une littérature belle. En montrant les limites de Renard, Sartre nous montre tout autant les siennes. On peut retenir néanmoins quelques remarques fort justes : « dans cet univers instantané, où rien n’est vrai, où rien n’est réel que l’instant, la seule forme d’art possible est la notation. La phrase, qui se lit en un instant et qui est séparée des autres phrases par un double néant, a pour contenu l’impression instantanée que je cueille au vol. Aussi toute la psychologie de Renard sera-t-elle de notations. Il s’examine, s’analyse, se surprend, mais toujours au vol » (p. 370).
Mais le résultat, mais le plaisir du lecteur, s’agace-t-on de plus en plus ? Ne tire-t-on pas une jouissance dans la perfection verbale de ces joyaux descriptifs ? Et le Renard poète, où est-il ? Sartre devine l’objection, et va y répondre par trois pages brillantes et révoltantes, où l’article tourne à l’exécution en règle. Il s’acharne sur deux citations de Renard, deux images condamnées sans appel. La première (« une araignée glisse sur un fil invisible, comme si elle nageait dans l’air ») est dénoncée comme vaine, fumeuse : « C’est là le gauchissement qui menace toutes les images de Renard et qui les détourne vers la "cocasserie", la "gentillesse", qui en fait autant d’évasions hors d’un réel ennuyeux et parfaitement connu vers un monde parfaitement imaginaire qui ne peut en rien éclairer la prétendue réalité » (p. 375). La seconde (« les buissons semblaient saouls de soleil, s’agitaient d’un air indisposé et vomissaient de l’aubépine, écume blanche ») est jugée à la fois maladroite, vaine, anti-poétique et affreuse (p. 376).
Le pire est encore à venir. Dans les trois pages suivantes, le philosophe cède la place à l’idéologue. Renard est maintenant condamné en tant qu’artiste bourgeois. Il a le tort fatal de ne pas correspondre à l’idéal sartrien de l’écrivain engagé. Les thèses ineptes de Qu’est-ce que la littérature ? (que Sartre publiera deux ans plus tard) sont déjà là : « L’écrivain contemporain se préoccupe avant tout de présenter à ses lecteurs une image complète de la condition humaine. Ce faisant, il s’engage. On méprise un peu, aujourd’hui, un livre qui n’est pas un engagement. Quant à la beauté, elle vient par surcroît, quand elle peut » (p. 378). Ce qui est assez désopilant, c’est que Sartre semble ignorer que Renard avait des convictions républicaines et socialistes affirmées et qu’il était, dans les dernières années de sa vie, proche de Blum et Jaurès. Il a même prononcé des discours et publié des articles qui sont justement la partie la plus périmée de son œuvre. Mais Sartre le prend pour un pur artiste muré dans tour d’ivoire, comme Flaubert et Goncourt, alors qu’il a été maire de son village de 1904 à sa mort, luttant au quotidien contre l’influence cléricale, s’occupant activement de l’école, contribuant à la campagne législative de 1906, etc. Finalement, peu d’écrivains auront été aussi « engagés » que Renard dans la politique la plus concrète, celle qui consiste à améliorer le sort de ses voisins. Mais non, Sartre plaque mécaniquement ses théories sur lui : « Voilà Renard entièrement ligoté : c’est qu’il est, en dépit de quelques dénégations sans force, un réaliste. Or, le propre du réaliste, c’est qu’il n’agit pas. Il contemple, puisqu’il veut peindre le réel tel qu’il est, c’est-à-dire tel qu’il apparaît à un témoin impartial. Il faut qu’il se neutralise, c’est son devoir de clerc. Il n’est pas, il ne doit jamais être "dans le coup". Il plane au-dessus des partis, au-dessus des classes, et, par cela même, il s’affirme comme un bourgeois, car le caractère spécifique du bourgeois est de nier l’existence de la classe bourgeoise » (p. 379). Et le caractère spécifique de l’intellectuel engagé est de refuser de comprendre la réalité complexe, a-t-on envie de lui répondre.
Le dernier paragraphe salue quand même le rôle précurseur de Renard et des écrivains fin-de-siècle qui ont été à l’origine de la littérature contemporaine. Sartre retrouve en partie ses qualités de lecteur, mais son parti-pris hostile l’enferme d’une sévérité très injuste : « Il s'est tu, il n'a rien fait. Son entreprise fut de se détruire. Saucissonné, bâillonné par sa famille, par son époque et son milieu, par son parti pris d'analyse psychologique, par son mariage, stérilisé par son Journal, il n'a trouvé de ressources que dans le rêve. Ses images, qui devaient d'abord s'enfoncer comme des griffes dans le réel, sont vite devenues des rêveries-minutes, en marge des choses. Mais il avait trop peur de perdre pied pour songer à construire, au delà du monde, un univers qui lui fût personnel. Il revenait bien vite aux objets, à ses amis, à sa décoration, et ses rêves les plus persistants – parce qu'ils étaient les moins dangereux – se sont bornés à caresser les images d'un bon petit adultère tout plat qu'il a rarement osé commettre. […] Il agonise sa vie, le réalisme finissant l’a élu pour agoniser en lui ». De même que Jacques Laurent a mis en parallèle Sartre avec Paul Bourget dans son essai satirique Paul et Jean-Paul, il y aurait un article à faire sur Jean-Paul et Jules : car après tout, Sartre aussi s’est « ligoté » par ses théories stupides sur l’écrivain engagé, lui aussi a tué à petit feu l’écrivain qu’il portait en lui, bâillonné par ses idées, par ses amis, par son sur-moi politique ; il s’est détruit par l’alcol et la corydrane, il s’est perdu dans les articles de propagande gauchiste et les monuments philosophiques inachevés et inhabitables. Après 1948, qu’a-t-il fait à l’exception des Mots, ultime surgissement de l’artiste qu’il a méthodiquement renié ? Plus de romans, des pièces d’une médiocrité croissante, des pavés illisibles, maintes pages brillantes mais plus d’œuvre marquante. Croyant se débarrasser de sa névrose d’artiste flaubertien, il a succombé à la névrose du militant. Stérilisé par son exécration de la bourgeoisie, il n’a trouvé de ressources que dans l’utopie. Comme Renard, il est devenu un écrivain pour anthologie : on retient des phrases de l’un, des pages de l’autre, mais ils ont renoncé à faire des œuvres. Il a agonisé sa vie, le marxisme finissant l’a élu pour agoniser en lui.
13:30 Écrit par Le déclinologue dans Littérature et arts | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, flaubert, sartre, paul valéry, léon bloy, maurice barrès, la bruyère, aphorismes, maximes, réalisme, japonisme, michel butor, jean paulhan, shakespeare, hugo, chitry, le plaisir de rompre, poil de carotte, histoires naturelles, style, minimalisme, nihilisme, haïku, situations, l'homme ligoté, engagement, henri bachelin, paul léautaud, léon guichard, andré billy, l'écornifleur, jacques proust, andré gide, jacques laurent, paul et jean-paul, jacques julliard, l'année des fantômes, misanthropie, humour |  |
|  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer | |
Imprimer | |  Digg |
Digg |  |
|


