15.03.2015
DRIEU LA ROCHELLE : L'HOMME À CHEVAL (revue critique)
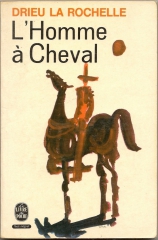 Il y a septante ans aujourd'hui, le 15 mars 1945, mourait Pierre Drieu la Rochelle. Par son suicide, il assumait noblement son mauvais choix politique : « Nous avons joué, j’ai perdu. Je réclame la mort »[1], contrairement à tant de collaborateurs qui préférèrent s’enfuir, sans parler de ceux qui, un peu plus tard, n’eurent aucune gêne à jouer un rôle dans une société devenue si contraire à celle qu’ils appelaient auparavant de leurs vœux. L’un des derniers livres de Drieu, L’Homme à cheval, paru en 1943, n’est pas le plus connu de ses titres. Il n’a pas été retenu dans le choix de romans et récits parus en un volume de la bibliothèque de la Pléiade en 2012 [2]. Ce roman bien curieux [3] est l’histoire d’un imaginaire dictateur bolivien, Jaime Torrijos, racontée par Felipe, un guitariste laid et féru de théologie (passion qu’il mentionne plusieurs fois mais n’est jamais vraisemblable). L’époque reste longtemps indéterminée, avant que quelques indices viennent la préciser dans le dernier tiers : « quarante ans depuis l’Indépendance » (p. 172) : donc en 1865, « en cette année 1868 » (p. 197). Relevons aussi, un peu avant, un clin d’œil malheureusement erroné : le narrateur découvre dans une maison un seul livre, Les Fleurs du mal : « cela nous était venu par un diplomate de notre pays à Rio de Janeiro, qui le tenait du représentant de la France à cet endroit, M. de Gobineau » (p. 161). Or Gobineau est arrivé à Rio le 20 mars 1869, et il est douteux qu’il ait été féru de Baudelaire.
Il y a septante ans aujourd'hui, le 15 mars 1945, mourait Pierre Drieu la Rochelle. Par son suicide, il assumait noblement son mauvais choix politique : « Nous avons joué, j’ai perdu. Je réclame la mort »[1], contrairement à tant de collaborateurs qui préférèrent s’enfuir, sans parler de ceux qui, un peu plus tard, n’eurent aucune gêne à jouer un rôle dans une société devenue si contraire à celle qu’ils appelaient auparavant de leurs vœux. L’un des derniers livres de Drieu, L’Homme à cheval, paru en 1943, n’est pas le plus connu de ses titres. Il n’a pas été retenu dans le choix de romans et récits parus en un volume de la bibliothèque de la Pléiade en 2012 [2]. Ce roman bien curieux [3] est l’histoire d’un imaginaire dictateur bolivien, Jaime Torrijos, racontée par Felipe, un guitariste laid et féru de théologie (passion qu’il mentionne plusieurs fois mais n’est jamais vraisemblable). L’époque reste longtemps indéterminée, avant que quelques indices viennent la préciser dans le dernier tiers : « quarante ans depuis l’Indépendance » (p. 172) : donc en 1865, « en cette année 1868 » (p. 197). Relevons aussi, un peu avant, un clin d’œil malheureusement erroné : le narrateur découvre dans une maison un seul livre, Les Fleurs du mal : « cela nous était venu par un diplomate de notre pays à Rio de Janeiro, qui le tenait du représentant de la France à cet endroit, M. de Gobineau » (p. 161). Or Gobineau est arrivé à Rio le 20 mars 1869, et il est douteux qu’il ait été féru de Baudelaire.
Le roman est composé de quatre parties séparées par des ellipses temporelles, et assez distinctes par le propos et par le ton, si bien qu’on pourrait presque y voir un recueil de quatre nouvelles. La première partie, assez enlevée, est la plus réussie. On y voit le narrateur et Jaime, séduisant lieutenant de cavalerie, décider et accomplir la prise du pouvoir, en tuant le « Protecteur » de l’État, don Benito Ramirez, un homme placide et désabusé qui attend la mort. La deuxième partie tourne autour d’une intrigue sentimentale entre Jaime et Camilla Bustamente, une femme élégante de la grande bourgeoisie, qu’il séduit puis rejette. Dans la troisième partie, Jaime est confronté à une révolte des Indiens, dont l’origine est mystérieuse. La quatrième est la plus courte et la plus intéressante. Jaime et Felipe, avec quelques autres cavaliers, se rendent au lac Titicaca. Ils y méditent sur leur destinée et sacrifient un cheval. Jaime quitte le pouvoir et part seul vers l’Amazone : « Je regardai le dos de cet homme derrière lequel j’avais marché pendant vingt ans. L’homme à cheval était à pied » (dernière phrase du récit).
Drieu ne se soucie pas de reconstitution géographique ni culturelle. Il dédaigne le pittoresque et ne s’intéresse pas à l’univers matériel, qu’il soit naturel ou artisanal. Il n’y aurait pas grand-chose à modifier pour transposer l’histoire dans un tout autre contexte [4]. Si on devait classer ce roman dans un sous-genre, ce serait celui de l’analyse psychologique à la Benjamin Constant. C’est particulièrement frappant dans les deuxième et troisième parties (qui couvrent les deux tiers du roman, lequel fait 250 pages), et surtout à partir de la page 100. Pendant près de cent pages, le roman est presque uniquement constitué de ce qu’on pourrait appeler les consultations de Felipe. Celui-ci va tour à tour interroger les protagonistes du récit pour tenter de pénétrer ce qu’ils savent et ce qu’ils pensent à propos de la situation. Mais tous dissimulent et mentent, et Felipe doit presque systématiquement feindre qu’il sait déjà tout pour les amener à lâcher ingénument ce qu’il ignorait encore, sans garantie qu’il tient là la clef de l’histoire. Le récit se perd dans une subtilité qu’il faut bien qualifier de décourageante. Chaque nouvelle consultation frappe de suspicion l’interprétation précédente et embrouille encore plus l’écheveau compliqué des intrigues politico-sentimentales qui tentent d’engluer le héros. On en vient à ne plus croire personne et à s’impatienter devant ces raffinements stériles.
Le moins déconcertant n’est pas que ce livre dont le héros est un chef d’État ne contienne quasiment aucune considération politique. Parmi les protagonistes figurent le Père Florida, un jésuite qui représente à lui tout seul l’Église, et le docteur Belmez, qui représente à lui tout seul la franc-maçonnerie, c’est-à-dire la bourgeoisie progressiste. Cette double allégorie permet à Drieu d’escamoter l’analyse politique et sociale pour se concentrer sur les rapports psychologiques qu’entretiennent ses personnages. Jaime est certes une sorte de péroniste qui entend agir au service de la plèbe et donc mater les « grands », mais ni lui ni le narrateur ne sont à un seul degré des idéologues. Jaime est successivement, voire simultanément, soutenu et trahi par Belmez et Florida, mais ce sont les jalousies personnelles et une sorte de goût de l’intrigue pure qui semblent motiver ces manœuvres souterraines.
La tentation est bien sûr irrésistible de lire ce livre, écrit au milieu de l’Occupation, à la lumière de la biographie de son auteur. Or ce dédain paradoxal pour la politique ne permet pas d’en tirer grand-chose. C’est seulement dans la dernière partie, un peu didactique, qu’on trouve des éléments : Jaime confesse son rêve brisé de créer un empire sud-américain qui aurait dépassé les nations, comme Drieu voulait dépasser la France dans l’Europe, d’où son soutien au Troisième Reich. Mais le roman n’a rien d’un manifeste fachiste, car on n’y trouve pas vraiment une apologie de l’héroïsme, ou alors indirecte, et encore moins une justification du pouvoir autoritaire. À l’arrivée, le livre laisse une impression trouble. Le héros n’aura finalement pas réussi grand-chose, et son conseiller s’est perdu dans des intrigues labyrinthiques. C’est donc un roman du ratage, mais aussi un roman raté : ni roman d’aventures, ni roman politique, ni pur roman d’analyse, il se laisse tenter par ces trois voies sans opter pour une seule. Dans un résumé que Drieu a lui-même fait de son livre, il déclare y avoir posé « un fait capital : il y a beaucoup d’action dans l’homme de rêve et beaucoup de rêve dans l’homme d’action »[5]. Mais n’est-ce pas une façon de nier l’action en tant que telle ? Au début du roman, le héros établit un croquis de son plan d’action pour éliminer don Benito : « Jaime se mit à dessiner avec un crayon si brutal que le papier crevait et que la future action apparaissait comme une chiure de mouche » (p. 36). Impression prémonitoire car ce plan échouera. Quant à l’homme de rêve, il est tenaillé plusieurs fois par le remords d’avoir fait le malheur de son ami et de s’être servi de lui pour accomplir ses désirs par procuration (par exemple p. 118 ou p. 163). C’est peut-être celà qui rend Drieu si attachant pour beaucoup : il se projette non pas dans un héros, mais dans une espèce de Père Joseph un peu bouffon, obsédé par sa laideur, et qui n’arrive à rien. Une scène assez impressionnante, qui précède immédiatement la dernière partie, renforce encore l’aspect dérisoire de cet aède des coulisses [6], qui n’aura fait que rêver la vie d’un autre avant d’être dénoncé par l’épilogue comme ayant aussi rêvé ce rêve-là, mirage dans le mirage. Quoique trop lourde et trop psychologique, cette scène est sans doute la plus forte du livre. Elle nous montre Felipe resté seul dans un ermitage perché sur un promontoire : il croit que Jaime lui y a laissé Camilla, pour qu’il en fasse ce qu’il veut. Mais il se rend compte que son désir s’est consumé et qu’il ne pourrait rien en faire. Il découvre alors le Père Florida ligoté. Il pourrait l’abattre avec son pistolet, mais la vengeance elle-même vient trop tard. Ainsi l’amour et la haine, ces illusions, se dérobent à lui. Cette impuissance, qu’il considère paradoxalement comme une délivrance, contribue à colorer la fin du récit d’une insondable mélancolie. Devisant au milieu des ruines, chacun des deux personnages constate qu’il n’a pas été à la hauteur. Promesse de renouvellement, sans doute aussi mythique que cette religion inca qu’ils aimeraient ressusciter mais qu’ils n’ont pu retrouver soit parce qu’on la leur a cachée soit parce qu’elle avait déjà disparu, le sacrifice qu’ils accomplissent rituellement est surtout une manière de consacrer la déchéance de l’homme à cheval. La séparation ultime se fait dans les larmes. C’est triste et beau comme un songe évanoui.
[1] Dernière phrase d’ « Exorde », texte publié en annexe au Journal 1939-1945, Gallimard, 1992, p. 504.
[2] Un exemple parmi bien d’autres de ce que la Pléiade a complètement changé de nature depuis une vingtaine d’années. Elle était une collection d’œuvres complètes, elle est devenue une collection d’œuvres choisies. Auparavant, nous eussions eu droit, sinon à toute l’œuvre de Drieu, du moins à une série de trois ou quatre volumes rassemblant tous ses textes romanesques et autobiographiques. Maintenant, il faut se contenter d’une sélection très subjective en un seul volume. Je sais bien que cette redéfinition de la collection n’est pas un vrai choix de Gallimard, mais plutôt l’adaptation aux contraintes économiques : les volumes se vendent moins qu’avant, la collection ne peut pas se permettre de publier à fonds perdus des titres qui resteront indéfiniment en stoc. Eh oui, en ce début de vingt-et-unième siècle, la culture s’affaiblit, les vrais lecteurs se raréfient. Mais quand on songe aux millions que le ministère de la Culture gaspille en pure perte, par exemple dans l’art contemporain, on se dit que s’il y a un support littéraire que l’État devrait mécéner de façon illimitée, c’est bien la bibliothèque de la Pléiade.
[3] Mes numéros de page renvoient à l’édition Livre de poche n°1473, publiée en 1965.
[4] Le roman s’achève par un épilogue de deux pages où un autre narrateur révèle comment il a découvert le manuscrit qu’on vient de lire. Ce procédé conventionnel dévoile la fiction romanesque : « Il n’y a pas eu de Jaime Torrijos selon l’histoire, et ce récit, qui renferme de monstrueuses inexactitudes, semble avoir été écrit par quelqu’un qui n’a jamais mis les pieds en Bolivie, qui tout au plus en a rêvé. » (p. 254 : ce sont les derniers mots du roman).
[5] Résumé reproduit dans F.J. Grover, Drieu la Rochelle (1893-1945), vie, œuvres, témoignages, Gallimard, coll. Idées n°414, 1979, p. 252-253. On trouve aussi cette sentence dans notre roman : « Les hommes d’action ne sont importants que lorsqu’ils sont suffisamment hommes de pensée, et les hommes de pensée ne valent qu’à cause de l’embryon d’homme d’action qu’ils portent en eux » (p. 198).
[6] « Je n’étais destiné qu’à voir. J’avais fait piètre figure dans les coulisses de la révolte indienne ; toute cette matière humaine, épaisse et fuyante comme du poisson s’était tour à tour offerte et dérobée à moi selon son seul caprice. J’étais comme un dieu à qui sa création échappe de plus en plus. » (p. 191).
00:45 Écrit par Le déclinologue dans Littérature et arts, Livres | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : drieu la rochelle, l'homme à cheval, bibliothèque de la pléiade, hugues pradier, bolivie, dictateur, benjamin constant, roman d'analyse, roman politique, gobineau, lac titicaca, coup d'état, échec, frederic grover, rêve, action, homme d'action, jaime torrijos, exorde, suicide, collaboration, fascisme, empire, occupation, péronisme, allégorie |  |
|  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer | |
Imprimer | |  Digg |
Digg |  |
|


