20.03.2011
L’AIGLON DE ROSTAND, POÈME DE L’IMPUISSANCE HISTORIQUE
20 mars 2011. Aujourdhui, bicentenaire de la naissance de Napoléon II, le roi de Rome. Le 20 mars 1811 fut l’un des jours les plus heureux de la vie de Napoléon : ce jour-là, il put croire que la naissance de ce garçon assurait l’avenir de sa lignée, faisant de lui non pas un météore, mais un fondateur de dynastie. L’avenir, comme on sait, en décida autrement.
Hugo a évoqué, dans « Napoléon II » (Les Chants du crépuscule, V) – à mon avis l’un des deux meilleurs parmi la douzaine de ses poèmes consacrés à Napoléon, avec « Lui » (Les Orientales, XL) –, ce moment de triomphe et la chute qui s’ensuivit : « Quand il eut bien fait voir l'héritier de ses trônes / Aux vieilles nations comme aux vieilles couronnes, / Éperdu, l'œil fixé sur quiconque était roi, / Comme un aigle arrivé sur une haute cime, / Il cria tout joyeux avec un air sublime : / – L'avenir ! l'avenir ! l'avenir est à moi ! // Non, l'avenir n'est à personne ! / Sire, l'avenir est à Dieu ! / À chaque fois que l'heure sonne, / Tout ici-bas nous dit adieu. / L'avenir ! l'avenir ! mystère ! / Toutes les choses de la terre, / Gloire, fortune militaire, / Couronne éclatante des rois, / Victoire aux ailes embrasées, / Ambitions réalisées, / Ne sont jamais sur nous posées / Que comme l'oiseau sur nos toits ! » (v. 31-48). Hugo a très bien saisi que cet enfant symbolisait à la fois les espérances les plus surhumaines et la vanité de toute espérance démesurée. Mais il n’a pas consacré d’autres textes à Napoléon II que ce poème d’août 1832, préférant chanter inlassablement la gloire de Napoléon le Grand, fût-ce à partir de 1851 pour l’opposer à la vilenie de Napoléon le Petit. Il laissait à d’autres le soin d’exploiter le thème de l’héritier tué dans l’œuf. Il a tout-de-même, semble-t-il, joué un rôle important dans la diffusion du surnom d’ « Aiglon », qui avait été immédiatement utilisé à la naissance du roi de Rome, mais un peu oublié ensuite : « Oui, l'aigle, un soir, planait aux voûtes éternelles, / Lorsqu'un grand coup de vent lui cassa les deux ailes ; / Sa chute fit dans l'air un foudroyant sillon ; / Tous alors sur son nid fondirent pleins de joie ; / Chacun selon ses dents se partagea la proie ; / L'Angleterre prit l'aigle, et l'Autriche l'aiglon. » (v. 115-120).
C’est sans doute aux alentours de 1900 que la légende napoléonienne atteint son point culminant. Une France assoiffée de revanche contre l’Allemagne puise dans le souvenir de l’épopée impériale la certitude de sa force et le sentiment de son destin. Tandis que les éditions Plon multiplient les publications de mémoires du Premier empire, tandis que les généraux de l’École de guerre commentent sans fin la stratégie du vainqueur d’Austerlitz, Maurice Barrès montre dans son roman Les Déracinés (1897) un groupe de jeunes nationalistes péleriner aux Invalides pour y prendre une leçon de volonté de puissance : « Au tombeau de Napoléon, professeur d’énergie, jurons d’être des hommes »[1].  L’évocation mythologique de l’Aigle entraîne alors celle de l’Aiglon. Je possède un livre curieux, maigre héritage d’une arrière-grand-tante un peu excentrique : L’Aiglon en images, et dans la fiction poétique et dramatique, par John Grand-Carteret, Lib. Charpentier et Fasquelle, 1901. Cet ouvrage unique en son genre n’est pas consacré à Napoléon II en soi mais à son image littéraire et iconographique. C’est le seul équivalent pour le fils de la bonne dizaine de livres consacrés à la légende du père. La première partie propose des « considérations historiques, médicales et littéraires » sur la foisonnante production de textes, et plus encore d’images (portraits, affiches, bibelots) qui a accompagné le fils de l’Empereur, à sa naissance, dans son enfance parisienne, dans sa jeunesse viennoise, puis après sa mort. Le premier chapitre, qui a une valeur introductive, regarde avec un certain dédain cet « engouement » pour l’Aiglon, ce « roi-de-romisme aigu » (p. 15) qui entraîne, à côté des bonapartistes convaincus, « la foule, l’éternel troupeau obéissant à ses bergers » (p. 8), laquelle ne manque jamais de prodiguer ces « apitoiements de circonstance » (p. 12) devant les puissants devenus faibles, comme le montre l’exemple parallèle du petit Louis XVII et de ses parents. Mais cette « sensiblerie nerveuse » est propre à l’époque moderne, car « jadis c’étaient les mâles vertus, les dévouements sublimes, la torture voulue du sentiment ; tout l’opposé. Plus on écrasait le cœur sous l’implacable raison, afin que mieux triomphât le devoir, plus aussi le public applaudissait » (p. 12) : c’est très bien vu, quoique un peu exagéré (pensons à Andromaque ou Manon Lescaut). L’auteur souligne que le culte du Roi de Rome a connu deux phases nettement distinctes : sous la Restauration et jusqu’en 1832, une phase essentiellement politique, qui se termina par « l’enterrement des espérances de toute une génération » (p. 14) ; puis, dans la fin du XIXe, une phase sentimentale : « aujourd’hui, c’est pure affaire de dilettantisme, simple prise de possession d’une figure disparue qui ne fit que passer à travers l’histoire, à peine esquissée, – tel un souffle, telle une ombre » (p. 14).
L’évocation mythologique de l’Aigle entraîne alors celle de l’Aiglon. Je possède un livre curieux, maigre héritage d’une arrière-grand-tante un peu excentrique : L’Aiglon en images, et dans la fiction poétique et dramatique, par John Grand-Carteret, Lib. Charpentier et Fasquelle, 1901. Cet ouvrage unique en son genre n’est pas consacré à Napoléon II en soi mais à son image littéraire et iconographique. C’est le seul équivalent pour le fils de la bonne dizaine de livres consacrés à la légende du père. La première partie propose des « considérations historiques, médicales et littéraires » sur la foisonnante production de textes, et plus encore d’images (portraits, affiches, bibelots) qui a accompagné le fils de l’Empereur, à sa naissance, dans son enfance parisienne, dans sa jeunesse viennoise, puis après sa mort. Le premier chapitre, qui a une valeur introductive, regarde avec un certain dédain cet « engouement » pour l’Aiglon, ce « roi-de-romisme aigu » (p. 15) qui entraîne, à côté des bonapartistes convaincus, « la foule, l’éternel troupeau obéissant à ses bergers » (p. 8), laquelle ne manque jamais de prodiguer ces « apitoiements de circonstance » (p. 12) devant les puissants devenus faibles, comme le montre l’exemple parallèle du petit Louis XVII et de ses parents. Mais cette « sensiblerie nerveuse » est propre à l’époque moderne, car « jadis c’étaient les mâles vertus, les dévouements sublimes, la torture voulue du sentiment ; tout l’opposé. Plus on écrasait le cœur sous l’implacable raison, afin que mieux triomphât le devoir, plus aussi le public applaudissait » (p. 12) : c’est très bien vu, quoique un peu exagéré (pensons à Andromaque ou Manon Lescaut). L’auteur souligne que le culte du Roi de Rome a connu deux phases nettement distinctes : sous la Restauration et jusqu’en 1832, une phase essentiellement politique, qui se termina par « l’enterrement des espérances de toute une génération » (p. 14) ; puis, dans la fin du XIXe, une phase sentimentale : « aujourd’hui, c’est pure affaire de dilettantisme, simple prise de possession d’une figure disparue qui ne fit que passer à travers l’histoire, à peine esquissée, – tel un souffle, telle une ombre » (p. 14).  L’évocation fictive du jeune prince ne suscite plus qu’une passion « purement platonique » (p. 16). De fait, l’arrière-grand-tante de qui je tiens ce volume relié avait bien un côté midinette : j’ai un autre document où on la sent bouleversée par le destin brisé d’Astrid de Belgique, la Lady Diana des années 1930. Passion platonique peut-être que ce roi-de-romisme, mais lucrative assurément : la mode de l’Aiglon 1900 s’accompagna, déjà, d’une incroyable bibeloterie commerciale que l’auteur résume dans sa préface et qui montre que l’invasion des « produits dérivés » ne date pas d’aujourd’hui[2]. On s’étonne que J. Grand-Carteret se soit appliqué à scruter avec une attention aussi minutieuse cette imagerie populaire, à laquelle son caractère naïf et terriblement répétitif ôte beaucoup d’intérêt, et dont le recensement a dû lui prendre tant de temps. Mais c’est aussi qu’on a affaire à un spécialiste de l’art populaire : sa bibliographie abonde en ouvrages rassemblant et étudiant les caricatures sur tel ou tel sujet. En 1895, il avait déjà publié un Napoléon en images : estampes anglaises (portraits et caricatures) : il a dû vouloir continuer sur sa lancée. La seconde partie de L’Aiglon en images, la plus importante, est un copieux inventaire iconographique : près de 200 pages déroulent une liste d’images, portraits, affiches, illustrations, lithographies, estampes, peintures, gravures, sculptures, caricatures, objets divers, etc, qui tous font l’objet d’une brève notice : titre, auteur, date, lieu de réalisation, éditeur, format, description. Ces notices d’images ne sont pas numérotées, mais il doit bien y en avoir dans les 650, dont 139 sont reproduites dans le livre. Je note que ces images recensées et décrites ont presque toutes été produites entre 1811 et 1833 : est-ce que la production iconographique de la légende de l’Aiglon a vraiment chuté de 90 % ensuite, ou bien est-ce que J. Grand-Carteret a concentré ses recherches sur cette période, négligeant la production postérieure ? Un peu des deux, sans doute. Vient ensuite un inventaire de textes imprimés et de livres, puis un florilège de documents et extraits d’œuvres entre 1829 et 1836, chacun d’une quinzaine de pages. Dans le premier, je compte 10 pièces de théâtre (dont 6 de 1832), 5 monologues et parodies (pour théâtres ou cafés-concerts), 43 livres ou brochures d’ « histoire et vie » (dont 20 de 1832-33 et 7 de 1850-53, et 2 en allemand), 22 poésies et musiques (dont 14 de 1832-34), 14 articles de revues (dont 10 de 1890-1900).
L’évocation fictive du jeune prince ne suscite plus qu’une passion « purement platonique » (p. 16). De fait, l’arrière-grand-tante de qui je tiens ce volume relié avait bien un côté midinette : j’ai un autre document où on la sent bouleversée par le destin brisé d’Astrid de Belgique, la Lady Diana des années 1930. Passion platonique peut-être que ce roi-de-romisme, mais lucrative assurément : la mode de l’Aiglon 1900 s’accompagna, déjà, d’une incroyable bibeloterie commerciale que l’auteur résume dans sa préface et qui montre que l’invasion des « produits dérivés » ne date pas d’aujourd’hui[2]. On s’étonne que J. Grand-Carteret se soit appliqué à scruter avec une attention aussi minutieuse cette imagerie populaire, à laquelle son caractère naïf et terriblement répétitif ôte beaucoup d’intérêt, et dont le recensement a dû lui prendre tant de temps. Mais c’est aussi qu’on a affaire à un spécialiste de l’art populaire : sa bibliographie abonde en ouvrages rassemblant et étudiant les caricatures sur tel ou tel sujet. En 1895, il avait déjà publié un Napoléon en images : estampes anglaises (portraits et caricatures) : il a dû vouloir continuer sur sa lancée. La seconde partie de L’Aiglon en images, la plus importante, est un copieux inventaire iconographique : près de 200 pages déroulent une liste d’images, portraits, affiches, illustrations, lithographies, estampes, peintures, gravures, sculptures, caricatures, objets divers, etc, qui tous font l’objet d’une brève notice : titre, auteur, date, lieu de réalisation, éditeur, format, description. Ces notices d’images ne sont pas numérotées, mais il doit bien y en avoir dans les 650, dont 139 sont reproduites dans le livre. Je note que ces images recensées et décrites ont presque toutes été produites entre 1811 et 1833 : est-ce que la production iconographique de la légende de l’Aiglon a vraiment chuté de 90 % ensuite, ou bien est-ce que J. Grand-Carteret a concentré ses recherches sur cette période, négligeant la production postérieure ? Un peu des deux, sans doute. Vient ensuite un inventaire de textes imprimés et de livres, puis un florilège de documents et extraits d’œuvres entre 1829 et 1836, chacun d’une quinzaine de pages. Dans le premier, je compte 10 pièces de théâtre (dont 6 de 1832), 5 monologues et parodies (pour théâtres ou cafés-concerts), 43 livres ou brochures d’ « histoire et vie » (dont 20 de 1832-33 et 7 de 1850-53, et 2 en allemand), 22 poésies et musiques (dont 14 de 1832-34), 14 articles de revues (dont 10 de 1890-1900).
De tout cela il n’est rien resté. Ce cimetière de références fait naître, à le feuilleter, une étrange émotion. Se peut-il que le pâle duc de Reichstadt, dont seuls les passionnés d’histoire connaissent aujourd’hui l’existence (demandez donc à un bachelier pourquoi le Second empire a été fondé par Napoléon Trois !), ait pu, de son vivant et après, connaître un culte populaire comparable à celui qui a entouré et entoure encore John F. Kennedy, James Dean ou la princesse Diana ? Napoléon est, paraît-il, l’homme le plus connu au monde avec Jésus, et très nombreuses sont les œuvres littéraires, artistiques et cinématographiques qui l’évoquent et qui sont toujours fameuses ; mais ces images et ces textes qui exaltent son fils ou s’apitoient sur lui sont tombées dans le néant. Qui a lu « Poésie sur la mort du fils de Bonaparte » de Charles Lassailly (1832), « Madame Mère » de Béranger (dans Chansons posthumes) ou « Le Fils de l’Empereur » de François Coppée (dans Les Récits et les élégies, 1878), trois auteurs qui sont pourtant bien connus des amateurs de littérature du XIXe ? Qui se souvient du Fils de l’homme, ou souvenirs de Vienne, long poème de Méry et Barthélemy qui créa la légende de l’Aiglon (1829), ou bien du Fils de l’Empereur, histoire contemporaine en deux actes, par MM. Dupeuty, Fontan et Th. Cogniard, représentée au Vaudeville le 10 septembre 1832 et publiée chez Dondey-Dupré fils, ou encore du Roi de Rome, pièce en 5 actes et un prologue, par Émile Pouvillon et Armand d’Artois, représentée le 10 janvier 1899 et qui tint l’affiche plus d’un trimestre grâce au talent d’un monstre sacré de l’époque, De Max, dans le rôle-titre ? Qui connaît l’existence de l’Histoire de Napoléon II, né Roi de Rome, mort duc de Reichstadt, faisant suite à toutes les histoires de Napoléon, pseudo-biographie romancée de P. Franc-Lecomte (de la Marne), illustrée par Tony Johannot, Fragonard, Bourdet (1842), ou bien de Palmyre, fils du duc de Reichstadt, roman de J.-B. Bardon (1871), dont le titre suffit à énoncer le fantasme uchronique ? Tout cela a disparu…
Sauf le poème de Hugo et L’Aiglon de Rostand, bien sûr. Bien sûr ? On a un peu oublié, je crois, que L’Aiglon connut, en 1900, un triomphe presque comparable à celui de Cyrano de Bergerac trois ans plus tôt. Il a ouvert à son auteur les portes de l’Académie française à seulement trente-trois ans, exploit qui n’a pas été renouvelé depuis. La critique s’est montrée assez réservée, mais le public fut au rendez-vous, et l’est resté pendant un demi-siècle. La pièce fut jouée sans interruption du 15 mars au 30 octobre 1900 (234 fois), partit vite en tournée en France et à l’étranger, fut très souvent reprise avec succès jusqu’aux années 50, période où elle commença à décliner nettement, alors que Cyrano trouvait une nouvelle jeunesse.
Le contraste entre les deux chefs-d’œuvre de Rostand est devenu formidable. D’un côté, l’une des trois ou quatre pièces les plus importantes du répertoire français, qu’on joue sans arrêt (même par des petites troupes qui n’ont pas les moyens de s’offrir le décor qu’exige le texte), dans laquelle les grands acteurs veulent s’illustrer à chaque génération, qu’on adapte au cinéma, qu’on étudie au collège et au lycée, qu’on peut acheter dans plusieurs collections de poche, dont le héros a définitivement pris place dans l’imaginaire national. De l’autre, un monument de moins en moins visité, un souvenir réservé aux histoires de la littérature, une belle ruine qui chaque année se couvre d’un peu plus de poussière, jusqu’à bientôt ne plus pouvoir être distinguée, dans le cimetière du théâtre, de Rodogune, de Mithridate, de Zaïre, de Chatterton, de Pelléas et Mélisande, des Séquestrés d’Altona, du Maître de Santiago, ces pièces qui eurent leur heure de gloire, qu’on connaît encore de nom et qu’on salue parfois de loin mais qu’on ne fait même plus l’effort de lire, encore moins de jouer. C’est tout juste si on ne lui préfère pas Chantecler pour sa bouffonnerie pré-surréaliste, depuis que Jérôme Savary l’a ressuscité.
Et pourtant, L’Aiglon pourrait (voire devrait) revenir par un biais inattendu. Cette pièce s’inscrit en effet dans un usage théâtral fort à la mode pendant au moins un siècle, et qui ne laisse pas de nous déconcerter, quoique notre époque de « transgenrisme » ait, je le crains, vocation à le restaurer : le travesti héroïque. Le sait-on, la prodigieuse carrière de Sarah Bernhardt, pour qui Rostand écrivit sa pièce, s’est aussi construite sur des rôles d’hommes, par exemple Hamlet et Lorenzaccio. Et il est dailleurs sidérant de songer que quand la grande Sarah créa triomphalement ce rôle d’un frêle adolescent qui a 19 ans au premier acte et 21 au dernier, elle en avait elle-même… 56 !! Il faut qu’il y ait quelque chose d’essentiellement artificiel et faisandé dans l’art de Rostand pour avoir non seulement permis mais même suscité une telle incongruité… Cependant l’influence de l’opéra n’explique pas à elle seule cet étrange usage de confier à des femmes des rôles d’hommes, qui montre la relativité des normes. Chose notable, l’habitude avait été prise d’emblée pour le duc de Reichstadt : dès décembre 1830 (oui, de son vivant !), une pièce signée P. de Lussan, Le Fils de l’Homme, est jouée par une femme, Virginie Déjazet.
s’inscrit en effet dans un usage théâtral fort à la mode pendant au moins un siècle, et qui ne laisse pas de nous déconcerter, quoique notre époque de « transgenrisme » ait, je le crains, vocation à le restaurer : le travesti héroïque. Le sait-on, la prodigieuse carrière de Sarah Bernhardt, pour qui Rostand écrivit sa pièce, s’est aussi construite sur des rôles d’hommes, par exemple Hamlet et Lorenzaccio. Et il est dailleurs sidérant de songer que quand la grande Sarah créa triomphalement ce rôle d’un frêle adolescent qui a 19 ans au premier acte et 21 au dernier, elle en avait elle-même… 56 !! Il faut qu’il y ait quelque chose d’essentiellement artificiel et faisandé dans l’art de Rostand pour avoir non seulement permis mais même suscité une telle incongruité… Cependant l’influence de l’opéra n’explique pas à elle seule cet étrange usage de confier à des femmes des rôles d’hommes, qui montre la relativité des normes. Chose notable, l’habitude avait été prise d’emblée pour le duc de Reichstadt : dès décembre 1830 (oui, de son vivant !), une pièce signée P. de Lussan, Le Fils de l’Homme, est jouée par une femme, Virginie Déjazet.  En 1850, Le Roi de Rome, par Desnoyer et Beauvallet, est à nouveau joué par une femme travestie, Émilie Guyon. Et quand, dès 1900, L’Aiglon est traduit en anglais et monté à La Nouvelle York, c’est encore avec une femme dans le rôle-titre, Maude Adams (ci-contre), déjà célèbre pour avoir joué Peter Pan. De nombreuses autres actrices joueront ensuite l’Aiglon de Rostand : Jane Grumbach dans la tournée provinciale de 1900, Mary Marquet et Simone pendant la Grande guerre, puis Véra Sergine, puis Jeanne Provost dans les années 20, etc. On ose à peine le dire de peur de donner des idées à un metteur en scène, mais le rôle du pâle et nerveux Franz semble fait pour (re)devenir une icône transsexuelle : Maude Adams était une lesbienne notoire ; Sarah Bernhardt était peut-être bisexuelle car on lui prête des liaisons lesbiennes ; et aussitôt après elle, le rôle fut repris par une vedette homosexuelle affichée, le Jean Marais de l’époque, Edouard de Max, dit De Max, dont j’ai signalé qu’il avait déjà joué Le Roi de Rome de Pouvillon en 1899.
En 1850, Le Roi de Rome, par Desnoyer et Beauvallet, est à nouveau joué par une femme travestie, Émilie Guyon. Et quand, dès 1900, L’Aiglon est traduit en anglais et monté à La Nouvelle York, c’est encore avec une femme dans le rôle-titre, Maude Adams (ci-contre), déjà célèbre pour avoir joué Peter Pan. De nombreuses autres actrices joueront ensuite l’Aiglon de Rostand : Jane Grumbach dans la tournée provinciale de 1900, Mary Marquet et Simone pendant la Grande guerre, puis Véra Sergine, puis Jeanne Provost dans les années 20, etc. On ose à peine le dire de peur de donner des idées à un metteur en scène, mais le rôle du pâle et nerveux Franz semble fait pour (re)devenir une icône transsexuelle : Maude Adams était une lesbienne notoire ; Sarah Bernhardt était peut-être bisexuelle car on lui prête des liaisons lesbiennes ; et aussitôt après elle, le rôle fut repris par une vedette homosexuelle affichée, le Jean Marais de l’époque, Edouard de Max, dit De Max, dont j’ai signalé qu’il avait déjà joué Le Roi de Rome de Pouvillon en 1899.
Voilà qui risque de décourager beaucoup d’ouvrir cette pièce. Ce serait bien dommage, car à vrai dire rien dans le texte n’indique une déviance sexuelle : faire jouer le personnage par une femme ou un inverti n’est qu’une manière de suggérer son identité incertaine, son malaise existentiel : l’Aiglon, c’est avant tout l’homme qui ne peut pas être lui-même, car tout autour de lui et en lui le pousse à incarner une figure qu’il est incapable d’assumer. C’est la tragédie des fils de génie, écrasés par l’image du Père, mais c’est aussi le drame de toute époque de désolation, taraudée par la nostalgie d’un jadis épique.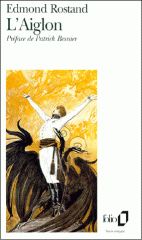 Je viens de relire cette pièce que j’adore[3]. Elle est si digne de l’auteur de Cyrano de Bergerac ! On l’y reconnaît bien, car c’est le même style : alexandrins éclatés, trouvailles verbales constantes, mots d’esprit à foison, tirades brillantes mais inutiles, alternance de l’épique et de l’élégiaque. Il y a même un passage en stances (V,2), comme il y avait la ballade du duel et la chanson des Cadets de Gascogne. Mais la thématique est aussi très proche : comme Cyrano est victime d’une opposition interne entre son âme sublime et son corps laid, l’Aiglon est affligé d’une scission intime entre son héritage napoléonien et son atavisme Habsbourg : Metternich se fait un plaisir cruel de l’en crucifier, afin de briser ses velléités impériales, dans le sublime acte III. Le personnage du grognard conspirateur, Flambeau, a aussi un côté cyranesque, en particulier son goût de l’attitude éclatante mais suicidaire, pour la pure beauté du geste (p. 169 : II, 9 et bien sûr p. 214 : III, 7). Je note aussi que dans Cyrano, la féerie du voyage dans la Lune n’était qu’un discours de Cyrano pour berner de Guiche. Dans L’Aiglon, après le cauchemar éveillé de Metternich, qui est une suggestion et ne sort donc pas de la réalité, la scène de Wagram bascule bien dans le fantastique, avec ses multiples voix qui assaillent le Duc. Dans Chantecler, Rostand ira jusqu’au merveilleux. L’arrachement progressif au réalisme est sensible, quoique les deux premières pièces s’appuient sur une documentation assez solide. Mais Cyrano et l’Aiglon, s’ils sont des personnages réels, sont aussi des figures mineures, qui n’ont joué aucun rôle historique, et étaient donc disponibles pour la recréation littéraire. Les héros de Rostand sont des ratés qui n’ont pas réussi à entrer dans l’Histoire, le premier trop pur, le second trop tendre, l’un et l’autre trop ambitieux et trop pleins de rêves.
Je viens de relire cette pièce que j’adore[3]. Elle est si digne de l’auteur de Cyrano de Bergerac ! On l’y reconnaît bien, car c’est le même style : alexandrins éclatés, trouvailles verbales constantes, mots d’esprit à foison, tirades brillantes mais inutiles, alternance de l’épique et de l’élégiaque. Il y a même un passage en stances (V,2), comme il y avait la ballade du duel et la chanson des Cadets de Gascogne. Mais la thématique est aussi très proche : comme Cyrano est victime d’une opposition interne entre son âme sublime et son corps laid, l’Aiglon est affligé d’une scission intime entre son héritage napoléonien et son atavisme Habsbourg : Metternich se fait un plaisir cruel de l’en crucifier, afin de briser ses velléités impériales, dans le sublime acte III. Le personnage du grognard conspirateur, Flambeau, a aussi un côté cyranesque, en particulier son goût de l’attitude éclatante mais suicidaire, pour la pure beauté du geste (p. 169 : II, 9 et bien sûr p. 214 : III, 7). Je note aussi que dans Cyrano, la féerie du voyage dans la Lune n’était qu’un discours de Cyrano pour berner de Guiche. Dans L’Aiglon, après le cauchemar éveillé de Metternich, qui est une suggestion et ne sort donc pas de la réalité, la scène de Wagram bascule bien dans le fantastique, avec ses multiples voix qui assaillent le Duc. Dans Chantecler, Rostand ira jusqu’au merveilleux. L’arrachement progressif au réalisme est sensible, quoique les deux premières pièces s’appuient sur une documentation assez solide. Mais Cyrano et l’Aiglon, s’ils sont des personnages réels, sont aussi des figures mineures, qui n’ont joué aucun rôle historique, et étaient donc disponibles pour la recréation littéraire. Les héros de Rostand sont des ratés qui n’ont pas réussi à entrer dans l’Histoire, le premier trop pur, le second trop tendre, l’un et l’autre trop ambitieux et trop pleins de rêves.
Les rêves de l’Aiglon sont, plus encore que des rêves de gloire, des rêves d’imitation de son père. Ce que j’apprécie particulièrement, c’est que c’est une pièce tout entière tournée vers le passé. L’image de l’Empereur est constamment prégnante d’un bout à l’autre, elle obsède tous les personnages, même quand ils essayent de penser à autre chose : nous n’avons pas à faire à une pièce sur Napoléon, mais à une pièce sur le souvenir de Napoléon, ce qui est plus subtil et plus poignant. L’avenir n’y est vu que comme une restauration possible d’un passé grandiose, et le présent n’y existe que dans cette aspiration vers un temps aboli. J’aime cette façon de conjuguer grandeur et néant, héroïsme et mélancolie, exaltation d’un mythe fabuleux et retombée dans l’impuissance du réel. Cyrano, pareillement, était un héros de l’échec, le survivant donquichottesque, magnifique mais impuissant, d’une époque héroïque remplacée par l’âge des calculs, du carriérisme, des coups par derrière : il « aur[a] tout manqué, même [s]a mort » (V,7 : vers 2487), il ne garde à la fin que son panache, qui n’a servi à rien. Franz est plus pitoyable encore, car au moins Cyrano aura vécu, aura tenté, aura ébloui : incapable d’imiter son père, miné par l’autodépréciation, l’Aiglon n’aura rien été qu’une ombre, un bourgeon non éclos, un embryon avorté, une promesse non accomplie. Ce dont il a lui-même parfaitement conscience, notamment dans la dernière scène (VI, 3), p. 377 et 379 : « J’étais plus grand dans ce berceau que dans ce lit ». C’est beau comme le « Tu Marcellus eris » de Virgile !... Les héros de la pièce, ce sont les conspirateurs qui entament le processus d’une restauration impériale : Flambeau et la Comtesse Camerata, voire le faux tailleur et l’attaché français : lui n’est que l’horizon fantasmé vers lequel ils tendent.
C’est que Rostand est lui-même un auteur complètement anachronique, qui semble refaire Ruy Blas avec soixante ans de retard, au moment où André Antoine impose un théâtre naturaliste. Ses drames romantiques relèvent de l’esthétique de 1830, pas de celle de 1900 où s’illustrent Feydeau, Porto-Riche, Tchekhov et Ibsen. On devine que le rapport que l’Aiglon entretient avec l’ombre écrasante de Napoléon n’est pas loin de reproduire celui que Rostand entretient avec le Père par excellence, le Maître indépassable dont le génie en a stérilisé plus d’un : Victor Hugo. Il passe son temps à essayer de l’imiter et, loin de pouvoir se comparer à lui, ne parvient qu’à faire entendre la complainte de l’impuissant, qui sent trop bien qu’il est voué à la mort obscure d’un raté. De surcroît, ceux qui sont en retard sont souvent aussi en avance, et c’est le cas de Rostand, né soixante ans trop tôt. Le rôle capital conféré au décor (sans lequel la scène n’aurait plus aucun sens), le rôle à peine moins important des costumes, l’attention aux objets, le goût des scènes surchargées de personnages, parmi lesquels d’innombrables figurants qui viennent juste glisser un alexandrin ou un hémistiche : Rostand était fait pour le cinéma, il aurait pu être à Abel Gance ce que Cocteau est à Pagnol. Il est dailleurs remarquable qu’il ait eu le temps de le pressentir : dans la chronologie de l’édition Folio (p. 396), Patrick Besnier cite, pour l’année 1916, l’extrait d’une lettre de Rostand à sa maîtresse Mary Marquet où il manifeste son admiration pour un film de Cecil B. de Mille : « C’est étonnant. Voilà ce qu’on devrait faire chez nous. Cela prouve que le "ciné" a un avenir énorme ». Mais cet avenir, il ne le connaîtra jamais, emporté par la grippe espagnole fin 1918. En somme, Rostand était fait pour vivre et créer en 1830 ou en 1950, bien plus qu’en 1900. Combien de talents auraient été des génies s’ils étaient nés à la bonne époque !
Celà dit, il est bien évident que Rostand appartient aussi à son temps, et pas seulement par l’esprit cocardier et la grande vague de napoléonomanie de la fin du siècle, sur laquelle il surfe. Dans sa préface, Patrick Besnier, sensible à sa façon de miner le langage de l’intérieur, le rapproche de Raymond Roussel et même de Jean-Pierre Brisset : voilà bien le démon des universitaires contemporains, qui veulent voir du modernisme déstructurant partout. Moi, en lisant la phrase « Vous vous êtes dit, en artiste, / Que ce serait joli d’être bonapartiste » (I, 10, p. 94), j’ai aussitôt pensé à Georges Fourest et son fameux : « Qu’il est joli garçon l’assassin de papa ». Le rapprochement entre Rostand et Fourest (nés à un an d’intervalle, en 1868 et 1867) est évident, quoique je ne l’aie vu nulle part : goût banvillien pour la jonglerie verbale, prosodie éclatée, obsession de l’intertextualité, parodies qui peuvent se lire comme des hommages… 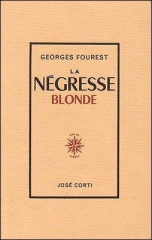
Dans Cyrano, le dernier acte était un épilogue superflu, une longue déploration funèbre. De même le dernier acte ici, encore plus inutile, et aussi la dernière scène de l’acte précédent, magnifique hallucination morbide. Le théâtre de Rostand n’est ni un théâtre de personnages (comme Cyrano, L’Aiglon est écrasé par le personnage éponyme ; il n’y a guère que Flambeau qui équilibre un peu la pièce, mais ce personnage haut en couleurs est tout d’une pièce ; et Metternich est un peu falot, somme toute), ni un théâtre d’intrigues (il n’y a guère qu’à la fin de l’acte IV et au début de l’acte V qu’il se passe quelque chose : ce qui précède est une longue préparation, ce qui suit est un épilogue). C’est un théâtre de mots et un théâtre de scènes, de "scènes à faire", magnifiques mais oiseuses, théâtrales plus que dramaturgiques : le costume napoléonien que demande le Duc à son tailleur (I, 9), la leçon d’histoire du Duc à ses précepteurs (I, 13), le face-à-face du maréchal Marmont et du grognard Flambeau (II, 8-9), la sollicitation du Duc à son grand-père l’empereur d’Autriche qui rend la justice (III, 1-2), le conflit politique du Duc et de Metternich (III, 3), la garde secrète de Flambeau (III, 7), l’apostrophe de Metternich au bicorne puis son face-à-face hallucinatoire avec Flambeau (III, 8), le duel psychologique du Duc et de Metternich (III, 10), le Duc témoin du marivaudage de sa mère avec Bombelles (IV, 7), Flambeau au milieu des autres personnages déguisés (IV, 10-11), la fuite angoissante du faux Duc (IV, 13), le Duc et Flambeau, incognitos, face aux sarcasmes d’un antibonapartiste (IV, 14), le Duc environné des fantômes de Wagram (V, 6), la mort du Duc revivant son baptême (VI, 3). Tous ces morceaux sont prodigieux, mais on pourrait trop facilement les détacher pour une anthologie : autant la personnalité vigoureuse et éclatante de Cyrano parvenait à fusionner les scènes de sa pièce en un tout organique, autant le jeune Hamlet splinétique qu’est le Duc de Reichstadt  peine à ligaturer celles de la sienne. En somme, l’incapacité de l’auteur à construire une intrigue reflète bien l’incapacité du personnage à bâtir sa propre vie…
peine à ligaturer celles de la sienne. En somme, l’incapacité de l’auteur à construire une intrigue reflète bien l’incapacité du personnage à bâtir sa propre vie…
La scène où le Duc sympathise avec le jeune Français déguisé en tailleur (I, 10), moins éclatante, me touche particulièrement. C’est la plus explicitement romantique : on y trouve un portrait à deux voix du Jeune-France de 1830, accâblé par la médiocrité de son époque, isolé de ses contemporains par sa singularité, s’agitant par impuissance à agir, ne pouvant parler sans faire de la littérature (p. 88-95). Cette peinture d’une génération à la fois fiévreuse et désenchantée, à la fois bonapartiste et libérale, mériterait d’être largement citée. Le portrait est complété par la scène 4 de l’acte II, où Franz se complaît dans la neurasthénie autodévalorisante, – ou la lucidité démobilisante : « Oh ! vouloir à l’Histoire ajouter des chapitres, / Et puis n’être qu’un front qui se colle à des vitres ! » (p. 139).
L’Aiglon, finalement, nous émeut comme élégie funèbre de la gloire nationale, drame de la France aliénée, poème de l’impuissance historique. Peu de pièces sont aussi bien accordées à notre sensibilité crépusculaire, à nous autres qui rêvons de restaurer la grandeur de la France, mais qui savons que cela est à jamais impossible. Nous regardons de Gaulle, le Napoléon du siècle dernier, comme Franz regardait son père, et comme celui-ci nous dépérissons lentement d’être incapables non seulement de le faire revivre ou de l’égaler, mais même de l’imiter. Il y a en nous du jouisseur décadent, comme il y a de l’Habsbourg dans le duc de Reichstadt. Il rêve de régner sur les Français mais il vit à l’étranger, – où il est chez lui. Et nous-mêmes, ne sommes-nous pas en exil dans cette époque qui pourtant nous a engendrés et constitués ? Nous mourrons comme des enfants, car nous n’aurons jamais été que des enfants. Paul Morand a écrit que l’Aiglon fut « enfermé dans la pire des forteresses : sa famille »[4]. Pareillement, nous sommes prisonniers de cette époque amollissante, qui nous offre un confort matériel et une douceur du quotidien tels qu’aucune autre époque n’en offrit. Nous rêvons d’exploits épiques sur des champs de bataille, mais nous ne sortirons jamais de notre palais si luxueux et si plaisant, hanté d’ombres insaisissables, et alors même que nous sentons qu’il pue la mort et que ses murs commencent à se lézarder. Nous sommes tous des Aiglons.
[1] Chapitre VIII. Collection Bouquins (Romans et voyages), tome I p. 614.
[3] Édition utilisée : Folio n°1764, Gallimard 1986, préfacée et annotée par Patrick Besnier.
[4] Paul Morand, La Dame blanche des Habsbourg (1963), Perrin, 1980, p. 93.
19:40 Écrit par Le déclinologue dans France, Histoire, Littérature et arts, Livres, Problématiques sexuelles | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : l'aiglon, edmond rostand, napoléon, napoléon ii, duc de reichstadt, roi de rome, hugo, maurice barrès, les déracinés, john grand-carteret, astrid de belgique, grotesque triste, lady diana, légende, cyrano de bergerac, sarah bernhardt, hamlet, émile pouvillon, metternich, flambeau, chantecler, patrick besnier, abel gance, georges fourest, la négresse blonde, en passant sur le quai, jeune-france, habsbourg, paul morand, maude adams, travesti héroïque, jean marais, midinettes, panache, raymond roussel, fin-de-siècle, marie-louise, bonapartisme, enfants gâtés, don juan, flaubert, jérôme savary, produits dérivés, mary marquet, nostalgie, impuissance, élégie funèbre, histoire, de gaulle, père |  |
|  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer | |
Imprimer | |  Digg |
Digg |  |
|


