ALFRED DE MUSSET : CHOIX DE CITATIONS
22.02.2017
 Alfred de Musset (1810-1857) est à la fois connu et méconnu. Plusieurs de ses pièces sont régulièrement jouées et plaisent par leur grâce poétique, leur vivacité, leur fantaisie qui en atténue le sombre tragique. Le reste de son œuvre est en péril. Sa poésie est, il faut bien l’avouer, « étranglée par la forme vieille », comme le disait Rimbaud de Lamartine, avant de se déchaîner directement contre lui [1] : beaucoup de verbosité redondante, beaucoup de pathos romantique, des hectolitres d’alexandrins pour délayer sa complaisance à se regarder souffrir… Et néanmoins, Musset est plus proche de Baudelaire (qui pourtant le méprisait aussi) qu’on pourrait le croire : angoisse du temps et de la mort, obsession de la déchéance, double postulation, etc. Par-delà ses déclamations et sa facilité, sachons écouter Musset, peut-être l’expression la plus pure du romantisme français de 1830. Comme le remarquait Jules Renard, « il faut admirer le génie de Musset, parce que ses défauts ne sont que ceux de son époque » [2]. Notons aussi qu’il avait sur la société moderne un regard assez lucide et qu’on trouve chez lui quelques observations à ce sujet qui, pour n’aller pas plus loin que des exclamations de poète, n’en sont pas moins intéressantes.
Alfred de Musset (1810-1857) est à la fois connu et méconnu. Plusieurs de ses pièces sont régulièrement jouées et plaisent par leur grâce poétique, leur vivacité, leur fantaisie qui en atténue le sombre tragique. Le reste de son œuvre est en péril. Sa poésie est, il faut bien l’avouer, « étranglée par la forme vieille », comme le disait Rimbaud de Lamartine, avant de se déchaîner directement contre lui [1] : beaucoup de verbosité redondante, beaucoup de pathos romantique, des hectolitres d’alexandrins pour délayer sa complaisance à se regarder souffrir… Et néanmoins, Musset est plus proche de Baudelaire (qui pourtant le méprisait aussi) qu’on pourrait le croire : angoisse du temps et de la mort, obsession de la déchéance, double postulation, etc. Par-delà ses déclamations et sa facilité, sachons écouter Musset, peut-être l’expression la plus pure du romantisme français de 1830. Comme le remarquait Jules Renard, « il faut admirer le génie de Musset, parce que ses défauts ne sont que ceux de son époque » [2]. Notons aussi qu’il avait sur la société moderne un regard assez lucide et qu’on trouve chez lui quelques observations à ce sujet qui, pour n’aller pas plus loin que des exclamations de poète, n’en sont pas moins intéressantes.
J’ai réparti les citations que j’ai rassemblées dans les dix rubriques suivantes, accessibles d’un clic. Dans chacune, je les ai rangées par ordre chronologique d’écriture, sans tenir aucun compte des genres, comme si c’était la même voix qui s’exprimait, accompagnée par divers instruments. Démarche critiquable mais dont le résultat est parfois curieux.
Autoportrait Psychologie humaine Les femmes et l’amour
Religion, philosophie Désenchantement Le siècle moderne
Paradoxes et cynisme Politique, patriotisme Morale Littérature
. Je suis jeune ; j'arrive. À moitié de ma route, / Déjà las de marcher, je me suis retourné. / La science de l'homme est le mépris sans doute ; / C'est un droit de vieillard qui ne m'est pas donné. / Mais qu'en dois-je penser ? Il n'existe qu'un être / Que je puisse en entier et constamment connaître, / Sur qui mon jugement puisse au moins faire foi, / Un seul !… Je le méprise. – Et cet être, c'est moi. (Alfred de Musset, Premières poésies, « Les vœux stériles » (1830) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 114).
. Grèce, ô mère des arts, terre d'idolâtrie, / De mes vœux insensés éternelle patrie, / J'étais né pour ces temps où les fleurs de ton front / Couronnaient dans les mers l'azur de l'Hellespont. / Je suis un citoyen de tes siècles antiques ; / Mon âme avec l'abeille erre sous tes portiques. (Alfred de Musset, Premières poésies, « Les vœux stériles » (1830) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 114-115).
. Je ne me suis pas fait écrivain politique, / N’étant pas amoureux de la place publique. / Dailleurs, il n’entre pas dans mes prétentions / D’être l’homme du siècle et de ses passions. / C’est un triste métier que de suivre la foule, / Et de vouloir crier plus fort que les meneurs, / Pendant qu’on se raccroche au manteau des traîneurs. / On est toujours à sec, quand le fleuve s’écoule. (Alfred de Musset, La Coupe et les lèvres, Dédicace (1832) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 155).
. Que de gens aujourd’hui chantent la liberté, / Comme ils chantaient les rois, ou l’homme de brumaire ! / Que de gens vont se pendre au levier populaire, / Pour relever le dieu qu’ils avaient souffleté ! / On peut traiter cela du beau nom de rouerie, / Dire que c’est le monde et qu’il faut qu’on en rie. / C’est peut-être un métier charmant, mais tel qu’il est, / Si vous le trouvez beau, moi, je le trouve laid. / Je n’ai jamais chanté ni la paix ni la guerre ; / Si mon siècle se trompe, il ne m’importe guère : / Tant mieux s’il a raison, et tant pis s’il a tort ; / Pourvu qu’on dorme encore au milieu du tapage, / C’est tout ce qu’il me faut, et je ne crains pas l’âge / Où les opinions deviennent un remord. (Alfred de Musset, La Coupe et les lèvres, Dédicace (1832) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 155).
. Mais je hais les cités, les pavés et les bornes, / Tout ce qui porte l’homme à se mettre en troupeau, / Pour vivre entre deux murs et quatre faces mornes ; / Le front sous un moellon, les pieds sur un tombeau. (Alfred de Musset, La Coupe et les lèvres, Dédicace (1832) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 156).
. Mais je hais les pleurards, les rêveurs à nacelles, / Les amants de la nuit, des lacs, des cascatelles, / Cette engeance sans nom, qui ne peut faire un pas / Sans s’inonder de vers, de pleurs et d’agendas. / La nature, sans doute, est comme on veut la prendre. / Il se peut, après tout, qu’ils sachent la comprendre ; / Mais eux, certainement, je ne les comprends pas. (Alfred de Musset, La Coupe et les lèvres, Dédicace (1832) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 156).
. Silvio : « Que pourrai-je valoir, seigneur, en action ? / Tout le réel pour moi n’est qu’une fiction. » (Alfred de Musset, À quoi rêvent les jeunes filles (1832), I, 4 ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 219).
. Octave : « Le monde entier m’a abandonné ; je tâche d'y voir double, afin de me servir à moi-même de compagnie. » (Alfred de Musset, Les Caprices de Marianne (1833), II, 1 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 89).
. Octave : « C’était un homme d’un autre temps ; il connaissait les plaisirs, et leur préférait la solitude ; il savait combien les illusions sont trompeuses, et il préférait ses illusions à la réalité. Elle eût été heureuse la femme qui l’eût aimé. » (Alfred de Musset, Les Caprices de Marianne (1833), II, 6 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 100).
. Dis-moi un peu d'où vient cette manie de n'être jamais ce qu'on est ? (Alfred de Musset, Le Roman par lettres (1833), X ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 301).
. Il souffrira longtemps, celui qui conçoit les larmes sans but et les douleurs sans motifs, la pire de toutes les douleurs. Il souffrira longtemps, celui qui ne peut dire ce qu’il désire et qui répond seulement que ce qu’il possède n’est pas ce qu’il désire ! celui pour qui ce monde si magnifique n’est qu’un piédestal sans statue ! (Alfred de Musset, Le Roman par lettres (1833), X ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 302).
. Le meilleur de ma vie a passé comme un rêve / Si léger, qu’il m’est cher encor. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Silvia » (1839) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 367).
. Camargo : « Qui peut lécher peut mordre, et qui peut embrasser / Peut étouffer. » (Alfred de Musset, Les Marrons du feu (1829), II ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 26).
. L’homme / Qui vit sans jalousie, en ce bas monde, est comme / Celui qui dort sans lampe ; il peut sentir le bras / Qui vient pour le frapper, mais il ne le voit pas. (Alfred de Musset, Premières poésies, « Portia » (1829), I ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 59). 
. Quel homme fut jamais si grand, qu’il se pût croire / Certain, ayant vécu, d’avoir une mémoire / Où son souvenir, jeune et bravant le trépas, / Pût revivre une vie et ne s’éteindre pas ? / Les larmes d’ici-bas ne sont qu’une rosée / Dont un matin au plus la terre est arrosée, / Que la brise secoue, et que boit le soleil ; / Puis l’oubli vient au cœur, comme aux yeux le sommeil. (Alfred de Musset, Premières poésies, « Portia » (1829), III ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 68).
. Qui trouvera le temps d’écouter vos malheurs ? / On croit au sang qui coule, et l'on doute des pleurs. (Alfred de Musset, Premières poésies, « Les vœux stériles » (1830) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 117).
. Ce n’est point assez de tant de tristesse ; / Et ne vois-tu pas que changer sans cesse / Nous rend doux et chers les chagrins passés ? (Alfred de Musset, Premières poésies, « Chanson » (1831) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 114).
. Il n'est pire douleur / Qu'un souvenir heureux dans les jours de malheur. (Alfred de Musset, Premières poésies, « Le saule », I (1831) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 133).
. Laërte : « Ceux qui parlent beaucoup savent prouver très peu. » (Alfred de Musset, À quoi rêvent les jeunes filles (1832), II, 1 ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 223).
. La voix : « Et bientôt l’habitude / Tous les jours, malgré toi, t’enseigna ce chemin ; / Car l’habitude est tout au pauvre cœur humain. » (Alfred de Musset, La Coupe et les lèvres (1832), I, 3 ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 169).
. Les montagnards : « Eh ! quel homme ici-bas n’a son déguisement ? / Le froc du pèlerin, la visière du casque, / Sont autant de cachots pour voir sans être vu. / Et n’en est-ce pas un souvent que la vertu ? / Vrai masque de bouffon, que l’humble hypocrisie / Promène sur le vain théâtre de la vie, / Mais qui, mal fixé, tremble, et que la passion / Peut faire à chaque instant tomber dans l’action. » (Alfred de Musset, La Coupe et les lèvres (1832), V, 2 ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 201).
. Fantasio : « L’esprit peut venir à un homme vieux, tout comme à une jeune fille. Cela est si difficile quelquefois de distinguer un trait spirituel d’une grosse sottise ! » (Alfred de Musset, Fantasio (1833), II, 1 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 119).
. Fantasio : « Chacun a ses lunettes ; mais personne ne sait au juste de quelle couleur en sont les verres. Qui est-ce qui pourra me dire au juste si je suis heureux ou malheureux, bon ou mauvais, triste ou gai, bête ou spirituel ? » (Alfred de Musset, Fantasio (1833), II, 1 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 121).
. Fantasio : « La dimension d’un palais ou d’une chambre ne fait pas l’homme plus ou moins libre. Le corps se remue où il peut : l’imagination ouvre quelquefois des ailes grandes comme le ciel dans un cachot grand comme la main. » (Alfred de Musset, Fantasio (1833), II, 5 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 127).
. Lorenzo : « Je ne les méprise point [=les hommes], je les connais. Je suis très persuadé qu'il y en a très peu de très méchants, beaucoup de lâches, et un grand nombre d'indifférents. » (Alfred de Musset, Lorenzaccio (1834), V, 2 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 243).
. Mais hélas ! je n’en suis pas à apprendre aujourdhui quel hiéroglyphe terrible c’est que ce mot si souvent répété, le bonheur ! Ô mon Dieu, la création toute entière frémit de crainte et d’espérance en l’entendant. – Le bonheur ! Est-ce l’absence du désir ? est-ce de sentir tous les atomes de son être en contact avec d’autres ? Est-ce dans la pensée, dans les sens, dans le cœur que se trouve le bonheur ? Qui sait pourquoi il souffre ? (Alfred de Musset, lettre n° 34-13 à George Sand, 15 juin 1834 ; dans Correspondance d’Alfred de Musset, tome 1. 1826-1839, P.U.F., 1985, p. 108).
. En pensant à ses amours, on ne regarde pas le bout de son nez. (Alfred de Musset, lettre n° 35-22 à Alfred Tattet, 3 août 1835 ; dans Correspondance d’Alfred de Musset, tome 1. 1826-1839, P.U.F., 1985, p. 163).
. Jacqueline : « Vous êtes jeune, et à l'âge où le cœur est riche, on n'a pas les lèvres avares. » (Alfred de Musset, Le Chandelier (1835), II, 4 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 357).
. Valentin : « Faites-moi nommer premier ministre et vous verrez comme je ferai mon chemin. » [3] (Alfred de Musset, Il ne faut jurer de rien (1836), I, 1 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 380).
. Van Buck : « Elle vous plaisait hier au soir, quand vous ne l’aviez encore qu’entrevue […]. Maintenant, vous la trouvez laide, parce qu'elle a fait à peine attention à vous. » (Alfred de Musset, Il ne faut jurer de rien (1836), II, 1 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 394).
. Se railler de la gloire, de la religion, de l’amour, de tout au monde, est une grande consolation pour ceux qui ne savent que faire. […] Et puis il est doux de se croire malheureux, lorsqu’on n’est que vide et ennuyé. (Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle (1836), I, 2 ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 76).
. Les malheurs ont leurs symptômes comme les maladies, et il n'y a rien de si redoutable en mer qu'un petit point noir à l'horizon. (Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle (1836), IV, 1 ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 189).
. Étrange chose, que l’homme qui souffre veuille faire souffrir ce qu’il aime ! Qu’on ait si peu d’empire sur soi, n’est-ce pas la pire des maladies ? (Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle (1836), IV, 2 ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 201).
. L'incertitude est de tous les tourments le plus difficile à supporter. (Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle (1836), V, 2 ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 233).
. La muse : « Le cœur a beau mentir, la blessure est au fond. » (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « La nuit d’août » (1836) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 317).
. La muse : « Crois-tu donc qu'on oublie autant qu'on le souhaite ? » (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « La nuit d’août » (1836) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 318).
. Qu'est-ce donc qu’oublier, si ce n'est pas mourir ? / Ah ! c’est plus que mourir ; c’est survivre à soi-même. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Lettre à M. de Lamartine » (1836) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 333).
. Le poète : « C’était un mal vulgaire et bien connu des hommes ; / Mais, lorsque nous avons quelque ennui dans le cœur, / Nous nous imaginons, pauvres fous que nous sommes, / Que personne avant nous n’a senti la douleur. » (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « La nuit d’octobre » (1837) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 320).
. Le poète : « Il est doux de pleurer, il est doux de sourire / Au souvenir des maux qu'on pourrait oublier. » (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « La nuit d’octobre » (1837) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 321).
. Ce n'est quelquefois qu'en perdant ceux qu'on aime qu'on sent combien on les aimait. (Alfred de Musset, Emmeline (1837), IV ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 389).
. Durand : « Ah ! Dupont, que le monde aime la calomnie ! / Quel ingrat animal que ce sot genre humain, / Et que l’on a de peine à faire son chemin ! » (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Dupont et Durand » (1838) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 351).
. Durand : « Ah ! Dupont, qu’il est doux de tout déprécier ! / Pour un esprit mort-né, convaincu d’impuissance, / Qu’il est doux d’être un sot et d’en tirer vengeance ! / À quelque vrai succès lorsqu’on vient d’assister, / Qu’il est doux de rentrer et de se débotter, / Et de dépecer l’homme, et de salir sa gloire, / Et de pouvoir sur lui vider une écritoire, / Et d’avoir quelque part un journal inconnu / Où l’on puisse à plaisir nier ce qu’on a vu ! / Le mensonge anonyme est le bonheur suprême. / Écrivains, députés, ministres, rois, Dieu même, / J’ai tout calomnié pour apaiser ma faim. / Malheureux avec moi qui jouait au plus fin ! » (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Dupont et Durand » (1838) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 356).
. Dans un cœur troublé par le souvenir, il n'y a pas de place pour l'espérance ; ces deux sentiments, dans leur extrême vivacité, s’excluent l’un l’autre. (Alfred de Musset, Frédéric et Bernerette (1838), III ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 462).
. Frédéric avait fait sur lui-même une funeste tentative. […] Les indifférents trouvent trop souvent du ridicule à des actes semblables, lorsqu’on y survit. Les jugements du monde sont tristes sur ce point ; on rit de celui qui essaye de mourir, et celui qui meurt est oublié. (Alfred de Musset, Frédéric et Bernerette (1838), X ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 498).
. La sagesse est un travail, et pour être seulement raisonnable, il faut se donner beaucoup de mal, tandis que pour faire des sottises, il n’y a qu’à se laisser aller. (Alfred de Musset, Margot (1838), IV ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 539).
. Notez que le jour où [la sagesse] nous échappe, il ne nous est tenu aucun compte de l’avoir roulée [comme Sisyphe] pendant nombre d’années, tandis qu’au contraire, si un fou vient à faire, par hasard, une action raisonnable, on lui en sait un gré infini. [4] (Alfred de Musset, Margot (1838), IV ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 540).
. Il est singulier qu’aux choses de ce monde ceux qui se trompent le mieux soient précisément ceux qui y sont intéressés. (Alfred de Musset, Margot (1838), VII ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 556).
. Albert : « Je compris que l’aimer était peine inutile ; / Et cependant mon cœur prit un amer plaisir / À sentir qu’il aimait et qu’il allait souffrir ! » (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Idylle » (1839) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 362).
. Albert : « Et la satiété, qui succède au désir, / Amène un tel dégoût quand le cœur se soulève, / Que je ne sais, au fond, si c’est peine ou plaisir. » (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Idylle » (1839) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 364).
. Le plus grand danger que courent les gens qui sont habituellement un peu fous, c'est de le devenir tout à fait par instants. (Alfred de Musset, Croisilles (1839), V ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 521).
. De ces biens passagers que l’on goûte à demi, / Le meilleur qui nous reste est un ancien ami. / On se brouille, on se fuit. – Qu’un hasard nous rassemble, / On s’approche, on sourit, la main touche la main, / Et nous nous souvenons que nous marchions ensemble, / Que l’âme est immortelle, et qu’hier c’est demain. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « À M. V.H. » (1843) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 428).
. Tout vrai regard est un désir ; / Mais le désir n'est rien si l'on n'espère. (Alfred de Musset, Poésies posthumes, « Impromptu » ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 494).
. Camargo : « La pensée / D’un homme est de plaisirs et d’oublis traversée ; / Une femme ne vit et ne meurt que d’amour ; / Elle songe une année à quoi lui pense un jour ! » (Alfred de Musset, Les Marrons du feu (1829), IV ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 35).
. L'amour (hélas ! l’étrange et la fausse nature !) / Vit d'inanition, et meurt de nourriture. (Alfred de Musset, Premières poésies, « Mardoche » (1829), XVI ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 92).
. On garde le parfum en effeuillant la rose ; / Il n’est si triste amour qui n’ait son souvenir. (Alfred de Musset, La Coupe et les lèvres, Dédicace (1832) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 154). 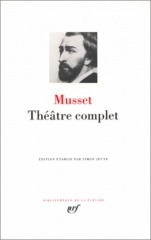
. Doutez, si vous voulez, de l’être qui vous aime, / D’une femme ou d’un chien, mais non de l’amour même. / L’amour est tout, – l’amour, et la vie au soleil. / Aimer est le grand point, qu’importe la maîtresse ? / Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse ? (Alfred de Musset, La Coupe et les lèvres, Dédicace (1832) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 157).
. Frank : « Voilà bien la sirène et la prostituée ; – / Le type de l’égout ; – la machine inventée / Pour désopiler l’homme et pour boire son sang : / La meule de pressoir de l’abrutissement. / Quelle atmosphère étrange on respire autour d’elle ! / Elle épuise, elle tue, et n’en est que plus belle. / Deux anges destructeurs marchent à son côté ; / Doux et cruels tous deux, – la mort, – la volupté. – / Je me souviens encor de ces spasmes terribles, / De ces baisers muets, de ces muscles ardents, / De cet être absorbé, blême et serrant les dents. / S’ils ne sont pas divins, ces moments sont horribles. / Quel magnétisme impur peut-il donc en sortir ? / Toujours en l’embrassant j’ai désiré mourir. / Ah ! malheur à celui qui laisse la débauche / Planter le premier clou sous sa mamelle gauche ! / Le cœur d’un homme vierge est un vase profond : / Lorsque la première eau qu’on y verse est impure, / La mer y passerait sans laver la souillure, / Car l’abîme est immense, et la tache est au fond. » (Alfred de Musset, La Coupe et les lèvres (1832), IV, 1 ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 190).
. La voix : « La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, / Et vous aurez vécu, si vous avez aimé. » (Alfred de Musset, À quoi rêvent les jeunes filles (1832), I, 1 ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 210).
. Silvio : « Mes rivaux, sous mes yeux, sauront plaire et charmer. / Je resterai muet ; – moi, je ne sais qu’aimer. » — Laërte : « Les femmes cependant demandent autre chose. / Bien plus, sans les aimer, du moment que l’on ose, / On leur plaît. La faiblesse est si chère à leur cœur / Qu’il leur faut un combat pour avoir un vainqueur. / Croyez-moi, j’ai connu ces êtres variables. / Il n’existe, dit-on, ni deux feuilles semblables, / Ni deux cœurs faits de même, et moi, je vous promets / Qu’en en séduisant une on séduit tout un monde. / L’une aura les pieds plats, l’autre la jambe ronde, / Mais la communauté ne changera jamais. » (Alfred de Musset, À quoi rêvent les jeunes filles (1832), I, 4 ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 218).
. Laërte : « Bon ! Je ne hais rien tant que les jeunes roués. / Le cœur d’un libertin est fait comme une auberge ; / On y trouve à toute heure un grand feu bien nourri, / Un bon gîte, un bon lit, – et la clef sur la porte. / Mais on entre aujourd’hui : demain il faut qu’on sorte. / Ce n’est pas ce bois-là, dont on fait un mari. / Que tout vous soit nouveau, quand la femme est nouvelle. » (Alfred de Musset, À quoi rêvent les jeunes filles (1832), II, 1 ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 224).
. Une femme est comme votre ombre : courez après, elle vous fuit ; fuyez-la, elle court après vous. (Alfred de Musset, Premières poésies, « Namouna », épigraphe (1832) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 239).
. Marianne : « Qu’est-ce après tout qu’une femme ? L’occupation d’un moment, une coupe fragile qui renferme une goutte de rosée, qu’on porte à ses lèvres et qu’on jette par-dessus son épaule. Une femme ! c’est une partie de plaisir ! Ne pourrait-on pas dire, quand on en rencontre une : Voilà une belle nuit qui passe ? » (Alfred de Musset, Les Caprices de Marianne (1833), II, 1 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 86).
. J’ai vu trop de feintes faiblesses succomber devant moi, j’ai vu trop souvent les mêmes gestes, les mêmes larmes, la même faute et les mêmes remords ; tous les amours ne se ressemblent pas, toutes les maîtresses se ressemblent. (Alfred de Musset, Le Roman par lettres (1833), IX ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 300).
. Le cardinal Cibo : « Heureux celui qui sait se faire aimer ainsi après sept années de mariage ! » (Alfred de Musset, Lorenzaccio (1834), I, 3 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 148).
. Salviati : « Toutes les femmes sont faites pour coucher avec les hommes, et ta sœur peut bien coucher avec moi. » (Alfred de Musset, Lorenzaccio (1834), I, 5 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 158).
. Le baron : « Je connais ces êtres charmants et indéfinissables [=les femmes]. Soyez persuadé qu’elles aiment à avoir de la poudre dans les yeux, et que plus on leur en jette, plus elles les écarquillent, afin d’en gober davantage. » (Alfred de Musset, On ne badine pas avec l’amour (1834), I, 2 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 258).
. Perdiccan : « Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels ; toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées ; le monde n’est qu’un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange ; mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c’est l’union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux ; mais on aime, et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière, et on se dit : J’ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j’ai aimé. C’est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » (Alfred de Musset, On ne badine pas avec l’amour (1834), II, 5 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 280).
. Le chevalier : « Si vous voulez plaire aux femmes, […] traitez-les toutes (sans exception) ni plus ni moins que des divinités. Vous pouvez, il est vrai, si cela vous plaît, dire hautement aux autres hommes que de ces mêmes femmes vous n’en faites aucun cas, mais seulement d’une manière générale, et sans jamais médire d’une seule plutôt que du reste. » (Alfred de Musset, La Quenouille de Barberine (1835), I, 2 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 304 et 1099). [5]
. Retenez ceci ; il n’y a de bon, de vrai, de gai, de triste, d’aimable, de variable, de désirable, de potable, de chantable, de célébrable, d’idolâtrable, que le delta qui existe depuis la ceinture d’une femme jusqu’à ses jarretières. La motte est faite en triangle, il est clair que c’est le symbole de la divinité. (Alfred de Musset, lettre n° 35-22 à Alfred Tattet, 3 août 1835 ; dans Correspondance d’Alfred de Musset, tome 1. 1826-1839, P.U.F., 1985, p. 163).
. Desgenais : « Vouloir chercher dans la vie réelle des amours pareils à ceux [de la mythologie], éternels et absolus, c’est la même chose que de chercher sur la place publique des femmes aussi belles que la Vénus, ou de vouloir que les rossignols chantent les symphonies de Beethoven. / La perfection n’existe pas ; la comprendre est le triomphe de l’intelligence humaine ; la désirer pour la posséder est la plus dangereuse des folies. » (Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle (1836), I, 5 ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 93).
. Desgenais : « Prenez de l’amour ce qu’un homme sobre prend de vin ; ne devenez pas un ivrogne. Si votre maîtresse est sincère et fidèle, aimez-la pour cela ; mais si elle ne l’est pas, et qu’elle soit jeune et belle, aimez-la parce qu’elle est jeune et belle ; et si elle est agréable et spirituelle, aimez-la encore ; et si elle n’est rien de tout cela, mais qu’elle vous aime seulement, aimez-la encore. On n’est pas aimé tous les soirs. » (Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle (1836), I, 5 ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 96).
. Desgenais : « Si vous êtes une nature exaltée, croyant à des rêves et voulant les réaliser, je vous réponds alors tout net : L’amour n’existe pas. » (Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle (1836), I, 5 ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 99).
. Quel tombeau que le cœur, et quelle solitude ! (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Lettre à M. de Lamartine » (1836) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 333).
. L’amour est une divinité jalouse qui s’irrite dès qu’on cesse de la craindre, et on aime quelquefois seulement parce qu’on a promis de ne pas aimer. (Alfred de Musset, Frédéric et Bernerette (1838), III ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 463).
. Il ne connaissait pas les mobiles étranges qui gouvernent quelquefois les actions des femmes ; il ne savait pas que celle qui veut réellement refuser se contente de dire « non », et que celle qui s’explique veut être convaincue. (Alfred de Musset, Frédéric et Bernerette (1838), III ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 465).
. Rodolphe : « Non, l’amour qui se tait n’est qu’une rêverie. / Le silence est la mort, et l’amour est la vie ; / Et c’est un vieux mensonge à plaisir inventé, / Que de croire au bonheur hors de la volupté ! / Je ne puis partager ni plaindre ta souffrance. / Le hasard est là haut pour les audacieux ; / Et celui dont la crainte a tué l’espérance / Mérite son malheur et fait injure aux dieux. » (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Idylle » (1839) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 364).
. Rodolphe : « Le droit est au plus fort, en amour comme en guerre, / Et la femme qu’on aime aura toujours raison. » (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Idylle » (1839) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 365).
. En te perdant je sens que je t’aimais. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Adieu » (1839) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 386).
. Oui, femmes, quoi qu'on puisse dire, / Vous avez le fatal pouvoir / De nous jeter par un sourire / Dans l'ivresse ou le désespoir. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « À Mademoiselle *** » (1839) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 388).
. Les femmes, j’en conviens, sont assez ignorantes. / On ne dit pas tout haut ce qui les rend contentes ; / Et, comme, en général, un peu de fausseté / Est leur plus grand plaisir après la vanité, / On en peut, par hasard, trouver qui sont méchantes. / Mais qu’y voulez-vous faire ? elles ont la beauté. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Après une lecture », VII (1842) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 424).
. Le comte : « L'amour est immortellement jeune, et les façons de l'exprimer sont et demeureront éternellement vieilles. Les formes usées, les redites, ces lambeaux de romans qui vous sortent du cœur on ne sait pas pourquoi, tout cet entourage, tout cet attirail, c’est un cortège de vieux chambellans, de vieux diplomates, de vieux ministres, c’est le caquet de l’antichambre d’un roi ; tout cela passe, mais le roi ne meurt pas ; l’amour est mort, vive l’amour ! » (Alfred de Musset, Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée (1845) ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 463).
. Margot : « Aimer, c'est une grande affaire ; il faut avoir du courage pour aimer. » (Alfred de Musset, Margot (1838), VII ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 560).
. Rosemberg : « Quoi de plus léger qu'une plume ? la poussière ; – de plus léger que la poussière ? le vent ; – de plus léger que le vent ? la femme ; – de plus léger que la femme ? rien. » (Alfred de Musset, Barberine (1853), II, 1 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 1101). [6]
. Le baron de Valbrun : « On peut bien être ridicule quand on aime, mais on ne l'est pas quand on souffre. » (Alfred de Musset, L’Âne et le ruisseau (1855), X ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 750).
. Tu crois ce que tu vois ! ô raisonneur habile ! / Et l'aveugle, à ton gré, que croira-t-il alors ? / Parce que l'on t'a fait à ta prison d'argile / Une fenêtre ou deux pour y voir au dehors ; / Parce que la moitié d'un rayon de lumière / Échappé du soleil dans ton œil peut glisser, / Quand il n'est pas bouché par un grain de poussière, / Tu crois qu'avec ses lois le monde y va passer ! / Ô mon ami ! le monde incessamment remue / Autour de nous, en nous, et nous n'en voyons rien. / C'est un spectre voilé qui nous crée et nous tue ; / C'est un bourreau masqué que notre ange gardien. / […] Un geste ! malheureux ! tu ne sais pas peut-être / Que la religion n'est qu'un geste, et le prêtre / Qui, l'hostie à la main, lève le bras sur nous, / Un saint magnétiseur qu'on écoute à genoux ! / […] Quand Christus renversa les idoles de Rome, / Il avait vu quel pas restait à faire encor, / Et qu'à qui veut donner l'homme pour maître à l'homme / Un caveau verrouillé vaut mieux qu'un trépied d'or. / C'est ce pouvoir, ami, c'est ce nœud redoutable / De l'aigle à l'hirondelle et du prêtre à l'enfant, / Qui fait que l'homme fort doit briser son semblable / Contre sa volonté de fer qui le défend. (Alfred de Musset, Premières poésies, « Suzon » (1831) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 109-110).
. Frank [entendant des moines parler du Jugement divin] : « C’est une jonglerie atroce, en vérité ! / Ô toi qui les entends, suprême Intelligence, / Quelle pagode ils font de leur Dieu de vengeance ! / Quel bourreau rancunier, brûlant à petit feu ! / Toujours la peur du feu. – C’est bien l’esprit de Rome. / Ils vous diront après que leur Dieu s’est fait homme. / J’y reconnais plutôt l’homme qui s’est fait Dieu. » (Alfred de Musset, La Coupe et les lèvres (1832), IV, 1 ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 186). 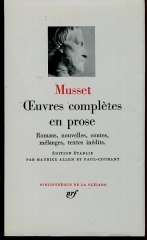
. Frank : « Si le doute, ce fruit tardif et sans saveur, / Est le dernier qu’on cueille à l’arbre de science, / Qu’ai-je à faire de plus, moi qui le porte au cœur ? / Le doute ! il est partout, et le courant l’entraîne, / Ce linceul transparent, que l’incrédulité / Sur le bord de la tombe a laissé par pitié / Au cadavre flétri de l’espérance humaine ! » (Alfred de Musset, La Coupe et les lèvres (1832), IV, 1 ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 196).
. Octave : « Où est donc la raison de tout cela ? pourquoi la fumée de cette pipe va-t-elle à droite plutôt qu’à gauche ? Voilà la raison de tout. – Fou ! trois fois fou à lier, celui qui calcule ses chances, qui met la raison de son côté ! La justice céleste tient une balance dans ses mains. La balance est parfaitement juste, mais tous les poids sont creux. Dans l’un il y a une pistole, dans l’autre un soupir amoureux, dans celui-là une migraine, dans celui-ci il y a le temps qu’il fait, et toutes les actions humaines s’en vont de haut en bas, selon ces poids capricieux. » (Alfred de Musset, Les Caprices de Marianne (1833), II, 4 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 98).
. Elsbeth : « Dieu laisse faire les hommes, […] et il ne fait guère plus de cas de nos plaintes que du bêlement d’un mouton. » (Alfred de Musset, Fantasio (1833), II, 1 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 117).
. Ô Christ ! je ne suis pas de ceux que la prière / Dans tes temples muets amène à pas tremblants ; / Je ne suis pas de ceux qui vont à ton Calvaire, / En se frappant le cœur, baiser tes pieds sanglants ; / Et je reste debout sous tes sacrés portiques, / Quand ton peuple fidèle, autour des noirs arceaux, / Se courbe en murmurant sous le vent des cantiques, / Comme au souffle du nord un peuple de roseaux. / Je ne crois pas, ô Christ ! à ta parole sainte. / […] Les clous du Golgotha te soutiennent à peine ; / Sous ton divin tombeau le sol s’est dérobé : / Ta gloire est morte, ô Christ ! et sur nos croix d’ébène / Ton cadavre céleste en poussière est tombé ! (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Rolla », I (1833) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 274).
. Lorenzo : « S'il y a quelqu'un là-haut, il doit bien rire de nous tous ; cela est très comique, très comique, vraiment. » (Alfred de Musset, Lorenzaccio (1834), IV, 9 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 231).
. À vingt-deux ans [7], sans avoir jamais fait de mal à personne, en être où je suis, et recevoir ainsi constamment jour par jour, un nouveau coup de pierre sur la tête, c’est trop. Qu’il y ait une Providence ou non, je n’en veux rien savoir ; s’il y en a une, je le lui dis en face : elle est injuste et cruelle. Elle est la plus forte, je le sais ; qu’elle me tue. Je ferai mieux que de la maudire, je la renie. (Alfred de Musset, lettre n° 34-25 à George Sand, 15 septembre 1834 ; dans Correspondance d’Alfred de Musset, tome 1. 1826-1839, P.U.F., 1985, p. 125-126).
. En lisant l’histoire de la chute de l’empire romain, il est impossible de ne pas s’apercevoir du mal que les chrétiens, si admirables dans le désert, firent à l’État dès qu’ils eurent la puissance. (Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle (1836), I, 2 ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 77).
. Je ne puis ; – malgré moi l’infini me tourmente. / Je n’y saurais songer sans crainte et sans espoir ; / Et, quoi qu’on en ait dit, ma raison s’épouvante / De ne pas le comprendre et pourtant de le voir. / Qu’est-ce donc que ce monde, et qu’y venons-nous faire, / Si, pour qu’on vive en paix, il faut voiler les cieux ? / Passer comme un troupeau les yeux fixés à terre, / Et renier le reste, est-ce donc être heureux ? / Non, c’est cesser d’être homme et dégrader son âme. / Dans la création le hasard m’a jeté ; / Heureux ou malheureux, je suis né d’une femme, / Et je ne puis m’enfuir hors de l’humanité. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « L’espoir en Dieu » (1838) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 341).
. Me voilà dans les mains d’un Dieu plus redoutable / Que ne sont à la fois tous les maux d’ici-bas ; / Me voilà seul, errant, fragile et misérable, / Sous les yeux d’un témoin qui ne me quitte pas. / Il m’observe, il me suit. Si mon cœur bat trop vite, / J’offense sa grandeur et sa divinité. / Un gouffre est sous mes pas ; si je m’y précipite, / Pour expier une heure il faut l’éternité. / Mon juge est un bourreau qui trompe sa victime. / Pour moi tout devient piège et tout change de nom ; / L’amour est un péché, le bonheur est un crime, / Et l’œuvre des sept jours n’est que tentation. / Je ne garde plus rien de la nature humaine ; / Il n’existe pour moi ni vertu ni remord. / J’attends la récompense et j’évite la peine ; / Mon seul guide est la peur, et mon seul but la mort. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « L’espoir en Dieu » (1838) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 342).
. On me dit cependant qu’une joie infinie / Attend quelques élus. – Où sont-ils, ces heureux ? / Si vous m’avez trompé, me rendrez-vous la vie ? / Si vous m’avez dit vrai, m’ouvrirez-vous les cieux ? / Hélas ! ce beau pays dont parlaient vos prophètes, / S’il existe là-haut, ce doit être un désert. / Vous les voulez trop purs, les heureux que vous faites, / Et, quand leur joie arrive, ils en ont trop souffert. / Je suis seulement homme, et ne veux pas moins être, / Ni tenter davantage. – À quoi donc m’arrêter ? / Puisque je ne puis croire aux promesses du prêtre, / Est-ce l’indifférent que je vais consulter ? (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « L’espoir en Dieu » (1838) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 342).
. Puisque tu te laisses comprendre, / Pourquoi fais-tu douter de toi ? / Quel triste plaisir peux-tu prendre / À tenter notre bonne foi ? (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « L’espoir en Dieu » (1838) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 344).
. Pourquoi donc, ô Maître suprême ! / As-tu créé le mal si grand, / Que la raison, la vertu même, / S’épouvantent en le voyant ? (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « L’espoir en Dieu » (1838) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 345).
. À qui donc, juste Dieu ! peut-on dire : À demain ? / L’Espérance et la Mort se sont donné la main, / Et traversent ainsi la terre désolée. / L’une marche à pas lents, toujours calme et voilée ; / Sur ses genoux tremblants l’autre tombe en chemin, / Et se traîne en pleurant, meurtrie et mutilée. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Le treize juillet », V (1843) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 431).
. Ô Mort ! tes pas sont lents, mais ils sont bien comptés. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Le treize juillet », VI (1843) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 431).
. Razetta : « J'ai trop connu ce qu'on est convenu d'appeler la vie, pour n'avoir pas trouvé au fond de cette mer le mépris de ce qu'on aperçoit à la surface. » (Alfred de Musset, La Nuit vénitienne (1830), I ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 12).
. Qu'ai-je fait ? qu'ai-je appris ? – Le temps est si rapide ! / L'enfant marche joyeux, sans songer au chemin ; / Il le croit infini, n'en voyant pas la fin. / Tout à coup il rencontre une source limpide, / Il s'arrête, il se penche, il y voit un vieillard. (Alfred de Musset, Premières poésies, « Les vœux stériles » (1830) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 114).
. Ô vieillesse ! à quoi donc sert ton expérience ? / Que te sert, spectre vain, de te courber d'avance / Vers le commun tombeau des hommes, si la mort / Se tait en y rentrant, lorsque la vie en sort ? / N'existait-il donc pas à cette loterie / Un joueur par le sort assez bien abattu / Pour que, me rencontrant sur le seuil de la vie, / Il me dît en sortant : N'entrez pas, j'ai perdu ! (Alfred de Musset, Premières poésies, « Les vœux stériles » (1830) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 114). 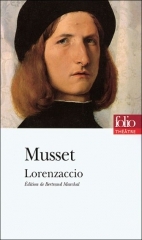
. À l'action ! au mal ! Le bien reste ignoré. / Allons ! cherche un égal à des maux sans remède. / Malheur à qui nous fit ce sens dénaturé ! / Le mal cherche le mal, et qui souffre nous aide. / L'homme peut haïr l'homme, et fuir, mais malgré lui, / Sa douleur tend la main à la douleur d'autrui. / C'est tout. Pour la pitié, ce mot dont on nous leurre, / Et pour tous ces discours prostitués sans fin, / Que l'homme au cœur joyeux jette à celui qui pleure, / Comme le riche jette au mendiant son pain, / Qui pourrait en vouloir ? et comment le vulgaire, / Quand c'est vous qui souffrez, pourrait-il le sentir, / Lui que Dieu n'a pas fait capable de souffrir ? (Alfred de Musset, Premières poésies, « Les vœux stériles » (1830) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 116).
. Ainsi va le monde ici-bas. / Le temps emporte sur son aile / Et le printemps et l'hirondelle, / Et la vie et les jours perdus ; / Tout s’en va comme la fumée, / L’espérance et la renommée, / Et moi qui vous ai tant aimée, / Et toi qui ne t’en souviens plus ! (Alfred de Musset, Premières poésies, « À Juana » (1831) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 126).
. L’oubli, ce vieux remède à l’humaine misère, / Semble avec la rosée être tombé des cieux. / Se souvenir, hélas ! – oublier, – c’est sur terre / Ce qui, selon les jours, nous fait jeunes ou vieux ! (Alfred de Musset, Premières poésies, « Le saule », II (1831) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 138).
. Ah ! si la rêverie était toujours possible ! / Et si le somnambule, en étendant la main, / Ne trouvait pas toujours la nature inflexible / Qui lui heurte le front contre un pilier d’airain ! / Si l’on pouvait se faire une armure insensible ! / Si l’on rassasiait l’amour comme la faim ! (Alfred de Musset, Premières poésies, « Namouna », I, 56 (1832) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 251).
. Frank : « Le mépris, Dieu puissant, voilà donc la science ! / L’éternelle sagesse est l’éternel silence ; / Et nous aurons réduit, quand tout sera compté, / Le balancier de l’âme à l’immobilité. / Quel hideux océan est-ce donc que la vie, / Pour qu’il faille y marcher à la superficie, / Et glisser au soleil en effleurant les eaux, / Comme ce fils de Dieu qui marchait sur les flots ? / Quels monstres effrayants, quels difformes reptiles / Labourent donc les mers sous les pieds des nageurs, / Pour qu’on trouve toujours les vagues si tranquilles, / Et la pâleur des morts sur le front des plongeurs ? / A-t-elle assez traîné, cette éternelle histoire / Du néant de l’amour, du néant de la gloire, / Et de l’enfant prodigue auprès de ses pourceaux ! » (Alfred de Musset, La Coupe et les lèvres (1832), IV, 1 ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 197).
. Frank : « Magnifique univers, en est-ce ainsi partout ? / Ô nuit, profonde nuit, spectre toujours debout, / Large création, quand tu lèves tes voiles / Pour te considérer dans ton immensité, / Vois-tu du haut en bas la même nudité ? » (Alfred de Musset, La Coupe et les lèvres (1832), IV, 1 ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 198).
. Y a-t-il une idée plus exécrable que celle-là ? Ce qui m’a plu hier m’ennuie aujourdhui, et ce qui me plaît aujourdhui m’ennuiera demain. Quel chien vorace est-ce donc que le néant ? Faut-il qu’il nous prenne jour par jour cette vie si courte dont la totalité lui appartient tôt ou tard ? Oui, il faut qu’il tire l’échelle derrière nous dès que nous faisons une halte ; que dis-je, qu’il nous la brise entre les jambes, échelon par échelon, dès que nous levons un pied pour avancer ! (Alfred de Musset, Le Roman par lettres (1833), III ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 292).
. Cœlio : « Malheur à celui qui, au milieu de la jeunesse, s'abandonne à un amour sans espoir ! Malheur à celui qui se livre à une douce rêverie, avant de savoir où sa chimère le mène, et s'il peut être payé de retour ! Mollement couché dans une barque, il s’éloigne peu à peu de la rive ; il aperçoit au loin des plaines enchantées, de vertes prairies et le mirage léger de son Eldorado. Les vents l’entraînent en silence, et quand la réalité le réveille, il est aussi loin du but où il aspire que du rivage qu’il a quitté ; il ne peut plus ni poursuivre sa route ni revenir sur ses pas. » (Alfred de Musset, Les Caprices de Marianne (1833), I, 1 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 73).
. Fantasio : « Hélas ! tout ce que les hommes se disent entre eux se ressemble ; les idées qu’ils échangent sont presque toujours les mêmes dans toutes leurs conversations. » (Alfred de Musset, Fantasio (1833), I, 2 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 108).
. Fantasio : « Quelle misérable chose que l’homme ! Ne pas pouvoir seulement sauter par sa fenêtre sans se casser les jambes ! être obligé de jouer du violon à dix ans pour devenir un musicien passable ! Apprendre pour être peintre, pour être palefrenier ! Apprendre pour faire une omelette ! » (Alfred de Musset, Fantasio (1833), I, 2 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 111).
. Lorenzo : « Vous êtes resté immobile au bord de l’océan des hommes, et vous avez regardé dans les eaux la réflexion de votre propre lumière. Du fond de votre solitude, vous trouviez l’océan magnifique sous le dais splendide des cieux. Vous ne comptiez pas chaque flot, vous ne jetiez pas la sonde ; vous étiez plein de confiance dans l’ouvrage de Dieu. Mais moi, pendant ce temps-là, j’ai plongé – je me suis enfoncé dans cette mer houleuse de la vie – j’en ai parcouru toutes les profondeurs, couvert de ma cloche de verre – tandis que vous admiriez la surface, j’ai vu les débris des naufrages, les ossements et les Léviathans. » (Alfred de Musset, Lorenzaccio (1834), III, 3 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 200-201).
. Lorenzo : « Je me suis réveillé de mes rêves, rien de plus ; je te dis le danger d’en faire. Je connais la vie, et c’est une vilaine cuisine, sois-en persuadé, ne mets pas la main là dedans, si tu respectes quelque chose. » (Alfred de Musset, Lorenzaccio (1834), III, 3 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 201).
. Lorenzo : « Tous les masques tombaient devant mon regard ; l’Humanité souleva sa robe, et me montra, comme à un adepte digne d’elle, sa monstrueuse nudité. J’ai vu les hommes tels qu’ils sont, et je me suis dit : Pour qui est-ce donc que je travaille ? Lorsque je parcourais les rues de Florence, avec mon fantôme à mes côtés, je regardais autour de moi, je cherchais les visages qui me donnaient du cœur, et je me demandais : Quand j’aurai fait mon coup, celui-là en profitera-t-il ? – J’ai vu les républicains dans leurs cabinets, je suis entré dans les boutiques, j’ai écouté et j’ai guetté. J’ai recueilli les discours des gens du peuple, j’ai vu l’effet que produisait sur eux la tyrannie ; j’ai bu dans les banquets patriotiques le vin qui engendre la métaphore et la prosopopée ; j’ai avalé entre deux baisers les larmes les plus vertueuses ; j’attendais toujours que l’humanité me laissât voir sur sa face quelque chose d’honnête. » (Alfred de Musset, Lorenzaccio (1834), III, 3 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 202).
. Lorenzo : « Tu ne veux voir en moi qu’un mépriseur d’hommes : c’est me faire injure. Je sais parfaitement qu’il y en a de bons, mais à quoi servent-ils ? que font-ils ? comment agissent-ils ? Qu’importe que la conscience soit vivante, si le bras est mort ? Il y a de certains côtés par où tout devient bon : un chien est un ami fidèle ; on peut trouver en lui le meilleur des serviteurs, comme on peut voir aussi qu’il se roule sur les cadavres, et que la langue avec laquelle il lèche son maître sent la charogne d’une lieue. Tout ce que j’ai à voir, moi, c’est que je suis perdu, et que les hommes n’en profiteront pas plus qu’ils ne me comprendront. » (Alfred de Musset, Lorenzaccio (1834), III, 3 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 203).
. Lorenzo : « Les jeunes gens à la mode ne se font-ils pas une gloire d’être vicieux, et les enfants qui sortent du collège ont-ils quelque chose de plus pressé que de se pervertir ? Quel bourbier doit donc être l’espèce humaine, qui se rue ainsi dans les tavernes avec des lèvres affamées de débauche. » (Alfred de Musset, Lorenzaccio (1834), IV, 5 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 225).
. Desgenais : « Quand bien même votre maîtresse ne vous aurait jamais trompé, et quand elle n’aimerait que vous à présent, songez […] combien son amour serait encore loin de la perfection, combien il serait humain, petit, restreint aux lois de l’hypocrisie du monde ; songez qu’un autre homme l’a possédée avant vous, et même plus d’un autre homme ; que d’autres encore la posséderont après vous. » (Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle (1836), I, 5 ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 94).
. Desgenais : « Ce qui vous pousse en ce moment au désespoir, c’est cette idée de perfection que vous vous étiez faite sur votre maîtresse, et dont vous voyez qu’elle est déchue. Mais dès que vous comprendrez bien que cette idée première elle-même était humaine, petite et restreinte, vous verrez que c’est bien peu de chose qu’un degré de plus ou de moins sur cette grande échelle pourrie de l’imperfection humaine. » (Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle (1836), I, 5 ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 94).
. Octave : « Un homme de vingt ans peut avoir plus vécu qu’une femme de trente. La liberté dont les hommes jouissent les mène bien plus vite au fond de toutes choses ; ils courent sans entraves à tout ce qui les attire ; ils essaient de tout. Dès qu’ils espèrent, ils se mettent en marche ; ils vont, ils s’empressent. Arrivés au but, ils se retournent ; l’espérance est restée en route, et le bonheur a manqué de parole. » (Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle (1836), III, 4 ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 163).
. Octave : « Combien de temps pour qu'elle m'oublie si je n'existe plus demain ? combien de larmes ? aucune peut-être ! Pas un ami, personne qui l'approche, qui ne lui dise que ma mort est un bien, qui ne s'empresse de l'en consoler, qui ne la conjure de n'y plus songer ! Si elle pleure, on voudra la distraire ; si un souvenir la frappe, on l'écartera ; si son amour me survit en elle, on l'en guérira comme d'un empoisonnement ; et elle-même, qui le premier jour dira peut-être qu'elle veut me suivre, se détournera dans un mois pour ne pas voir de loin le saule pleureur qu'on aura planté sur ma tombe ! Comment en serait-il autrement ? » (Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle (1836), V, 6 ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 278-279).
. Hélas ! ces longs regrets des amours mensongères, / Ces ruines du temps qu’on trouve à chaque pas, / Ces sillons infinis de lueurs éphémères, / Qui peut se dire un homme, et ne les connaît pas ? / Quiconque aima jamais porte une cicatrice ; / Chacun l’a dans le sein, toujours prête à s’ouvrir ; / Chacun la garde en soi, cher et secret supplice, / Et mieux il est frappé, moins il en veut guérir. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Lettre à M. de Lamartine » (1836) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 330).
. Mme Delaunay : « Si rien n'est plus doux que le souvenir du bonheur, rien n'est plus affreux que de s'apercevoir que le bonheur passé était un mensonge. Avez-vous jamais pensé à ce que ce peut être que de haïr ceux qu'on a aimés ? Concevez-vous rien de pis ? » (Alfred de Musset, Les Deux maîtresses (1837), VII ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 355).
. Quand j’ai connu la Vérité, / J’ai cru que c’était une amie ; / Quand je l’ai comprise et sentie, / J’en étais dégoûté. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Tristesse » (1840) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 402).
. Oui, sans doute, tout meurt ; ce monde est un grand rêve, / Et le peu de bonheur qui nous vient en chemin, / Nous n’avons pas plutôt ce roseau dans la main, / Que le vent nous l’enlève. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Souvenir » (1841) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 407).
. Pourquoi sur ces flots où s’élance / L’Espérance, / Ne voit-on que le Souvenir / Revenir ? (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Réponse à M. Charles Nodier » (1843) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 444).
. Temps heureux, temps aimés ! Mes mains alors peut-être, / Mes lâches mains, pour vous auraient pu s'occuper ; / Mais aujourd'hui pour qui ? dans quel but ? sous quel maître ? / L'artiste est un marchand, et l'art est un métier. / Un pâle simulacre, une vile copie, / Naissent sous le soleil ardent de l'Italie… / Nos œuvres ont un an, nos gloires ont un jour ; / Tout est mort en Europe, – oui, tout, – jusqu'à l'amour. (Alfred de Musset, Premières poésies, « Les vœux stériles » (1830) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 115-116).
. Frank : « Ô siècles à venir ! Quel est donc votre sort ? / La gloire comme une ombre au ciel est remontée. / L’amour n’existe plus ; la vie est dévastée, – / Et l’homme, resté seul, ne croit plus qu’à la mort. / […] Que vous restera-t-il, enfants de nos entrailles, / Le jour où vous viendrez suivre les funérailles / De cette moribonde et vieille humanité ? / Ah ! tu nous maudiras, pâle postérité ! / Nos femmes ne mettront que des vieillards au monde. / Ils frapperont la terre avant de s’y coucher ; / Puis ils crieront à Dieu : "Père, elle était féconde. / À qui donc as-tu dit de nous la dessécher ?"» (Alfred de Musset, La Coupe et les lèvres (1832), IV, 1 ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 196). 
. Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux. / D’un siècle sans espoir naît un siècle sans crainte ; / Les comètes du nôtre ont dépeuplé les cieux. / Maintenant le hasard promène au sein des ombres / De leurs illusions les mondes réveillés ; / L’esprit des temps passés, errant sur leurs décombres, / Jette au gouffre éternel tes anges mutilés. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Rolla », I (1833) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 274).
. Vous vouliez pétrir l’homme à votre fantaisie ; / Vous vouliez faire un monde. – Eh bien, vous l’avez fait. / Votre monde est superbe, et votre homme est parfait ! / Les monts sont nivelés, la plaine est éclaircie ; / Vous avez sagement taillé l’arbre de vie ; / Tout est bien balayé sur vos chemins de fer ; / Tout est grand, tout est beau, mais on meurt dans votre air. / Vous y faites vibrer de sublimes paroles ; / Elles flottent au loin dans des vents empestés. / Elles ont ébranlé de terribles idoles ; / Mais les oiseaux du ciel en sont épouvantés. / L’hypocrisie est morte, on ne croit plus aux prêtres ; / Mais la vertu se meurt, on ne croit plus à Dieu. / Le noble n’est plus fier du sang de ses ancêtres ; / Mais il le prostitue au fond d’un mauvais lieu. / On ne mutile plus la pensée et la scène, / On a mis au plein vent l’intelligence humaine ; / Mais le peuple voudra des combats de taureau. / Quand on est pauvre et fier, quand on est riche et triste, / On n’est plus assez fou pour se faire trappiste ; / Mais on fait comme Escousse [8], on allume un réchaud. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Rolla », IV (1833) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 286-287).
. Oui, c’est la vérité, le théâtre et la presse / Étalent aujourd’hui des spectacles hideux, / Et c’est, en pleine rue, à se boucher les yeux. / Un vil mépris de tout nous travaille sans cesse ; / La Muse, de nos temps, ne se fait plus prêtresse, / Mais bacchante ; et le monde a dégradé ses dieux. // Oui, c’est la vérité qu’à peine émancipée, / L’intelligence humaine, hier esclave encor, / A pris à tire-d’aile un monstrueux essor. / Nos hommes ont souillé leur plus vaillante épée, / La Parole, cette arme au sein de Dieu trempée, / Dont notre siècle au flanc porte la lame d’or. (Alfred de Musset, Poésies complémentaires, « La loi sur la presse » (1835) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 473-474).
. Le siècle présent […] n’est ni [le présent] ni [l’avenir], ressemble à tous deux à la fois, et [on n’y] sait, à chaque pas qu’on fait, si l'on marche sur une semence ou sur un débris. (Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle (1836), I, 2 ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 69).
. Tout ce qui était n'est plus ; tout ce qui sera n'est pas encore. Ne cherchez pas ailleurs le secret de nos maux. (Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle (1836), I, 2 ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 78).
. Dites-moi un peu où est le progrès ? On dit que l'humanité marche ; c'est possible, mais dans quoi, bon Dieu ! (Alfred de Musset, Lettres de Dupuis et Cotonet, III (mars 1837) ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 854).
. Il n’en est pas ainsi dans nos fêtes grossières : / Les vierges aujourd’hui se montrent moins sévères, / Et se laissent toucher sans grâce et sans fierté. / Nous ouvrons à qui veut nos quadrilles vulgaires ; / Nous perdons le respect qu’on doit à la beauté, / Et nos plaisirs bruyants font fuir la volupté. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « À la mi-carême » (1838) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 341).
. Dabord, le grand fléau qui nous rend tous malades, / Le seigneur Journalisme et ses pantalonnades ; / Ce droit quotidien qu’un sot a de berner / Trois ou quatre milliers de sots, à déjeuner ; / Le règne du papier, l’abus de l’écriture, / Qui d’un plat feuilleton fait une dictature, / Tonneau d’encre bourbeux par Fréron défoncé, / Dont, jusque sur le trône, on est éclaboussé ; / En second lieu, nos mœurs, qui se croient plus sévères, / Parce que nous cachons et nous rinçons nos verres, / Quand nous avons commis dans quelque coin honteux / Ces éternels péchés dont pouffaient nos aïeux ; / Puis nos discours pompeux, nos fleurs de bavardage, / L’esprit européen de nos coqs de village, / Ce bel art si choisi d’offenser poliment, / Et de se souffleter parlementairement ; / Puis, nos livres mort-nés, nos poussives chimères, / Pâture des portiers ; et ces pauvres commères, / Qui, par besoin d’amants ou faute de maris, / Font du moins leur besogne en pondant leurs écrits ; / Ensuite, un mal profond, la croyance envolée, / La prière inquiète, errante et désolée, / Et, pour qui joint les mains, pour qui lève les yeux, / Une croix en poussière et le désert aux cieux ; / Ensuite, un mal honteux, le bruit de la monnaie, / La jouissance brute et qui croit être vraie, / La mangeaille, le vin, l’égoïsme hébété, / Qui se berce en ronflant dans sa brutalité ; / Puis un tyran moderne, une peste nouvelle, / La médiocrité, qui ne comprend rien qu’elle, / Qui, pour chauffer la cuve où son fer fume et bout, / Y jetterait le bronze où César est debout, / Instinct de la basoche, odeur d’épicerie, / Qui fait lever le cœur à la mère patrie, / Capable, avec le temps, de la déshonorer, / Si sa fierté native en pouvait s’altérer. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Sur la paresse » (1841) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 410-411).
. Il n’est que trop facile, à qui sait regarder, / De comprendre pourquoi tout est malade en France ; / Le mal des gens d’esprit, c’est leur indifférence, / Celui des gens de cœur, leur inutilité. / Mais à quoi bon venir prêcher la vérité, / Et devant les badauds étaler sa faconde, / Pour répéter en vers ce que dit tout le monde ? / Sur notre état présent qui s’abuse aujourd’hui ? / Comme dit Figaro : « Qui trompe-t-on ici ? » / D’ailleurs, est-ce un plaisir d’exprimer sa pensée ? (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Sur la paresse » (1841) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 413).
. Comme elles tomberaient, nos gloires mendiées, / De patois étrangers nos muses barbouillées, / Devant toi [=Mathurin Régnier]. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Sur la paresse » (1841) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 412).
. Voyez-vous, ma chère, au siècle où nous sommes, / La plupart des hommes / Sont très inconstants. / Sur deux amoureux pleins d’un zèle extrême, / La moitié vous aime / Pour passer le temps. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Conseils à une Parisienne » (1845) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 452).
. En vérité, ce siècle est un mauvais moment. / Tout s’en va, les plaisirs et les mœurs d’un autre âge, / Les rois, les dieux vaincus, le hasard triomphant. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Sonnet au lecteur » (1850) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 465).
. Frank : « Qu’importe le moyen, pourvu qu’on s’en souvienne ? / Le bien a pour tombeau l’ingratitude humaine. / Le mal est plus solide : Érostrate a raison. » (Alfred de Musset, La Coupe et les lèvres (1832), IV, 1 ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 195). 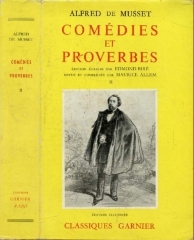
. Frank : « Prends-y garde ; je pars. – N’importe le chemin. – / Je marcherai, – j’irai, – partout où l’âme humaine / Est en spectacle, et souffre. – Ah ! la haine ! la haine ! / La seule passion qui survive à l’espoir ! » (Alfred de Musset, La Coupe et les lèvres (1832), IV, 1 ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 195).
. Avec de la mémoire on se tire de tout. (Alfred de Musset, Premières poésies, « Namouna », I, 23 (1832) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 244).
. Tibia : « Un arrêt de mort est une chose superbe à lire à haute voix. » (Alfred de Musset, Les Caprices de Marianne (1833), I, 3 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 82).
. Fantasio : « Un calembour console de bien des chagrins ; et jouer avec les mots est un moyen comme un autre de jouer avec les pensées, les actions et les êtres. Tout est calembour ici-bas. » (Alfred de Musset, Fantasio (1833), II, 1 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 121).
. Lorenzo : « Ce que vous dites là est parfaitement vrai et parfaitement faux, comme tout au monde. » (Alfred de Musset, Lorenzaccio (1834), II, 2 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 166).
. Tebaldeo : « Les nations paisibles et heureuses ont quelquefois brillé d’une clarté pure, mais faible. Il y a plusieurs cordes à la harpe des anges ; le zéphyr peut murmurer sur les plus faibles, et tirer de leur accord une harmonie suave et délicieuse ; mais la corde d’argent ne s’ébranle qu’au passage du vent du nord. C’est la plus belle et la plus noble ; et cependant le toucher d’une rude main lui est favorable. L’enthousiasme est frère de la souffrance. » — Lorenzo : « C’est-à-dire qu’un peuple malheureux fait les grands artistes. » (Alfred de Musset, Lorenzaccio (1834), II, 2 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 168).
. Perdiccan : « À quoi sert de se quereller, quand le raccommodement est impossible ? Le plaisir des disputes, c'est de faire la paix. » (Alfred de Musset, On ne badine pas avec l’amour (1834), III, 6 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 290-291).
. La muse : « Quel que soit le souci que ta jeunesse endure, / Laisse-la s’élargir, cette sainte blessure / Que les noirs séraphins t’ont faite au fond du cœur : / Rien ne nous rend si grands qu’une grande douleur. / Mais, pour en être atteint, ne crois pas, ô poète, / Que ta voix ici-bas doive rester muette. / Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, / Et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. » (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « La nuit de mai » (1835) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 308).
. Que la liberté sainte engendre la licence, / C’est un mal, je le sais ; et de tous les fléaux / Le pire est qu’un bandit soit bâtard d’un héros. / […] Dieu voulut qu’un grand bien fît toujours de grands maux. (Alfred de Musset, Poésies complémentaires, « La loi sur la presse » (1835) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 473).
. Desgenais : « Ne vous arrachez pas les cheveux et ne parlez pas de vous poignarder parce que vous avez un rival. Vous dites que votre maîtresse vous trompe pour un autre ; c’est votre orgueil qui en souffre ; mais changez seulement les mots : dites-vous que c’est lui qu’elle trompe pour vous, et vous voilà glorieux. » (Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle (1836), I, 5 ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 96).
. Octave : « Ne croyez-vous pas à l’expérience ? » — Mme Pierson : « Je sais que c’est le nom que la plupart des hommes donnent à leurs folies et à leurs chagrins. » (Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle (1836), III, 4 ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 162).
. Le poète : « C’est un engrais que le meurtre et la guerre. » (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « La nuit d’août » (1836) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 319).
. La muse : « Le coup dont tu te plains t’a préservé peut-être, / Enfant ; car c’est par là que ton cœur s’est ouvert. / L’homme est un apprenti, la douleur est son maître, / Et nul ne se connaît tant qu’il n’a pas souffert. / C’est une dure loi, mais une loi suprême, / Vieille comme le monde et la fatalité, / Qu’il nous faut du malheur recevoir le baptême, / Et qu’à ce triste prix tout doit être acheté. » (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « La nuit d’octobre » (1837) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 325).
. La muse : « Pourquoi veux-tu haïr ta jeune expérience, / Et détester un mal qui t’a rendu meilleur ? » (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « La nuit d’octobre » (1837) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 326).
. J’aime peu les proverbes en général, parce que ce sont des selles à tous chevaux ; il n’en est pas un qui n’ait son contraire, et, quelque conduite que l’on tienne, on en trouve un pour s’appuyer. (Alfred de Musset, Emmeline (1837), V ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 395).
. Les larmes du passé fécondent l'avenir. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Sur la naissance du comte de Paris » (1838) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 360).
. Le seul bien qui me reste au monde / Est d'avoir quelquefois pleuré. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Tristesse » (1840) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 402).
. Un souvenir heureux est peut-être sur terre / Plus vrai que le bonheur. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Souvenir » (1841) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 406).
. Troisième demoiselle : « L'espérance est le seul vrai bien qu'on puisse posséder. » (Alfred de Musset, Carmosine (1850), II, 6 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 581).
. Les montagnards : « Le modèle était mort, et le peuple crédule / Ne sait que ce qu’il voit. » (Alfred de Musset, La Coupe et les lèvres (1832), V, 2 ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 200). 
. Hartman : « Des lampions allumés ne font pas le bonheur d’un peuple. » (Alfred de Musset, Fantasio (1833), I, 2 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 106).
. La marquise Cibo : « Sais-tu où vont les larmes des peuples, quand le vent les emporte ? » (Alfred de Musset, Lorenzaccio (1834), III, 6 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 210).
. Le baron : « Il est impossible de faire le bonheur des hommes en général, et de ses vassaux en particulier, sans donner parfois à son valet de chambre l’ordre rigoureux de ne laisser entrer personne. Qu’il est austère et difficile le recueillement de l’homme d’État ! » (Alfred de Musset, On ne badine pas avec l’amour (1834), I, 2 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 257).
. Ce qu’on appelle la liberté de la presse, est, à mon avis, un des égouts les plus noirs de notre civilisation. C’est une banque qui fait de l’infamie un papier monnaie ; qu’on leur donne une bonne fois les étrivières, ce n’est pas moi qui réclamerai. (Alfred de Musset, lettre n° 35-22 à Alfred Tattet, 3 août 1835 ; dans Correspondance d’Alfred de Musset, tome 1. 1826-1839, P.U.F., 1985, p. 163).
. Que les hommes entre eux soient égaux sur la terre, / Je n’ai jamais compris que cela pût se faire, / Et je ne suis pas né de sang républicain. (Alfred de Musset, Poésies complémentaires, « La loi sur la presse » (1835) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 472).
. Je ne fais pas grand cas des hommes politiques ; / Je ne suis pas l’amant de nos places publiques ; / On n’y fait que brailler et tourner à tous vents. (Alfred de Musset, Poésies complémentaires, « La loi sur la presse » (1835) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 472).
. C’est un ardent soleil que celui de la France ; / Son immense clarté projette une ombre immense. (Alfred de Musset, Poésies complémentaires, « La loi sur la presse » (1835) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 473).
. Oui, c’est la vérité, la France déraisonne ; / Elle donne aux badauds, comme à Lacédémone, / Le spectacle effrayant d’un esclave enivré. / C’est que nous avons bu d’un vin pur et sacré, / Et joyeux vignerons qu’un pampre vert couronne, / Nous vendangeons encor d’un pas mal assuré. (Alfred de Musset, Poésies complémentaires, « La loi sur la presse » (1835) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 474).
. Que voulez-vous qu’on puisse dire, du moment que l’on peut tout dire ? (Alfred de Musset, Lettres de Dupuis et Cotonet, III (mars 1837) ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 852).
. Où le père a passé, passera bien l'enfant. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Le Rhin allemand » (1841) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 404).
. Quels projets nous faisions à cet âge ingénu / Où toute chose parle, où le cœur est à nu ! / Quand, avec tant de force, eut-on tant d’espérance ? / Innocente bravoure, audace de l’enfance ! / Nous croyions l’heure prête et le moment venu ; / Nous étions fiers et fous, mais nous avions la France. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Le treize juillet », XXVII (1843) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 435).
. Car la France, hier encor la maîtresse du monde, / A reçu, quoi qu’on dise, une atteinte profonde, / Et, comme Juliette, au fond des noirs arceaux, / À demi réveillée, à demi moribonde, / Trébuchant dans les plis de sa pourpre en lambeaux, / Elle marche au hasard, errant sur des tombeaux. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Le treize juillet », XXXI (1843) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 436).
. Le Prince : « [Une jeune fiancée] seule renferme les deux grands secrets du bonheur : le plaisir et l'oubli. » — Laurette : « Mais le chagrin ? » — La Prince : « C’est la réflexion, et il est si facile de la perdre ! » (Alfred de Musset, La Nuit vénitienne (1830), II ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 27).
. Il est sain de dormir, – ignoble de bâiller. (Alfred de Musset, La Coupe et les lèvres, Dédicace (1832) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 153).
. Franck : « Tout nous vient de l’orgueil, même la patience. / L'orgueil, c'est la pudeur des femmes, la constance / Du soldat dans le rang, du martyr sur la croix. / L'orgueil, c'est la vertu, l'honneur et le génie, / C'est ce qui reste encor d'un peu beau dans la vie, / La probité du pauvre et la grandeur des rois. » (Alfred de Musset, La Coupe et les lèvres (1832), I, 1 ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 163-164). 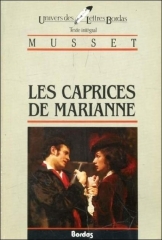
. Laërte : « Eh bien ! moi, tout celà m’amuse à la folie. / Je ne fais pas la guerre à la mélancolie. / Après l’oisiveté, c’est le meilleur des maux. / En général d’ailleurs, c’est ma pierre de touche ; / Elle ne pousse pas, cette plante farouche, / Sur la majestueuse obésité des sots. / Mais la gaîté, Silvio, sied mieux à la vieillesse ; / Nous voulons la beauté pour aimer la tristesse. / Il faut bien mettre un peu de rouge à soixante ans ; / C’est le métier des vieux de dérider le temps. » (Alfred de Musset, À quoi rêvent les jeunes filles (1832), II, 1 ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 222-223).
. Fantasio : « Ah ! pour être revenu de tout, mon ami, il faut être allé dans bien des endroits. » (Alfred de Musset, Fantasio (1833), I, 2 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 109).
. Fantasio : « Beaucoup parler, voilà l’important ; le plus mauvais tireur de pistolet peut attraper la mouche, s’il tire sept cent quatre-vingts coups à la minute, tout aussi bien que le plus habile homme qui n’en tire qu’un ou deux bien ajustés. » (Alfred de Musset, Fantasio (1833), II, 1 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 119).
. Tebaldeo : « Je n'appartiens à personne. Quand la pensée veut être libre, le corps doit l'être aussi. » (Alfred de Musset, Lorenzaccio (1834), II, 2 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 168).
. Lorenzo : « Prends garde à toi, Philippe, tu as pensé au bonheur de l’humanité. » (Alfred de Musset, Lorenzaccio (1834), III, 3 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 198).
. Lorenzo : « La vie est comme une cité – on peut y rester cinquante ou soixante ans sans voir autre chose que des promenades et des palais – mais il ne faut pas entrer dans les tripots, ni s’arrêter, en rentrant chez soi, aux fenêtres des mauvais quartiers. […] S’il s’agit de tenter quelque chose pour les hommes, je te conseille de te couper les bras, car tu ne seras pas longtemps à t’apercevoir qu’il n’y a que toi qui en aies. » (Alfred de Musset, Lorenzaccio (1834), III, 3 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 201).
. Lorenzo : « Je puis délibérer et choisir, mais non revenir sur mes pas quand j'ai choisi. » (Alfred de Musset, Lorenzaccio (1834), IV, 5 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 225).
. Sois heureuse, ou, si tu ne l’es pas, tâche d’oublier qu’on peut l’être. (Alfred de Musset, lettre n° 34-22 à George Sand, 23 août 1834 ; dans Correspondance d’Alfred de Musset, tome 1. 1826-1839, P.U.F., 1985, p. 119).
. Perdiccan : « Ces arbres et ces prairies enseignent à haute voix la plus belle de toutes [les choses], l’oubli de ce qu’on sait. » (Alfred de Musset, On ne badine pas avec l’amour (1834), I, 4 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 264).
. Si vous ne couchez pas avec les filles d’auberge, vous ne serez jamais qu’un ignorant. (Alfred de Musset, lettre n° 35-22 à Alfred Tattet, 3 août 1835 ; dans Correspondance d’Alfred de Musset, tome 1. 1826-1839, P.U.F., 1985, p. 163).
. Le chevalier : « Ne doutez pas du succès, et vous en aurez. » (Alfred de Musset, La Quenouille de Barberine (1835), I, 2 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 302).
. Le chevalier : « Pour réussir dans le monde […], retenez bien ces trois maximes : voir, c'est savoir ; vouloir, c'est pouvoir ; oser, c'est avoir. » (Alfred de Musset, La Quenouille de Barberine (1835), I, 2 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 304).
. Le chevalier : « N’ayez jamais l’air de vous occuper ni de ce que [les hommes] disent, ni de ce qu’ils font. Soyez toujours poli, mais paraissez indifférent ; ne vous échauffez jamais dans une discussion ; laissez à chacun ses idées, mais tenez-vous pour persuadé qu’il n’y a de bon que les vôtres. […] Que cette idée ne vous vienne jamais de paraître douter de vous, car aussitôt tout le monde en doute. Ne montrez pas en public la mesure de vos forces ; cela rend les gens tranquilles, fussiez-vous un Hercule. Eussiez-vous avancé par hasard la plus grande sottise du monde, n’en démordez pas pour un diable, et faites-vous plutôt assommer. » (Alfred de Musset, La Quenouille de Barberine (1835), I, 2 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 305 et 1099). [9]
. Le chevalier : « Frappez comme la flèche ; que le monde disparaisse à vos yeux ; que l’étincelle de vie que vous avez reçue de Dieu s’isole, et devienne un Dieu elle-même. Que votre volonté soit comme l’œil du lynx, comme le museau de la fouine, comme la flèche du guerrier. Oubliez, quand vous agissez, qu’il y ait d’autres êtres sur la terre que vous et celui à qui vous avez affaire. » (Alfred de Musset, La Quenouille de Barberine (1835), I, 2 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 306 et 1099).
. Desgenais : « L’insensé veut posséder le ciel ; le sage l’admire, s’agenouille et ne le désire pas. / La perfection […] n'est pas plus faite pour nous que l'immensité. Il faut ne la chercher en rien, ne la demander à rien, ni à l’amour, ni à la beauté, ni au bonheur, ni à la vertu ; mais il faut l’aimer pour être vertueux, beau et heureux autant que l’homme peut l’être. » (Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle (1836), I, 5 ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 94).
. Desgenais : « Ne confondez pas le vin avec l’ivresse ; ne croyez pas la coupe divine où vous buvez le breuvage divin ; ne vous étonnez pas le soir de la trouver vide et brisée. C’est une femme, c’est un vase fragile, fait de terre, par un potier. / Remerciez Dieu de vous montrer le ciel, et parce que vous battez de l’aile ne vous croyez pas un oiseau. » (Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle (1836), I, 5 ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 96).
. Desgenais : « Ne vous faites pas de règle de conduite et ne dites pas que vous voulez être aimé exclusivement ; car, en disant cela, comme vous êtes homme et inconstant vous-même, vous êtes forcé d’ajouter tacitement : Autant que cela est possible. / Prenez le temps comme il vient, le vent comme il souffle, la femme comme elle est. » (Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle (1836), I, 5 ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 97).
. Le poète : « Après avoir souffert, il faut souffrir encore ; / Il faut aimer sans cesse, après avoir aimé. » (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « La nuit d’août » (1836) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 319).
. Le poète : « Jours de travail ! Seuls jours où j'ai vécu ! / Ô trois fois chère solitude ! / Dieu soit loué, j’y suis donc revenu, / À ce vieux cabinet d’étude ! » (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « La nuit d’octobre » (1837) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 321).
. Mme de Léry : « Vous savez, ma chère, que les dentistes vous disent de crier, quand ils vous font mal. Moi, je vous dis : Pleurez ! Pleurez ! Douces ou amères, les larmes soulagent toujours. » (Alfred de Musset, Un caprice (1837), scène VI ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 434).
. Que faire donc ? Jouis, dit la raison païenne ; / Jouis et meurs ; les dieux ne songent qu’à dormir. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « L’espoir en Dieu » (1838) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 341).
. Minuccio : « La plus belle fille ne donne que ce qu'elle a, et l'ami le plus dévoué se tait sur ce qu'il ignore. » (Alfred de Musset, Carmosine (1850), III, 3 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 589).
. Les rimeurs, vous voyez, sont comme les amants. / Tant qu’on n’a rien écrit, il en est d’une idée / Comme d’une beauté qu’on n’a pas possédée : / On l’adore, on la suit ; – ses détours sont charmants. / Pendant que l’on tisonne en regardant la cendre, / On la voit voltiger ainsi qu’un salamandre ; / Chaque mot fait pour elle est comme un billet doux ; / On lui donne à souper ; – qui le sait mieux que vous ? / (Vous pourriez au besoin traiter une princesse.) / Mais dès qu’elle se rend, bonsoir, le charme cesse. / On sent dans sa prison l’hirondelle mourir. / Si tout cela, du moins, vous laissait quelque chose ! (Alfred de Musset, La Coupe et les lèvres, Dédicace (1832) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 154). 
. Je ne fais pas grand cas, pour moi, de la critique. / Toute mouche qu’elle est, c’est rare qu’elle pique. / On m’a dit l’an passé que j’imitais Byron : / Vous qui me connaissez, vous savez bien que non. / Je hais comme la mort l’état de plagiaire ; / Mon verre n’est pas grand, mais je bois dans mon verre. / C’est bien peu, je le sais, que d’être homme de bien, / Mais toujours est-il vrai que je n’exhume rien. (Alfred de Musset, La Coupe et les lèvres, Dédicace (1832) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 155).
. Il faut être ignorant comme un maître d’école / Pour se flatter de dire une seule parole / Que personne ici-bas n’ait pu dire avant vous. / C’est imiter quelqu’un que de planter des choux. (Alfred de Musset, Premières poésies, « Namouna », II, 9 (1832) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 257-258).
. Fantasio : « Ah ! si j’étais poète, comme je peindrais la scène de cette perruque voltigeant dans les airs ! Mais celui qui est capable de faire de pareilles choses dédaigne de les écrire. Ainsi la postérité s’en passera. » (Alfred de Musset, Fantasio (1833), II, 7 ; Pléiade Théâtre complet, 1990, p. 133).
. « Tiens, regarde celà [=un roman-feuilleton], et dis-moi si la littérature d’imagination peut vivre longtemps, quand on abrutit ainsi ses lecteurs en s’abrutissant soi-même. – Eh ! ne vois-tu pas que cette littérature de portières va faire sortir de terre tout un monde nouveau de lecteurs ignorants et à demi-barbares ? Je sais bien qu’elle se tuera elle-même par ses propres excès ; mais, avant cela, elle aura dégoûté les esprits délicats de la lecture. En attendant, je la renie. » (Alfred de Musset, propos oral vers 1839, rapporté par son frère Paul de Musset dans Biographie d’Alfred de Musset, sa vie et ses œuvres (1877), III, xii, Charpentier, 1881, p. 219-220).
. Dans tout vers remarquable d’un vrai poète, il y a deux ou trois fois plus que ce qui est dit ; c’est au lecteur à suppléer le reste, selon ses idées, sa force, ses goûts. (Alfred de Musset, Le Poète déchu (1839), VIII ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 316-317).
. La poésie est si essentiellement musicale qu'il n'y a pas de si belle pensée devant laquelle le poète ne recule si sa mélodie ne s'y trouve pas. (Alfred de Musset, Le Poète déchu (1839), VIII ; Pléiade Œuvres complètes en prose, 1960, p. 317).
. Que nous font, je vous prie, et que pourraient nous faire, / À nous autres rimeurs, de qui la grande affaire / Est de nous consoler en arrangeant des mots, / Que nous font les sifflets, les cris ou les bravos ? / Nous chantons à tue-tête ; il faut bien que la terre / Nous réponde, après tout, par quelques vains échos. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Après une lecture », III (1842) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 423).
. Or la beauté, c’est tout. Platon l’a dit lui-même : / La beauté, sur la terre, est la chose suprême. / C’est pour nous la montrer qu’est faite la clarté. / Rien n'est beau que le vrai, dit un vers respecté ; / Et moi, je lui réponds, sans crainte d'un blasphème : / Rien n'est vrai que le beau, rien n'est vrai sans beauté. (Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « Après une lecture », VIII (1842) ; Pléiade Poésies complètes, 1957, p. 424).
Autres pages de citations en rapport avec celle-ci sur ce blogue : William Shakespeare [en préparation] ; Écrivains divers du XVIIIe siècle [en préparation] ; Libertins du XVIIIe siècle [en préparation] ; Voltaire [en préparation] ; Jean-Jacques Rousseau [en préparation] ; Chamfort ; Napoléon [en préparation] ; Auteurs romantiques français [en préparation] ; Germaine de Staël ; Benjamin Constant ; Chateaubriand [en préparation] ; Stendhal [en préparation] ; Honoré de Balzac [en préparation] ; Alexandre Dumas ; Alfred de Vigny [en préparation] ; Victor Hugo [en préparation] ; Jules Michelet ; Sainte-Beuve [en préparation] ; Émile de Girardin [en préparation] ; Claude Tillier ; Alphonse Karr [en préparation] ; Théophile Gautier ; Baudelaire ; Flaubert [en préparation] ; Henri-Frédéric Amiel [en préparation] ; Jules Renard ; Oscar Wilde ; Élémir Bourges ; Paul-Jean Toulet ; Poètes français modernes [en préparation] ; Dramaturges français XIXe-XXe siècles [en préparation] ; Jean Giraudoux ; Gabriel Matzneff, – et la page générale : citations choisies et dûment vérifiées.
____________________________________
[1] C’est dans la lettre à Paul Demeny du 15 mai 1871, c’est-à-dire la lettre du Voyant : « Musset est quatorze fois exécrable pour nous, générations douloureuses et prises de visions, — que sa paresse d’ange a insultées ! Ô ! les contes et les proverbes fadasses ! Ô les nuits ! Ô Rolla, Ô Namouna, Ô la Coupe ! Tout est français, c’est-à-dire haïssable au suprême degré ; français, pas parisien ! Encore une œuvre de cet odieux génie qui a inspiré Rabelais, Voltaire, Jean La Fontaine, commenté par M. Taine ! Printanier, l’esprit de Musset ! Charmant, son amour ! En voilà, de la peinture à l’émail, de la poésie solide ! On savourera longtemps la poésie française, mais en France. Tout garçon épicier est en mesure de débobiner une apostrophe Rollaque, tout séminariste en porte les cinq-cents rimes dans le secret d’un carnet. À quinze ans, ces élans de passion mettent les jeunes en rut ; à seize ans, ils se contentent déjà de les réciter avec cœur ; à dix-huit ans, à dix-sept même, tout collégien qui a le moyen fait le Rolla, écrit un Rolla ! Quelques-uns en meurent peut-être encore. Musset n’a rien su faire : il y avait des visions derrière la gaze des rideaux : il a fermé les yeux. Français, panadif, traîné de l’estaminet au pupitre de collège, le beau mort est mort, et, désormais, ne nous donnons même plus la peine de le réveiller par nos abominations ! » (Pléiade Adam, 1972, p. 253).
[2] Journal, 1er décembre 1897 (Pléiade, 1972, p. 442).
[3] On peut l’entendre comme un cuir à la Henri Monnier, l’inventeur de Joseph Prudhomme : « Ah ! l’ambition, que de malheurs elle cause ! Elle a perdu Napoléon Ier, mon cher. S’il était resté lieutenant d’artillerie, il serait encore sur le trône. », mais aussi au sens de La Bruyère : « Jetez-moi dans les troupes comme un simple soldat, je suis Thersite ; mettez-moi à la tête d'une armée dont j'aie à répondre à toute l'Europe, je suis Achille. » (Les Caractères, IX, 41 ; Pléiade, 1951, p. 261).
[4] Comparez : « On reproche sévèrement à la Vertu ses défauts, tandis qu’on est plein d’indulgence pour les qualités du Vice. » (Balzac, Les Rivalités 1 : La Vieille fille (1836) ; Pléiade La Comédie humaine Castex, tome IV, 1976, p. 857).
[5] J’adopte ici le texte de Barberine (acte I, scène 4) : en 1853, Musset a réécrit pour la scène sa pièce de 1835. Le remaniement est si profond que c’est presque une autre pièce qui en résulte. Mais ce passage n’a été que légèrement modifié, comme le montre la variante c de la p. 304, qu’on lit p. 1099.
[6] Cette réplique, absente du texte de 1835, s’insère dans Barberine II, 1, qu’on peut considérer comme une réécriture de La Quenouille de Barberine I, 3. Elle est donnée p. 1101 dans la variante c de la p. 310.
[7] Né le 11 décembre 1810, Musset en avait vingt-trois, bientôt vingt-quatre.
[8] Victor Escousse (1813-1832) est un écrivain romantique qui, après avoir écrit et fait jouer trois drames, dont les deux derniers furent deux échecs, se suicida par asphyxie en compagnie d’un autre jeune écrivain, co-auteur de son troisième drame. Cette mort eut un grand retentissement. Béranger lui consacra son poème « Le suicide » et Hégésippe Moreau en parla dans son poème « Diogène » ; vingt ans plus tard, Alexandre Dumas évoquera cet épisode dans le chapitre 216 de Mes Mémoires. On peut lire à ce sujet La Gloire de Victor Escousse, par Claude Schopp, éd. Digraphe, 1996. Ce n’est pas le seul suicide d’écrivain mineur à l’époque : mentionnons le romancier Hippolyte Régnier-Destourbet en septembre 1832, les poètes Jules Mercier en juin 1834 et Émile Roulland en février 1835.
[9] La dernière phrase n’apparaît que dans Barberine I,4 (1853), version très remaniée de la pièce de 1835. Mais dans cette variante, si Musset a ajouté : « Eussiez-vous avancé par hasard la plus grande sottise du monde, n’en démordez pas pour un diable, et faites-vous plutôt assommer. », il a supprimé : « Ne montrez pas en public la mesure de vos forces ; cela rend les gens tranquilles, fussiez-vous un Hercule. » ainsi que, un peu plus haut : « ne vous échauffez jamais dans une discussion ; laissez à chacun ses idées, mais tenez-vous pour persuadé qu’il n’y a de bon que les vôtres. » Mon texte est donc un texte composite qui n’a existé ni en 1835 ni en 1853… Voir les variantes d, e et g de la p. 305, relevées p. 1099.

Écrire un commentaire