JULES VALLÈS, OCTAVE MIRBEAU, GEORGES DARIEN : MON CHOIX DE CITATIONS
16.02.2017
 Jules Vallès (1832-1885), Octave Mirbeau (1848-1917) et Georges Darien (1862-1921) me posaient un petit problème : j’hésitais sur l’assignation des citations que j’avais recueillies dans leurs livres : devais-je les placer plutôt dans ma page collective [en préparation] dévolue aux écrivains et penseurs de gauche, ou plutôt dans ma page collective dévolue aux romanciers français entre 1848 et 1914 ? Finalement j’ai tranché le nœud gordien en décidant de créer une page pour eux trois. Le butin était (du moins pour l’instant) trop maigre pour qu’ils eussent droit chacun à une page autonome, surtout Vallès et Darien, mais en les regroupant j’atteins une taille satisfaisante.
Jules Vallès (1832-1885), Octave Mirbeau (1848-1917) et Georges Darien (1862-1921) me posaient un petit problème : j’hésitais sur l’assignation des citations que j’avais recueillies dans leurs livres : devais-je les placer plutôt dans ma page collective [en préparation] dévolue aux écrivains et penseurs de gauche, ou plutôt dans ma page collective dévolue aux romanciers français entre 1848 et 1914 ? Finalement j’ai tranché le nœud gordien en décidant de créer une page pour eux trois. Le butin était (du moins pour l’instant) trop maigre pour qu’ils eussent droit chacun à une page autonome, surtout Vallès et Darien, mais en les regroupant j’atteins une taille satisfaisante.
Mettre ensemble Vallès, Mirbeau et Darien ne choquera, je pense, personne. Il saute aux yeux que ce sont les trois grands romanciers anarchistes ou anarchisants de la seconde moitié de notre grand dix-neuvième siècle. Leurs attaques frontales contre la société restent encore d’une grande force. 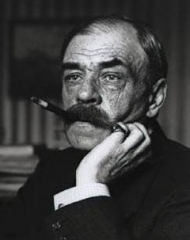
Le rapprochement de Vallès et Mirbeau est une évidence, presque un lieu commun. Tous deux ont des opinions politiques assez parentes. Tous deux ont été essentiellement et dabord journalistes, produisant tout au long de leur vie une masse impressionnante de chroniques et d’articles. Tous deux ont, en tant que romanciers, une inspiration fortement autobiographiques, et sont même les auteurs de trois romans tirés de leurs souvenirs de jeunesse (L’Enfant, Le Bachelier et L’Insurgé pour Vallès, Le Calvaire, L’Abbé Jules et Sébastien Roch pour Mirbeau). Enfin tous deux ont une visée réaliste dans le fond et la forme, mais aussi expressionniste, cherchant à renouveler la prose par la création d’un style proche de l’oral. Il n’est donc pas étonnant qu’ils soient souvent associés. Par exemple, il y a eu un colloque Vallès-Mirbeau à Montpellier en mars 2001, dont les actes ont été publiés dans la revue Autour de Vallès n°31. Darien est nettement moins fameux que ces deux auteurs qui sont constamment réédités depuis un siècle (même si leur place est encore mince dans les histoires littéraires et quasi inexistante dans les anthologies scolaires). Mais on trouve aussi, chez ce journaliste et romancier, virulence anarchiste, ton pamphlétaire, inspiration autobiographique, visée réaliste. Aussi sa parenté avec ses deux aînés est-elle fréquemment soulignée. Une thèse soutenue en mars 2015 à Paris-III par Aurélien Lorig, Un destin littéraire. Georges Darien, consacre ainsi tout son dernier chapitre, plus de soixante pages, à comparer Mirbeau et Darien, s’attachant particulièrement à leur production théâtrale. Un sous-chapitre en consacre aussi quelques pages à esquisser une comparaison entre Vallès et Darien, complétant un article universitaire de Christopher Lloyd qui explorait le parallèle [1]. Parmi les contemporains, l’idée que Darien fût l’héritier de Vallès avait déjà été lancée par Lucien Descaves et par Léon Daudet [2].
Darien est nettement moins fameux que ces deux auteurs qui sont constamment réédités depuis un siècle (même si leur place est encore mince dans les histoires littéraires et quasi inexistante dans les anthologies scolaires). Mais on trouve aussi, chez ce journaliste et romancier, virulence anarchiste, ton pamphlétaire, inspiration autobiographique, visée réaliste. Aussi sa parenté avec ses deux aînés est-elle fréquemment soulignée. Une thèse soutenue en mars 2015 à Paris-III par Aurélien Lorig, Un destin littéraire. Georges Darien, consacre ainsi tout son dernier chapitre, plus de soixante pages, à comparer Mirbeau et Darien, s’attachant particulièrement à leur production théâtrale. Un sous-chapitre en consacre aussi quelques pages à esquisser une comparaison entre Vallès et Darien, complétant un article universitaire de Christopher Lloyd qui explorait le parallèle [1]. Parmi les contemporains, l’idée que Darien fût l’héritier de Vallès avait déjà été lancée par Lucien Descaves et par Léon Daudet [2].
Jules Vallès : Romans Jules Vallès : Articles
Mirbeau : Chroniques politiques Mirbeau : Chroniques artistiques et littéraires
Octave Mirbeau : Romans et nouvelles Mirbeau : Théâtre Mirbeau : Correspondance
Georges Darien : Romans Georges Darien : Essais et articles
. Ah ! je crois qu’on eût mieux fait de m’aimer tout haut ! Il me semble qu’il me restera toujours, de ma vie d’enfant, des trous de mélancolie et des plaies sensibles dans le cœur ! (Jules Vallès, L’Enfant (1878), ch. XXV ; Pléiade tome II, 1990, p. 388).
. Le calembour n’empêche pas les convictions. (Jules Vallès, Le Bachelier (1881), ch. VIII ; Pléiade tome II, 1990, p. 503). 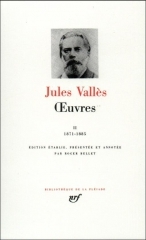
. Se singulariser, c’est très bête ! On se brouille avec tout le monde. J’aimerais bien mieux être de l’avis de la majorité ; on a toujours du café, et avec ça des politesses ; les gens disent : « Il est intelligent » parce que vous êtes de leur avis. (Jules Vallès, Le Bachelier (1881), ch. X ; Pléiade tome II, 1990, p. 518).
. Seul devant les balles, sous les boulets, on aurait peut-être peur – il ne faut pas se vanter d’avance – mais je sais bien que devant mes amis je ne voudrais pas reculer ; et mon courage me viendra beaucoup de ce que j’ai juré d’être brave dans ces séances à la chandelle. (Jules Vallès, Le Bachelier (1881), ch. XI ; Pléiade tome II, 1990, p. 522).
. Nous sommes arrivés, gourmands de la querelle, avides d’empoigner l’occasion. Il me semble que cela me grandirait de tenir cette belle lame d’acier, que celà m’apaiserait aussi de tuer un homme, un de ceux qui trouvent niais les gens qui ont un drapeau. (Jules Vallès, Le Bachelier (1881), ch. XV ; Pléiade tome II, 1990, p. 548).
. Il n’y a plus qu’à rouler sa carcasse bêtement, tristement, jusqu’au moment où elle sera démantibulée par la maladie plutôt que par le combat – j’en tremble !… […] Je dois avoir l’air vieux que je reprochais à mes amis ; j’ai vieilli, comme eux, plus qu’eux peut-être, parce que j’étais monté plus haut sur l’échelle des illusions ! (Jules Vallès, Le Bachelier (1881), ch. XVII ; Pléiade tome II, 1990, p. 565).
. Matoussaint : « Malheureusement, le siècle est à la prose, l’homme de génie est un anachronisme, puis le pouvoir a démoralisé les masses… » (Jules Vallès, Le Bachelier (1881), ch. XXVI ; Pléiade tome II, 1990, p. 632).
. Ce que je fais de personnel est dangereux, ce que je fais sur le patron des autres est bête !… (Jules Vallès, Le Bachelier (1881), ch. XXVI ; Pléiade tome II, 1990, p. 640).
. [Juste avant un duel :] C’est mon premier matin d’orgueil dans ma vie, toujours jusqu’ici humiliée et souffrante. Est-ce la peine de la mener ainsi, – pour aboutir à l’imbécilité des maniaques à cheveux blancs ?… Plutôt disparaître tout-de-suite dans une mort crâne. (Jules Vallès, Le Bachelier (1881), ch. XXXI ; Pléiade tome II, 1990, p. 691).
. Un flot de sang, d’où qu’il jaillisse, lavera la crotte et la tristesse de notre jeunesse ! (Jules Vallès, Le Bachelier (1881), ch. XXXI ; Pléiade tome II, 1990, p. 695).
. Si la vie des résignés ne dure pas plus que celle des rebelles, autant être un rebelle au nom d’une idée et d’un drapeau ! (Jules Vallès, Le Bachelier (1881), ch. XXXIII ; Pléiade tome II, 1990, p. 709).
. Briosne : « Le Capital mourrait si, tous les matins, on ne graissait pas les rouages de ses machines avec de l’huile d’homme. » (Jules Vallès, L’Insurgé (1886), ch. XIV ; Pléiade tome II, 1990, p. 950).
. Ah ! sacrebleu ! que j’ai donc bien fait de n’être d’aucune coterie, d’aucune Église, d’aucun clan, et d’aucun complot ! (Jules Vallès, L’Insurgé (1886), ch. XVII ; Pléiade tome II, 1990, p. 980).
. Ah ! ceux qui croient que les chefs mènent les insurrections sont de grands innocents ! / Émietté, dispersé, déchiré, noyé, ce qu’on appelle l’état-major dans le tumulte des vagues humaines ! Tout au plus, la tête d’un de ces chefs peut-elle émerger, à un moment comme les bustes de femmes peintes, sculptés à la proue des navires, et qui paraissent et disparaissent à la grâce de la tempête, au hasard du [tangage] [3] ! (Jules Vallès, L’Insurgé (1886), ch. XXI ; Pléiade tome II, 1990, p. 1003).
. Ferré : « Les trahisons se châtient, tandis que les faiblesses s’excusent. » (Jules Vallès, L’Insurgé (1886), ch. XXV ; Pléiade tome II, 1990, p. 1030).
. Plus le danger est grand, plus le devoir de rester est sacré ! (Jules Vallès, L’Insurgé (1886), ch. XXVIII ; Pléiade tome II, 1990, p. 1041).
. Les défroqués ne font que changer de religion et, dans le cadre de l’hérésie même, ils logent toujours des souvenirs de religion ! leur foi ou leur haine ne fait que se déplacer. (Jules Vallès, L’Insurgé (1886), ch. XXVIII ; Pléiade tome II, 1990, p. 1043-44).
. Pour ceux qui ont cru au ciel, souvent la terre est trop petite ; et, ne pouvant frapper ou être frappés sur les marches de quelque Vatican de faubourg, en plein soleil, ils se dévorent les poings dans l’ombre, ces déserteurs de la chaire ! Ayant ruminé la vie éternelle, ils agonisent de douleur dans la vie étroite et misérable. (Jules Vallès, L’Insurgé (1886), ch. XXVIII ; Pléiade tome II, 1990, p. 1044).
. Un fédéré : « Casser la tête d’un Judas, c’est sauver la tête de mille des siens ! » (Jules Vallès, L’Insurgé (1886), ch. XXXI ; Pléiade tome II, 1990, p. 1058).
. Un combattant : « Les gens qui ne s’occupent pas de politique !… Mais ce sont les plus lâches et les plus coquins ! Ils attendent, ceux-là, pour savoir sur qui ils baveront ou qui ils lècheront, après la boucherie ! » (Jules Vallès, L’Insurgé (1886), ch. XXXIII ; Pléiade tome II, 1990, p. 1071).
. J’ai toujours vu les nains tourmenter les géants. (Jules Vallès, « Le bachelier géant », I, paru dans Le Figaro, 24 juillet 1864 sous le titre « Les confessions d’un saltimbanque » puis repris dans Les Réfractaires, VIII ; Pléiade tome I, 1975, p. 268). 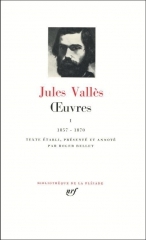
. Mieux vaut, dira-t-on, le parfum de l’encens que l’odeur de la boue. – Non, la boue ne salit que ceux qui la pétrissent, et les timides seuls s’effraient des cris que poussent sous leurs fenêtres les vertus terribles. Il ne faut pas craindre les gens qui lancent des ordures dans vos carreaux parce qu’ils n’osent y jeter des pierres. / Je parle pour ceux qui ont l’amour vrai du métier, la passion de vaincre. Il se peut que les arrivés souffrent à entendre railler leur royauté fainéante. Quand on est sur un piédestal, on n’aime pas à voir les passants barbouiller le socle. Mais quand on est jeune encore, et que l’on a confiance en soi, il faut aller là, comme les enfants à la pluie, comme les zouaves au combat. C’est le baptême de feu. (Jules Vallès, « Courrier de Paris », L’Époque, 21 avril 1865 ; Pléiade tome I, 1975, p. 519).
. Je n’ai jamais répondu à une critique écrite qu’une seule fois : je cassai ma plume sur le visage d’un pleutre. J’ai eu, depuis, honte de ma brutalité. Non que je sois devenu la patience même, mais si je me suis fait homme de lettres, c’est pour accepter tous les inconvénients du métier. Où serait la joie, s’il n’y avait pas de péril ? Je vous avouerai même entre nous que j’aimerais peut-être mieux, tant j’ai l’esprit mal fait, être attaqué qu’applaudi. / On ne me blesse jamais assez ! (Jules Vallès, « Michel-Ange, Covielle et Rigolo », Le Nain jaune, 24 février 1867 ; Pléiade tome I, 1975, p. 920).
. Le passé : voilà l'ennemi. C'est ce qui me fait m'écrier dans toute la sincérité de mon âme : on mettrait le feu aux bibliothèques et aux musées, qu'il y aurait, pour l'humanité, non pas perte, mais profit et gloire. (Jules Vallès, « Michel-Ange, Covielle et Rigolo », Le Nain jaune, 24 février 1867 ; Pléiade tome I, 1975, p. 922).
. J’exprime le sentiment de la foule. Si l’on adoptait le suffrage universel, ils seraient bientôt à bas et renvoyés au grenier, je vous le promets, tous ces gens de marbre [4] que vous croyez admirés de bonne foi, et qui ne le sont que par ricochet, parce qu’on a enseigné au collège la vénération de ces débris, et qu’on garde le souvenir de ses impressions de classe comme on reste catholique, sans savoir pourquoi, quand on a été élevé par une mère pieuse. (Jules Vallès, « Michel-Ange, Covielle et Rigolo », Le Nain jaune, 24 février 1867 ; Pléiade tome I, 1975, p. 923).
. Est-ce qu’on a le droit de trouver ridicule ou honteuse une agonie ? Qui sait ce que sera la vôtre ? [5] (Jules Vallès, « Lettres d’un irrégulier. Lettre à Ferragus », Le Figaro, 7 juin 1868 ; Pléiade tome I, 1975, p. 1061).
. Il ne faut pas plus être le prisonnier de ses amis que celui de ses ennemis. (Jules Vallès, lettre à Émile Massard, 11 avril 1884, publiée dans Le Cri du peuple le 31 janvier 1887, et dans Les Mémoires de Paris de Charles Chincholle, chap. I, Librairie moderne, 1889, p. 14).
OCTAVE MIRBEAU : CHRONIQUES POLITIQUES
. Plus l’art s’abaisse et descend, plus le comédien monte. […] Aujourdhui, le comédien est tout. C’est lui qui porte l’œuvre chétive ! Aux époques de décadence, il ne se contente pas d’être roi sur la scène, il veut aussi être roi dans la vie. Et comme nous avons tout détruit, comme nous avons renversé toutes nos croyances et brisé tous nos drapeaux, nous le hissons, le comédien, au sommet de la hiérarchie, comme le drapeau de nos décompositions. (Octave Mirbeau, « Le comédien », Le Figaro, 26 octobre 1882 ; dans Combats politiques, I, 1, Séguier, 1990, p. 50).
. Le patriotisme est chose sainte. C'est la vertu, la fierté, la santé et la consolation des peuples. C'est lui qui, seul, dans l'égoïsme abominable où nous nous mourons, dans la décomposition du sang de la France qui va pourrissant chaque jour davantage les meilleurs et les plus robustes, peut encore aux heures suprêmes du danger, faire germer, sur notre sol dégénéré, les semailles des gloires anciennes, et rallumer les enthousiasmes éteints dans nos cœurs refroidis. (Octave Mirbeau, « Déroulède ! », Le Gaulois, 11 janvier 1883). 
. Un moment, l'on s'est arraché à ses plaisirs et à ses indifférences, et l'on a écouté. Il semblait que tout à coup on entendît comme un grondement lointain d'émeute. Il vous venait aux narines un parfum de coup d'État, délicieux à humer. Le clairon allait-il sonner ? le canon allait-il tonner ? / […] C'est aux heures où la nation paraît le plus engourdie dans un pesant sommeil, qu'elle a quelquefois les beaux réveils du lion et ses bondissements superbes. Elle est lasse de dormir ; elle est lasse de s'avachir en de stupides plaisirs, d'être indifférente et incroyante à tout. Un grand ennui la prend de toujours s'amuser, de traîner ses mêmes paresses dans les mêmes cercles et chez les mêmes filles, de se pavaner au Bois dans les mêmes voitures et le long des mêmes allées. Elle a besoin de fouetter son sang qui chaque jour coule moins vite dans ses veines, d'endurcir sa chair épuisée, dans des luttes nobles et farouches. Hé ! pardieu ! cela ne vaut-il pas mieux de faire le coup de feu, dans la rue, que de faire sauter une demoiselle à l'hôtel Continental ? Ne vaut-il pas mieux avoir des cartouches dans sa poche, et un fusil sur l'épaule, que des gardénias à la boutonnière de son habit, et un claque sous le bras ? Le vrai dandysme, le dandysme d'autrefois, mêlait volontiers les odeurs de poudre de riz aux odeurs de la poudre des fusils. Il passait d'un cabinet de restaurant à une barricade, d'un éclat de rire à un éclat de bombe. / Croyez-vous donc que, si, au sortir d'une fête, nous avions ressenti ces frissons de bataille, pris notre fusil, et poussé de temps à autre le cri de guerre, joyeusement, nous aurions subi les ministres imbéciles et les imbéciles députes que nous avons subis ? Croyez-vous donc que nous aurions sur notre joue toutes les humiliations, toutes les hontes que cette République y a mises ? Croyez-vous que nous serions à deux doigts de la faillite, presque perdus d'honneur, et si bas que nous n'attendons plus de personne notre relèvement et notre salut ? (Octave Mirbeau, « Les frissons », Le Gaulois, 18 janvier 1883).
. Ce que nous avions de fierté nationale, on nous l'a pris ; ce que nous avons d'argent, on nous le prend. Une république a commis ces deux crimes de tuer la patrie dans son âme et dans ses muscles. Ce qu'une guerre impitoyable n'a pu faire, ce que n'ont pu faire les régiments victorieux et les canons tonnants de la Prusse, une chambre et un gouvernement français l'ont fait. Sauvée de l'Allemagne, la France s'apprête à périr par la France ; arrachée sanglante aux serres de l'Aigle noir, va-t-elle donc succomber, dépouillée, sous les coups de bec des chats-huants parlementaires ! / […] Quant à eux, nos maîtres aujourdhui, qui, aujourdhui, ont dans leurs mains la fortune et l'honneur de la France, qu'ont-ils donné ? Ont-ils donné un centime de leur argent, une miette de leur égoïsme ? Non. En échange de leurs ambitions satisfaites qui nous ont tant coûté, ils nous ont donné la honte et la ruine. Ce sont eux les traîtres, ce sont eux les malfaiteurs. Et, s'il nous restait un peu des vieilles ardeurs d'autrefois, et surtout le moindre sentiment de justice, nous les traînerions, ces patriotes, jusqu'au seuil des tribunaux, et nous exigerions qu'on les condamnât comme traîtres à la patrie. (Octave Mirbeau, « À vau-l'eau », Le Gaulois, 25 janvier 1883).
. La mort est belle parfois, auguste et glorieuse. Elle met de la lumière autour des visages qu’elle a touchés. (Octave Mirbeau, « Ode au choléra », Les Grimaces, 21 juillet 1883 ; dans Combats politiques, I, 3, Séguier, 1990, p. 58).
. Pourvu que [les politiciens républicains] rendent la France républicaine, par leur taquinerie bête et leur lâcheté, un objet de ridicule et de mépris auprès des nations voisines, ils se tiennent pour satisfaits. Et tant qu’il y aura de l’honneur à perdre et de l’argent à gagner, des emprunts et des conversions sur lesquels ils pourront voler l’épargne française ; tant qu’il y aura des crimes à commettre, qu’ils n’auront pas commis, des lâchetés qu’ils auront oubliées, ils resteront sourds à la voix du peuple qui se plaint, et qui menace. (Octave Mirbeau, « Ode au choléra », Les Grimaces, 21 juillet 1883 ; dans Combats politiques, I, 3, Séguier, 1990, p. 61).
. Dans la loge impériale se pavanait la famille Rothschild. Il faut que celà soit ainsi. Le siècle où la gloire, l’honneur, la patrie ne sont plus rien, où l’argent est tout, a bâti un trône aux Rothschild, un trône fait des débris des trônes de nos rois assassinés et de nos empereurs déchus. L’empereur ou le roi représentait les aspirations grandioses, nationales d’un peuple. Rothschild représente ses instincts bas, ses appétits cupides, ses corruptions. C’est le souverain qu’il faut à ces démocraties décomposées. (Octave Mirbeau, « L’invasion », Les Grimaces, 15 septembre 1883 ; dans Combats politiques, I, 4, Séguier, 1990, p. 65-66).
. C’étaient les Allemands et les Allemandes, les Grecs et les Grecques, les Égyptiens et les Égyptiennes, les Levantins et les Levantines, venus de tous les coins de l’Orient se ruer à la curée française, qui battaient des mains, en acclamant comme un chef, Rothschild, le premier qui ait osé drainer, – pour en faire de l’or, et mettre cet or dans ces caisses, – notre honneur, nos richesses, notre sang. / Voilà de quels éléments se compose aujourdhui, presque uniquement, la société parisienne. Notre antique génie, nos politesses si vantées, nos plaisirs si délicats meurent sous la morsure de cette lèpre d’Orient. […] Paris, ville des multitudes lointaines, ville courtisane qui se donne à qui la paie, n’est plus la capitale française. C’est la capitale anonyme de tous les hommes sans patrie et sans nom, qui, jadis, secouaient leur vermine sur le monde d’où ils étaient chassés. (Octave Mirbeau, « L’invasion », Les Grimaces, 15 septembre 1883 ; dans Combats politiques, I, 4, Séguier, 1990, p. 66-67).
. Il y a longtemps que nous avons abandonné, une à une, toutes les vertus qui font les peuples forts ; nous perdons maintenant la seule vertu qui fait les peuples. Notre nationalité s’efface de plus en plus et disparaît sous l’invasion, sans cesse grandissante, des mercantilismes étrangers, des bazars poussiéreux d’Orient, des guétos haïs de l’Allemagne. De Smyrne, de Chio, d’Alexandrie, de Constantinople, de Galata, comme de Cologne, de Francfort et de Berlin, des bandes d’hommes de proie se sont abattues sur nous. On ne voit plus qu’eux, on n’entend plus qu’eux, dans Paris, le Paris des affaires, du luxe et du plaisir, devenu leur Paris, où nous ne sommes plus que tolérés. […] Bien que leurs intérêts soient presque toujours contraires au nôtre, ils détiennent, en leurs mains, des parcelles de ce qui nous reste de patrie, jusqu’au moment où ils les accapareront définitivement, où ils les livreront à nos ennemis. / […] Dans les comptes-rendus de fêtes, qu’on croirait des passages cités de la Bible, on ne lit jamais que leurs noms, à complications orientales, à désinences étrangères, et l’on se demande si vraiment il existe encore, à Paris, une société française, et si un seul Français a survécu. / […] L’invasion est complète, irrémédiable. Nous ne sommes plus rien, nous autres Français ; ce sont des étrangers qui sont tout. […] On se dit que cette invasion pacifique est bien autrement terrible que l’invasion armée, et qu’il vaut mieux encore voir les sabres étrangers traîner sur nos trottoirs, que d’entendre les souliers vernis de ces juifs craquer sur le parquet de nos salons ! / Et le remède ? / Hélas ! Il n’y en a point. Il n’y a que le fer qui fait couler le sang, et le feu qui brûle ! Mais à quoi bon ? Un peuple assez bête et assez lâche pour laisser s’enraciner dans son sol une aussi formidable puissance est un peuple perdu, un peuple qui se suicide. […] / Pour le moment, nous nous appelons encore la France, ce qui est une concession dont on doit leur savoir gré. / Demain peut-être nous nous appellerons Jérusalem ! (Octave Mirbeau, « L’invasion », Les Grimaces, 15 septembre 1883 ; dans Combats politiques, I, 4, Séguier, 1990, p. 67-71).
. Il y a plus d’un an que je crie à la décadence, à la décomposition, à la fin de la France. Les gens les plus conservateurs me riaient agréablement au nez ; on me plaignait comme on plaint un fou, on haussait les épaules comme si je n’étais qu’un énergumène ou un farceur. / […] Se révolter ? À quoi bon ? N’avait-on pas la liberté de s’aller abrutir tous les sors, au théâtre, à la Bourse, au tripot ? Où avait-on vu que la République ait voulu entraver l’indépendance des jockeys et des bookmakers ? Non, vraiment, la vie n’était pas si maussade que celà ; et quant à la France, elle était pillée par des escrocs et démoralisée par des coquins, c’est qu’elle était assez riche et qu’elle avait derrière elle assez d’honneur pour se payer cette fantaisie. / […] Aujourdhui […] ils comprennent enfin que c’est la fin, la fin irrémédiable de ce pays qui fut si grand, si beau, de ce pays qui se chauffa à tous les soleils de gloire, et sur qui passa le resplendissement de toutes les apothéoses. La fin, oui ! c’est la fin. (Octave Mirbeau, « La fin », Les Grimaces, 6 octobre 1883 ; dans Combats politiques, I, 5, Séguier, 1990, p. 73-75).
. La République a tout sali et tout brisé. Elle a mis nos âmes en deuil, nos respects en fuite, nos drapeaux en loques. […] Elle apprend l'athéisme à l'enfant, la révolte à l'homme, l'adultère à la femme, au soldat la peur de mourir ; et le désespoir de l'au-delà au vieillard. / Il ne lui a pas suffi de traquer dans les consciences l'idée de Dieu, il lui a fallu étouffer dans les cœurs l'idée de la patrie inséparable de l'idée de Dieu. La patrie, elle l'a jetée, lambeau par lambeau, à la rapacité de nos voisins et de nos ennemis elle l'a compromise dans les pires aventures, […] Ce drapeau, qui fut si grand, ce drapeau qui conquit le monde, qui se chauffa, brûlé, à tous les soleils de gloire, elle l'a promené de comptoir en comptoir, de banque en banque, et elle en a fait un sac dans lequel elle entasse ses piles d'or, prix de notre fierté achetée et de notre honneur vendu. / Et, comme elle sait que ce n'est point assez d'aigrir un peuple pour le dompter, mais qu'on doit aussi l'avilir, elle a appelé à son aide la littérature obscène. […] Voilà l'œuvre de la république, œuvre de destruction impie qui a tout atteint et tout sapé les belles idées, les croyances nécessaires, les enthousiasmes superbes, les courages fous qui font que, dans les mauvais jours, un peuple qu'on croyait perdu, se relève et se ressaisit plus jeune plus fort, plus vivant que jamais. (Octave Mirbeau, « Jeanne d’Arc », Le Gaulois, 16 juillet 1884).
. Sait-on pourquoi l'on tue ? Et sait-on pourquoi l'on aime ? Pourquoi c'est le poison, et pourquoi le baiser ? Pauvre humanité, esclave fourbue de tes passions, malade délaissée de tes tendresses même, roulant, sans conscience, dans la nuit de la vie, du crime qui te rougit de sang les mains à l'extase qui t'emplit le cœur d'infini, il n'y a que Dieu qui sache de quoi tu es pétrie, et si c'est le châtiment ou le pardon qu'il faut à tes erreurs et à tes folies ! (Octave Mirbeau, « L'idéal », Le Gaulois, 24 novembre 1884).
. Que savons-nous des choses de l'amour, et pourquoi jugeons-nous, avec cette implacabilité et cette décision orgueilleuse, les actions humaines, sanglantes et terribles, qui en découlent ? Les poëtes s'emparent, pour les exalter sur la scène et les diviniser dans l'immortalité, des beaux vers, de ceux-là mêmes que les juges envoient à la mort. Ce qui est jugé horrible ici est trouvé là magnifique. Qui donc a tort ? Et la foule inconsciente, qui ne veut que des spectacles, quels qu'ils soient, qui se rue au rouge comme le taureau et à la lumière comme le papillon, applaudit de la même façon le châtiment à la cour d'assises et l'apothéose au théâtre. (Octave Mirbeau, « L'idéal », Le Gaulois, 24 novembre 1884). 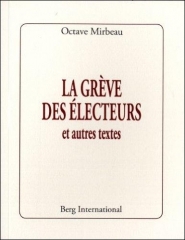
. [Critiquant une décision de cour d’assises :] N'est-ce point une anomalie prodigieuse de faire juger définitivement par des bandes de bonnetiers, de paysans et de tailleurs, des questions devant lesquelles les philosophes s'arrêtent hésitants et rêveurs, et que les plus sagaces observateurs de la vie seraient impuissants à trancher ? Mettre une âme et une âme de femme dans les lourdes pattes de ces gens, habitués à manier des chevaux, ou à métrer des aunes de toile, ou à gâcher du mortier, ces gens que toute exception étonne, que toute poésie effarouche, que tout amour inquiète comme une obscénité, et leur demander d'expliquer les aspirations de cette âme, d'en compter les replis, d'en saisir les frissons, d'en analyser les battements, n'est-ce point un véritable crime ? (Octave Mirbeau, « L'idéal », Le Gaulois, 24 novembre 1884).
. L'humanité n'est point belle, cela est certain ; elle n'est point bonne, je le concède ; mais il faut s'étonner encore, en analysant de quoi elle est pétrie, de ce qu'elle ne soit ni plus laide, ni plus méchante. Elle a des instincts terribles qui la portent à la révolte et au crime, des passions farouches qui la font se ruer, comme une bête, à toutes les jouissances qui donnent l'oubli, et qui endorment, et qui comblent, un instant, la dépouille de son éternelle livrée d'esclave. Et, devant la sombre vision de la vie qui se déroule, implacablement pareille, devant les souffrances interminables qu'il lui faut traverser, devant les douleurs tapies sur sa route et qui fondent sur elle, et lui plantent dans le crâne et dans toute sa chair ses serres aiguisées, sa première pensée est de se débattre et de blasphémer. Cependant elle va, aveugle et sourde, les pieds dans la boue et le front dans la tempête, déchirant ses pauvres genoux meurtris et las, ensanglantant ses mains et sa poitrine aux aspérités du chemin, ne se reposant jamais, harcelée par la besogne maudite, sans espoir d'arriver quelque jour en un endroit frais et doux où les êtres sourient, où les choses laissent tomber, sur ses blessures saignantes, de la bonté de l'espérance et de l'amour. (Octave Mirbeau, « Explications », Le Gaulois, 1erdécembre 1884).
. J’ai toujours pensé qu’on ne se grandissait pas en diminuant ses adversaires. La haine perd de sa force à être aveugle. (Octave Mirbeau, « La Légende du chancelier », Le Gaulois, 22 décembre 1884).
. Mais c’était la Bourse qu’il fallait voir, la Bourse au spectacle de laquelle le cœur se soulevait de dégoût. Chaque fois que la France est en péril, chaque fois que le sang ruisselle de ses flancs, les larmes de ses yeux, il y a des milliers d’hommes de proie qui s’abattent sur elle, qui se précipitent pour recueillir ce sang et ces larmes et, hideux alchimistes, les transformer en or. Du fond de quels antres, de quelles banques, de quels bagnes, de quels guétos déchaînés ces misérables étaient-ils accourus ? / La bouche tordue, les bras agités, les yeux allumés de rapines, ils couraient, s’écrasaient, se marchaient les uns sur les autres, et une immense clameur montait, plus barbare que les cris de victoire des Chinois [6]. […] / S’ils avaient pu apprendre tout d’un coup que la patrie s’effondrait, qu’il n’y avait plus que des ruines, que de Marseille à Lille, de Nancy à Bordeaux, la France était devenue un champ horrible de carnage, quelles acclamations et quels forcenés hourahs ! Et à mesure que les cours s’effondraient, à mesure que nos rentes, sous l’effort de ces brigands unis, s’abîmaient, affolés, dans la route, on voyait la joie se crisper sur ces visages, pareils à ceux de ces juifs sordides, qui, le soir des batailles, parmi les affûts de canons brisés et les fusils tordus, vont dépouiller les blessés et détrousser les cadavres. / Oui, je vous le jure, j’ai souhaité un instant de voir les canons et les mitrailleuses balayer cette bande de chacals et faire tomber une à une les pierres et les colonnes de ce temple maudit qui se dresse impudemment, comme une perpétuelle insulte et une trahison à la patrie. (Octave Mirbeau, « Les Chinois de Paris », La France, 1er avril 1885).
. Le monde a une eau lustrale qui efface toutes les infamies et toutes les souillures. Il n’y a qu’une chose qu’elle n’efface pas : c’est la probité et c’est l’honneur, les seules tares aujourdhui qui restent toujours marquées à l’épaule des hommes, celles qui, seules, les livrent désarmés et vaincus, au ridicule, au mépris, à la pauvreté. (Octave Mirbeau, « Le suicide », La France, 10 août 1885).
. Pourquoi redouter le néant ? Pourquoi craindre ce que nous avons été déjà ? Partout la mort est là qui nous guette, et n'est-ce point pitié de voir chacun la fuir et implorer lâchement une heure de sursis ! N’est-ce point elle qui est la vraie liberté et la paix définitive ! Et puis, que voulez-vous que deviennent ceux qui n’ont point entrevu la vérité, ceux qui n’ont pas compris que le vrai bonheur est dans la science et dans la solitude, et qu’il vaut mieux renoncer à tout que lutter pour jouir ? (Octave Mirbeau, « Le suicide », La France, 10 août 1885).
. La patrie où je vis, où ma maison est bâtie, où sont mes horizons familiers, qui doit garder dans son sol l’empreinte de mon vil squelette décharné, la patrie aux lois changeantes et souvent meurtrières de laquelle je me suis fortuitement soumis, certes, je l’aime, je la veux belle, heureuse, respectée, et ceux-là qui tentent d’y porter la main sont des criminels, des sacrilèges, mes ennemis. (Octave Mirbeau, « La rue », Le Gaulois, 8 mai 1887).
. Hélas ! les cris de la rue protestaient contre ce rêve. L’émeute était là, insultante et blagueuse : faces tordues de voyous ; indignations imbéciles de dupes exaltées par le vin ; camelots obscènes, couards et rapaces ; la rue mauvaise, enfin, qui roule dans les ruisseaux, avec les déjections et les ordures, les sales convoitises, les rancunes abjectes, les pensées de meurtre, les lâchetés cruelles, les plaisanteries boueuses. Et le rêve s’envola. Je redescendais dans la vie. (Octave Mirbeau, « La rue », Le Gaulois, 8 mai 1887).
. Voilà pourtant de longs siècles que le monde dure, que les sociétés se déroulent et se succèdent, pareilles les unes aux autres, qu’un fait unique domine toutes les histoires : la protection aux grands, l’écrasement aux petits. [L’électeur] ne peut arriver à comprendre qu’il n’a qu’une raison d’être historique, c’est de payer pour un tas de choses dont il ne jouira jamais, et de mourir pour des combinaisons politiques qui ne le regardent point. (Octave Mirbeau, « La grève des électeurs », Le Figaro, 28 novembre 1888 ; dans Combats politiques, II, 5, Séguier, 1990, p. 112).
. Les moutons vont à l'abattoir. Ils ne disent rien, eux, et ils n'espèrent rien. Mais du moins ils ne votent pas pour le boucher qui les tuera, [ni] pour le bourgeois qui les mangera. Plus bête que les bêtes, plus moutonnier que les moutons, l'électeur nomme son boucher et choisit son bourgeois. Il a fait des Révolutions pour conquérir ce droit. (Octave Mirbeau, « La grève des électeurs », Le Figaro, 28 novembre 1888 ; dans Combats politiques, II, 5, Séguier, 1990, p. 112).
. [Schopenhauer et Nordau] te diraient, en connaisseurs d’humanité, que la politique est un abominable mensonge, que tout y est à l’envers du bon sens, de la justice et du droit, et que tu n’as rien à y voir, toi dont le compte est réglé au grand livre des destinées humaines. (Octave Mirbeau, « La grève des électeurs », Le Figaro, 28 novembre 1888 ; dans Combats politiques, II, 5, Séguier, 1990, p. 113).
. C’est bon de rêver, et celà calme la souffrance. Mais ne mêle jamais l’homme à ton rêve, car là où est l’homme, là est la douleur, la haine et le meurtre. Surtout, souviens-toi que l’homme qui sollicite tes suffrages est, de ce fait, un malhonnête homme, parce qu’en échange de la situation et de la fortune où tu le pousses, il te promet un tas de choses merveilleuses qu’il ne te donnera pas et qu’il n’est dailleurs pas en son pouvoir de te donner. (Octave Mirbeau, « La grève des électeurs », Le Figaro, 28 novembre 1888 ; dans Combats politiques, II, 5, Séguier, 1990, p. 113-114).
. Malgré le développement toujours grandissant du bien-être, en dépit des conquêtes industrielles, des découvertes de toute nature qui devraient rendre la vie plus facile et plus agréable, personne n’est content de son sort, et tout le monde cherche autre chose que ce qu’il a. Tout homme, aujourdhui, pour peu qu’il soit au niveau de la civilisation actuelle, est atteint d’une inquiétude vague, d’un indéfinissable malaise, d’une mélancolie incurable et baudelairienne, qui se traduisent en découragements, en lassitudes énervées, en dégoût de « ce qui est », et qu’il attribue à des causes différentes, les unes physiologiques, les autres métaphysiques, celles-ci gouvernementales, toutes dailleurs illusoires et parfaitement erronées. (Octave Mirbeau, « Le mécontentement », Le Figaro, 9 janvier 1889).
. Deuxième passant : « Le mal du siècle, c’est l’ennui !… La France s’ennuie, voilà… elle crève de cette lente et abominable syphilis qui la ronge aux moelles, qui empeste son sang : l’ennui. Pourquoi, autrefois, étions-nous un grand peuple ? Parce que nous étions insouciants, gais, toujours prêts à rire, à danser comme à nous battre ; à nous jeter des vaisselles à la tête, dans les cabinets particuliers, et des obus, sur les champs de bataille… Oui, nous passions facilement, intrépidement d’un éclat de rire, à un éclat de bombe… Nous ne cherchions point midi à quatorze heures ; et sous notre air léger, sous les chansons de nos fêtes, nous avions ce qui est la sauvegarde d’un peuple – son palladium, si j’ose dire : la foi. Oui, la foi en la justice, en la patrie, en l’autorité ! Aujourdhui, la jeunesse ne croit plus en rien, et elle nie tout. Morne et songeuse, elle se replie sur elle-même, et cherche à toutes choses des raisons qui n’existent pas… vous m’entendez bien…qui ne peuvent pas exister. » (Octave Mirbeau, « Le mal moderne », L’Écho de Paris, 8 septembre 1891 ; repris dans Dialogues tristes, 25, Eurédit, 2005).
. Partout où il y a du sang versé à légitimer, des pirateries à consacrer, des violations à bénir, de hideux commerces à protéger, on est sûr de le voir, cet obscur Tartuffe britannique, poursuivre, sous prétexte de prosélytisme religieux ou d’étude scientifique, l’œuvre de la conquête abominable. Son ombre, astucieuse et féroce, se profile sur la désolation des peuplades vaincues, accolées à celle du soldat égorgeur et du Shylock rançonneur. (Octave Mirbeau, « Colonisons », Le Journal, 13 novembre 1892).
. Nous n’avons pas, dans le jugement des actes contemporains, la liberté d’esprit, ni l’impartialité, ni l’impersonnalité nécessaires. Nous sommes près d’eux et trop en eux. Il faut, à un acte politique et social de quelque importance, pour lui assigner une portée historique, ce recul de temps où, dégagée des menus détails qui l’obscurcissent, des préjugés, des habitudes, des passions immédiates, apparaît la synthèse, véritable atmosphère de l ‘histoire. (Octave Mirbeau, « Colonisons », Le Journal, 13 novembre 1892).
. L’Illustre Écrivain [7] : « Et quand même Dreyfus serait innocent ?… il faudrait qu’il fût coupable quand même… il faudrait qu’il expiât, toujours… même le crime d’un autre… C’est une question de vie ou de mort pour la société et pour les admirables institutions qui nous régissent !… La société ne peut pas se tromper… Les conseils de guerre ne peuvent pas se tromper… L’innocence de Dreyfus serait la fin de tout ! » (Octave Mirbeau, « Chez l’illustre écrivain », Le Journal, 28 novembre 1897 ; dans Combats politiques, IV, 1, Séguier, 1990, p. 178-179).
. « Moi, mon cher maître, disait un jour à Ernest Renan un fier jeune homme, moi, je n’ai jamais varié dans mes convictions ! » — À quoi l’admirable philosophe des Origines du christianisme répondit, avec cette douceur ironique et délicieuse qu’il avait : « Combien je vous envie !… C’est donc que vous n’avez jamais pensé ! » [8] (Octave Mirbeau, « Palinodies ! », L’Aurore, 15 novembre 1898 ; dans Combats politiques, IV, 5, Séguier, 1990, p. 206). 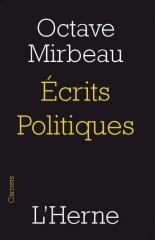
. Dans ces moments tragiques où se joue la destinée de tout un peuple, et où j’imagine que tous ceux-là qui sentent, qui pensent, et qui aiment, ne devraient avoir qu’une pensée commune de défense, rien ne m’est plus pénible que cette indifférence lourde et vaseuse où le pays s’enfonce de plus en plus. Chaque jour, de la colère sauvage ou de l’erreur violente on peut espérer des réactions salutaires… Qu’espérer de cette atonie qui fait que chaque face humaine est un mur intraversable, où les mots d’appel et de pitié se brisent avant d’avoir été entendus, où les idées généreuses – même les idées de justice – retombent en miettes, en poussières vaines que le vent emporte aussitôt ?… (Octave Mirbeau, « En province », L’Aurore, 22 juillet 1899 ; dans Combats politiques, IV, 7, Séguier, 1990, p. 222).
. Je ne suis pas anglophobe, et je le regrette, car, si j'en crois des personnages que je connais et qui le sont passionnément, cela procure d'intenses jouissances et de profonds enthousiasmes. Il n'y a rien de meilleur, paraît-il, comme de manger tous les matins, à son déjeuner, un Anglais. (Octave Mirbeau, « Apologie pour Chamberlain », Le Journal, 11 février 1900).
. Les prêtres [sont] les seuls pourtant qui soient, théoriquement, des célibataires, puisque, par leur vœu de chasteté, ils se mettent en révolte contre les lois de la vie… et qu’ils sont, volontairement, de la matière inerte et du poids mort !… (Octave Mirbeau, « Dépopulation (I) », Le Journal, 18 novembre 1900).
. II n’y a personne de plus obstiné et de plus dangereux qu’un bienfaiteur. C’est le pire ennemi de l’humanité en ce qu’il n’a qu’un but – quand ce n’est pas de tondre sur la peau des pauvres la laine de l’ambition et de la richesse –, énerver l’humanité, l’endormir par des mensonges, puis l’enchaîner, plus nue, par des lois. (Octave Mirbeau, « Dépopulation (III) », Le Journal, 2 décembre 1900).
. Les jésuites, en général tous les prêtres, font pour l’esprit de l’enfant ce que ces impresarii de cirques laïques et de pèlerinages religieux font pour son corps. Les maisons d’éducation religieuse, ce sont des maisons où se pratiquent ces crimes de lèse-humanité. Elles sont une honte et un danger permanent. / C’est pourquoi, étant partisan de toutes les libertés, je m’élève avec indignation contre la liberté d’enseignement, qui est la négation même de la liberté tout court… Est-ce que, sous prétexte de liberté, on permet aux gens de jeter du poison dans les sources ?… (Octave Mirbeau, « Réponse à une enquête sur l’éducation », La Revue blanche, tome XXVIII, 1er juin 1902, p. 175).
. La conception de la matière, maîtresse de la vie, me paraît une conception autrement grande, autrement consolante, autrement morale, que celle d’un Dieu, baroque, et clément, neurasthénique, qui ne se plaît qu’à mystifier les hommes, quand il n’exerce pas sur eux les pires violences et les plus folles cruautés. (Octave Mirbeau, « Propos de l’instituteur (II) », L’Humanité le 31 juillet 1904).
OCTAVE MIRBEAU : CHRONIQUES ARTISTIQUES ET LITTÉRAIRES
. En art, l’exactitude est la déformation et la vérité est le mensonge. Il n’y a rien là d’absolument vrai, ou plutôt il existe autant de vérités humaines que d’individus. (Octave Mirbeau, « Le Rêve », Le Gaulois, 3 novembre 1884 ; repris dans Les Écrivains. Première série 1884-1894, 3, Flammarion, 1925, p. 24 ; et dans Combats littéraires, L’Âge d’Homme, 2006, p. 110). 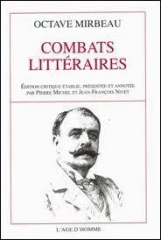
. Gardons le rêve, car le rêve est notre plus précieux héritage. C’est lui qui fait le prêtre, le soldat et l’artiste, cette trinité nécessaire à la vie sociale. La littérature et l’art seuls peuvent le conserver au cœur de l’homme, et l’homme meurt de ses rêves brisés. (Octave Mirbeau, « Le Rêve », Le Gaulois, 3 novembre 1884 ; repris dans Les Écrivains. Première série 1884-1894, 3, Flammarion, 1925, p. 26 ; et dans Combats littéraires, L’Âge d’Homme, 2006, p. 111).
. Ce dont on s'étonne aujourdhui, c'est qu'un auteur, pour faire de la réclame à son livre et lui assurer le succès, n'aille pas jusqu'au vol et à l'assassinat. / […] Chacun [des écrivains] a son mode de publicité, sa petite agence personnelle, ses trucs pour lesquels sans doute ils prennent des brevets d'invention. […] Mensonge ou vérité, peu leur importe, pourvu qu'on parle, pourvu qu'on écrive, pourvu que le journal, le matin, aille porter à plus de cent-milles lecteurs leur héroïsme ou leur infamie, dansant au haut de leur nom, l'enragé cancan de la publicité. / Ainsi nous en sommes là en ce siècle de la Réclame. Le talent n’est plus rien, l’art ne compte pas, le génie reste à terre, impuissant, rampant tristement sur les moignons de ses ailes coupées, s’il ne s’est pas promené à travers les rues par les pitres, affublé de costumes grotesques, comme un queue-rouge ! Voilà donc où nous a conduits le journalisme, avec sa camaraderie et ses guichets ouverts à tout, guichets et camaraderie qui font des gens de lettres et des artistes de misérables camelots et transforment la littérature en boutique foraine, sur le devant de laquelle des Bobèches grimacent hideusement, se donnent des soufflets et des coups de pied au derrière, pour mieux attirer la foule ! (Octave Mirbeau, « Réclame », Le Gaulois, 8 décembre 1884 ; repris dans Les Écrivains. Première série 1884-1894, 4, Flammarion, 1925, p. 31-33 ; et dans Combats littéraires, L’Âge d’Homme, 2006, p. 116-117).
. Un peintre qui n’a été qu’un peintre ne sera jamais que la moitié d’un artiste. (Octave Mirbeau, « Bastien-Lepage », La France, 21 mars 1885 ; repris dans Combats esthétiques, tome I. 1877-1892, Séguier, 1993, p. 143).
. [Constatant qu’il n’y a plus de nobles dotés de talent littéraire :] À quoi cela tient-il ? […] Cela tient surtout au cosmopolitisme financier dont [cette vieille société française] s’est laissé envahir et dont elle s’est assimilé les goûts malsains, les passions âpres, les plaisirs sans idéal, les corruptions sans grandeur. Le monde parisien, dont on a vanté toujours, par un reste d’habitude, d’entraînement, les politesses, les délicatesses, et, Dieu me pardonne, l’esprit aussi, ne se compose plus guère que d’étrangers venus de tous les coins de l’Orient se ruer à la curée française, sans autres préoccupations que les affaires d’argent et les conquêtes de la vanité en étalant un grand faste, semant l’or à pleines mains, décorés de titres bizarres et de renommées douteuses, parfois sanglantes. […] La fusion s’est donc opérée au point que cette fusion ressemble beaucoup à une conquête. Car, depuis, nos pauvres noms français font bien piteuse mine et sont en quelque sorte perdus au milieu de ces noms étrangers, à désinences barbares. […] / Cette invasion, à main armée… de billets de banque, a eu des conséquences sociales dont l’effet, par un travail inconscient et rapide, se fait cruellement sentir aujourdhui. Elle a pour ainsi dire dénationalisé la société parisienne en bouleversant ses habitudes, en lui imposant des goûts nouveaux, en ébranlant chaque jour son génie d’antique politesse, en ajoutant aux vices aimables d’une civilisation déjà attaquée aux moelles les décompositions des civilisations orientales, décadentes et pourries. / […] L’invasion est complète, non seulement dans les salons, mais aussi dans les cœurs. Nous n’avons même plus de jeunes gens ; ce sont les leurs qui se sont installés à leur place, partout, jusque dans les lieux de plaisir, où l’on ne rit plus d’ailleurs, car cette jeunesse est triste, mal élevée. (Octave Mirbeau, « La noblesse et la littérature », La France, 28 mars 1885 ; repris dans Les Écrivains. Première série 1884-1894, 10, Flammarion, 1925, p. 67-68).
. Une aurore d'enthousiasmes, de croyances et de bonheurs qui se lève sur notre jeunesse, et puis l'amour vient – oh ! si vite ! – l'amour qui souffle comme un fléau sur toutes les belles fleurs d'humanité, les dessèche et les fait mourir. Dès lors, il ne reste plus rien à l'homme, que des doutes, des mensonges et des douleurs ; son cœur est flétri ; ses rêves, aux formes si nobles, sont devenus des proies impures, vers lesquelles il se rue et qu'il ne peut même plus étreindre ; et dans son impuissance à se soustraire aux fatalités qui le poursuivent et l'angoissent, il se traîne, pantelant, de tortures en supplices, du néant de la vie au néant de la mort. (Octave Mirbeau, « Un crime d'amour », Le Gaulois, 11 février 1886 ; repris dans Combats littéraires, L’Âge d’Homme, 2006, p. 200-201).
. L’homme est ignoble, la vie immonde. Il en a toujours été ainsi, et il en sera toujours de même. Les héros d’autrefois que vous honorez, qui vous paraissent si admirables grâce au recul du temps et au mirage de l’histoire, qui mettent autour des figures mortes un halo menteur de vaillance et de poésie, ne valaient pas mieux que les pauvres diables d’aujourdhui que menace votre canne à épée. Et les autres qui viendront seront pareils ! […] Mêlez-vous de produire des chefs-d’œuvre, mais ne vous mêlez plus de guérir l’humanité : elle est incurable […], et elle crèvera dans sa lèpre, c’est moi qui vous le dis. (Octave Mirbeau, « Jean Baffier », Le Gaulois, 6 avril 1887 ; repris dans Combats esthétiques, tome I. 1877-1892, Séguier, 1993, p. 321-322).
. Chaque fois que j'apprends qu'un artiste que j'aime, qu'un écrivain que j'admire viennent d'être décorés, j'éprouve un sentiment pénible, et je me dis aussitôt : « Quel dommage ! ». C’est comme une atteinte portée à mon affection et à mon admiration. (Octave Mirbeau, « Le Chemin de la croix », Le Figaro, 16 janvier 1888 ; repris dans Combats esthétiques, tome I. 1877-1892, Séguier, 1993, p. 344).
. Pour M. [Léon] Hennique, un véritable écrivain doit écrire ; il doit surtout n’attendre satisfaction et succès que de ses livres. C’est là une erreur grave, assurément, et qui retarde, par trop de candeur, sur le siècle. Nous avons marché, que diable ! La littérature est devenue, aujourdhui, un métier très compliqué, très en dehors, où la force du talent, la qualité de la production ne sont rien, où la mise en scène spéciale et continue de la vie de l’auteur est tout. / Il ne s’agit plus de créer une belle œuvre, il faut savoir s’organiser une belle réclame. Et cette réclame savante, raffinée, ne portera pas directement sur les livres, ce qui serait grossier et ne contenterait personne ; elle englobera les choses étrangères au travail littéraire et se diffusera, de préférence, sur les sports qu’un homme bien né est susceptible de pratiquer. (Octave Mirbeau, « Le Manuel du savoir-écrire », Le Figaro, 11 mai 1889 ; repris dans Les Écrivains. Première série 1884-1894, 20, Flammarion, 1925, p. 144-145 ; et dans Combats littéraires, L’Âge d’Homme, 2006, p. 291).
. Le ridicule n'existe pas. Ceux qui, pénétrés de cette vérité, osèrent le braver en face, conquirent le monde. (Octave Mirbeau, « Le Manuel du savoir-écrire », Le Figaro, 11 mai 1889 ; repris dans Les Écrivains. Première série 1884-1894, 20, Flammarion, 1925, p. 145 ; et dans Combats littéraires, L’Âge d’Homme, 2006, p. 291).[9]
. Le public veut de l’amour et ne veut que de l’amour. Les littérateurs sont bien forcés d’en vendre. […] Si la littérature est restée en arrière des sciences, dans la marche ascensionnelle vers la conquête de l’idée, c’est que, plus avide de succès immédiats et d’argent, elle a davantage incarné les routines, les vices, l’ignorance du public qui veut qu’on le berce et qu’on le berne avec des histoires de l’autre monde. (Octave Mirbeau, « Amour ! Amour ! », Le Figaro, 25 juillet 1890 ; repris dans Les Écrivains. Première série 1884-1894, 27, Flammarion, 1925, p. 207 et 212 ; et dans Combats littéraires, L’Âge d’Homme, 2006, p. 306 et 308).
. « L’opinion publique ? […] C’est celui qui crie le plus fort… […] Ça a toujours été ainsi. Depuis que les sociétés existent et surtout depuis que fonctionne le suffrage universel, l’opinion publique ne fut jamais que l’opinion d’un hardi isolé. » (Octave Mirbeau, « L’opinion publique », Le Figaro, 8 mars 1891 ; repris dans Les Écrivains. Première série 1884-1894, 28, Flammarion, 1925, p. 219 ; et dans Combats littéraires, L’Âge d’Homme, 2006, p. 326).
. Aujourdhui la presse est libre, mais à la condition qu’elle restera dans son strict rôle d’abrutissement public. (Octave Mirbeau, « Les beautés du patriotisme », Le Figaro, 18 mai 1891 ; repris dans Les Écrivains. Première série 1884-1894, 30, Flammarion, 1925, p. 229 ; et dans Combats littéraires, L’Âge d’Homme, 2006, p. 338).
. La femme n’est pas un cerveau, elle n’est qu’un sexe, et rien de plus. Elle n’a qu’un rôle, dans l’univers, celui de faire l’amour, c’est-à-dire de perpétuer l’espèce ; rôle assez important, en somme, assez grandiose, pour qu’elle ne cherche pas à en exercer d’autres. Selon les lois infrangibles de la nature, dont nous sentons mieux l’implacable et douloureuse harmonie que nous ne la raisonnons, la femme est inapte à ce qui n’est ni l’amour, ni la maternité ; elle ne peut concevoir les idées générales, embrasser les grands ensembles ; elle ne conçoit et n’embrasse que le fait particulier. Quelques femmes – exceptions très rares – ont pu donner, soit dans l’art, soit dans la littérature, l’illusion d’une force créatrice. Mais ce sont ou des monstres, c’est-à-dire des êtres anormaux, en état de révolte contre les lois de la nature, ou de simples reflets du mâle dont elles ont gardé, par le sexe, l’empreinte intellectuelle. Et j’aime mieux ce qu’on appelle les prostituées, car elles sont, celles-là, dans l’harmonie de l’univers. / […] Le jour où les femmes auront conquis ce qu’elles demandent, le jour où elles seront tout, sauf des femmes, c’en sera fait de l’équilibre de la vie humaine. Et Lilith reparaîtra, avec son ventre à jamais stérile, et souillé de vaines, de désolantes fornications. (Octave Mirbeau, « Lilith », Le Journal, 20 novembre 1892). [10] 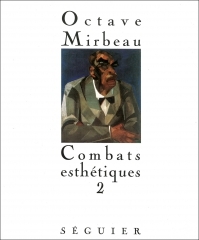
. C'est avec les vers qu’on habille le plus somptueusement le néant ou le pas grand-chose. Avec les vers, on se tire toujours d'affaire et combien glorieusement ! […] Lorsque l'on n’a rien à dire, et que l'on ne peut pas faire de la prose avec ce rien tout nu, on fait des vers ! Et c'est admirable ! Et du pauvre imbécile que l'on est, on devient, tout de suite, un dieu ! Par les vers, on rend le vide sonore, et le néant se peuple aussitôt de quelque chose… on ne sait pas quoi… mais de quelque chose. / Ah ! les vers… quels thèmes merveilleux ! Quelles ressources infinies, pour tous ceux-là à qui les idées sont étrangères et les sensations inconnues !… (Octave Mirbeau, « Contes pour une malade », Le Journal, n°2901, 9 septembre 1900, p. 1).
. Il est vraiment extraordinaire qu’une société capitaliste, fondée exclusivement sur le droit de propriété, se déclare impuissante, indifférente même, quand des cambrioleurs détroussent si allègrement, si impunément, le plus précieux trésor que nous possédions : notre histoire, notre langue, nos chefs-d’œuvre… (Octave Mirbeau, « L’avenir des chefs-d'œuvre », Le Journal, 9 mars 1902 ; repris dans Les Écrivains. Deuxième série 1895-1910, 31, Flammarion, 1925, p. 252 ; et dans Combats littéraires, n°164, L’Âge d’Homme, 2006, p. 544).
. « Je n'ai pas pris mon parti de la méchanceté et de la laideur des hommes… J'enrage de les voir persévérer dans leurs erreurs monstrueuses, de se complaire à leurs cruautés raffinées… Et je le dis… » (Octave Mirbeau, interviou par Louis Nazzi : « À la gloire de Dingo. Octave Mirbeau nous parle de son prochain livre », Comœdia, n°879, 25 février 1910, p. 1).
. « Je crois qu’on connaît mal les paysans et que tout ce qu'on a dit et écrit sur eux, est, le plus souvent, faux… Le paysan crève d'amour-propre… Si l’on veut se jouer de lui, il faut lui en imposer… Jamais un paysan ne consentira à avouer qu'il ne comprend pas une chose… Si, à ses phrases retorses, on oppose une sorte d’éloquence confuse et intraduisible, on obtient de lui tout ce qu'on veut… Les gens de loi le savent bien, et les gens d'église… Dès qu'il saisit ce qu'on lui propose, le paysan est intraitable… Une fois son avis arrêté, soyez certain qu'il n'en démordra point… » [11] (Octave Mirbeau, interviou par Louis Nazzi : « À la gloire de Dingo. Octave Mirbeau nous parle de son prochain livre », Comœdia, n°879, 25 février 1910, p. 1).
. On n'atteint un peu de la signification, du mystère et de l'âme des choses que si l'on est attentif à leurs apparences. (Octave Mirbeau, « Renoir », Les Cahiers d'aujourdhui, février 1913 ; repris dans Combats esthétiques, tome II. 1893-1914, Séguier, 1993, p. 521).
OCTAVE MIRBEAU : ROMANS et NOUVELLES
. Pierre Lucet : « Nous ne reproduisons rien… que notre impuissance, et notre infimité d’atome perdu dans l’espace… […] Il est nécessaire de vivre… voilà tout !… La vie n’a pas de but, ou plutôt, elle n’a pas d’autre but que de vivre… Elle est, sans plus… C’est pourquoi elle est belle… Quant aux poètes, aux philosophes, aux savants qui se torturent l'esprit pour chercher la raison, le pourquoi de la vie, qui l’enferment en formules contradictoires, qui la débitent en préceptes opposés…, ce sont des farceurs ou bien des fous… Il n'y a pas de pourquoi !… » (Octave Mirbeau, « Mémoires pour un avocat », III, Le Journal, 14 octobre 1894, p. 1 ; dans Contes cruels, tome II, Séguier, 1990, p. 91). 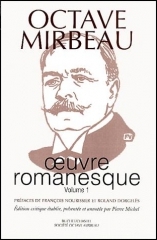
. L’abbé Jules : « Qu'est-ce que tu dois chercher dans la vie ?… Le bonheur… Et tu ne peux l'obtenir qu'en exerçant ton corps, ce qui donne la santé, et en te fourrant dans la cervelle le moins d'idées possible, car les idées troublent le repos et vous incitent à des actions inutiles toujours, toujours douloureuses, et souvent criminelles… […] Tu réduiras tes connaissances du fonctionnement de l'humanité au strict nécessaire : 1° L'homme est une bête méchante et stupide ; 2° La justice est une infamie ; 3° L'amour est une cochonnerie ; 4° Dieu est une chimère… » (Octave Mirbeau, L’Abbé Jules (1888), II, iii ; dans Œuvre romanesque, tome 1, Buchet-Chastel, 2000, p. 470).
. L’abbé Jules : « Au lieu de conserver à l’amour le caractère qu’il doit avoir dans la nature, le caractère d’un acte régulier, tranquille et noble… le caractère d’une fonction organique, enfin… nous y avons introduit le rêve… le rêve nous a apporté l’inassouvi… et l’inassouvi, la débauche. Car la débauche, ce n’est pas autre chose que la déformation de l’amour naturel, par l’idéal… Les religions – la religion catholique, surtout – […] sous prétexte d’en adoucir le côté brutal – qui est le seul héroïque, – en ont développé le côté pervers et malsain, par la sensualité des musiques et des parfums, par le mysticisme des prières et l’onanisme moral des adorations… […] Elles savaient que c’était le meilleur et le plus sûr moyen d’abrutir l’homme, et de l’enchaîner… Alors les poètes n’ont chanté que l’amour, les arts n’ont exalté que l’amour… Et l’amour a dominé la vie, comme le fouet domine le dos de l’esclave qu’il déchire, comme le couteau du meurtre, la poitrine qu’il troue !… Du reste, Dieu !… Dieu, ce n’est qu’une forme de la débauche d’amour !… C’est la suprême jouissance inexorable, vers laquelle nous tendons tous nos désirs surmenés, et que nous n’atteignons jamais… Autrefois, j’ai cru à l’amour, j’ai cru à Dieu !… J’y crois encore souvent, car de ce poison on ne guérit pas complètement… » (Octave Mirbeau, L’Abbé Jules (1888), II, iv ; dans Œuvre romanesque, tome 1, Buchet-Chastel, 2000, p. 484-485).
. J’ai voulu me dévouer aux autres, […] par la pitié et par la raison. Et j’ai compris que c’était absurde et vain. […] Je n’ai jamais vu [dans cette petite ville] que des choses désespérantes et qui m’ont écœuré. Au fond, ces gens se détestent et se méprisent. Les bourgeois détestent les ouvriers, les ouvriers détestent les vagabonds ; les vagabonds cherchent plus vagabonds qu’eux pour avoir aussi quelqu’un à détester, à mépriser. Chacun s’acharne à rendre plus irréparable l’exclusivisme homicide des classes, plus étroit l’étroit espace de bagne où ils meuvent leurs chaînes éternelles. (Octave Mirbeau, Sébastien Roch (1890), II, ii, 8 janvier minuit ; dans Œuvre romanesque, tome 1, Buchet-Chastel, 2000, p. 721).
. Tout me fut une souffrance, car je n'avais pas encore le sentiment, si rassurant, si égoïste, de la beauté éparse dans les choses, de la beauté qui, seule, suffit à expliquer, à excuser ce malentendu, ce crime : l'univers. (Octave Mirbeau, Dans le ciel (1892), chap. VI ; éd. du Boucher, 2003, p. 48).
. Lucien : « Exagéré… mais l'art, imbécile, c'est une exagération… L'exagération c'est une façon de sentir, de comprendre… » (Octave Mirbeau, Dans le ciel (1893), chap. XV ; éd. du Boucher, 2003, p. 88).
. Un convive : « Prendre quelque chose à quelqu'un, et le garder pour soi, ça c'est du vol… Prendre quelque chose à quelqu'un et le repasser à un autre, en échange d'autant d'argent que l'on peut, ça, c'est du commerce… Le vol est d’autant plus bête qu’il se contente d’un seul bénéfice, souvent dangereux, alors que le commerce en comporte deux, sans aléa… » (Octave Mirbeau, Le Jardin des supplices (1899), I, ii ; Folio n°1899, 1991, p. 74).
. Clara : « Ce n'est pas de mourir qui est triste… c'est de vivre quand on n'est pas heureux… » (Octave Mirbeau, Le Jardin des supplices (1899), II, vi ; Folio n°1899, 1991, p. 220).
. […] cette tristesse et ce comique d’être un homme. Tristesse qui fait rire, comique qui fait pleurer les âmes hautes. (Octave Mirbeau, Le Journal d’une femme de chambre (1900), dédicace à Jules Huret ; Folio n°1536, 1984, p. 30).
. Célestine : « On ne s’imagine pas […] combien il y en a qui sont indécentes et loufoques dans l’intimité, même parmi celles qui, dans le monde, passent pour les plus retenues, les plus sévères, pour des vertus inaccessibles… Ah, dans les cabinets de toilette, comme les masques tombent !… Comme s’effritent et se lézardent les façades les plus orgueilleuses !… » (Octave Mirbeau, Le Journal d’une femme de chambre (1900), II ; Folio n°1536, 1984, p. 72).
. Célestine : « Ah ! ceux qui ne perçoivent, des êtres humains, que l’apparence et que, seules, les formes extérieures éblouissent, ne peuvent pas se douter de ce que le beau monde, de ce que « la haute société » est sale et pourrie… » (Octave Mirbeau, Le Journal d’une femme de chambre (1900), VI ; Folio n°1536, 1984, p. 153).
. Célestine : « Si infâmes que soient les canailles, ils ne le sont jamais autant que les honnêtes gens. » (Octave Mirbeau, Le Journal d’une femme de chambre (1900), IX ; Folio n°1536, 1984, p. 224).
. Un ouvrier menuisier : « Les lois sont toujours faites pour les riches contre les pauvres. » (Octave Mirbeau, Les 21 jours d’un neurasthénique (1901), XIX ; dans Œuvre romanesque, tome 3, Buchet-Chastel, 2001, p. 195).
. Plus je vais dans la vie, et plus je vois clairement que chacun est l’ennemi de chacun. Un même farouche désir luit dans les yeux de deux êtres qui se rencontrent : le désir de se supprimer. Notre optimisme aura beau inventer des lois de justice sociale et d’amour humain, les républiques auront beau succéder aux monarchies, les anarchies remplacer les républiques, tant qu’il y aura des êtres vivants, tant qu’il y aura des hommes sur la terre, la loi du meurtre dominera parmi leurs sociétés, comme elle domine parmi la nature. C’est la seule qui puisse satisfaire les convoitises, départager les intérêts… (Octave Mirbeau, La 628-E8 (1907), VI ; dans Œuvre romanesque, tome 3, Buchet-Chastel, 2001, p. 503).
. Les gens de finance sont en général fort bornés, et orgueilleux avec médiocrité. Ils manquent de culture, d’imagination, de générosité d’esprit, dans un métier où il en faut beaucoup. Ils n’ont que de la routine dans une aventure où il n’en faut pas du tout. Concevoir une affaire, c'est concevoir un poème. L'homme d'affaires qui n'est pas, en même temps, un idéaliste, un poète, ce n'est rien… rien qu'un escroc, la plupart du temps. (Octave Mirbeau, La 628-E8 (1907), VII, « Avec Balzac » ; dans Œuvre romanesque, tome 3, Buchet-Chastel, 2001, p. 566).
. Hélas ! j’ai eu dans ma vie assez d’amis, d’excellents, fidèles et très chers amis, pour savoir que l’amitié humaine n’est le plus souvent que la culture d’une domination ou l’exploitation usuraire d’un intérêt, d’une candeur, d’une confiance. (Octave Mirbeau, Dingo (1913), IV ; dans Œuvre romanesque, tome 3, Buchet-Chastel, 2001, p. 688).
. Germaine : « Quand il y a, quelque part, un homme trop riche… il y a, par celà même, autour de lui… des gens trop pauvres… » (Octave Mirbeau, Les Affaires sont les affaires (1903), acte I, scène 1 ; dans Œuvres illustrées. Théâtre, Les Éditions nationales, 1935, p. 112).
. Mme Lechat : « Ceux qui ne parlent jamais… en disent beaucoup plus que ceux qui parlent toujours… » (Octave Mirbeau, Les Affaires sont les affaires (1903), acte I, scène 1 ; dans Œuvres illustrées. Théâtre, Les Éditions nationales, 1935, p. 113). 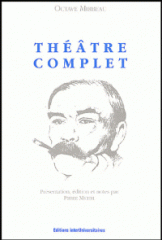
. Isidore Lechat : « Les affaires sont des échanges… on échange de l’argent… de la terre… des titres… des mandats électoraux… de l’intelligence… de la situation sociale… des places… de l’amour… du génie… ce qu’on a contre ce qu’on n’a pas… » (Octave Mirbeau, Les Affaires sont les affaires (1903), acte III, scène 2 ; dans Œuvres illustrées. Théâtre, Les Éditions nationales, 1935, p. 205).
. Isidore Lechat : « Les programmes !… (avec un geste qui rejette les choses au loin) Une fois nommé… les programmes sont loin… et ils courent encore… […] Les convictions sont quelquefois implacables… Et encore !… Les affaires, jamais… » (Octave Mirbeau, Les Affaires sont les affaires (1903), acte III, scène 2 ; dans Œuvres illustrées. Théâtre, Les Éditions nationales, 1935, p. 207).
. Courtin : « Mon cher enfant, on s’expose à de graves déceptions quand on ne compte que sur la Justice… Vous êtes jeune, enthousiaste… vous rêvez… Mais vous reconnaîtrez vous-même, bientôt, que nous ne sommes pas mûrs pour le règne de la Justice… […] Heureusement, pour compléter l’effort de la charité, il y a mieux… il y a la résignation… […] La résignation… l’admirable vertu des déshérités… Oui, par bonheur, les pauvres ont la résignation… » (Octave Mirbeau et Thadée Natanson, Le Foyer (1908), acte I, scènes 3-4 ; dans Œuvres illustrées. Théâtre, Les Éditions nationales, 1935, p. 258).
. Courtin : « On en dit trop aux pauvres… On les instruit trop… […] Vous prétendez, messieurs, qu’il y a trop peu d’écoles, moi, j’ose affirmer qu’il y en a trop… […] Il n’est pas désirable que l’instruction s’étende davantage… Car l’instruction est un commencement d’aisance, et l’aisance n’est pas à la portée de tout le monde… » (Octave Mirbeau et Thadée Natanson, Le Foyer (1908), acte I, scène 4 ; dans Œuvres illustrées. Théâtre, Les Éditions nationales, 1935, p. 259).
. Courtin : « Rien n'est capital pour le maintien de l'ordre, comme de taire le mal… Il est beaucoup moins important de faire le bien que de taire le mal… Taire le mal… taire le mal… l'empêcher, si l'on peut… mais, surtout, le taire… » (Octave Mirbeau et Thadée Natanson, Le Foyer (1908), acte I, scène 6 ; dans Œuvres illustrées. Théâtre, Les Éditions nationales, 1935, p. 263).
. Lerible : « On vit en travaillant… On ne s'enrichit qu'en faisant travailler… » (Octave Mirbeau et Thadée Natanson, Le Foyer (1908), acte III, scène 8 ; dans Œuvres illustrées. Théâtre, Les Éditions nationales, 1935, p. 361).
OCTAVE MIRBEAU : CORRESPONDANCE
[À compléter]
. L’abbé Lamargelle : « Le repentir, une des colonnes du christianisme, qui semble faire des mamours à l’homme et lui dire : "Tu peux mal agir, à condition que tu fasses semblant de regretter tes méfaits", est une excellente invention, merveille de lâcheté et d’hypocrisie, admirablement adaptée aux besoins modernes. » (Georges Darien, Le Voleur (1897), IX ; Folio n°1798, 1987, p. 184). 
. L’abbé Lamargelle : « Avez-vous songé que tout acte criminel est une fenêtre ouverte sur la Société ? Que connaitrait-on du monde, sans les malfaiteurs ? Je crois qu'un acte, quel qu'il soit, ne peut être mauvais. L'acte ! Oui, agir ce qu'on rêve. Le secret du bonheur, c'est le courage. » (Georges Darien, Le Voleur (1897), IX ; Folio n°1798, 1987, p. 185-186).
. L’abbé Lamargelle : « La Bourse est une institution, comme l'Église, comme la Caserne […]. Les charlatans qui y règnent sont d'abominables gredins ; mais il est impossible d'en dire du mal, tellement leurs dupes les dépassent en infamie. » (Georges Darien, Le Voleur (1897), IX ; Folio n°1798, 1987, p. 193).
. Le Monsieur jovial : « Savez-vous, Monsieur, quelle est la principale cause de cette démoralisation dont on se plaint un peu trop, peut-être, mais qui pourtant nous menace ? C’est qu’on applique trop rarement la peine de mort. Un chef d’État conscient de ses devoirs ne devrait jamais faire grâce, Monsieur ! Il y va du salut de la Société. Ne pensez-vous point qu’on ne guillotine pas assez ? » (Georges Darien, Le Voleur (1897), X ; Folio n°1798, 1987, p. 201).
. Le Monsieur jovial : « L'instruction donne la patience […]. Elle donne une patience d'ange aux déshérités. Croyez-vous que si les Français d’aujourdhui ne savaient pas lire, ils supporteraient ce qu’ils endurent ? Quelle plaisanterie ! » (Georges Darien, Le Voleur (1897), X ; Folio n°1798, 1987, p. 203).
. L’abbé Lamargelle : « Autrefois, quand on était las et dégoûté du monde, on entrait au couvent ; et lorsqu'on avait du bon sens, on y restait. Aujourdhui, quand on est las et dégoûté du monde, on entre dans la révolution, et, lorsqu'on est intelligent, on en sort. » (Georges Darien, Le Voleur (1897), XI ; Folio n°1798, 1987, p. 214).
. Georges Randal : « Elle ne serait ni difficile ni longue pourtant, la battue à opérer dans cette forêt de Bondy où font ripaille les hyènes du capital ! Et il y aurait du pain et du bonheur pour tous, si l’on voulait !… » — L’abbé Lamargelle : « Oui, vous avez raison. Si l’on voulait ! Mais !… Ah ! quelle servilité ! Qui donc écrira l'Histoire de l'esclavage depuis sa suppression ?… Je crois qu’on a dit quelque part que l’homme avait été tiré du limon ; il n’a point oublié son origine… » (Georges Darien, Le Voleur (1897), XXI ; Folio n°1798, 1987, p. 368-369).
. Mme Voisin : « Rien ne peut vous rendre philosophe comme de tenir un hôtel. On entend tout, on voit tout, on apprend tout. On arrive à ne plus faire aucune distinction entre les choses les plus opposées, et l’on devient indifférent au bien comme au mal, au mensonge comme à la vérité, à la vertu comme au vice. Si cette maison pouvait parler ! Combien de gens honnêtes qui s’y sont conduits en forbans, combien de filous qui ont été des modèles de droiture ! Que de cocottes qui s’y sont comportées en femmes d’honneur, et que de femmes mariées qui ont mis leur vénalité aux enchères ! Et que de filous qui ont été des coquins, que d’honnêtes gens qui sont restés intègres, que de cocottes qui furent des courtisanes et que d’épouses qui restèrent pures ! C’est encore plus étonnant… Décidément, le monde est semblable aux braises du foyer : on y voit tout ce qu’on rêve. Et le mieux est de rêver le moins possible, car on finit par croire à ses rêves, et ils n’en valent jamais la peine. La vie, voyez-vous, c’est comme une baraque de la foire, devant laquelle se trémoussent des parades burlesques, tandis qu’on joue des drames sanglants à l’intérieur. À quoi bon entrer, pour assister aux souffrances de l’orpheline et souhaiter la mort du traître, quand vous pouvez vous distraire gratis aux bagatelles de la porte ? La tragédie, c’est pour les cerveaux faibles… » (Georges Darien, Le Voleur (1897), XXII ; Folio n°1798, 1987, p. 392-393).
. L’abbé Lamargelle : « Je crois qu'il ne faut se laisser lier par rien, surtout par les serments qu'on se fait à soi-même. Ils coûtent toujours trop cher… » (Georges Darien, Le Voleur (1897), XXII ; Folio n°1798, 1987, p. 396).
GEORGES DARIEN : ESSAIS et ARTICLES
. C’est une chose laide, un vaincu. / L’être qui porte au front le stigmate de la défaite, quels qu’aient été sa bravoure dans le combat et ses efforts vers la victoire, n’est pas beau à contempler. Il a perdu, au moins momentanément, l’estime de lui-même et la confiance en soi qui sont la marque de l’Individu libre ; s’il put échapper à l’esclavage matériel, la servitude morale pèse sur lui, l’enserre, l’étreint ; et il cesse d’être un homme, oui, pour devenir une chose. […] / Mais, lorsque le vaincu travestit ses revers en victoires morales, lorsqu’il se fait un manteau de théâtre du haillon de drapeau qui lui fut laissé, lorsqu’il prend des poses, crâne, parade, provoque, rentre dans son trou au premier signe de danger, en sort plus insolent que jamais, braille, brait, aboie, jappe, insulte, menace, disparaît pour reparaître et pour faire la roue : alors, le vaincu n’est pas seulement une chose laide : c’est une sale et méprisable chose – c’est une ordure. (Georges Darien, La Belle France (1900), I ; coll. 10/18 n°1235, 1978, p. 13-14). 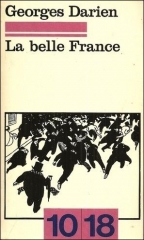
. Le patriotisme n'est pas seulement le dernier refuge des coquins [12] ; c'est aussi le premier piédestal des naïfs et le reposoir favori des imbéciles. Je ne parle pas du patriotisme tel qu’il devrait être, ou tel qu’il pourrait être, mais du patriotisme que nous voyons en France. (Georges Darien, La Belle France (1900), II ; coll. 10/18 n°1235, 1978, p. 37).
. La diversité des opinions n’existe qu’à la surface, les dissensions sont factices. Sur ce qu’ils appellent les principes fondamentaux de leur état politique et social, ils sont tous d’accord, et d’un parti à l’autre il est impossible de découvrir de différence réelle. Écartez les mots, balayez les phrases, ne tenez compte que des faits ; et vous apercevrez qu’il y a entente parfaite entre les diverses fractions du corps politique, du corps électoral français. Tous les partis, tous les groupes que créa l’ambition des politiciens, bien plus que la force des circonstances, ont tout à tour exercé le pouvoir. Par quels actes peuvent-ils se différencier les uns des autres ? […] La seule politique que veuille la France, c'est une politique incolore, insipide, flasque ; elle est prête à payer n'importe quoi pour avoir cette politique-là ; et elle paye, et elle l'a. Moyennant quoi, elle peut dormir et, entre deux sommeils, se trémousser quelque peu afin de donner aux autres et surtout à elle-même l’illusion d’une agitation féconde. (Georges Darien, La Belle France (1900), III ; coll. 10/18 n°1235, 1978, p. 65).
. La France ne veut pas d’hommes. Ce qu’il lui faut, c’est des castrats. Elle les exige de premier choix, coupe et profil (coupe surtout), rasés de près, tondus à la malcontent. (Georges Darien, La Belle France (1900), III ; coll. 10/18 n°1235, 1978, p. 70-71).
. Le crime le plus horrible des riches envers les pauvres est de s'être arrogé le droit de leur distribuer la justice et l'assistance, de leur faire la charité. (Georges Darien, La Belle France (1900), IV ; coll. 10/18 n°1235, 1978, p. 101).
. L’existence du sentiment religieux chez le catholique est en raison exacte de l’absence du sentiment de solidarité humaine. L’hypocrisie du bourgeois est grande ; mais son imbécillité, plus grande encore, lui laisse une certaine bonne foi que l’Église l’amène à placer, sans difficulté, dans le sentiment religieux. Le bourgeois croit parce qu’il a peur de ne point croire. (Georges Darien, La Belle France (1900), VI ; coll. 10/18 n°1235, 1978, p. 179-180).
. Le catholicisme a développé jusqu’à l’extrême l’esprit du christianisme ; le sacrifice de la messe, la présence réelle de Dieu, font oublier le sacrifice des vies douloureuses, la présence réelle du Pauvre. Les cris de l’orgue, clamant les angoisses de la victime du Golgotha, étouffent les plaintes des malheureux qui râlent sous le genou du prêtre, sous le talon du soudard à son service. Plus les souffrances du pauvre deviennent intolérables, plus le prêtre exagère les souffrances de son Dieu. (Georges Darien, La Belle France (1900), VI ; coll. 10/18 n°1235, 1978, p. 180).
. Il est incroyable que le Pauvre n’ait pas encore supprimé, définitivement, le saltimbanque en soutane. Il est incroyable qu’il ne se soit pas encore élevé contre la continuation de cette répugnante farce ecclésiastique que son absurde patience, seule, rend possible. Il est incroyable qu’il tolère le prêtre. […] Quant aux marchands que jadis on chassait du temple à coups de fouet, il est devenu impossible de les mettre dehors sans vicier le temple ; ce sont eux qui font le service, et l’autel est devenu leur comptoir. Celà démontre combien il était inutile de chasser ces marchands ; il ne fallait point les forcer à quitter le temple, mais faire écrouler le temple sur leurs têtes. […] Autrefois, les criminels traqués […] trouvaient dans le sanctuaire un asile inviolable. Aujourdhui, les criminels, qui ne sont plus poursuivis par personne, n’ont plus besoin d’asile ; ce sont eux qui poussent leurs victimes à se réfugier dans l’église où elles espèrent trouver un abri, la protection qu’elles ont renoncé à chercher dans la vigueur de leur cerveau ou de leurs bras. Et le prêtre, sur qui elles comptaient pour les défendre ou les consoler, les sacrifie à son autel […], ou les livre de nouveau, après leur avoir lié pieds et poings avec des chapelets bénits, à la férocité de leurs oppresseurs. Il ne faut pas chercher asile au temple ; il faut l’abolir. […] C’est l’église […], c’est cette impertinente pétrification du mensonge dont l’ombre jette sur la beauté de la terre la tristesse d’un voile de deuil, qu’il ne faut pas tolérer. Pour détruire le pouvoir du prêtre, ce n’est ni un philosophe avec ses arguments ni un révolutionnaire avec ses formules que je demande ; c’est un maçon avec sa pioche. (Georges Darien, La Belle France (1900), VI ; coll. 10/18 n°1235, 1978, p. 181-182).
. Les yeux d'un écrivain, pour être clairs, doivent être secs, et non rougis de pleurs de crocodiles et tamponnés par des mouchoirs en deuil. (Georges Darien, « Le roman anarchiste », article dans L'En-dehors, n°23, 8 octobre 1891, p. 2).
Autres pages de citations en rapport avec celle-ci sur ce blogue : Humoristes ; Écrivains et penseurs de gauche [en préparation] ; Voltaire [en préparation] ; Jean-Jacques Rousseau [en préparation] ; Diderot [en préparation] ; Chamfort ; Auteurs romantiques français [en préparation] ; Claude Tillier ; Balzac [en préparation] ; Victor Hugo [en préparation] ; Jules Michelet ; Gustave Flaubert [en préparation] ; Romanciers français 1848-1914 ; Romanciers français de la première moitié du XXe siècle ; Dramaturges français XIXe-XXe [en préparation] ; Jules Barbey d’Aurevilly [en préparation] ; Edmond et Jules de Goncourt [en préparation] ; Maupassant [en préparation] ; Émile Zola ; Anatole France [en préparation] ; Léon Bloy ; Jules Renard ; Georges Courteline ; Paul-Jean Toulet ; Élémir Bourges ; Charles Péguy ; Maurice Barrès [en préparation] ; Paul Léautaud ; Georges Bernanos ; Louis-Ferdinand Céline [en préparation] ; Camus et Saint-Exupéry [en préparation] ; Jean-Paul Sartre [en préparation] ; Gilbert Cesbron, – et la page générale : citations choisies et dûment vérifiées.
______________________________________
[1] « Jules Vallès et Georges Darien : le roman contestataire », dans Les Amis de Jules Vallès, 1985, p. 239-250. Je relève aussi l’existence une thèse soutenue par Arnaud Vareille à Grenoble en 1996 sous le titre : Écriture romanesque et contestation sociale : l’évolution de la figure du réprouvé à la fin du XIXe siècle chez Léon Bloy , Georges Darien (Le Voleur) et Octave Mirbeau.
[2] Pour Lucien Descaves, voir Jules Huret, Enquête sur l’évolution littéraire, V, 6, éd. José Corti, 1999, p. 258 ; pour Léon Daudet, voir « Jules Vallès », article paru dans Candide le 26 mai 1932.
[3] Vallès a écrit « roulis ». C’est une impropriété : le roulis est le balancement transversal, qui fait pencher le bateau tantôt à bâbord tantôt à tribord. C’est le tangage qui le fait pencher tantôt en avant tantôt en arrière.
[4] Vallès vise en particulier les sculptures de Michel-Ange, dont l’esclave n’est « point humain », dont les « grandeurs factices » ne peuvent « remuer » le peuple qui ne connaît pas la mythologie antique.
[5] Vallès prend ici la défense de Musset. Pourtant, dans « Les victimes du livre », article paru dans Le Figaro le 9 octobre 1862 et repris dans le recueil Les Réfractaires en 1865, Vallès n’avait pas été très amène pour Musset et son lent suicide à l’absinthe (voir Pléiade tome I p. 242-243). Plus encore, un an avant ce texte, il avait été très sévère pour Baudelaire, donnant – par ouï-dire – une vision ridicule et honteuse de son agonie, dans un article nécrologique assez ignoble publié dans La Rue le 7 septembre 1867 (Pléiade tome I p. 975-976), dont j’ai déjà donné quelques citations ailleurs.
[6] Octave Mirbeau a une vision particulièrement négative des Chinois. Trois jours plus tard, le 4 avril 1885, il publie dans Le Gaulois « Les Barbares », étonnant morceau de sinophobie.
[7] Dans ce texte dreyfusard, Mirbeau caricature Paul Bourget, figure emblématique des antidreyfusards.
[8] Je n’ai trouvé cette anecdote nulle part ailleurs, et je me demande donc si Mirbeau ne l’aurait pas inventée.
[9] Mirbeau a repris cette phrase (sans « pénétrés de cette vérité ») pour la placer en excipit d’un autre article six ans plus tard : « La gloire des lettres », Le Journal, 21 juillet 1895 (repris dans Les Écrivains. Deuxième série 1895-1910, 7, Flammarion, 1926, p. 59 ; et dans Combats littéraires, L’Âge d’Homme, 2006, p. 417). Les deux fois, la phrase est ironique et sert à souligner l’ingéniosité sans limite des esprits publicitaires qui soumettent la vie littéraire aux principes du commerce. Dans le second article, Mirbeau la place même dans la bouche d’un personnage caricatural.
[10] Mirbeau a repris ce passage avec quelques menues variantes, sept ans plus tard, pour le placer à la fin d’un autre article : « Propos galants sur les femmes », Le Journal, 1er avril 1900 (repris ensuite dans le recueil posthume Les Écrivains. Deuxième série 1895-1910, 23, Flammarion, 1926, p. 191).
[11] On lira un autre portrait féroce du paysan dans l’article « Propos de l’instituteur (II) », paru dans L’Humanité le 31 juillet 1904.
[12] « Patriotism is the last refuge of a scoundrel » : sentence de Samuel Johnson proférée le 7 avril 1775 : voir James Boswell, Vie de Samuel Johnson (1791), L’Âge d’homme, 2002, p. 361.

Écrire un commentaire