ÉLÉMIR BOURGES : CITATIONS CHOISIES
14.06.2012
 Je propose ici une sélection personnelle de citations d’Élémir Bourges (1852-1925). Pour l’instant, elles ne sont tirées que de ses deux romans centraux, Le Crépuscule des dieux (paru en mars 1884 chez Giraud) et Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (publié en pré-originale dans L’Écho de Paris à partir du 14 juin 1892 et dans la Revue hebdomadaire à partir du 29 octobre 1892, puis en volume chez Plon en mars 1893).
Je propose ici une sélection personnelle de citations d’Élémir Bourges (1852-1925). Pour l’instant, elles ne sont tirées que de ses deux romans centraux, Le Crépuscule des dieux (paru en mars 1884 chez Giraud) et Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (publié en pré-originale dans L’Écho de Paris à partir du 14 juin 1892 et dans la Revue hebdomadaire à partir du 29 octobre 1892, puis en volume chez Plon en mars 1893).
Bourges n’est pas un romancier à maximes, comme le sont Balzac, Radiguet, Montherlant ou Monteilhet. La moisson n'est donc pas très riche, mais en compensation je me suis plu à reproduire, dans le Crépuscule, des pages du dernier chapitre, qui peint l’effondrement d’un monde, et dans les Oiseaux, des pages de la dernière partie, qui est une sorte de bréviaire du nihilisme. Je n’ai pas eu de scrupule à donner en entier de longues tirades, afin d’étoffer cette page.
Les Oiseaux posent un petit problème philologique : à l’occasion d’une réédition chez Crès en 1921 (en deux volumes), Bourges a modifié son texte, apportant environ cinquante-cinq amendements de détail, mais retranchant aussi environ quarante-cinq passages, tantôt une simple phrase, tantôt un paragraphe, et parfois même une page entière. [1] « J’ai ôté là quelques grosses taches de cambouis dont la suppression a amélioré le livre », écrivait-il à son ami Armand Point. C’est surtout la troisième partie qui a été victime de ces coups de sabre. Or on peut les regretter : du point-de-vue de l’art romanesque, ces quelques pages en moins ne corrigent nullement l’un des vices fondamentaux de ce roman raté, dont la troisième partie reste obèse et encombrée de digressions assommantes qui n’ont rien à y faire. Mais si l’on extrait du roman ces digressions, si on les considère pour elles-mêmes, dans leur beauté âpre et désespérée, on déplore d’avoir perdu des morceaux pleins de force, des imprécations magnifiques contre l’homme et la vie, des tirades nihilistes d’une éloquence digne de Villiers de l’Isle-Adam, ou, pour jouer sur le titre, des envolées superbes qui s’écrasent avec classe. Heureusement, l’édition du roman que Gisèle Marie a procurée au Mercure de France en 1964 (la dernière à ce jour) les a toutes colligées en annexe. J’ai donc rétabli ces morceaux qui me plaisent dans leur version originale de 1893, en signalant par des italiques tous les passages supprimés en 1921.
[en préparation : revue critique de Les Oiseaux s’envolent les fleurs tombent.]
SOUS LA HACHE
[à compléter]
LE CRÉPUSCULE DES DIEUX
. Arcangeli : « Croyez-moi, seigneur comte, il faut prendre les femmes comme on prend les tortues, en les mettant sur le dos. » (Élémir Bourges, Le Crépuscule des dieux (1884), chap. III ; Stock, 1950, p. 56). 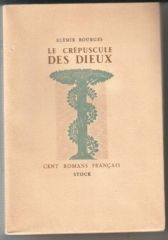
. Une passion renaît toujours, tant qu’on ne l’a pas ôtée jusqu’à la dernière racine. (Élémir Bourges, Le Crépuscule des dieux (1884), chap. VII ; Stock, 1950, p. 146).
. Les ambitieux, des combles les plus désirés, même les plus inespérés, une fois atteints, se font aussitôt des degrés pour arriver à davantage. (Élémir Bourges, Le Crépuscule des dieux (1884), chap. VII ; Stock, 1950, p. 164).
. Il éprouvait un vide de dégoût, un horrible désenchantement. – Ah ! voilà donc ce que c'était qu'aimer ; rien de plus qu'avec les autres femmes ! Comme un enfant qui reste étonné, aussitôt qu'il a mangé le fruit convoité, Otto doutait si ce moment était bien une réalité. Quoi ! les ravissantes douceurs de ses longues rêveries, cet amour qui avait dormi trois années, à un endroit de son être si profond et si retiré, que lui-même n'en soupçonnait rien, ces ardentes lettres écrites dans le plus ténébreux secret, ses désirs, ses élans, sa passion, ses lèvres qui tremblaient vers elle, tout cela se réduisait donc à cette triste et courte débauche, à ce néant affreux qu'il sentait ! (Élémir Bourges, Le Crépuscule des dieux (1884), chap. VIII ; Stock, 1950, p. 176).
. À si peu de jours de la Schlosser [=une ex-maîtresse laide et désagréable], les mêmes propos de tendresse qu'Otto avait tenus à celle-ci, les mêmes pensées, les mêmes phrases, jusqu'au même arrangement et aux mêmes mots, se retrouvèrent sur ses lèvres ; de manière que, peu à peu, et quelque ennui qu'il en eût, l'amant nomma la Belcredi [=une femme idéalisée] de ces mêmes termes mignards dont il avait appelé la danseuse, – tant l'homme a des ressources bornées, pour exprimer l'infini de son cœur ! (Élémir Bourges, Le Crépuscule des dieux (1884), chap. VIII ; Stock, 1950, p. 178).
. Moins il aimait, et plus son cœur avait l'instinct de vouloir se poursuivre soi-même, et s'accablait d'exaltation et d'efforts, pour retrouver ce qu'il avait perdu. (Élémir Bourges, Le Crépuscule des dieux (1884), chap. VIII ; Stock, 1950, p. 193).
. « Parle-moi, dis-moi quelque chose… » murmurait enfin la jeune femme ; mais il n'avait rien à lui dire, il ne savait qu'un seul mot : « Je t'aime ! » et tout ce qui n'était pas ce mot, l'importunait. – Ah ! l'aimait-elle donc si peu, qu'il fallût la distraire maintenant, babiller, étaler des grâces en sa présence ! (Élémir Bourges, Le Crépuscule des dieux (1884), chap. VIII ; Stock, 1950, p. 194).
. La honte, on l'avale vite, quand on est amant. (Élémir Bourges, Le Crépuscule des dieux (1884), chap. VIII ; Stock, 1950, p. 197).
. Ah ! vieille idole de l'amour, qu'importe comment l'on t'adore ! Dans les dérèglements du corps, c'est toujours notre âme qui agit, et tourmentée de l'infini où elle voudrait s'amalgamer, entraîne, de bourbiers en bourbiers, son misérable compagnon. / Mais le spasme une fois terminé, son cœur ne fut pas plus heureux ; la convoitise de l'amour demeura en lui, tout aussi âpre. Non! le plaisir ne comblait pas ce vide immense qui le séparait d'avec sa maîtresse. Et il avait beau la serrer dans ses bras, jusques à mourir, s'emplir par tous les sens et par tous les excès de cette chair, où s'accomplissait ce qui causait ces transports à son âme, toujours, il semblait à Otto que, pour posséder Giulia, pour avoir toute sa personne, et atteindre au profond d'elle-même, il dût ôter un dernier voile et percer encore une nuée. (Élémir Bourges, Le Crépuscule des dieux (1884), chap. VIII ; Stock, 1950, p. 198).
. Ainsi, cette race superbe qui avait tenu autrefois l'Allemagne entière sous son joug, et brillé par les plus grands hommes en tous genres, des rois, des empereurs, des saints, finissait dans un abîme de boue sanglante, avec des bâtards, des incestueux, des voleurs et des parricides. / Alors, le cœur du Duc se brisa. – Et lui-même, dailleurs, qu'avait-il été ? Fils dénaturé, cruel père, mari terrible, maître détestable, jaloux, capricieux, inquiet sans relâche, quel bonheur avait-il goûté, quelle grandeur lui restait-il, à lui qui voulait tout mettre à ses pieds ? Il se vit seul, plus que malheureux en famille, en frère, en oncle, et en enfants, déchiré au dedans par des catastrophes poignantes, sans consolation de personne, portant son front découronné, dans tous les hôtels de l'Europe, abandonné à deux ou trois valets, qui le gouvernaient despotiquement, ne faisant plus rien que par eux, ayant donné à son bouffon, son goût, son jugement, ses oreilles, ses yeux ; dailleurs, infirme et ridicule. La nuit montait autour de lui, les ténèbres s'épaississaient ; ces temps cruels, hélas ! avaient été le crépuscule de sa race. (Élémir Bourges, Le Crépuscule des dieux (1884), chap. X ; Stock, 1950, p. 264).
. Certes, une fête si fameuse, annoncée depuis de longs mois, et à laquelle tant de gens avaient mis leur point d'honneur de figurer et d'être vus, était comme un congrès de l'Europe assemblée, dont tous les puissants, les arbitres, et si l’on peut dire, les premières têtes, en noblesse, en art, en capacité, devaient se trouver là réunis ; et cependant, qu'y voyait Charles d'Este ? Beaucoup d'industriels, enrichis dans leurs forges ou leurs filatures ; des hommes d'affaires, des légistes, qui s'étaient poussés peu à peu par les plus vils emplois de plume, ou d'aboyeurs devant un tribunal ; quantité de ces beautés galantes des diverses capitales de l'Europe, admises partout maintenant à exercer leur sale métier ; et le reste, des gens de lettres, ou des reporteurs de gazettes : tout mêlé, nivelé, confondu, devenu peuple, grands et petits, connus et inconnus, dans la parité des habits. Plus de règle, plus de hiérarchie ! Une arrogante bourgeoisie, des suppôts brouillons de politique, des écrivassiers besogneux, se mêlaient, comme bon leur semblait, aux seigneurs et aux souverains mêmes, tant l'esprit de révolte et d'innovation avait comme enivré le monde. (Élémir Bourges, Le Crépuscule des dieux (1884), chap. X ; Stock, 1950, p. 265).
. Il lui pardonnait maintenant d'avoir anéanti les souverains d'Allemagne, et écrasé les derniers débris de cette noble et grande féodalité. Contre les peuples turbulents, les violences de l'esprit nouveau, et la licence débordée et triomphante, qu'eussent fait ces princes vides de tout, et ne formant nul corps ensemble ? Au lieu qu'un seul chef et un guide unique, avec ses tentes, ses pavillons, son armée de soldats dévoués, pouvait se ranger en bataille contre tant de sectes nouvelles, les écraser et remettre tout dans la soumission et dans le devoir. (Élémir Bourges, Le Crépuscule des dieux (1884), chap. X ; Stock, 1950, p. 265-266). 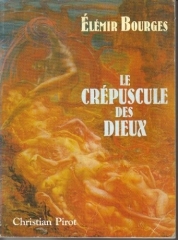
. En se rasseyant, Charles d'Este vit près de lui et peu éloignés l'un de l'autre, deux Juifs à nom fameux, qui faisaient en Europe le plus gros commerce d'argent, et il devint blême de dépit. C'était à eux, non pas à lui, que s'adressait le salut particulier, rendu par l'empereur Guillaume ; et cette espèce de prostitution de ce prince si avare de ses grâces, à deux hommes d'une telle sorte, marquait assez la puissance qu'ils avaient. Oui ! les Juifs étaient à présent montés par dessus la tête des Rois. Cette tribu vorace et ennemie, et sans cesse occupée à sucer les peuples par les cruelles inventions que l'avarice peut imaginer, avait, siècle à siècle, amassé, dans la doublure de ses guenilles, tous les trésors et l'or du monde ; et par là, maintenant, rois, prélats, empereurs, la terre, le travail, le commerce, et même la paix et la guerre, quelques juifs immondes les tenaient captifs, et en disposaient souverainement. Leurs rapines, tournées en science et en stratégie financières, leur avaient asservi ce temps, qui rend un culte au Veau d'or : tout pliait, tout courbait la tête devant eux ; leurs filles entraient au lit des princes, et mêlaient au plus pur sang chrétien, la boue infecte du Ghetto. / Le Duc détourna ses regards avec dégoût de ces usuriers à nez crochu ; mais ses yeux tombèrent, au même moment, sur un groupe de gens habillés en désordre, l'air impudent, les mains énormes, le plastron étalé et cassé, et la barbe de bouc du Yankee. Ils étaient des Américains, et les plus opulents personnages du monde entier, prétendait-on : celui-ci, possédant des puits à pétrole, cet autre, d'immenses bazars, un troisième, des troupeaux de bœufs, et cet autre, court et rougeaud, que l'on surnommait le Commodore, les steamers de l'Atlantique. Tous ces « milliardaires, » visiblement, sortaient de la plèbe du peuple, et Dicky Bennett portait encore de petites boucles d'oreille. Ils avaient dû être là-bas, avant leur brusque enrichissement, gardiens de porcs, flotteurs de bois, pilotes d'une barque marchande, conducteurs de railways, pionniers. Et, rien qu'à les apercevoir, cyniques et vautrés à leur place, on découvrait en eux, du premier coup d'œil, l'arrogance la plus affectée, un orgueil de grossièreté étalé dans tout leur maintien, et un mépris stupide et superbe pour les arts et les élégances de la vieille Europe. (Élémir Bourges, Le Crépuscule des dieux (1884), chap. X ; Stock, 1950, p. 266-267).
. Le Duc vit tout à coup cette multitude infinie de peuples, d'ouvriers et de misérables, comme un abîme immense, d'où allaient s'élever des flots furieux. L'indépendance et l'indocilité entraient par trop d'endroits, dans les sociétés, pour pouvoir être arrêtées de toutes parts. Qu'on bouchât cette eau d'un côté, aussitôt elle pénétrait de l'autre ; elle bouillonnait même, par dessous la terre. Oui ! le temps fatal approchait. Tous les signes de destruction étaient visibles sur l’ancien monde, comme des anges de colère, au-dessus d’une Gomorrhe condamnée. Et ensuite, qu’y aurait-il ? Quel sombre avenir attendait les hommes ? Désormais libres et égaux, sujets de personne, pas même de Dieu, contre qui leurs savants leur créeraient des prestiges, comme les magiciens de Pharaon, ils bouleverseraient la terre par des trous et des mécaniques, pour percer à travers les montagnes, et abréger les continents ; mais, enflés par l'orgueil de la matière, ils en seraient pour ainsi dire crevés. Toute fleur de la vie flétrie, les Grâces réfugiées au ciel, nulle tête ne s'élevant sous le niveau pesant d'une monstrueuse égalité, la terre allait, en peu de temps, devenir une auge immonde, où le troupeau des hommes se rassasierait. (Élémir Bourges, Le Crépuscule des dieux (1884), chap. X ; Stock, 1950, p. 267).
LES OISEAUX S’ENVOLENT ET LES FLEURS TOMBENT
. Floris : « À quoi bon la vie, en effet, s’il n’y a aucun remède à mes maux ? Qu’est-ce qu’un jour ajouté à un jour peut m’apporter de félicité, puisque mon cœur est à un amour sans espoir, puisque jamais je ne posséderai ce que je désire, puisque je ne crois plus en des temps meilleurs ? […] Ah ! il n’y a rien en nous et autour de nous, que des ombres !… La réalité est un songe, que nous faisons les yeux grands ouverts. » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), I, 1 ; Mercure de France, 1964, p. 36).
. Floris : « Qu’appelles-tu être raisonnable ? […] Me résigner, m’accoutumer à la misère et à l’abjection, plier le dos, flatter ceux qui nous gardent ?… La raison ! la raison ! […] Si la raison peut me tirer de cet enfer que nous habitons, me rendre riche, puissant, heureux, et me donner celle que j’aime, alors parle-moi de raison, et je te bénirai… Sinon, tais-toi, et laisse-moi m’arracher les cheveux et me rouler par terre !… » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), I, 2 ; Mercure de France, 1964, p. 51).
. Floris : « Ah ! […] si mon souffle pouvait consumer cette terre, ne laisser sous les pâles étoiles que deux créatures, elle et moi !… Maudites soient les conventions, les hiérarchies, les règles humaines ! Maudit soit l’homme, avec son cœur abject, ses folies, ses infamies, ses injustices !… Que tous les fléaux le dévorent ! Que le sol s’entrouvre sous ses pieds ! Que le feu en sorte et le brûle ! Que les mers déchaînées noient les continents, et qu’il n’y ait plus rien dans l’espace, qu’un globe désert et glacé ! » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), I, 2 ; Mercure de France, 1964, p. 53). 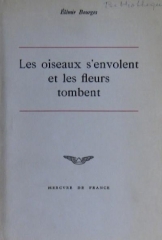
. Vassili Manès : « Qui peut s’assurer, quand il change de fortune, si c’est pour sa félicité ou pour son malheur ? » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), I, 2 ; Mercure de France, 1964, p. 63).
. Floris : « La vraie noblesse de la vie, c’est de n’obéir qu’à soi-même ! » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), I, 3 ; Mercure de France, 1964, p. 77).
. Floris : « Oh ! le monde est un mauvais rêve, et nous ne sommes rien que des ombres. Les plaisirs où nous tendons les mains sont des bulles de savon qui crèvent : ce qui nous suit éternellement sous nos pieds, c’est la terre de notre tombe, la fosse où il nous faut choir un jour ! » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), II, 1 ; Mercure de France, 1964, p. 119).
. Floris : « J’ai encore les mêmes traits que lorsque j’épousai Isabelle, et je n’ai plus la même âme… Oh ! je jurais que cet amour était le fond immuable de mon être, le cœur le plus profond de mon cœur, la flamme même de ma vie. Et après quelques changements dans la position de la lune, je ne trouve plus en moi-même que fragilité et inconstance… Est-ce possible ? En suis-je venu là ?… Et cependant, je sais qu’elle est plus belle, plus aimante, plus vertueuse que la plus rare des autres femmes. Tous les attraits, toutes les grâces exquises, elle les a !… Hélas ! que te faut-il donc pour t’assouvir, cœur vorace et insatiable ? » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), II, 3 ; Mercure de France, 1964, p. 170).
. José-Maria : « N’ayez point de regrets au monde, si l’heure est arrivée d’en sortir. La terre, ma sœur, était pour vous un lieu d’exil. Vous chérissez la solitude, et le monde n’est que multitude ; vous recherchez le silence, et le monde n’est que clameurs ; vous êtes touchée de la vérité, et le monde n’est que mensonges ; vous aimez la pureté, et le monde n’est que corruption. Pourquoi donc souhaiteriez-vous d’habiter encore parmi les hommes ? Quitter la vie, ma sœur, c’est se réveiller d’un songe plein d’inquiétude… Homme superbe, qu’es-tu donc ? Quelle est cette existence à laquelle tu t'attaches si âprement ?… Fils de la femme et pétri de la boue impure de son sang, tu es pareil aux bêtes par tes besoins, comme par tes concupiscences… Qu’es-tu encore ? Un sol stérile, un ténébreux abîme d’iniquités, un enfant de la colère de Dieu, un vase de misère et d’ignominie… Ta naissance est souillée d’ordures ; ta vie est une longue chaîne de souffrances, et ta mort est remplie de frayeurs… Quittez cette terre, ma sœur, abandonnez les voies de ce monde ; déprenez votre cœur des attaches terrestres ; laissez cette vie sans regrets, comme on jette un roseau fêlé qui, loin de nous soutenir, nous percerait la main, si nous voulions nous y appuyer. C’est une vie triste et fragile, une vie inconstante, agitée, sujette à mille vicissitudes, une vie de fantômes et d’illusions, une vie qui n’a rien de réel que ses afflictions et ses peines, une vie que l’on pourrait nommer un enfer déjà commencé, et qui du chaume, du palais, des hameaux, des villes, des solitudes, si diverse qu’elle ait été, aboutit enfin à la mort, comme toutes les eaux de la terre vont s’abîmer dans l’Océan. » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), II, 4 ; Mercure de France, 1964, p. 253-254, et p. 381-382 pour le passage et le bout de phrase supprimés dans la version définitive).
. Une voix : « Que t’ont servi tous ceux qui t’aimaient, tant de cœurs qui portaient ta marque ? Aucun des tiens n’a pris ta place ! Aucun n’a pu venir à ton secours ! » — Une autre voix : « La fin de toutes les fatigues, le carrefour où mènent tous les chemins, c’est un étroit cercueil qui vous renferme. À quoi bon se donner des peines ? Pourquoi courir ? Pourquoi chercher l’avenir ? » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), II, 4 ; Mercure de France, 1964, p. 382 pour ce passage supprimé dans la version définitive qui aurait pris place p. 264).
. Floris : « Quel bourreau se complaît donc là-haut à prolonger l’agonie de ses victimes, et en leur montrant le salut, à les replonger dans la nuit ?… Ah ! nous sommes pour le destin ce que sont les papillons pour les enfants… Ils les torturent, puis les tuent ! » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), III, 1 ; Mercure de France, 1964, p. 303).
. Floris : « Morte ! morte !… On dirait qu’elle dort… Ne se pourrait-il pas […] qu’elle ne fût qu’en léthargie ?… Mais non ! elle a fini sa tâche. Son lit, désormais, est dans les ténèbres. Elle ne verra plus la hideur du jour, ni l’immortel ennui du soleil ! […] Oui, c’est ainsi, c’est bien ainsi que devait se terminer notre voyage ! Ô pauvre fou, qui t’enfonçais joyeusement dans les vapeurs d’or de l’Occident, comme sous un arc triomphal, par où l’on allait aux contrées heureuses, qu’as-tu vu, durant tes longues courses, sinon le Mal universel ? Des peuples nouveaux, grossiers et barbares, d’antiques races en train de disparaître, phtisiques et rongées d’alcool, la lèpre aux îles Hawaï, les prostitutions de l’Océanie. Partout la ruse, la violence, la fraude, le vol, les supplices !… Puis, quand la mer, de vague en vague, nous eut portés au pays des merveilles, à la terre dont le nom seul est un prestige, dans l’Inde rouge et étincelante, les chemins en étaient bordés de fantômes hideux, exténués par la famine, et le vent qui soufflait de la jungle apportait l’odeur des corps pourris. "Ce n’est rien, Altesse, disait l’Anglais : la récolte de riz a manqué cette année…" Et moi, moi comme les autres, je prenais peu de souci de ces maux, jusqu’au jour où tous les fléaux que nous avions vus séparés, Folie, Peste, Famine, Massacre, ont fondu ensemble, pour tenir leur cour, sur le radeau qui nous ballottait, et nous ont soudain accablés. […] Qu’on ne me parle plus d’espérance !… Laisse tes consolations, Manès ; ou, si tu veux m’entretenir, causons de la vieille tyrannie, de la force, de l’esclavage, du sang amer que boit la terre, des soupirs déchirants qui, d’un pôle à l’autre, troublent la sérénité de l’air… Oh ! s’agiter, peiner, lutter, souffrir, toujours souffrir !… Jusqu’à ce que la chair défaille, jusqu’à ce que crève, dans les ténèbres, le frêle globule de vie que nous nous plaisons à nommer notre âme… Souffrir !… Aussi, faire souffrir ! Telle est la vengeance de l’homme. Ce qu’un Dieu inconnu lui inflige, il veut l’infliger à son tour… Les petits sont grossiers et féroces ; les grands, cruels et raffinés… Assez agi ! assez agi, Manès ! N’es-tu pas encore las des pas inutiles où tu as promené ta vie ?… Viens, assieds-toi, près de moi, et disons la sombre histoire de la débile Humanité, puisque ses fils, parmi tant de mers et tant de climats, viennent de passer devant nous : les uns, aussi rampants que la brute, d’autres écrasés de misère, d’autres torturés par la souffrance, d’autres marchepieds d’un maître insolent, les plus heureux, engloutis dans l’opium ; tous, sous la faux de la Mort. Car l’immense roue torturante sur laquelle la Terre roule, et qui nous emporte à travers l’espace, ainsi que ses suppliciés, est couronnée du vieux Crâne aux yeux vides qui guette et ricane, et trône là-haut, se raillant de nos espérances, nous accordant une haleine, un moment, pour jouer notre petite scène, soufflant à nos cœurs la vanité, l’égoïsme, la rancune, l’orgueil ; puis, après s’être ainsi amusé, en finissant d’un seul coup, et abattant sur le sillon sa moisson d’hommes… Josine est morte. Elle est heureuse !… À quoi bon vivre ?… Oui ! à quoi bon, s’attarder entre ciel et terre ? » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), III, 1 ; Mercure de France, 1964, p. 304-305, et p. 382-383 pour les deux passages supprimés dans la version définitive).
. Floris : « Je n’ai pas un mépris assez large pour tout ce qui respire sous le soleil… […] Tout est à vendre !… Tout, tout, tout ! Juges, prêtres, magistrats, sénateurs ! Les lois civiles et les canons religieux ! L’honneur des femmes et l’innocence des vierges !… » […] Oh ! l’ignoble foule des hommes !… Et moi, moi qui déclame ici, moi qui récrimine si haut, n’ai-je pas commis des actions telles ?… Oh ! j’ai horreur d’être homme… » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), III, 2 ; Mercure de France, 1964, p. 315).
. Floris : « Ah ! je pourrais distribuer, maintenant, tout l’or et les trésors de la terre, toutes les perles de la mer, sans me trouver appauvri. C’est le jour où j’ai dû céder à la mort ma sœur, ma mère, Isabelle, Josine, c’est ce jour-là que j’ai perdu mes richesses… Prenez tout, prenez tout, vous dis-je ! Je suis un chêne dépouillé et dont les feuilles tombent au vent d’hiver… Mais quoi !… Vous voilà tout saisis ! Vous avez changé de couleur… Ô Dieu ! Dieu ! c’est donc là ce qu’il faut, pour amener quelque émotion sur la vieille face de l’homme ! Ce visage, dont il a fait l’impassible masque de son cœur, ne s’enflamme ou ne pâlit plus que sous de telles influences… Qui s’étonne aux grandes actions ? Qui paraît encore touché de l’héroïsme et de la magnanimité ?… Mais qu’il vienne à être question du plus pauvre gain, d’un profit sordide, que résonne ce mot magique : de l’or ! alors, la passion saute et rayonne à la face, et l’on voit s’animer soudain ces fantômes automates… Ô Seigneur ! sont-ce là les hommes que vous avez créés à votre image ?… Ceux-ci m’ont secouru, pourtant. Auraient-ils secouru de même un misérable, un pauvre mendiant ?… Bien, bien ! Question inutile !… Ne scrutons pas ! ne scrutons pas ! » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), III, 2 ; Mercure de France, 1964, p. 318, et p. 384 pour le passage supprimé dans la version définitive).
. Floris [en regardant un Juif qui essaye de prostituer sa femme ] : « Que je le regarde ! {…] Oui ! que je voie comment est fait un être si complètement vil !… Et pourtant, rien de monstrueux… Ah ! peut-être que tous les hommes ressemblent de cœur à celui-ci, puisqu’il leur est pareil par la forme. Peut-être sont-ils tous, ainsi que lui, habités par les démons du Vol, de la Cupidité, de la Fraude, du Mensonge… Oui ! qui donc osera se lever, dans l’intégrité de sa conscience, et crier : "Cet homme est un infâme !" S’il l’est, tous le sont ; car qui ne cède à la tentation, qui ne la sollicite, qui ne prostitue, sinon sa femme, du moins ses pensées, son âme, ses sentiments, son intelligence ?… Prostitution ! prostitution !… Tu avais raison, Vassili. Il n’y a que celà dans le monde ! Le cuistre prostitue sa science, l’homme de génie son génie, le prêtre son Dieu, à l’imbécile cousu d’or… Prostitués, entremetteurs ! Voilà toute l’humanité !… » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), III, 2 ; Mercure de France, 1964, p. 328, et p. 385 pour le passage supprimé dans la version définitive).
. Floris : « Silence ! je connais tes mensonges !… Je sais quelle découverte l’on a faite à Isgaour, et pourquoi tu voulais ce domaine… N’importe ! Je te le donne, parce qu’il n’est pas un seul être au monde que je méprise autant que toi ! Au vil ce qu’il y a de plus vil !… Cette richesse que je mets dans tes mains sera, pour des milliers d’hommes, une source de calamités… Sois sans pitié envers ton débiteur ! C’est un fripon… Ruine la veuve ! Elle n’avait épousé son mari que pour des robes ou de l’argent… Que le sourire des enfants ne t’attendrisse pas ! Ils grandissent pour être des coquins, des usuriers, des faussaires… Pressure le pauvre ! c’est un envieux… Lèche la poussière devant le riche ; et ruiné, crache-lui au visage !… Abjure toute émotion ! Moque-toi de ce que les niais appellent honneur, vertu, probité… Soigne ton or, couve ton or ! Et fais-le, de jour en jour, pulluler, afin de pouvoir te montrer sans risques, plus abject, plus fourbe, plus insolent, plus infâme encore que tu ne l’es ! Tu as raison, tu as raison ! Puisque les hommes ont choisi un tel symbole pour l'adorer, puisque d'une souille à truies l'or peut faire un temple, puisqu'il confère à un lépreux le respect public et l'admiration, profites-en ! oui ! vole, attire, absorbe tout l'or du monde, toi, avec tes frères d'Israël !… Continuez d'être ce que vous êtes, d'immondes vers fourmillant dans nos entrailles !… C'est pour vous que les nations s'engraissent, pour vous que les arts et tous les métiers travaillent et suent !… Parasites abjects, épuisez la terre ! Devenez des rois à votre tour ! Courbez les peuples sous le joug de vos lourdes machines de fer ! Corrompez, empoisonnez l'âme humaine ! Que le culte de l'or remplace les religions, les dieux abolis !… Puis, lorsque vous posséderez tout, quand les richesses de l'univers ne formeront plus qu' une pyramide, au sommet de laquelle trôneront quatre ou cinq Juifs, alors enfin, vous les esclaves, les misérables, révoltez-vous !… Viens, mort ! Souffle, esprit de vertige ! Que l'horreur, le deuil, la folie, le meurtre, la destruction se déchaînent sur le globe, bouleversent tout, ruinent tout !… Adieu ! Mon dernier vœu, s'il te naît un fils, c'est qu' il puisse te ressembler !… Va-t’en ! va ! ôte-toi de mes yeux… Que je ne te revoie jamais ! » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), III, 2 ; Mercure de France, 1964, p. 328-329, et p. 385 pour les deux passages supprimés dans la version définitive).
. Floris : « Ah ! si l’on connaissait d’avance […] les trahisons, les dérisions du sort ! Ou si, du moins, notre misérable cœur ne se laissait toujours duper à l’illusion du bonheur !… Mais aucun homme, sans cet espoir, ne voudrait poursuivre sa route… Non ! l’on se coucherait par terre, pour y rester immobile et y mourir… Le bonheur, […] le bonheur, qui donc le possède ? Entre tous ceux que j’ai connus, que j’ai aimés, qui donc eût pu se dire heureux ?… […] Ainsi, quelque route qu’on prenne, c’est à l’abîme qu’elle nous jette. Volupté, vertu, joies maternelles, amour, dévouement, jeunesse, beauté, tous ces mots qui semblent si superbes, le Destin railleur ne s’en sert qu’à composer des histoires tragiques, des contes de mort, de cœurs brisés, de calamités, de longues souffrances !… Plaisirs de la vie, qu’êtes-vous ? Rien que les heures sans fièvre des fiévreux ! Un court répit pour mieux endurer la peine… Oh ! dans quel charnier ténébreux, dans quel cimetière d’ombres vit la débile Humanité ! En chancelant, nous poursuivons à tâtons les feux follets qui y voltigent, avec l’espoir que ces guides sinistres vont nous conduire au bonheur… […] Oui, partout la dérision, le mensonge !… Parmi tant de millions de cœurs qui battent, dans cet univers, l’instant où nous sommes, un seul connaîtra-t-il le bonheur ? Tous, nous tendons vers lui nos bras suppliants, et le bonheur n’est nulle part… Mot vain et sonore, qui ne répond à aucune réalité, urne sans fond où nos désirs s’épanchent, mirage non moins fabuleux que ces palais qu’on voit dans les nues !… Il n’y a pour l’homme aucun refuge ! non, pas un seul ! Tout ce que son cœur lui suggère, lui ment. Tout ce qu’imagine son esprit, lui ment encore… L’art ? Mais n’ai-je pas vu Giano, tout fanfaron qu’il fût de lui-même, pleurer de rage et se désespérer ? Il jetait ses pinceaux impuissants, il martelait sa cire rebelle, jurant cent fois de renoncer à cet exécrable supplice… Dailleurs, quel niais serait l’homme, quel automate et stupide marmot, s’il suffisait, pour le contenter, de deux ou trois couleurs éclatantes, de sons, de mots cadencés, de la blancheur d’un marbre taillé ?… Non, non ! L’art ne le donne pas, ce bonheur sans cesse convoité… Le trouve-t-on dans la science ?… Mais Vassili semble-t-il heureux, lui, le railleur au cœur glacé, le sceptique à force de savoir ? Est-ce le bonheur que d’avoir en tête quelques chiffres, quelques termes grecs, des nomenclatures, des formules ! Est-ce le bonheur que de ramper aux pieds d’une Figure géante, voilée d’une vapeur ténébreuse, qu’on ne dissipera jamais !… Que reste-t-il ? La piété, la foi ?… Ah ! qui ne voudrait, en effet, si la chose dépendait de notre choix, s’humilier, se renoncer soi-même, se sentir comme un enfant, mené par une main invisible, croire, s’abandonner à Dieu… Croire !… Mais peut-être douter… Oui ! là est l’écueil… Et alors, quelles terreurs, quels tourments, quel enfer toujours ouvert en notre âme !… Ah ! maintenant, je la comprends trop bien, la pâleur de José-Maria, sa détresse solitaire et farouche… Oui, que sont les autres souffrances, vaines et futiles comme la vie, au prix de celle-ci, où se débat pour nous l’éternité !… Ainsi, l’Art a pour son salaire l’impuissance ; la fin de la Science, c’est le scepticisme ; le fond de la Foi, c’est le doute !… Quoi donc alors ? Subir le sort ? Obéir à ces pédants de sagesse qui prescrivent, pour unique remède, d’aveugler son cœur et ses yeux, de n’avoir nul désir, afin d’ôter par là toute prise à la fortune, d’être tel qu’un cadavre vivant… Mais quel homme se résignerait à mourir avant le tombeau ?… C’est ainsi que, d’espoirs en espoirs, d’heure en heure pour ainsi dire, toujours déçus, toujours persévérants, nous arrivons à la dernière ; et poursuivant jusque par delà, notre rêve de félicité, nous nous plaisons encore à croire que cette porte mystérieuse est le seuil de quelque paradis, et que de notre pourriture va s’exhaler enfin la blanche étoile de l’immuable et éternelle Joie ! » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), III, 2 ; Mercure de France, 1964, p. 330, et p. 385-387 pour le long passage supprimé dans la version définitive).
. Floris : « Non ! le bonheur n’existe pas. Plus qu’aucun homme, j’ai le droit, peut-être, de l’attester hautement ! Plus qu’aucun, j’en suis la vivante preuve, un témoin, un exemple fameux, qu’on pourrait raconter aux enfants, et leur montrer dans les syllabaires. Car, en quelques brèves années, j’ai joué, aux deux bouts de la fortune, les personnages les plus divers de cette tragédie du monde. L’inexécutable miracle que souhaitent en leurs vœux tous les hommes, s’est subitement accompli pour moi. Des torrents de sang ont coulé, Paris a brûlé comme Sodome, les cimetières ont été gorgés de morts, et de ce chaos de désastres, de hasards, de bouleversements, de cette sorte de loterie immense et sinistre, un seul gain est sorti : le mien !… Moi seul, j’ai fait contrepoids, dans la balance dérisoire où le destin pesait les hommes, aux efforts d’un peuple soulevé, aux aspirations séculaires, aux rêves, aux utopies de bonheur, à l’innombrable armée des misérables, à tous ceux qui souffrent sur la terre et qui voudraient ne plus souffrir… Oui ! le rêve universel des êtres s’est réalisé pour un seul… Pauvre, je suis devenu riche… Torturé d’amour, celle que j’aimais, pâle déesse inaccessible, est descendue jusqu’à moi… J’ai marché tout vivant dans un prodige. J’ai habité le palais enchanté, l’île heureuse qui fuit toujours… Et c’est au sein du bonheur même, que j’ai été le plus malheureux !… Pourquoi ? Ah ! par le vice naturel de notre cœur, sans nulle cause extérieure, par la fatalité qui pèse sur tout ce qui est humain et terrestre… Et maintenant, malade, hanté de spectres, lourd de remords, de douleurs, de crimes, sorte de tombe de moi-même, qu’ai-je à faire qu’à chercher enfin le soulagement suprême, la mort, l’anéantissement ? » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), III, 2 ; Mercure de France, 1964, p. 330).
. Vassili Manès : « Ne disons pas de mal des marchands, Monseigneur. S'ils pratiquent le dol, la fraude, la tromperie, le mensonge, c'est du moins par un accord public, et l'on pourrait presque hasarder le mot, qu'ils volent de bonne foi… Les paysans sont des bêtes farouches ; les ouvriers, avec leur turbulence, leur sottise, leur scurrilité, des singes adroits et malfaisants : le civilisé commence au marchand… » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), III, 2 ; Mercure de France, 1964, p. 332).
. Vassili Manès : « Le Code, Monseigneur, peut se comparer à cette étroite peau de bœuf, où la Reine antique trouva, la découpant en minces lanières, l'emplacement de toute une ville. De même, l'office du juge est d'étirer les lois si souplement, qu'elles puissent suffire et cadrer à l'infinie diversité des contestations et des querelles… […] La justice, l'équité, chimères ! Ce que nous appelons de ce nom n'est rien autre qu'un simulacre, un vain fantôme, une Allégorie, que les hommes, pour le trompe-l'œil, font plafonner au-dessus d'eux, avec la balance et le glaive… […] Tant nous savons que ce fracas de droiture n'est que comédie, nos décisions sont forcément hasardeuses et erronées, qu'il ne peut y avoir de justice !… Et, en effet, où se trouverait- elle ? Est-ce dans le droit positif ? Mais il varie selon les temps et les pays, chaque peuple accommodant ses lois à son humeur, à ses intérêts, à ses préjugés, à son caprice… Est-ce au fond de notre conscience, dans ce que l'on nomme le droit naturel ? Soit ! mais que l'on prouve d'abord si ce sentiment, prétendu divin, que nous croyons avoir de la justice, n’est pas, au vrai, tout simplement la crainte égoïste de l'injustice, du dommage que nous pourrions recevoir. Or, par malheur, les hommes, jusqu’ici, n'ont conclu de pactes d'équité que les uns à l'égard des autres, et lorsqu’ils ont à peu près même force. » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), III, 2 ; Mercure de France, 1964, p. 334-335).
. Floris : « Ainsi, […] ce triste monde n'est donc fondé que sur des mensonges ! » — Vassili Manès : « Il est vrai […] que le perpétuel désaccord en surprendrait davantage, si ce n'étaient les opinions et les mœurs qui forment la raison et non la raison les opinions. Tout est plein de folie, Monseigneur, d'absurdités, de contradictions. On bafoue un pauvre berger qui aura marmotté quelques mots bizarres, pour désenfler sa vache malade. Mais qu'un autre sorcier, en habit doré, fasse Dieu et le mange quotidiennement, moyennant sept à huit syllabes de latin, nous nous écrions : O altitudo ! et voilà un sublime mystère !… Le monde entier est une farce, Monseigneur. Tous ces grands piliers de l'État, le savant, le juge, le prêtre, des baladins, des masques, des masques !… Que dire encore du soldat, stupide automate pendant la paix, assassin légal pendant la guerre, pillant, violant, tuant, torturant, et se composant de la renommée et des vertus, avec des crimes ?… » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), III, 2 ; Mercure de France, 1964, p. 335-336).
. Vassili Manès : « De même que la main d’un enfant peut mouvoir des roues colossales, ainsi le vaste et séculaire équilibre où les affaires de l'État sont les unes à l'égard des autres, en rend le maniement aisé, et le succès fatal, quel qu'il soit… Les événements nous conduisent, bien plus que nous ne menons les événements. La plupart des choses du monde se font par elles-mêmes, croyez-moi. […] Quel génie suffirait à prévoir les innombrables cas fortuits qui se rencontrent dans toute entreprise ?… C'est par acquit qu'on y emploie la délibération et le conseil ; puis, la fortune souveraine prononce. […] On s'avise des dangers probables, et l’on ne voit pas les certains. D’ailleurs, par quoi le monde juge-t-il de l'habileté et du génie ? Uniquement par le succès. Heureux, on acclame le grand homme ; vient-il à échouer, on l'outrage… […] Jusque pour les martyrs et les saints, le succès est la pierre de touche ; on y éprouve leur auréole. […] Le succès est tout, Monseigneur, et cependant que prouve-t-il ? Rien… Il dépend des endroits, du temps, des circonstances. Le génie du triomphateur en est la plus petite pièce, moins importante, assurément, que la faiblesse ou l’imbécillité de l'adversaire qu'il a devant lui. » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), III, 2 ; Mercure de France, 1964, p. 336-337).
. Vassili Manès : « Tantôt, comme au temps où nous sommes, elle renonce à ses rêves célestes, et plaçant sur la terre même les pays de félicité, jure que seule, elle va suffire à se faire son paradis. C'est ce que ce siècle, en son jargon, appelle le progrès, Monseigneur ; c’est la charnelle religion que scribes et savants intronisent. La foi est devenue terrestre et, au nom du génie humain, nous promet, pour les temps à venir, un millénium de bonheur… Vaine chimère ! Espoirs plus enfantins que ceux que l’on fondait autrefois sur une promesse divine, sur une parousie du Christ, après laquelle commencerait le règne triomphant des élus… Le progrès ! Ha ! ha ! le progrès !… Comme si l’homme pouvait jamais faire autre chose qu’assouvir les mêmes appétits ! Du jour où il a commencé de manger quand il avait faim, et de s’accoupler avec sa femelle, son destin s’est trouvé fixé. Un Hottentot, sous sa hutte de feuilles, ne remplit pas moins tout son sort, qu’un rajah, dans son palais de marbre. Deux ou trois besoins font notre limite : manger, dormir, se reproduire. » — Floris : « […] Votre assertion est un peu forcée. La manière dont on satisfait ces appétits a bien aussi quelque importance. » — Vassili Manès : « […] Pure question d’habitude ! Si la vie sauvage paraît âpre et rude au civilisé, le sauvage se meurt dans nos villes : et quant à ces raffinements que vous estimez si précieux, les délices imaginaires en dépendent uniquement de la prévention et du caprice. Qui donc se trouve à plaindre aujourd'hui de n'être pas couché en soupant ? […] Sérieusement, sommes-nous malheureux d’ignorer tout ce qu’inventeront les âges futurs, et de n’en pouvoir jouir ? Pas plus que les anciens de n’avoir point connu nos mécaniques utilitaires… […] Si le progrès n’était pas une chimère, un mensonge, une utopie d'ingénieur, une déclamation d’écrivain, si l’homme, véritablement, ainsi que le prétend notre orgueil, se rapprochait d’un but idéal et se voyait tout près de l’atteindre, ce perfectionnement se marquerait d'abord dans les esprits et dans les mœurs, et non par la consommation croissante de la vapeur d’eau. » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), III, 2 ; Mercure de France, 1964, p. 339-340).
. Vassili Manès : « Jusqu’aux idées, jusqu’aux doctrines passent, tour à tour, d'un parti à l'autre ; on soutient des mêmes arcs-boutants les édifices les plus divers. Le dogme de Quatre-vingt-neuf, cet axiome fondamental des sociétés de notre temps, qu’au peuple seul appartient la souveraineté des États, que l’autorité des sujets l’emporte sur celle du roi, eh bien ! mais, Monseigneur, c'était une opinion enseignée, reçue, mise en pratique dans toutes les communions chrétiennes, et dont les jésuites spécialement s’étaient faits les défenseurs… Le plus catholique des lieux communs ! Oui, voilà ce qui est sorti de ce sublime livre à sept sceaux de la Révolution française, ouvert au milieu de tant de trompettes, de tonnerres, de tremblements de terre ! La mort de Louis XVI a eu lieu, en vertu des mêmes principes qui avaient armé Jacques Clément, Balthazar Gérard, Ravaillac. La théorie et les maximes reprochées avec horreur aux jésuites sont celles mêmes qu’on applique dans la démocratie triomphante, si bien que la Révolution… ha, ha, ha ! se trouve avoir pour mère le Gesù ! » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), III, 2 ; Mercure de France, 1964, p. 341).
. Floris : « Vous n’avez donc pas foi, Manès, aux destinées de la Démocratie ? » — Vassili Manès : « Qu’entendez-vous par là, Monseigneur ? La chute prochaine des rois ? L’avènement des Républiques ?… Peuh ! république ou monarchie, la pièce est la même sous d’autres masques… L’accession des foules au pouvoir ? Mais le suffrage universel, tel qu’il se pratique actuellement, en France et aux États-Unis, est précisément un leurre, une attrape, une duperie merveilleuse à fasciner les yeux des niais, un tour subtil de gobelet pour dépouiller la plèbe de ses droits et les lui filouter à sa barbe. La belle avance, n’est-ce pas ? que la volonté qui gouverne soit celle d’un tribun et non pas d’un roi, que la caste privilégiée ne s’appelle plus la noblesse, mais la majorité de la Chambre, et que le peuple soit souverain, puisqu’il lui faut céder son pouvoir !… Souverain ! Ha, ha, ha ! souverain !… Un plaisant souverain, ma foi !… Un souverain de liards et de guenilles ! Son trône est un siège boiteux, son palais un galetas sordide, son sceptre la navette ou l’outil qu’il manie douze heures par jour, sa couronne la marque au front, le sceau que la mort lui imprime, car la durée moyenne de la vie, pour ce troupeau des misérables, est d’un tiers ou de moitié plus courte que celle des bourgeois et des riches… Non, non, les vrais souverains, Monseigneur, les immortels tyrans de l’homme, ce sont les deux Mammons, les fantômes effrayants, les meurtrières abstractions sorties tout armées de sa cervelle, oui ! le Capital et l'État. Voilà les bergers de nations, les deux monstrueux Polyphèmes, tondeurs, tueurs de leur bétail d’hommes, et qui, jusqu’à la fin des temps, les paîtront sous ces dures houlettes qu’on nomme : impôt, impôt du sang, lois, religions, nationalités. Qui pourrait, en effet, renverser ces colosses d’iniquité ?… » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), III, 2 ; Mercure de France, 1964, p. 341-342).
. Vassili Manès : « L'égalité est l'idéal de l'esprit de l'homme, et l'inégalité, le penchant de son cœur. Le rêve de l'équité n'est qu'un rêve. Le monde est bâti sur la force, en ce siècle dit civilisé, juste autant qu'aux premiers jours du globe. » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), III, 2 ; Mercure de France, 1964, p. 343).
. Vassili Manès : « La plus minime de nos actions est liée à la Roue du monde, aussi indissolublement que le lever quotidien du soleil… Reconnaissons donc, de bonne foi, que le bien et le mal n’expriment que nos façons d’imaginer. Le vieil Adam, persuadé que l’univers était créé pour lui, a nommé le Bien ce qui lui servait, et le Mal ce qui pouvait lui nuire. Son égoïsme a partagé les choses, selon qu’elles l'affectaient […]. Ces grands mots : beauté, conscience, bonté, héroïsme, sainteté, ne sont rien que les voiles peints dont nous offusquons nos yeux, et sous lesquels on trouve simplement la volupté, l’orgueil, l'intérêt des créatures à deux pieds. Le vice et la vertu sont vides. Des mots sonores, et rien de plus !… Non que je veuille, […] dans le commun usage de la vie, ne pas approuver, ne pas suivre, ce qu’approuve et suit le troupeau vulgaire ; mais c'est l'amer privilège du sage, de pratiquer la vertu sans y croire… » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), III, 2 ; Mercure de France, 1964, p. 352).
. Vassili Manès : « Le Dieu de l’homme, Monseigneur, voulez-vous que je le définisse ? C’est l'homme s'adorant soi-même. L’esprit humain ne peut se dépasser, pas plus que les eaux ne s’élèvent au-dessus du niveau de leur source. Dans son autolâtrie naïve, l’homme a divinisé son image, donnant à l'Être inconcevable autant de masques et le peignant en autant de couleurs qu’il se sentait de facultés. Tout culte, toute théodicée aboutissent à l’anthropomorphisme. La Sainte Vierge, c'est Dieu femme ; la Trinité, la famille humaine idéalisée ; Dieu lui-même, Père et Seigneur, l’ombre de l’homme. » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), III, 2 ; Mercure de France, 1964, p. 353-354).
. Vassili Manès : « Tout […] est incompréhensible !… L’esprit humain, comme un enfant placé entre la Chimère et le Sphinx, n'a le choix qu'entre deux impossibilités. Il se détermine pour l'une, parce que la doctrine opposée lui paraît plus impossible encore, comme si ce qui est impossible pouvait l'être plus ou moins… Partout, la nuit ; partout, le mystère ! Les dernières idées scientifiques se réduisent à de purs symboles, et non à des notions du réel… » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), III, 2 ; Mercure de France, 1964, p. 356). 
. Floris : « Chose misérable que de vivre ! L'homme est l'esclave de toutes les influences, depuis l'étoile jusqu'à l'homme. En revanche, il est grand d’accomplir l'acte qui tranche d'un seul coup le nœud ardu de la vie, l'acte qui met fin à tous les autres… […] Qui peut mieux s’appeler, en effet, mon ennemi que moi-même ? Quels bourreaux plus cruels avons-nous que nos passions, que nos désirs ?… Un homme élève un tigre ou un lion. Petit, il le caresse, il s’en joue, il prend plaisir à le tenir entre ses bras, jusqu’à l’heure où, devenu grand, le monstre, tout à coup, rompt sa chaîne, et inonde la demeure de sang. Tel est son propre cœur pour l’homme !… Que nous péchions par avarice, par ambition, par luxure, nous seuls causons les maux qui nous arrivent, semblables aux diamants que l’on use avec leur propre poussière… » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), III, 2 ; Mercure de France, 1964, p. 362, et p. 387 pour la phrase finale supprimée dans la version définitive).
. Floris : « Le bonheur est de ne rien savoir ! Tout notre esprit, toute notre âme, ces facultés dont nous sommes si fiers, ne servent qu'à nous donner un sens plus profond du chagrin… » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), III, 2 ; Mercure de France, 1964, p. 363).
. Floris : « J'abandonne la vie sans regret. Je dépouille avec joie ce corps, cette triste argile humaine… Quoi de plus hideux, en effet, que ces chairs rougeâtres et ridées, ces yeux pareils à des pustules et retenus dans la peau, ce ventre impur, ces cuisses, ces jambes, ces pieds qui tiennent ensemble, à la façon d'une machine ? Quoi de plus misérable que cette âme, toujours battue et tourmentée, comme un flambeau exposé au vent ?… Puisque la joie n'est qu’un nom, puisque l’amour n'est qu’une ombre, puisque tout plaisir s’évanouit, puisqu'il n’y a rien que misère, anxiété, illusion, vide, néant, j’ai assez respiré la vie : je m'en vais chercher sous la terre le repos, l’oubli, l’ombre éternelle… D’une seule chose, ô Nature, d'une seule, sois remerciée ! C’est de m’avoir refusé des enfants… Oui, de cela, je te rends grâces ! Ainsi, du moins, je n'ai pas propagé, avec cette flamme de l'être, la douleur, les soucis cuisants, la maladie, la vieillesse, la mort. Mon agonie, comme un miroir affreux, ne m'en montre pas une foule d'autres. Je n'ai pas perpétué ma souffrance, par celle de mes descendants ! » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), III, 3 ; Mercure de France, 1964, p. 366, et p. 387 pour le passage supprimé dans la version définitive).
. Floris : « Mon cœur se trouble […] ; une vague frayeur me saisit… Ô vieille terre coutumière, si ta face peut nous montrer une si terrifiante horreur, quels spectacles nous réserve donc ce pays ténébreux de la mort ?… Qui en connaît les arcanes, en effet ? Quel blême voyageur est venu jurer qu’une fois passé ce seuil obscur, toutes nos douleurs ont pris fin ?… Peut- être les maux que je quitte me sembleront-ils des paradis, au prix de ceux qui m’attendent. Peut-être le corps, ce cachot, n’élargit-il l'esprit frémissant que pour le lancer aussitôt dans un monde hideux de tortures, de spectres, de visions, d'épouvantes, dans des mers de givre et de glace, ou dans des flammes inextinguibles… Je me sens frissonner… Que ferai-je ?… Eh bien, n’est-il pas d’autres lieux au monde ? N’y a-t-il pas des vallées fraîches, des bœufs mugissant à l'aurore, de beaux lacs qui brillent comme un cristal blanc, des bruyères, des cascades, des forêts, et de petites fleurs qui tremblent au vent, avec leur calice chargé de pluie ?… Arrière ! loin de moi, lâches pensées ! Vais-je me laisser de nouveau abuser par l'espérance ?… Quoi ! n'ai-je pas assez souffert ? N'ai-je pas assez longtemps poursuivi d’illusions en illusions, de rêve en rêve, Demain, Demain, puis encore Demain, le souriant, l’insaisissable spectre, à la place de qui je trouvais toujours ce que j’avais fui : Aujourd'hui !… Non, non, viens, souffle, esprit de Mort ! Loin de te craindre, c’est à toi seul que je veux devoir ma délivrance… […] Malédiction sur toute vie ! La souffrance en est l’unique salaire. Malédiction sur les fils d'Adam, sur leurs œuvres, sur leurs folies, sur leurs mensonges ! Fléaux contagieux à l'homme, suspendez vos fièvres au-dessus des cités populeuses, afin que sa société, comme son cœur, ne soit plus que poison !… Maudite soit notre forme éphémère ! Maudits nos yeux qui, en un instant, usent et dévorent tout ce qu’ils voient ! Maudit ce cœur insatiable, où des mondes se perdraient engloutis, et que la mer ne comblerait pas ! Maudites nos prospérités ! Une ombre, une vapeur les dissipe… Et maudits nos chétifs désastres, dont une éponge imprégnée d’eau lave la trace !… Malheur aux nouveau-nés ! Ils sont la hache des parents qui les ont engendrés… Malédiction sur le soleil, puisqu’il sert de miroir aux vivants ! Maudit le Temps, le démon qui nous hante, le colosse toujours debout sur notre toit, son sablier noir à la main, et qui pèse de plus en plus lourdement, avec les années, tant qu’enfin la demeure s’écroule ! Maudits soient les pièges auxquels on se prend, les formes aimables et agréables, les doux contacts, les sons mélodieux, les odeurs et les goûts suaves ! Tout cela est pareil au mirage, à la bulle d’eau, à l’écume… Anéantis-toi, pauvre monde, qui cries vers le ciel tes vœux inutiles, odieux théâtre où tous les êtres jouent un rôle contre leur volonté ! Que le cadran enfin s’arrête, que les ailes fatiguées du Temps tombent de ses épaules, et que l’Éternité proclame : Tout est fini !… […] Ô Néant profond et obscur, c'est de toi que mes lèvres ont soif ! C'est en toi que mes os fatigués voudraient enfin reposer ! La vie est un feu dévorant qui se répand dans une forêt où souffle le vent. Toi, tu es la fraîche caverne qui nous en défend… Oh ! dormir enfin ! ne plus sentir !… N'avoir plus de pensées, plus de rêves, plus de désirs, plus de joies ! N'avoir plus ni pieds, ni mains, ni rien ! » (Élémir Bourges, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent (1892), III, 3 ; Mercure de France, 1964, p. 367-368, et p. 387-388 pour la fin de phrase et le long passage supprimés dans la version définitive).
LA NEF
[à compléter]
CORRESPONDANCE et PROPOS ORAUX
. [à propos du naturalisme :] « N’est-ce pas assez de vivre toute cette saleté ? Faut-il encore la remâcher après l’avoir vomie ? » (Élémir Bourges, propos oral rapporté par Léon Deffoux, Chronique de l’académie Goncourt, Firmin-Didot et Cie, 1929, p. 85-86).
Autres pages de citations en rapport avec celle-ci sur ce blogue : Philosophes [en préparation] ; Historiens et sociologues [en préparation] ; Auteurs grecs [en préparation] ; Auteurs latins [en préparation] ; Auteurs germaniques et scandinaves [en préparation] ; Auteurs non-occidentaux [en préparation] ; Shakespeare [en préparation] ; Écrivains divers du XVIIe siècle [en préparation] ; Penseurs religieux du Grand Siècle : Pascal, Bossuet, Fénelon et les autres [en préparation] ; Chamfort ; Goethe [en préparation] ; Auteurs romantiques français [en préparation] ; Anthologie parnassienne [en préparation] ; Romanciers français 1848-1914 ; Romanciers français de la première moitié du XXe siècle ; Chateaubriand [en préparation] ; Balzac [en préparation] ; Victor Hugo [en préparation] ; Alfred de Musset ; Alfred de Vigny [en préparation] ; Alexandre Dumas ; Théophile Gautier ; Baudelaire ; Flaubert [en préparation] ; Maupassant [en préparation] ; Edmond et Jules de Goncourt [en préparation] ; Émile Zola ; Vallès, Mirbeau, Darien ; Barbey d'Aurevilly [en préparation] ; Villiers de l'Isle-Adam [en préparation] ; Schopenhauer [en préparation] ; Nietzsche [en préparation] ; Oscar Wilde ; Renan et Taine [en préparation] ; Jules Renard ; Anatole France [en préparation] ; Remy de Gourmont [en préparation] ; Paul-Jean Toulet ; Maurice Barrès [en préparation] ; Proust [en préparation] ; Ladislav Klima ; Paul Léautaud ; Louis-Ferdinand Céline [en préparation] ; Montherlant [en préparation] ; Albert Caraco [en préparation] ; Cioran [en préparation], – et la page générale : citations choisies et dûment vérifiées.
_________________________________________
[1] À vrai dire, le même problème se pose pour Le Crépuscule des dieux. En effet, Raymond Schwab, dans la préface de l’édition que j’ai lue (Stock, 1950), nous apprend page XVII que Bourges, perfectionniste infatigable, a très minutieusement revu son texte à l’occasion des rééditions de 1895, 1901 et 1905, y effectuant à chaque fois de nombreuses améliorations, mais aussi taillant des paragraphes et des pages entières, au moins la première fois. L’édition originale n’est pas consultable sur l'internet et, le serait-elle, j’avoue que j’aurais mieux à faire que de la lire pour y repérer tous les passages disparus ensuite. La thèse complémentaire d’André Lebois, qui est une édition critique du Crépuscule, est parue en 1954 chez L’Amitié par le livre sous le titre La Genèse du crépuscule des dieux. Je suppose qu’elle a recensé rigoureusement toutes les variantes du texte au fil des éditions successives. Je l’ai eue en mains il y a bien longtemps, mais je ne la possède pas. Si un jour elle atterrit dans ma bibliothèque, peut-être me permettra-t-elle de sauver de l'oubli quelques phrases bien frappées et bien frappantes…

Écrire un commentaire