DRAMATURGES FRANÇAIS XIXe-XXe SIÈCLES : SÉLECTION D’APHORISMES
12.10.2018
Le théâtre, tout du moins un certain théâtre, est propice aux « bons mots » : il n’est donc pas difficile de trouver des aphorismes dans les textes dramatiques. Après avoir collecté les meilleurs aphorismes des Dramaturges classiques, je propose maintenant ceux des dramaturges français des années 1820 à nos jours. Cependant, beaucoup de dramaturges sont aussi et dabord romanciers ou poètes. S’ils n’ont pas leur page particulière, on les trouvera plutôt sur d’autres pages collectives : Auteurs romantiques français [à paraître] ; Romanciers français entre 1848 et 1914 ; Romanciers français de la première moitié du XXe siècle ; Romanciers français de la seconde moitié du XXe siècle [à paraître] ; Romanciers français contemporains [à paraître] ; Écrivains féminins français XIXe-XXe [à paraître] ; Poètes français modernes [à paraître]. Ne figurent ici que des auteurs qui m’ont paru principalement des auteurs de théâtre – ce que bien sûr on peut contester pour quelques-uns –, et quand bien même ils ne seraient représentés ici que par des citations extraites d’œuvres non théâtrales.
Principaux contributeurs de cette page, directement accessibles d'un clic : Marcel ACHARD (5) ; Arthur ADAMOV (1) ; Jacques AUDIBERTI (2) ; Émile AUGIER (4) ; Henry BATAILLE (10) ; Samuel BECKETT (4) ; Henry BECQUE (49) ; Henri de BORNIER (5) ; Édouard BOURDET (5) ; Jean-Claude BRISVILLE (23) ; Alfred CAPUS (20) ; Casimir DELAVIGNE (23) ; Maurice DONNAY (11) ; Georges FEYDEAU (11) ; Robert de FLERS et Gaston de CAILLAVET (20) ; Robert de FLERS et Francis de CROISSET (5) ; Jean GENET (17) ; Michel de GHELDERODE (2) ; Edmond GONDINET (6) ; Eugène IONESCO (36) ; Alfred JARRY (17) ; Eugène LABICHE (24) ; Henri-René LENORMAND (6) ; Maurice MAETERLINCK (1) ; René de OBALDIA (1) ; François PONSARD (5) ; Emmanuel ROBLÈS (5) ; Edmond ROSTAND (30) ; André ROUSSIN (7) ; Armand SALACROU (5) ; Victorien SARDOU (2) ; Éric-Emmanuel SCHMITT (4) ; Eugène SCRIBE (6) ; Miguel ZAMACOÏS (11).
RENÉ-CHARLES GUILBERT de PIXÉRÉCOURT (1773-1844)
. Tel est le triste sort de tout livre prêté, / Souvent il est perdu, toujours il est gâté. (Guilbert de Pixérécourt, inscription au fronton de sa bibliothèque, selon le témoignage de Charles Nodier et Paul Lacroix dans la préface au catalogue Bibliothèque de M. G. de Pixérécourt, 1838, p. IV).
EUGÈNE SCRIBE (1791-1861) [1]
 . Arthur : « Le jour trop long me fatigue et m’ennuie, / Et je l’abrège de mon mieux ; / Sur les chagrins de cette vie, / Je l’avouerai, j’aime à fermer les yeux. / De cette erreur où le sommeil me plonge, / Pourquoi voudrais-tu me priver ? / Le bonheur n'existe qu'en songe, et je m'endors pour le trouver. » (Eugène Scribe, L'Ennui ou le comte Derfort (1820), acte I, scène 6 ; Œuvres complètes, tome IX, A. Tétot, 1858, p. 24).
. Arthur : « Le jour trop long me fatigue et m’ennuie, / Et je l’abrège de mon mieux ; / Sur les chagrins de cette vie, / Je l’avouerai, j’aime à fermer les yeux. / De cette erreur où le sommeil me plonge, / Pourquoi voudrais-tu me priver ? / Le bonheur n'existe qu'en songe, et je m'endors pour le trouver. » (Eugène Scribe, L'Ennui ou le comte Derfort (1820), acte I, scène 6 ; Œuvres complètes, tome IX, A. Tétot, 1858, p. 24).
. Stanislas : « Un vieux soldat sait souffrir et se taire sans murmurer. » (Eugène Scribe, Michel et Christine (1821), scène 14 ; Œuvres complètes, tome IX, A. Tétot, 1858, p. 204).
. Rémy : « Dans notre état, il faut du temps pour se faire connaître : nous ne jouissons que dans l’arrière-saison ; et quand la réputation arrive… » — Delmar : « Il faut s’en aller ; comme c’est gai ! » (Eugène Scribe, Le Charlatanisme (1825), scène 2 ; Œuvres complètes, tome VI, Imprimerie et librairie générale de France, 1858, p. 182).
. Masaniello et Piétro : « Pour un esclave est-il quelque danger ? / Mieux vaut mourir que rester misérable ! / Tombe le joug qui nous accable, / Et sous nos coups périsse l'étranger ! / Amour sacré de la patrie, / Rends-nous l'audace et la fierté. / À mon pays je dois la vie ; / Il me devra sa liberté. » (Eugène Scribe, La Muette de Portici (1828), acte II, scène 2 ; Œuvres complètes, tome XI, A. Tétot, 1858, p. 37).
. Juliano : « Les belles nuits font les beaux jours ! » (Eugène Scribe, Le Domino noir (1837), acte II, scène 4 ; Œuvres complètes, tome XI, A. Tétot, 1858, p. 229).
. Tâcher d'oublier, c'est encore se souvenir ! (Eugène Scribe, Le Filleul d'Amadis ou les amours d’une fée (1855), chap. XVIII ; Œuvres complètes. Proverbes nouvelles romans, tome 5, E. Dentu, 1874, p. 136).
VIRGINIE ANCELOT (1792-1875) : [Voir page en préparation dévolue aux écrivains féminins]
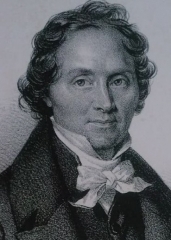 . Procida : « Et tout ce peuple ingrat pour qui je périrai, / S’enivrant du plaisir de compter mes blessures, / Viendra, la joie au front, sourire à mes tortures. » (Casimir Delavigne, Les Vêpres siciliennes (1819), II, 6 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 12).
. Procida : « Et tout ce peuple ingrat pour qui je périrai, / S’enivrant du plaisir de compter mes blessures, / Viendra, la joie au front, sourire à mes tortures. » (Casimir Delavigne, Les Vêpres siciliennes (1819), II, 6 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 12).
. Procida : « Il est de ces instants où l'audace est prudence… » (Casimir Delavigne, Les Vêpres siciliennes (1819), IV, 3 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 18).
. Victor : « L’excès peut tout gâter, tout, même la sagesse. » (Casimir Delavigne, Les Comédiens (1820), III, 11 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 42).
. Victor : « Estimons l’étranger sans rire à nos dépens ; / Aimons les nouveautés en novateurs prudents. » (Casimir Delavigne, Les Comédiens (1820), III, 11 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 42).
. Zarès : « On se plaît aux récit des maux qu'on ne sent plus. » (Casimir Delavigne, Le Paria (1821), III, 4 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 70).
. Alvar : « La loi fût-elle injuste, il la faut respecter. » (Casimir Delavigne, Le Paria (1821), IV, 5 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 74).
. Un brame du chœur : « Mourez, tout doit mourir, et nos saints monuments / S'abîment avec vous, sans laisser plus de trace / Qu’un sillon qui s’efface / Sur un sable mobile ou des flots écumants. » (Casimir Delavigne, Le Paria (1821), IV, 7 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 76).
. Bonnard : « Dans mon gouvernement despotisme complet : / Je rentre quand je veux, je sors quand il me plaît ; / Je dispose de moi, je m'appartiens, je m'aime, / Et sans rivalité je jouis de moi-même. / Célibat ! célibat ! le lien conjugal / À ton indépendance offre-t-il rien d'égal ? » (Casimir Delavigne, L'École des Vieillards (1823), I, 1 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 84).
. Le Duc : « On est moins tolérant pour des goûts qu'on n'a plus. » (Casimir Delavigne, L'École des Vieillards (1823), IV, 3 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 103).
. Danville : « Le ridicule cesse où commence le crime. » (Casimir Delavigne, L'École des Vieillards (1823), IV, 6 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 106).
. Policastro : « Jamais ! c'est long, comtesse, et ce mot à la cour / Nous trompe en politique aussi bien qu'en amour. » (Casimir Delavigne, La Princesse Aurélie (1828), I, 1 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 116).
. Alphonse : « Comme on me traite ! ô ciel ! que d’orgueil ! quels dédains ! / Mon cœur en a saigné ; mais du moins cette injure / Est un remède amer qui guérit ma blessure. / Enfin je n’aime plus : ce serait lâcheté / Que d’adorer encor cette altière beauté. / […] Adieu donc pour jamais, fière et froide Aurélie ! / À de plus grands que soi vouloir plaire est folie : / N'aimons que nos égaux ! Pour qui pense autrement, / L'amitié n'est qu'un piège, et l'amour un tourment. » (Casimir Delavigne, La Princesse Aurélie (1828), I, 6 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 122).
. Aurélie : « Plus le péril fut grand, plus grand est le vainqueur, / Et s’il trouble un cœur faible, il anime un grand cœur. » (Casimir Delavigne, La Princesse Aurélie (1828), III, 7 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 135).
. Sténo : « Le seul abus d'un bien en fait aimer l'usage. / Quoi de plus ennuyeux que vos plaisirs sensés ? » (Casimir Delavigne, Marino Faliero (1829), II, 4 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 159). 
. Israël : « Les traîtres d'aujourdhui sont des héros demain. » (Casimir Delavigne, Marino Faliero (1829), II, 8 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 163).
. Faliero : « Bien choisir l'heure est tout pour le succès des hommes. » (Casimir Delavigne, Marino Faliero (1829), III, 3 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 168).
. Nemours : « Chaque pas dans la vie est un pas vers la mort. » (Casimir Delavigne, Louis XI (1832), I, 9 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 191).
. Nemours : « Comme on croit aisément au bonheur qu'on désire ! » (Casimir Delavigne, Louis XI (1832), III, 10 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 213).
. Louis XI : « Tout pouvoir excessif meurt par son excès même. » (Casimir Delavigne, Louis XI (1832), V, 8 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 227).
. Louis XI : « Faites ce que je dis, et non ce que j'ai fait. » (Casimir Delavigne, Louis XI (1832), V, 15 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 229).
. Louis XI : « Si fort que vous soyez, si grand qu'on vous proclame, / Aimez qui vous résiste et croyez qui vous blâme. » (Casimir Delavigne, Louis XI (1832), V, 15 ; Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 229).
. Glocester : « Et cette indignité / Réussit en raison de son absurdité ! / Plus une calomnie est difficile à croire, / Plus pour la retenir les sots ont de mémoire. » (Casimir Delavigne, Les Enfants d’Édouard (1833), I, 3 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 239).
. Glocester : « Le flatteur qui nous perd est mieux venu souvent / Que l'ami qui nous sauve en nous désapprouvant. » (Casimir Delavigne, Les Enfants d'Édouard (1833), II, 4 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 249).
VICTOR HUGO (1802-1885) : [page spéciale en préparation]
ALEXANDRE DUMAS (1802-1870) : Voir page spéciale
ALFRED de MUSSET (1810-1857) : Voir page spéciale
 . Brute : « C'est peu de songer à détruire, / Si l'on ne songe encor comment reconstruire ; / Et le ressentiment n’opère qu’à demi, / S’il ne sert une cause en frappant l’ennemi. » (François Ponsard, Lucrèce (1843), II, 2 ; dans Œuvres complètes, tome I, Michel Lévy, 1865, p. 80).
. Brute : « C'est peu de songer à détruire, / Si l'on ne songe encor comment reconstruire ; / Et le ressentiment n’opère qu’à demi, / S’il ne sert une cause en frappant l’ennemi. » (François Ponsard, Lucrèce (1843), II, 2 ; dans Œuvres complètes, tome I, Michel Lévy, 1865, p. 80).
. Rodolphe : « On insulte les gens qu'on flatte de travers. » (François Ponsard, L'Honneur et l'argent (1853), I, 3 ; dans Œuvres complètes, tome II, Michel Lévy, 1865, p. 142).
. M. Mercier : « C’est à votre bonheur surtout qu’on doit penser ; / Mais je sais mieux que vous, ma fille, où le placer, / Et comme, en pareil cas, la raison se consulte, / Et non l’emportement des cœurs et leur tumulte. / Un père, qui raisonne, est meilleur conseiller / Qu'un cœur de dix-neuf ans, prompt à s'émerveiller. » (François Ponsard, L'Honneur et l'argent (1853), III, 3 ; dans Œuvres complètes, tome II, Michel Lévy, 1865, p. 192).
. Laure : « Quand la borne est franchie, il n'est plus de limite, / Et la première faute aux fautes nous invite. » (François Ponsard, L'Honneur et l'argent (1853), III, 5 ; dans Œuvres complètes, tome II, Michel Lévy, 1865, p. 200).
. Rodolphe : « Qui vend son cœur, vendra son honneur et sa foi. » (François Ponsard, L'Honneur et l'argent (1853), IV, 6 ; dans Œuvres complètes, tome II, Michel Lévy, 1865, p. 232).
 . Il est rentré dans la vie commune, dans la joie commune, dans le mouvement commun. À mesure que la poésie s’en est allée de lui, il s’est attaché à la terre. La poésie est une rêveuse mécontente, qui se soulève incessamment contre la matière ; dans une société organisée, c’est la pire des choses à mettre en pratique, elle conduit directement au dégoût de ce qui est. (Eugène Labiche, La Clef des champs (1839), chap. XX ; Œuvres complètes, tome I, Club de l’honnête homme, 1966, p. 370).
. Il est rentré dans la vie commune, dans la joie commune, dans le mouvement commun. À mesure que la poésie s’en est allée de lui, il s’est attaché à la terre. La poésie est une rêveuse mécontente, qui se soulève incessamment contre la matière ; dans une société organisée, c’est la pire des choses à mettre en pratique, elle conduit directement au dégoût de ce qui est. (Eugène Labiche, La Clef des champs (1839), chap. XX ; Œuvres complètes, tome I, Club de l’honnête homme, 1966, p. 370).
. Nolis : « Alors, quand j’ai vu que tout-le-monde était de mon avis… j’en ai changé, et je me suis dit : Un instant ! celà n’est pas encore sûr, ne nous pressons pas, il y a peut-être quelque chose là-dessous. » (Eugène Labiche, Auguste Lefranc et Marc-Michel, L’Avocat Loubet (1838), acte II, scène 5 ; Œuvres complètes, tome I, Club de l’honnête homme, 1966, p. 29).
. Zéphirine : « Depuis mon berceau, je marche dans une vallée de larmes. » — Bozonet : « Marcher dans une vallée de larmes, ça doit être bien gênant… surtout quand il fait du verglas. » (Eugène Labiche, Auguste Lefranc et Albert Monnier, Le Lierre et l’ormeau (1840), scène 11 ; Œuvres complètes, tome I, Club de l’honnête homme, 1966, p. 102).
. Rocambolle : « Quand on est jeune, faut rigoler, parce que la vie… suis-moi bien, la vie, c’est comme un panier de prunes… au commencement, en dessus, c’est superbe, c’est frais… pas une tache… alors faut en manger… là, hup !… au milieu y a déjà du déchet… c’est plus si savoureux… pourtant y a encore moyen de mastiquer un peu… Mais au fond !… ah ! mon pauvre vieux ! c’est là que le consommateur est volé !… plus rien ! tout est véreux… une vraie filouterie ! » (Eugène Labiche et Auguste Lefranc, Rocambolle le bateleur (1846), acte I, scène 6 ; Œuvres complètes, tome I, Club de l’honnête homme, 1966, p. 239).
. Pontbichet : « Vous aimez les vaudevilles ? » — Dardard : « Oh ! Dieu ! je les ai en horreur !… c’est toujours la même chose ; le vaudeville est l’art de faire dire oui au papa de la demoiselle qui disait non… » (Eugène Labiche, Un jeune homme pressé (1848), scène 4 ; Œuvres complètes, tome II, Club de l’honnête homme, 1966, p. 4).
. Lucien : « Qu’est-ce qu’on fait ? qu’est-ce qu’on dit ? quel est l’esprit des populations ? » — Le major : « Elles n’en ont pas, Monseigneur. » (Eugène Labiche, Adrien Decourcelle et Jules Barbier, Oscar XXVIII (1848), acte II, scène 3 ; Œuvres complètes, tome II, Club de l’honnête homme, 1966, p. 35).
. Antonin : « On a beau s’casser la tête / Pour fair’des constitutions, / Ôte-toi d’là que j’m’y mette… / C’est l’mot des révolutions ! » (Eugène Labiche et Auguste Lefranc, À bas la famille, ou les banquets (1848), scène 12 ; Œuvres complètes, tome II, Club de l’honnête homme, 1966, p. 108).
. Crevette : « Aujourdhui, 25 février… un gouvernement provisoire vient de se constituer à l’Hôtel de Ville. La France sera libre de choisir le gouvernement qui lui plaira… […] Pourvu que ça soit la République ! » (Eugène Labiche et Eugène Nyon, Rue de l’homme-armé, numéro 8 bis (1849), acte II, scène 1 ; Œuvres complètes, tome II, Club de l’honnête homme, 1966, p. 184).
. Grenouillard : « Je ne vous retiens pas… j’ai quelques notes à écrire pour mon grand ouvrage : Trois jours au pouvoir. » — Chevillard : « Ah ! Monsieur écrit ses mémoires ? » — Grenouillard : « Je n’y suis resté que trois jours, mais je crois y avoir fait de grandes choses !… » (Eugène Labiche et Eugène Nyon, Rue de l’homme-armé, numéro 8 bis (1849), acte III, scène 4 ; Œuvres complètes, tome II, Club de l’honnête homme, 1966, p. 193).
. Saint-Germain : « Ah ! madame, quand on ne travaille pas, le pain qu'on mange est bien amer !… » (Eugène Labiche et Marc-Michel, La Fille bien gardée (1850), scène 1 ; Œuvres complètes, tome II, Club de l’honnête homme, 1966, p. 280).
. Fadinard : « Le dévouement est la plus belle coiffure d'une femme. » (Eugène Labiche et Marc-Michel, Un chapeau de paille d'Italie (1851), acte III, scène 5 ; Œuvres complètes, tome III, Club de l’honnête homme, 1966, p. 85).
. Prunette : « Il se lève tard, très tard, afin, dit-il, de contempler moins longtemps ses semblables… » (Eugène Labiche, Lubize et Paul Siraudin, Le Misanthrope et l'Auvergnat (1852), scène 1 ; Œuvres complètes, tome III, Club de l’honnête homme, 1966, p. 159).
. Chiffonnet : « Veux-tu que je me lie par une parole d'honneur ? » — Machavoine : « Oh ! oh ! les paroles d'honneur… c'est comme la neige… ça fond devant le soleil !… (Eugène Labiche, Lubize et Paul Siraudin, Le Misanthrope et l'Auvergnat (1852), scène 7 ; Œuvres complètes, tome III, Club de l’honnête homme, 1966, p. 163).
. Prunette : « Mais si on se disait toujours la vérité, dans le monde… on passerait sa vie à se dire des injures… » (Eugène Labiche, Lubize et Paul Siraudin, Le Misanthrope et l'Auvergnat (1852), scène 16 ; Œuvres complètes, tome III, Club de l’honnête homme, 1966, p. 171). 
. Octave : « Règle générale : Pour faire une bonne affaire, il faut toujours avoir l’air d’un imbécile !… » (Eugène Labiche et Anicet-Bourgeois, L’Avare en gants jaunes (1858), acte II, scène 3 ; Œuvres complètes, tome V, Club de l’honnête homme, 1966, p. 36).
. Perrichon : « Je vous dois les plus douces émotions de ma vie… Sans moi, vous ne seriez qu’une masse informe et repoussante, ensevelie sous les frimas… Vous me devez tout, tout ! Je ne l'oublierai jamais ! » (Eugène Labiche et Édouard Martin, Le Voyage de Monsieur Perrichon (1860), acte II, scène 10 ; Œuvres complètes, tome V, Club de l’honnête homme, 1966, p. 336).
. Daniel : « Avant d'obliger un homme, assurez-vous bien dabord que cet homme n'est pas un imbécile. » — Armand : « Pourquoi ? » — Daniel : « Parce qu’un imbécile est incapable de supporter longtemps cette charge écrasante qu'on appelle la reconnaissance ; il y a même des gens d’esprit qui sont d’une constitution délicate… » (Eugène Labiche et Édouard Martin, Le Voyage de Monsieur Perrichon (1860), acte IV, scène 8 ; Œuvres complètes, tome V, Club de l’honnête homme, 1966, p. 349).
. Daniel : « Retenez bien ceci… et surtout gardez-moi le secret : les hommes ne s’attachent point à nous en raison des services que nous leur rendons, mais en raison de ceux qu’ils nous rendent ! » (Eugène Labiche et Édouard Martin, Le Voyage de Monsieur Perrichon (1860), acte IV, scène 8 ; Œuvres complètes, tome V, Club de l’honnête homme, 1966, p. 349-350).
. Désambois : « Il y a des circonstances où le mensonge est le plus saint des devoirs. » (Eugène Labiche et Édouard Martin, Les Vivacités du capitaine Tic (1861), acte II, scène 7 ; Œuvres complètes, tome VI, Club de l’honnête homme, 1966, p. 27).
. Magis : « L'amour est un feu… l'estime est un lien ! » (Eugène Labiche et Édouard Martin, Les Vivacités du capitaine Tic (1861), acte II, scène 7 ; Œuvres complètes, tome VI, Club de l’honnête homme, 1966, p. 27).
. Magis : « Pour moi, mademoiselle, l'idéal, dans le mariage, ce n'est pas l'amour ! […] C'est le calme et la contemplation… Quel plus beau spectacle que celui de deux êtres s'isolant dans une affection douce et modérée ! » (Eugène Labiche et Édouard Martin, Les Vivacités du capitaine Tic (1861), acte II, scène 8 ; Œuvres complètes, tome VI, Club de l’honnête homme, 1966, p. 28).
. Gatinais : « Il a pensé beaucoup plus à lui qu'à moi… c'est un égoïste !… » (Eugène Labiche et Adolphe Choler, Un pied dans le crime (1866), acte III, scène 8 ; Œuvres complètes, tome VII, Club de l’honnête homme, 1966, p. 131).
. Caboussat : « Mon ami, il est des injures auxquelles un homme qui se respecte ne doit répondre que par le silence et le mépris. » (Eugène Labiche et Alphonse Jolly, La Grammaire (1867), scène 11 ; Œuvres complètes, tome VII, Club de l’honnête homme, 1966, p. 172).
. Gargaret : « Si tu voyais ma femme ! Un air de candeur… une figure qui respire l’honnêteté… » — Muserolle : « La mienne aussi respirait l'honnêteté… Seulement elle avait la respiration très courte… » (Eugène Labiche et Alfred Duru, Doit-on le dire ? (1872), acte I, scène 14 ; Œuvres complètes, tome VIII, Club de l’honnête homme, 1966, p. 34).
 . Poirier : « Je te dis, moi, que le commerce est la véritable école des hommes d’État. Qui mettra la main au gouvernail, sinon ceux qui ont prouvé qu’ils savaient mener leur barque ? » — Verdelet : « Une barque n’est pas un vaisseau, un batelier n’est pas un pilote, et la France n’est pas une maison de commerce… J’enrage de voir cette manie qui s’empare de toutes les cervelles ! On dirait, ma parole, que dans ce pays-ci le gouvernement est le passe-temps naturel des gens qui n'ont plus rien à faire… » (Émile Augier et Jules Sandeau, Le Gendre de M. Poirier (1854), acte I, scène 4 ; Théâtre complet, tome II, Calmann-Lévy, 1876, p. 234).
. Poirier : « Je te dis, moi, que le commerce est la véritable école des hommes d’État. Qui mettra la main au gouvernail, sinon ceux qui ont prouvé qu’ils savaient mener leur barque ? » — Verdelet : « Une barque n’est pas un vaisseau, un batelier n’est pas un pilote, et la France n’est pas une maison de commerce… J’enrage de voir cette manie qui s’empare de toutes les cervelles ! On dirait, ma parole, que dans ce pays-ci le gouvernement est le passe-temps naturel des gens qui n'ont plus rien à faire… » (Émile Augier et Jules Sandeau, Le Gendre de M. Poirier (1854), acte I, scène 4 ; Théâtre complet, tome II, Calmann-Lévy, 1876, p. 234).
. Mme de la Vieuxtour : « Il a eu sur la charité des pensées si touchantes, si nouvelles ! » — Giboyer : « A-t-il dit qu’il ne faut pas la faire ? » (Émile Augier, Le Fils de Giboyer (1862), acte IV, scène 6 ; Théâtre complet, tome V, Calmann-Lévy, 1877, p. 135).
. Guérin : « On ne doit que la vérité aux absents ». (Émile Augier, Maître Guérin (1864), acte III, scène 6 ; Théâtre complet, tome V, Calmann-Lévy, 1877, p. 267).
. Depuis vingt ans surtout, les cultes étrangers ont fait invasion dans notre littérature ; nos plus francs poètes ont apostasié et ont entrepris de plier l'esprit français aux rites anglais et germaniques. Entreprise téméraire ! L'esprit français, qui a conquis l'Europe, veut bien s'enrichir de ses dépouilles, mais à la manière des Romains qui prenaient leurs dieux aux vaincus en leur donnant des noms latins et en les ajustant au culte de Rome. Le XVIIe siècle a commencé ces victorieux emprunts vis-à-vis de l'Espagne et de l'Italie ; continuons-les avec l'Angleterre et l'Allemagne, mais aussi fièrement que nos pères, et portons nos dépouilles opimes comme des trophées et non comme des livrées. En un mot, restons Gaulois, et que tout ce que nous touchons le devienne. (Émile Augier, « Le Bon sens », dans Le Spectateur républicain, 2 août 1848).
ALEXANDRE DUMAS FILS (1824-1895) : [page spéciale en préparation]
 . Charlemagne : « La noble épée a soif du sang de l’étranger. » (Henri de Bornier, La Fille de Roland (1875), IV, 3 ; Œuvres choisies, Grasset, 1913, p. 88).
. Charlemagne : « La noble épée a soif du sang de l’étranger. » (Henri de Bornier, La Fille de Roland (1875), IV, 3 ; Œuvres choisies, Grasset, 1913, p. 88).
. Élymas : « Leurs dogmes sont encor plus atroces qu'étranges, / Et les Samaritains sont auprès d'eux des anges ! / Lâches au fond : leur chef pleurait quand on le prit ; / Ce chef, qui se faisait appeler Jésus-Christ, / N'était qu'un ennemi de la chose publique, / Un simple malfaiteur. – La preuve sans réplique, / C'est qu'entre deux larrons on dut le mettre en croix. / Ses disciples étaient pires que lui, je crois : / Des gens sans feu ni lieu, nés dans la populace, / Scribes et publicains ayant perdu leur place ; / Des marchands de poisson, des bandits ténébreux, / Qui, pour trente deniers, se dénonçaient entre eux, / Buvant du sang humain à leurs repas infâmes ! / Et les hommes encor valent mieux que les femmes ! » (Henri de Bornier, L’Apôtre (1881), acte I, scène 3 ; Œuvres choisies, Grasset, 1913, p. 198-199).
. Hassan : « Hum ! Le Juif, c'est la lèpre, et le chrétien, la peste, / Et tant qu'il en reste un, c'est l'engeance qui reste. / Ils envahissent tout, ces chrétiens et ces Juifs, / On devrait les chasser, et mieux, les brûler vifs ! » (Henri de Bornier, Mahomet (1890), acte I, scène 2 ; Œuvres choisies, Grasset, 1913, p. 259).
. Mahomet : « Sachez donc que je n'ai de tendresse profonde / Et d'amour que pour l'œuvre immense que je fonde. / […] Pour les hommes pareils à moi, sachez-le bien, / Le péril c'est d'aimer, le reste ce n'est rien ! […] La femme est le plaisir d'un jour ; / Mais l'homme qui lui laisse usurper dans son âme / La place des devoirs austères, Dieu le blâme ! / Aussi, dût quelquefois le sage s'étonner, / Je partage mon cœur pour ne pas le donner ! » (Henri de Bornier, Mahomet (1890), acte II, scène 4 ; Œuvres choisies, Grasset, 1913, p. 281-282).
. Hugonnel : « J’aime à sentir ainsi les haines m’envahir : / Je voudrais croire en Dieu pour pouvoir le haïr ! » (Henri de Bornier, France… d’abord ! (1899), acte III, scène 4 ; Œuvres choisies, Grasset, 1913, p. 547).
 . Flavignac : « Le groupe Fléchinelle s’est trop accentué. […] On sait d’avance comment il votera ; il n’y a plus d’imprévu. » — Marthe : « Tandis que le groupe Lalubize ? » — Flavignac : « Ne se laisse guider que par sa conscience. […] Sa conscience du moment. L’avenir est là. » (Edmond Gondinet, Les Convictions de papa (1877), scène 2 ; dans Théâtre complet, tome III, Calmann-Lévy, 1894, p. 398). [2]
. Flavignac : « Le groupe Fléchinelle s’est trop accentué. […] On sait d’avance comment il votera ; il n’y a plus d’imprévu. » — Marthe : « Tandis que le groupe Lalubize ? » — Flavignac : « Ne se laisse guider que par sa conscience. […] Sa conscience du moment. L’avenir est là. » (Edmond Gondinet, Les Convictions de papa (1877), scène 2 ; dans Théâtre complet, tome III, Calmann-Lévy, 1894, p. 398). [2]
. Flavignac : « J’écris [à mes électeurs] que je ne change pas, parce que je change ; sans celà je n’aurais pas besoin d’écrire. » (Edmond Gondinet, Les Convictions de papa (1877), scène 4 ; dans Théâtre complet, tome III, Calmann-Lévy, 1894, p. 411).
. Flavignac : « Je peux me représenter fièrement devant mes électeurs. J’ai porté mes convictions à gauche, à droite, au centre ; elles sont restées inébranlables ! » (Edmond Gondinet, Les Convictions de papa (1877), scène 12, phrase finale ; dans Théâtre complet, tome III, Calmann-Lévy, 1894, p. 450).
. Valentine : « Les hommes peuvent s’étonner quelquefois – rarement – qu’on les aime, jamais qu’on les admire. » (Edmond Gondinet, Les Tapageurs (1879), acte I, scène 2 ; dans Théâtre complet, tome V, Calmann-Lévy, 1899, p. 365).
. Lucien : « On pardonne trop facilement aux imbéciles ; voilà pourquoi il y en a tant, ça les encourage. » (Edmond Gondinet, Les Grands enfants (1880), acte III, scène 3 ; dans Théâtre complet, tome IV, Calmann-Lévy, 1894, p. 397).
. Fernand : « Comme moraliste, je suis sévère, mais comme homme […], je ne déteste pas la gaudriole. » (Edmond Gondinet, Un voyage d'agrément (1881), acte II, scène 6 ; dans Théâtre complet, tome V, Calmann-Lévy, 1899, p. 86).
 . Flavarens : « Il est bon, là, avec sa proclamation ! Il n’y a qu’un moyen ! une bonne charge de cavalerie ! Demandez plutôt au colonel qui a vu toutes les révolutions de Paris ! » — Boubard : « La charge de cavalerie a du bon, au début, parce que le peuple n’est pas encore sacré. Plus tard, c’est délicat !… » […] — Vintimille : « Comment, sur des séditieux ? » — Boubard : « C’est encore une question d’heure ! J’ai vu à Paris des gens qui étaient des séditieux à midi et qui étaient le gouvernement à quatre heures. » — Carle : « Mais alors, à quoi distingue-t-on une émeute d’une révolution ? » — Boubard : « C’est bien facile ! L'émeute, c'est quand le populaire est battu : tous des vauriens !… La révolution, c'est quand il est le plus fort : tous des héros ! » (Victorien Sardou, Rabagas, acte III, scène 1, Michel Lévy, 1872, p. 107).
. Flavarens : « Il est bon, là, avec sa proclamation ! Il n’y a qu’un moyen ! une bonne charge de cavalerie ! Demandez plutôt au colonel qui a vu toutes les révolutions de Paris ! » — Boubard : « La charge de cavalerie a du bon, au début, parce que le peuple n’est pas encore sacré. Plus tard, c’est délicat !… » […] — Vintimille : « Comment, sur des séditieux ? » — Boubard : « C’est encore une question d’heure ! J’ai vu à Paris des gens qui étaient des séditieux à midi et qui étaient le gouvernement à quatre heures. » — Carle : « Mais alors, à quoi distingue-t-on une émeute d’une révolution ? » — Boubard : « C’est bien facile ! L'émeute, c'est quand le populaire est battu : tous des vauriens !… La révolution, c'est quand il est le plus fort : tous des héros ! » (Victorien Sardou, Rabagas, acte III, scène 1, Michel Lévy, 1872, p. 107).
. Rabagas : « Oh ! mes enfants ! Ne disons pas de bêtises entre nous, n'est-ce pas. Nous ne faisons pas ici un article pour La Carmagnole. La République, ce n'est qu'un mot : ce que nous voulons, c'est un fait ! Le progrès !… c'est-à-dire tout ce que nous n'avons pas ! Et le triomphe du peuple, représenté par le nôtre ! Or le gouvernement qui me donne tout ça… Je me moque bien de son étiquette… Je l'acclame !… J'ai tout ! » […] — Vuillard : « Si les questions sociales !… » — Rabagas : « Mais ne disons donc pas de bêtises entre nous !… Sapristi ! Est-ce qu'il y a des questions sociales ?… Il y a des positions sociales ; et quand on n'a pas les meilleures, il faut les prendre, voilà tout ! » (Victorien Sardou, Rabagas, acte IV, scène 9, Michel Lévy, 1872, p. 188-189).
LUDOVIC HALÉVY (1834-1908)
. Louis-Joseph Martin : « Vous me dites que cette insurrection-là n'était pas légitime… C'est possible, mais je ne sais pas trop pourquoi… Je commence à m'embrouiller, moi, dans ces insurrections qui sont un devoir, et dans ces insurrections qui sont un crime !… Je ne vois pas bien la différence. / […] Il y a des insurrections qui vous plaisent. Vous leur élevez des colonnes, vous leur donnez des noms de rues, vous vous distribuez les places, les grades, les gros traitements, et, nous autres, qui avons fait la révolution, vous nous appelez : grands citoyens, héros, peuple de braves, etc, etc. C'est avec cette monnaie-là qu'on nous paye. / Et puis, il y a d'autres insurrections qui vous déplaisent. À la suite de celles-là, vous nous distribuez l'exil, la déportation, la mort. Eh bien, voyez-vous, si vous ne nous aviez pas fait tant de compliments après les premières, nous n'aurions peut-être pas fait les dernières. Si vous n'aviez pas élevé la colonne de Juillet à l'entrée de nos faubourgs, nous ne serions peut-être pas allés démolir la colonne Vendôme dans votre quartier. » (Ludovic Halévy, Monsieur et Madame Cardinal, 11. « L’insurgé » (septembre 1871), Calmann-Lévy, 1889, p. 241-242).
. Boislambert : « J’ai été l’amant de Marguerite pendant vingt-deux mois, j'ai été son portier pendant cinq minutes, eh bien, il me semble que j'en ai beaucoup plus appris sur elle, en étant son portier pendant cinq minutes, qu’en étant son amant pendant vingt-deux mois ! » — Mitaine : « Jugez un peu, monsieur, jugez ce que vous auriez appris si vous aviez été son amant pendant cinq minutes et son portier pendant vingt-deux mois. » (Henri Meilhac et Ludovic Halévy, La Mi-carême (1874), scène 21 ; dans Théâtre, tome III, Calmann-Lévy, 1900, p. 390-391).
ÉDOUARD PAILLERON (1834-1899)
. Madame Castelli : « C’est toujours la même chose ! Éros, Cupido, Amor, chez les anciens ; chez nous, celà s’appelle une toquade, parfaitement. […] Mais qu’on l’appelle comme on voudra, c’est toujours par une sottise que celà commence, et par un remords que celà finit… L’amour ? Eh ! laisse-moi donc avec ton amour ! Des grands mots avant, des petits mots pendant… et des gros mots après ! » (Édouard Pailleron, Petite pluie (1875), scène 9 ; Calmann-Lévy, 1881, p. 24).
 . Mme de Saint-Genis : « C'est très joli, l'amour, très vague et très poétique, mais une passion, si grande qu'elle soit, ne dure jamais bien longtemps et ne conduit pas à grand-chose. Je sais ce que je dis. On ne paie pas, avec cette monnaie-là, son propriétaire et son boulanger. » (Henry Becque, Les Corbeaux, acte III, scène 11, Tresse, 1882, p. 114).
. Mme de Saint-Genis : « C'est très joli, l'amour, très vague et très poétique, mais une passion, si grande qu'elle soit, ne dure jamais bien longtemps et ne conduit pas à grand-chose. Je sais ce que je dis. On ne paie pas, avec cette monnaie-là, son propriétaire et son boulanger. » (Henry Becque, Les Corbeaux, acte III, scène 11, Tresse, 1882, p. 114).
. « La liberté et la santé se ressemblent ; on n'en connaît bien le prix que lorsqu'elles vous manquent. » (Henry Becque, Souvenirs d’un auteur dramatique (1895), 18. « Les jeunes gens » ; dans Œuvres complètes, tome VI, G. Crès, 1926, p. 107).
. Le meilleur souvenir que garde une femme d’une liaison, c’est l’infidélité qu’elle lui a faite. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 109).
. Quand tu ouvres ta porte, c’est un ennemi qui entre. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 109).
. Défends-toi, défends-toi de toi-même et des autres. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 109).
. Toutes les idées sont justes, toutes les bouches sont fausses. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 110).
. La femme et l’homme vont ensemble comme la chaîne et le boulet. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 110).
. L’homme vraiment bien élevé vit chez sa maîtresse et meurt chez sa femme. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 110).
. Il est bien difficile de dire si l’homme naît méchant ou s’il le devient tout-de-suite. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 110).
. Le déluge n’a pas réussi ; il est resté un homme. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 111).
. Le malheur de l'égalité, c'est que nous ne la voulons qu'avec nos supérieurs. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 111).
. Personne n’a jamais compris personne. On n’a pas le temps d’observer les autres, on n’a pas le temps de les entendre, on n’a que le temps de les blâmer. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 111).
. En vieillissant, on s’aperçoit que la vengeance est encore la forme la plus sûre de la justice. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 112).
. Parlez-moi d’une souffrance qui se cache et reste ignorée. C’est celle-là que je voudrais secourir. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 112).
. Les grandes fortunes sont faites d’infamies ; les petites, de saletés. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 112).
. Vivent les honnêtes gens ! ils sont encore moins canailles que les autres. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 112). 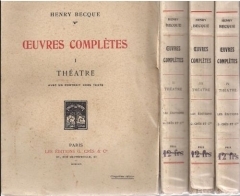
. Il faut peut-être entendre par démocratie les vices de quelques-uns à la portée du plus grand nombre. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 112).
. Nous nous plaignons de la calomnie et nous avons tort ; elle sert à nous défendre de choses qui sont fausses et d’autres choses qui sont vraies. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 113).
. Si vous vivez dans la retraite, vous aurez tout-le-monde contre vous. Les hommes exigent qu’on participe à leurs faiblesses, et les femmes ne pardonnent pas qu’on échappe à leur domination. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 113).
. En vieillissant, nous perdons nos qualités : nous n’en gardons que l’habitude. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 114).
. Il n'y a que deux manières de parler des autres : ou d'en dire du bien, ou d'en dire du mal. Notre intérêt nous conseille d'en dire du bien. La vérité veut que nous en disions du mal. Mais soyez certains que vous regretterez un jour et le mal et le bien que vous en aurez dit. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 114).
. Les hommes diffèrent entre eux de mille manières : par la puissance et par l’éducation ; par la position ; par l’âge, le caractère, le mérite, les opinions, les goûts, etc. Ils se ressemblent tous dans leurs rapports avec leurs semblables : ils sont ignobles. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 114).
. C’est un grand repos de vivre toujours avec les mêmes gens : on sait qu’ils vous détestent. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 114).
. Il y a deux époques dans la vie d'un écrivain : la première où l'on parle de lui, la seconde où il en parle lui-même. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 115).
. La moitié de ce que nous écrivons est nuisible ; l’autre moitié est inutile. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 115).
. On ne reproche à un homme faible que sa faiblesse avec les autres. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 115).
. Nous promettons avec nos espérances, et nous tenons avec nos déboires. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 115). [3]
. Les réconciliations ont un intérêt tout spécial et qu’il faut savoir apprécier. Ce sont des rechutes légères dont on revient complètement guéri. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 115).
. Ce ministre qui ne me recevait pas lorsqu’il était au pouvoir se plaint que je l’abandonne depuis qu’il est tombé. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 115).
. On admire le talent, le courage, la bonté, les grands devoirs et les grandes épreuves ; on n’a de considération que pour l’argent. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 116).
. Eh, oui, oui ! on s’épouse sans se connaître. Vous voulez donc qu’il n’y ait plus de mariage ? (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 116).
. L’homme le plus honnête est un scélérat dans son ménage et dans sa profession. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 116). 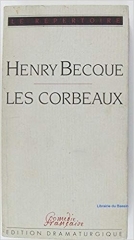
. On trouve bien peu d’esprit à celui qui se moque de nous. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 117).
. L’homme connu n’a pas assez de réputation ; l’homme célèbre n’a pas assez de gloire ; et le grand homme, qui a la gloire, ne l’a pas à lui seul. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 117).
. Que de choses il faut pour retenir l’homme : la religion, l’autorité, l’opinion publique, ses devoirs, ses intérêts, sa conservation, son repos ! / Et il n’est pas retenu du tout. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 117).
. La civilisation nous donne des lumières plutôt que des vertus. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 117).
. La vie est bien courte, lorsqu’on approche de la fin. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 118).
. La décision est souvent l’art d’être cruel à temps. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 118).
. Je suis toujours surpris de voir la morale occuper tant de place dans nos écrits et dans nos conversations. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 119).
. La morale n’est peut-être que la forme la plus cruelle de la méchanceté. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 119).
. Tout s’explique et rien ne se justifie. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 119).
. La vie est une œuvre d’art très difficile, et c’est déjà beaucoup que d’en réussir quelques parties. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 119).
. À y regarder d’un peu près, le salon d’une grande dame ne diffère pas sensiblement d’une loge de concierge. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 120).
. Je répète constamment à mes confrères que nos œuvres ne dureront pas : ils ne veulent pas me croire. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 120).
. Les économistes nous conseillent l’épargne ; les financiers viennent derrière eux et la raflent. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 120).
. Les hommes se plaignent de l’injustice et des abus jusqu’à ce qu’ils se soient créé une force ; dès que cette force est entre leurs mains, ils la font servir à l’injustice et aux abus. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 120).
. Voilà la question : passer du camp des exploités dans celui des exploiteurs ; toute la question est là. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 120).
. Il ne faut pas voir ses amis, si l’on veut les conserver. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 121).
. Nous sommes trop imparfaits pour inspirer de grands sentiments, et surtout pour les éprouver. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 121).
AUGUSTE de VILLIERS de L’ISLE-ADAM (1838-1889) : [page spéciale en préparation]
JULES CLARETIE (1840-1913)
. Les femmes fatales sont très rares. Je ne vois pas qu'elles aient tué ou ruiné des gens de génie. Dalila est une exception. Dans ce genre de bataille, je ne compte guère de vaincus que les niais. (Jules Claretie, La Vie à Paris. 1896, 24 mai 1896, G. Charpentier et E. Fasquelle, 1897, p. 26).
OCTAVE MIRBEAU (1848-1917) : Voir page spéciale
GEORGES de PORTO-RICHE (1849-1930)
. Béhopé : « Si on ne mentait pas, l’existence ne serait pas possible. » […] — Bracony : « Le mensonge adoucit les mœurs. » — Mariotte : « Tous, nous lui devons des moments agréables. » […] — Béhopé : « Sans lui, nous serions la proie des raseurs et des méchants. […] La franchise est un révolver qu’on n’a pas le droit de décharger sur les passants. » […] Mariotte : [Le mensonge n’est] « pas si laid que ça, car il cache plus de vilaines choses qu’il n’en montre. » — Bracony : « C’est la vérité qui est laide. » — Béhopé : « La meilleure preuve, c’est que, pour accabler quelqu’un, on n’a qu’à lui jeter la vérité au visage. » (Georges de Porto-Riche, Le Passé, acte I, scène 5, Paul Ollendorff, 1898, p. 67-70).
ALFRED CAPUS (1857-1922) [4]
 . Ramel : « On dit toujours d’un coquin qu’il est très intelligent, comme on dit toujours d’un honnête homme qu’il est un imbécile. » (Alfred Capus, Mariage bourgeois (1898), acte I, scène 7 ; dans Théâtre complet, tome 3, Fayard, 1910, p. 24).
. Ramel : « On dit toujours d’un coquin qu’il est très intelligent, comme on dit toujours d’un honnête homme qu’il est un imbécile. » (Alfred Capus, Mariage bourgeois (1898), acte I, scène 7 ; dans Théâtre complet, tome 3, Fayard, 1910, p. 24).
. Madeleine : « Le devoir, l’honneur !… des mots à qui on fait dire tout ce qu’on veut, comme aux perroquets ! » (Alfred Capus, Mariage bourgeois (1898), acte II, scène 8 ; dans Théâtre complet, tome 3, Fayard, 1910, p. 77).
. Piégoy : « L’origine de ma fortune ? L’exploitation des imbéciles ? Mais les imbéciles ont toujours été exploités, et c’est justice. Le jour où ils cesseraient de l’être, ils triompheraient, et le monde serait perdu. » (Alfred Capus, Mariage bourgeois (1898), acte IV, scène 6 ; dans Théâtre complet, tome 3, Fayard, 1910, p. 151).
. Le Houssel : « Avez-vous remarqué que maintenant, à Paris, ce qu'on appelait autrefois l'âge mûr tend à disparaître. On reste jeune très longtemps, puis tout d’un coup, sans transition, on devient gâteux. » (Alfred Capus, La Bourse ou la vie (1900), acte III, scène 1 ; dans Théâtre complet, tome 2, Fayard, 1910, p. 232).
. Julien : « Je crois que tout homme un peu bien doué, pas trop sot, pas trop timide, a dans la vie son heure de veine, un moment où les autres hommes semblent travailler pour lui, où les fruits viennent se mettre à portée de sa main pour qu'il les cueille. Cette heure-là, […] c'est triste à dire, mais ce n'est ni le travail, ni le courage, ni la patience qui nous la donnent. Elle sonne à une horloge qu'on ne voit pas, et tant qu'elle n'a pas sonné pour nous, nous avons beau déployer tous les talents et toutes les vertus, il n'y a rien à faire, nous sommes des fétus de paille. » (Alfred Capus, La Veine (1901), acte I, scène 6 ; dans Théâtre complet, tome 2, Fayard, 1910, p. 317).
. Marthe : « J’ai relevé […] un fait assez curieux : les vagabonds qui, il y a une dizaine d’années, étaient presque tous illettrés, savent maintenant pour la plupart lire, écrire et compter. Quelques-uns semblent même avoir reçu une instruction supérieure. C’est un grand progrès. » — Valentin : « Évidemment. Mais est-ce un progrès de l’instruction ou un progrès du vagabondage ? » (Alfred Capus, Le Beau jeune homme (1903), acte I, scène 3 ; dans Théâtre complet, tome 5, Fayard, 1910, p. 162).
. Madame Bréautin : « Il n'est donc pas ambitieux, Darlay ?… » — Marianne : « Je commence à croire que non. » — Madame Bréautin : « C'est peut-être qu'il ne sent pas à ses côtés une volonté toujours présente et toujours agissante. Voyez-vous, ma chère, l'avenir de nos maris est dans nos mains et non dans les leurs. Les hommes n'ont jamais, réunies ensemble, les deux grandes conditions du succès : la volonté et la patience. Il faut que nous leur apportions l'une ou l'autre, sinon les deux !… Allez, il y a toujours une femme à l'origine d’une carrière d'homme ; et quand l'homme part, c'est que la femme a donné le signal. Voulez-vous mon opinion bien sincère sur votre mari ? Ce n'est pas un paresseux, ce n'est pas un incapable, loin de là ! C'est simplement un homme trop heureux. » — Marianne : « Je ne peux pourtant pas le rendre malheureux exprès ! » — Madame Bréautin : « Non ! Mais c'est une question de dosage. Il ne faut pas que les hommes soient trop heureux. Le bonheur qui nous rend, nous, si reconnaissantes, les rend vaniteux et égoïstes. Ils ne s'aperçoivent bientôt plus qu'ils nous le doivent : ils en font hommage à leur caractère, à leur esprit ou à leur chance. » (Alfred Capus et Emmanuel Arène, L’Adversaire (1903), acte I, scène 2 ; dans Théâtre complet, tome 4, Fayard, 1910, p. 164-165).
. Maurice : « J’aime mieux n’être rien qu’un ambitieux encombrant et médiocre. On n'est pas obligé d'être un grand homme : c'est déjà très joli d'être un homme. » (Alfred Capus et Emmanuel Arène, L’Adversaire (1903), acte I, scène 7 ; dans Théâtre complet, tome 4, Fayard, 1910, p. 178).
. Marianne : « Tu vas nier peut-être aussi que Bréautin est ce qu’on appelle un homme arrivé ? » — Maurice : « Oui, il est arrivé, mais dans quel état ! » (Alfred Capus et Emmanuel Arène, L’Adversaire (1903), acte I, scène 7 ; dans Théâtre complet, tome 4, Fayard, 1910, p. 181).
. Marianne : « Vouloir arriver, c'est avoir déjà fait la moitié du chemin. » (Alfred Capus et Emmanuel Arène, L’Adversaire (1903), acte I, scène 12 ; dans Théâtre complet, tome 4, Fayard, 1910, p. 197). 
. Madame Bréautin : « Mépriser la calomnie, mais prendre garde aux potins, pardonner une insulte, mais jamais une impolitesse, c’est la seule façon de se faire respecter. » (Alfred Capus et Emmanuel Arène, L’Adversaire (1903), acte II, scène 1 ; dans Théâtre complet, tome 4, Fayard, 1910, p. 214-215).
. Marianne : « Vous êtes trop ambitieux pour avoir des passions désordonnées et douloureuses ; le même cœur ne peut pas contenir l’ambition et l’amour. » — Langlade : « […] Oui… je suis ambitieux ! […] Mais gloire, succès, triomphes, tout celà n'est rien si, dès qu’on les a, on ne peut pas les jeter aux pieds d'une femme ! » (Alfred Capus et Emmanuel Arène, L’Adversaire (1903), acte II, scène 3 ; dans Théâtre complet, tome 4, Fayard, 1910, p. 223).
. Montferran : « L'humanité, hélas ! mon ami, est faite de telle façon que, donner la liberté aux uns, c'est presque toujours l'enlever aux autres ! » — Bizot : « Et l'on se demande alors s'il ne vaudrait pas mieux l'enlever à tout le monde. » (Alfred Capus et Lucien Descaves, L’Attentat (1906), acte IV, scène 7 ; dans Théâtre complet, tome 6, Fayard, 1911, p. 152).
. Amélie : « La jalousie n’est belle que sur un visage jeune et ardent. Après les premières rides, la confiance doit revenir. » (Alfred Capus, Les Passagères (1906), acte I, scène 4 ; dans Théâtre complet, tome 5, Fayard, 1910, p. 276).
. Marcel : « Chaque époque a ses armes. Seulement, les uns savent les manier, et les autres ne le savent pas. Les uns prennent sans effort, par un instinct naturel, le courant, les habitudes et la moralité de l'heure où ils vivent, et, quand l'heure change, ils changent comme elle ; tandis que les autres sont immobiles dans la foule toujours mouvante et ils finissent par être piétinés. Enfin, […] il y a deux grandes catégories d'hommes civilisés ; ceux qui s'adaptent exactement à leur époque et ne lui demandent que ce qu'elle peut donner, et c'est parmi ceux-là que la vie choisit les vainqueurs, car ce qu'on appelle la chance, c'est la faculté de s'adapter instantanément à l'imprévu. Et puis, il y a ceux qui ne s'adaptent pas, qu'ils soient nés trop tard ou trop tôt, qu'ils aient encore les idées d'hier ou qu'ils aient déjà celles de demain. Et ceux-là, ce sont les vaincus. Je ne vous dis pas qu'ils le méritent ; je ne vous dis pas que cela soit très juste, mais cela s'accomplit avec la tranquille fatalité des lois de la nature. » (Alfred Capus, Les Deux hommes (1908), acte III, scène 3 ; dans Théâtre complet, tome 7, Fayard, 1911, p. 124-125).
. Ranson : « Savez-vous ce que c’est qu’un misanthrope ? » — Geneviève : « C’est un homme qui vous force à réfléchir, ce qui est très ennuyeux. » (Alfred Capus, L’Aventurier (1910), acte II, scène 3 ; dans Théâtre complet, tome 7, Fayard, 1911, p. 422).
. Germaine : « Les hommes sont incapables de reconnaître un accent sincère ! Ce sont des égoïstes qui n’écoutent que leur sot orgueil et qui prennent toujours la vérité pour une insulte. » (Alfred Capus, En garde (1912), acte II, scène 13 ; dans Théâtre complet, tome 8, Fayard, 1913, p. 262-263).
. Sébastien : « On ne s’aime pas dans le rêve et dans l’idéal, ce n’est pas vrai. On s’aime dans la réalité, chacun avec tout son caractère et avec toutes ses passions. Un avare aime en avare ; un ambitieux aime en ambitieux. » (Alfred Capus, Hélène Ardouin (1913), acte II, scène 2 ; dans Théâtre complet, tome 8, Fayard, 1913, p. 360).
. « À force de faire le sceptique, je suis devenu sceptique sur beaucoup de points, et, notamment, sur le scepticisme. » (Alfred Capus, propos oral rapporté par Sacha Guitry, De 1429 à 1942 ou de Jeanne d’Arc à Philippe Pétain (1944), « L’esprit d’Alfred Capus » ; Omnibus Cinquante ans d’occupations, 1993, p. 1096).
. Un jour, un ami de Capus allait se marier. Quelqu’un demande à l’auteur de La Veine : « Croyez-vous qu’il soit capable de rendre une femme heureuse ? » À quoi Capus répondit : « Ce qu’il faudrait dabord savoir, c’est s’il serait capable de la rendre malheureuse. » (Maurice Donnay, Mon journal 1919-1939, 11 novembre 1937, Fayard, 1953, p. 279).
GEORGES COURTELINE (1858-1929) : Voir page spéciale
 . [C’est] l’histoire de deux amants qui s’adorent et qui sont obligés de se quitter pour des raisons de conscience… et qui n’en meurent pas. […] [Je] tien[s] essentiellement à ce qu’ils n’en meurent pas ; [je] prétend[s] traiter le cas le plus ordinaire de la passion, et [j’] ajoute que si on mourait à la suite de toutes les aventures d’amour, il n’y aurait plus personne, plus d’auteurs pour les raconter, plus de directeurs pour monter les pièces, d’acteurs pour les jouer ni de spectateurs pour aller les entendre. (Maurice Donnay, propos oral à Lucien Guitry en juillet 1895, et rapporté par lui-même dans « Comment j’ai écrit Amants », article dans Le Gaulois, n°16092, 25 octobre 1921, p. 1).
. [C’est] l’histoire de deux amants qui s’adorent et qui sont obligés de se quitter pour des raisons de conscience… et qui n’en meurent pas. […] [Je] tien[s] essentiellement à ce qu’ils n’en meurent pas ; [je] prétend[s] traiter le cas le plus ordinaire de la passion, et [j’] ajoute que si on mourait à la suite de toutes les aventures d’amour, il n’y aurait plus personne, plus d’auteurs pour les raconter, plus de directeurs pour monter les pièces, d’acteurs pour les jouer ni de spectateurs pour aller les entendre. (Maurice Donnay, propos oral à Lucien Guitry en juillet 1895, et rapporté par lui-même dans « Comment j’ai écrit Amants », article dans Le Gaulois, n°16092, 25 octobre 1921, p. 1).
. Antonia : « Dire qu’il y en a toujours un qui aime davantage… et c’est celui-là qui souffre. » — Roger : « Mais c’est l’autre qui s’ennuie. » (Maurice Donnay, L’Affranchie, acte I, scène 5, Paul Ollendorff, 1898, p. 49 ; ou Théâtre, tome 2, Fasquelle, 1908, p. 290-291).
. Roger : « C’est un orateur : il dit des choses vagues avec la dernière violence. » (Maurice Donnay, L’Affranchie, acte II, scène 5, Paul Ollendorff, 1898, p. 120 ; ou Théâtre, tome 2, Fasquelle, 1908, p. 326).
. Mme Sinnglott : « Êtes-vous féministe, monsieur ? » — Roger : « Ça dépend des femmes, madame, et ça dépend aussi de ce qu’elles demandent. » (Maurice Donnay, L’Affranchie, acte II, scène 5, Paul Ollendorff, 1898, p. 120 ; ou Théâtre, tome 2, Fasquelle, 1908, p. 326).
. Galbrun : « La vie, c'est le passé, le présent et l'avenir. Je connais un homme qui est toujours amoureux de trois femmes : celle qu'il a quittée, souvenirs et regrets ; celle qu'il possède, satisfactions immédiates ; et celle qu'il aura et qu'il ne connaît pas encore, illusions et rêves. » (Maurice Donnay, L'Escalade (1904), acte II, scène 5 ; Théâtre, tome 5, Fasquelle, 1912, p. 77).
. Suzanne : « J’ai peur des installations nouvelles. Tu sais ce que dit le proverbe arabe ? […] Quand la maison est finie, la mort entre. » — Friolley : « Tu es gaie… […] Foin des proverbes arabes ! » — Suzanne : « Aimes-tu mieux un proverbe français ? Déménager, c'est mourir un peu… » — Friolley : « Et mourir, c'est déménager beaucoup. » (Maurice Donnay, La Chasse à l’homme (1919), acte I, scène 1 ; Théâtre, tome 8, Fasquelle, 1927, p. 14).
. La poésie lyrique : « Il faut rêver très haut, pour ne pas réaliser trop bas. » (Maurice Donnay, Conversations pendant la guerre. L’Alerte ; dans Revue des deux mondes, mai 1918, tome XLV, p. 800).
. Pour collaborer, c’est comme pour aimer : il faut se ressembler avec quelques différences et non pas être différents avec quelques ressemblances. (Maurice Donnay, Mon journal 1919-1939, 13 août 1927, Fayard, 1953, p. 184).
. Il ne faut pas apporter en amour de trop grands sentiments ; celà ne facilite pas les échanges. On ne trouve personne pour vous rendre ; il faut absolument faire de la monnaie. (Maurice Donnay, Mon journal 1919-1939, 13 août 1927, Fayard, 1953, p. 185).
. On doit la vérité aux gens intelligents, mais on doit le mensonge aux imbéciles. (Maurice Donnay, Mon journal 1919-1939, 5 novembre 1927, Fayard, 1953, p. 187).
. Dalila devait être une femme qui coupait les cheveux en quatre. S’il vit auprès d’une telle femme, l’homme le plus fort perd toutes ses forces. (Maurice Donnay, Mon journal 1919-1939, 2 décembre 1927, Fayard, 1953, p. 189).
MAURICE MAETERLINCK (1862-1949)
. Aglavaine : « Il n’y a rien de plus beau qu’une clef, tant qu’on ne sait pas ce qu’elle ouvre… » (Maurice Maeterlinck, Aglavaine et Sélysette, acte I, scène unique, Mercure de France, 1896, p. 31).
GEORGES FEYDEAU (1862-1921) [5]
 . Gévaudan : « L’homme est fait pour la femme, la femme est faite pour l’homme… surtout en province… où il n’y a pas de distractions ! » (Georges Feydeau et Maurice Desvallières, Les Fiancés de Loches (1888), acte I, scène 9 ; Théâtre complet, tome 1, classiques Garnier, 1988, p. 555).
. Gévaudan : « L’homme est fait pour la femme, la femme est faite pour l’homme… surtout en province… où il n’y a pas de distractions ! » (Georges Feydeau et Maurice Desvallières, Les Fiancés de Loches (1888), acte I, scène 9 ; Théâtre complet, tome 1, classiques Garnier, 1988, p. 555).
. Gévaudan : « Quand une femme parle c'est pour ne rien dire, donc quand elle ne dit rien, c'est qu'elle parle. » (Georges Feydeau et Maurice Desvallières, Les Fiancés de Loches (1888), acte II, scène 8 ; Théâtre complet, tome 1, classiques Garnier, 1988, p. 582).
. Léontine : « Est-ce que l’on sait ce qu’on dit dans les moments de deuil ? » — Moricet : « Oh ! pardon ! Vous étiez sincère à ce moment-là, je vous jure… Il n’y a même que dans ces courts instants où la femme ne pense plus du tout à ce qu’elle dit qu’on peut être sûr qu’elle dit vraiment ce qu’elle pense. » (Georges Feydeau, Monsieur chasse (1892), acte I, scène 3 ; Théâtre complet, tome 1, classiques Garnier, 1988, p. 865).
. Pontagnac : « Les maris des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles. » (Georges Feydeau, Le Dindon (1896), acte I, scène 1 ; Théâtre complet, tome 2, classiques Garnier, 1988, p. 469).
. Mme Pinchard : « Comment veux-tu que je te comprenne !… Tu me parles à contre-jour, je ne vois pas ce que tu me dis ! » (Georges Feydeau, Le Dindon (1896), acte II, scène 15 ; Théâtre complet, tome 2, classiques Garnier, 1988, p. 549).
. Lucien : « Et voilà les femmes ! Elles ne vous permettent pas de les lâcher quand vous avez assez d'elles. Elles vous le permettent quand vous n'avez plus assez pour elles. » (Georges Feydeau, Les Pavés de l’ours (1896), scène 13 ; Théâtre complet, tome 2, classiques Garnier, 1988, p. 606-607).
. Petypon : « Allons donc ! comme il n'y a pas de fumée sans feu… il n'y a pas de feu sans allumage ! » (Georges Feydeau, La Dame de chez Maxim (1899), acte III, scène 5 ; Théâtre complet, tome 2, classiques Garnier, 1988, p. 886).
. Francine : « Le grand tort que nous avons nous autres femmes, c'est, pour amant, de chercher toujours un homme que nous aimons ; alors que la vérité serait d'en chercher un qui nous aime ! » (Georges Feydeau, La Main passe (1904), acte IV, scène 4 ; Théâtre complet, tome 3, classiques Garnier, 1988, p. 153-154).
. Finache : « L'amour-propre et l'amour, ça ne va pas ensemble… Si même il y en a un qu'on appelle propre, c'est pour le distinguer de l'autre… qui ne l'est pas ! » (Georges Feydeau, La Puce à l’oreille (1907), acte I, scène 8 ; Théâtre complet, tome 3, classiques Garnier, 1988, p. 553).
. Bibichon : « Ah ! non, non pas ça ! Je suis royaliste, moi ! La Marseillaise, merci ! c'était bon sous l'Empire !… quand j'étais républicain ! » (Georges Feydeau, Occupe-toi d'Amélie (1908), acte I, scène 1 ; Théâtre complet, tome 3, classiques Garnier, 1988, p. 690).
. Mme Dingue : « L'argent ne fait pas le bonheur. » — Follbraguet : « Oui, c'est même à se demander pourquoi les riches y tiennent tant ! » (Georges Feydeau, Hortense a dit : je m’en fous ! (1916), scène 3 ; Théâtre complet, tome 4, classiques Garnier, 1989, p. 499).
JULES RENARD (1864-1910) : Voir page spéciale
TRISTAN BERNARD (1866-1947) : Voir page dévolue aux humoristes
 . Le baron : « Les hommes ont, vois-tu, des âmes de marmots ; / Quand on n'a pas de sucre, on leur donne des mots. » (Miguel Zamacoïs, Les Bouffons (1907), acte I, scène 4, Librairie théâtrale, p. 11).
. Le baron : « Les hommes ont, vois-tu, des âmes de marmots ; / Quand on n'a pas de sucre, on leur donne des mots. » (Miguel Zamacoïs, Les Bouffons (1907), acte I, scène 4, Librairie théâtrale, p. 11).
. Gobelousse : « Emporter de chez soi les accents familiers, / C’est emporter un peu sa terre à ses souliers ! / […] Lorsque, loin du pays, le cœur gros, on s’enfuit, / L’accent ? mais c’est un peu le pays qui vous suit ! / C’est un peu, cet accent, invisible bagage, / Le parler de chez soi qu’on emporte en voyage ! / C’est, pour les malheureux à l’exil obligés, / Le patois qui déteint sur les mots étrangers ! / Avoir l’accent, enfin, c’est, chaque fois qu’on cause, / Parler de son pays, en parlant d’autre chose !… » (Miguel Zamacoïs, La Fleur merveilleuse, acte II, scène 5, Charpentier et Fasquelle, 1910, p. 94).
. Veux-tu donner à une femme rêveuse une occasion de mentir ? Demande-lui à quoi elle pense. (Miguel Zamacoïs, « Quand on y pense… », dans Le Figaro. Supplément littéraire, n°269, 31 mai 1924, p. 1).
. Il n'y a pas de sots métiers, c'est entendu… Mais il y a ceux qu'on laisse aux autres. (Miguel Zamacoïs, « Quand on y pense… », dans Le Figaro. Supplément littéraire, n°269, 31 mai 1924, p. 1).
. Avoir vieilli, c’est bien triste, et pourtant celà n’est rien auprès de vieillir davantage. (Miguel Zamacoïs, « Quand on y pense… », dans Le Figaro. Supplément littéraire, n°269, 31 mai 1924, p. 1).
. Quand nous regardons chez les autres notre « instinct de conservation », nous l’appelons égoïsme. (Miguel Zamacoïs, « Quand on y pense… », dans Le Figaro. Supplément littéraire, n°269, 31 mai 1924, p. 1).
. Nous pourrions croire que certaines gens s’intéressent à notre santé s’ils ne nous demandaient pas de nos nouvelles : mais comme ils n’écoutent pas la réponse, nous sommes fixés. (Miguel Zamacoïs, « Quand on y pense… », dans Le Figaro. Supplément littéraire, n°269, 31 mai 1924, p. 1).
. « On » est un imbécile à qui nous faisons endosser les idées dont nous ne sommes pas sûrs. (Miguel Zamacoïs, « Quand on y pense… », dans Le Figaro. Supplément littéraire, n°269, 31 mai 1924, p. 1).
. L'amour n'est pas aveugle, il est atteint de presbytie ; la preuve, c'est qu'il ne commence à distinguer les défauts que lorsqu'il s'éloigne. (Miguel Zamacoïs, « Quand on y pense… », dans Le Figaro. Supplément littéraire, n°269, 31 mai 1924, p. 1).
. Tu fais semblant de croire que l'Univers gravite autour du soleil, mais tu sais bien que c'est autour de toi. (Miguel Zamacoïs, « Quand on y pense… », dans Le Figaro. Supplément littéraire, n°269, 31 mai 1924, p. 1).
. Le seul qui ne dise jamais de bêtises, c’est le silence. (Miguel Zamacoïs, « Quand on y pense… », dans Le Figaro. Supplément littéraire, n°269, 31 mai 1924, p. 1).
 . Le fâcheux : « Quoi, pas un grand seigneur pour couvrir de son nom ?… » — Cyrano : « Non, ai-je dit deux fois. Faut-il donc que je trisse ? » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte I, scène 4, vers 267-268 ; Folio n°3246, 2002, p. 90).
. Le fâcheux : « Quoi, pas un grand seigneur pour couvrir de son nom ?… » — Cyrano : « Non, ai-je dit deux fois. Faut-il donc que je trisse ? » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte I, scène 4, vers 267-268 ; Folio n°3246, 2002, p. 90).
. Cyrano : « Je me les sers moi-même, avec assez de verve, / Mais je ne permets pas qu’un autre me les serve. » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte I, scène 4, vers 364-365 ; Folio n°3246, 2002, p. 100).
. Cyrano : « Moi, c’est moralement que j’ai mes élégances. / Je ne m’attife pas ainsi qu’un freluquet, / Mais je suis plus soigné si je suis moins coquet. / […] Mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise, / Empanaché d’indépendance et de franchise ; / Ce n’est pas une taille avantageuse, c’est / Mon âme que je cambre ainsi qu’en un corset, / Et tout couvert d’exploits qu’en rubans je m’attache, / Retroussant mon esprit ainsi qu’une moustache, / Je fais, en traversant les groupes et les ronds, / Sonner les vérités comme des éperons. » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte I, scène 4, vers 369-371 et 376-383 ; Folio n°3246, 2002, p. 100-101).
. Cyrano : « J’errais dans un méandre ; / J’avais trop de partis, trop compliqués, à prendre ; / J’ai pris… » — Le Bret : « Lequel ? » — Cyrano : « Mais le plus simple, de beaucoup. / J’ai décidé d’être admirable, en tout, pour tout ! » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte I, scène 5, vers 478-481 ; Folio n°3246, 2002, p. 115-116).
. Cyrano : « Mon ami, j’ai de mauvaises heures ! / De me sentir si laid, parfois, tout seul… » […] — Le Bret : « Va, ne t’attriste pas ! L’amour n’est que hasard ! » — Cyrano : « Non ! J’aime Cléopâtre : ai-je l’air d’un César ? / J’adore Bérénice : ai-je l’aspect d’un Tite ? » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte I, scène 5, vers 526-527 et 536-538 ; Folio n°3246, 2002, p. 119-120).
. Ragueneau : « Sur les cuivres, déjà, glisse l’argent de l’aube ! / Étouffe en toi le dieu qui chante, Ragueneau ! / L’heure du luth viendra, – c’est l’heure du fourneau ! » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte II, scène 1, vers 615-617 ; Folio n°3246, 2002, p. 135).
. De Guiche : « Il vous corrigera seulement quelques vers… » — Cyrano : « Impossible, Monsieur ; mon sang se coagule / En pensant qu’on y peut changer une virgule. » — De Guiche : « Mais quand un vers lui plaît, en revanche, mon cher, / Il le paye très cher. » — Cyrano : « Il le paye moins cher / Que moi, lorsque j’ai fait un vers, et que je l’aime, / Je me le paye, en me le chantant à moi-même ! » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte II, scène 7, vers 931-937 ; Folio n°3246, 2002, p. 184).
. Cyrano : « Chanter, / Rêver, rire, passer, être seul, être libre, / Avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, /Mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, / Pour un oui, pour un non, se battre, — ou faire un vers ! / Travailler sans souci de gloire ou de fortune, / À tel voyage, auquel on pense, dans la lune ! / N'écrire jamais rien qui de soi ne sortît, / Et modeste d'ailleurs, se dire : mon petit, / Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, / Si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles ! / Puis, s'il advient d'un peu triompher, par hasard, / Ne pas être obligé d'en rien rendre à César, / Vis-à-vis de soi-même en garder le mérite, / Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, / Lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, / Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul ! » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte II, scène 8, vers 999-1015 ; Folio n°3246, 2002, p. 191).
. Cyrano : « J’aime raréfier sur mes pas les saluts, / Et m’écrie avec joie : un ennemi de plus ! » — Le Bret : « Quelle aberration ! » — Cyrano : « Eh bien ! oui, c’est mon vice. / Déplaire est mon plaisir. J’aime qu’on me haïsse. / Mon cher, si tu savais comme l’on marche mieux / Sous la pistolétade excitante des yeux ! / Comme, sur les pourpoints, font d’amusantes taches / Le fiel des envieux et la bave des lâches ! / […] Car, pareille en tous points à la fraise espagnole, / La Haine est un carcan, mais c’est une auréole ! » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte II, scène 8, vers 1022-1029 et 1040-1041 ; Folio n°3246, 2002, p. 192-193). 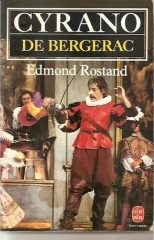
. Cyrano : « Celà m’amuserait ! / C’est une expérience à tenter un poète. » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte II, scène 10, vers 1143-1144 ; Folio n°3246, 2002, p. 210).
. Cyrano : « Car nous sommes ceux-là qui pour amante n’ont / Que du rêve soufflé dans la bulle d’un nom !… / […] Tu verras que je fus dans cette lettre – prends ! – / D’autant plus éloquent que j’étais moins sincère ! » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte II, scène 10, vers 1154-1155 et 1159-1160 ; Folio n°3246, 2002, p. 211).
. Cyrano : « Je sais tout ce qu’il faut. Prépare ta mémoire. / Voici l’occasion de se couvrir de gloire. » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte III, scène 4, vers 1311-1312 ; Folio n°3246, 2002, p. 236).
. Cyrano : « Oui, tout autre, car dans la nuit qui me protège / J’ose être enfin moi-même, et j’ose… […] / Si nouveau… mais oui… d’être sincère : / La peur d’être raillé, toujours au cœur me serre… » — Roxane : « Raillé de quoi ? » — Cyrano : « Mais de… d’un élan !… Oui, mon cœur, / Toujours, de mon esprit s’habille, par pudeur : / Je pars pour décrocher l’étoile, et je m’arrête / Par peur du ridicule, à cueillir la fleurette ! » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte III, scène 7, vers 1406-1407 et 1410-1415 ; Folio n°3246, 2002, p. 252).
. Cyrano : « Je vous dis tout celà, vous m’écoutez, moi, vous ! / C’est trop ! Dans mon espoir même le moins modeste, / Je n’ai jamais espéré tant ! Il ne me reste / Qu’à mourir maintenant ! » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte III, scène 7, vers 1469-1472 ; Folio n°3246, 2002, p. 256).
. Carbon : « Mais tu les fais pleurer ! » — Cyrano : « De nostalgie !… Un mal / Plus noble que la faim !… pas physique : moral ! / J’aime que leur souffrance ait changé de viscère, / Et que ce soit leur cœur, maintenant, qui se serre ! » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte IV, scène 3, vers 1804-1807 ; Folio n°3246, 2002, p. 305-306).
. De Guiche : « Eh bien ! que dites-vous de ce trait ? » — Cyrano : « Qu’Henri quatre / N’eût jamais consenti, le nombre l’accablant, / À se diminuer de son panache blanc. » — De Guiche : « L’adresse a réussi, cependant ! » — Cyrano : « C’est possible. / Mais on n’abdique pas l’honneur d’être une cible. » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte IV, scène 4, vers 1859-1863 ; Folio n°3246, 2002, p. 311-312).
. Carbon : « Et pour gagner du temps ? » — De Guiche : « Vous aurez l’obligeance / De vous faire tuer. » […] — Cyrano : « Souffrez que je vous sois, monsieur, reconnaissant. » — De Guiche : « Je sais que vous aimez vous battre un contre cent. / Vous ne vous plaindrez pas de manquer de besogne. » — Cyrano : « Eh bien donc ! nous allons au blason de Gascogne, / Qui porte six chevrons, messieurs, d’azur et d’or, / Joindre un chevron de sang qui lui manquait encor ! » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte IV, scène 4, vers 1902-1903 et 1908-1913 ; Folio n°3246, 2002, p. 315-316).
. De Guiche : « Ne le plaignez pas trop : il a vécu sans pactes, / Libre dans sa pensée autant que dans ses actes. » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte V, scène 2, vers 2308-2309 ; Folio n°3246, 2002, p. 384).
. Cyrano : « Que dites-vous ?… C'est inutile ?… Je le sais ! / Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès! / Non ! non ! c'est bien plus beau lorsque c'est inutile ! / — Qu'est-ce que c'est que tous ceux-là ? — Vous êtes mille ? / Ah ! je vous reconnais, tous mes vieux ennemis ! / Le Mensonge ? Tiens, tiens ! — Ha ! ha ! les Compromis, / Les Préjugés, les Lâchetés !… Que je pactise ? / Jamais, jamais ! — Ah ! te voilà, toi, la Sottise ! / — Je sais bien qu'à la fin vous me mettrez à bas ; / N'importe : je me bats ! je me bats ! je me bats ! » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte V, scène 6, vers 2556-2565 ; Folio n°3246, 2002, p. 417). 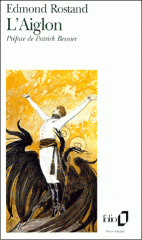
. Le Duc : « Moi je ne sais jamais si c’est der, die ou das ! » — Dietrichstein : « Le neutre seul, ici, serait correct ! » — Le Duc : « Mais pleutre. / Je n’aime pas beaucoup que la France soit neutre. » (Edmond Rostand, L’Aiglon (1900), acte I, scène 8 ; Folio n°1764, 1986, p. 73).
. Le Duc : « Vous, qui donc êtes-vous ? » — Le jeune homme : « Qu’importe ? un anonyme, / Las de vivre en un temps qui n’a rien de sublime / Et de fumer sa pipe en parlant d’idéal. / Ce que je suis ? Je ne sais pas. Voilà mon mal ; / Suis-je ? Je voudrais être, – et ce n’est pas commode. » (Edmond Rostand, L’Aiglon (1900), acte I, scène 10 ; Folio n°1764, 1986, p. 88).
. Le Duc : « Monsieur, vous me plaisez, mais vos propos sont fous. » — Le jeune homme : « Ne me jugez pas trop sur ce qu’ils ont d’étrange ; / Un besoin d’étonner, malgré moi, me démange ; / Mais sincère est le mal dont je me sens ronger, / Et qui me fait chercher cet oubli : le danger ! » (Edmond Rostand, L’Aiglon (1900), acte I, scène 10 ; Folio n°1764, 1986, p. 89).
. Le jeune homme : « Eh bien ! faibles, fiévreux, tourmentés par jadis, / Murmurant comme vous : "Que reste-t-il à faire ?" / Nous sommes tous un peu les fils de votre père. » (Edmond Rostand, L’Aiglon (1900), acte I, scène 10 ; Folio n°1764, 1986, p. 90).
. Le jeune homme : « Oui, l’histoire à la tête nous monte. / Les batailles qu’on ne fait plus, on les raconte ; / Et le sang disparaît, la gloire seule luit ! / Si bien qu’avec un I majuscule, Il, c’est Lui ! / C’est maintenant qu’il fait ses plus belles conquêtes : / Il n’a plus de soldats, mais il a les poètes ! » (Edmond Rostand, L’Aiglon (1900), acte I, scène 10 ; Folio n°1764, 1986, p. 94).
. Le Duc : « Oh ! vouloir à l’histoire ajouter des chapitres, / Et puis n’être qu’un front qui se colle à des vitres ! » (Edmond Rostand, L’Aiglon (1900), acte II, scène 4 ; Folio n° 1764, 1986, p. 139).
. Flambeau : « C’est pour moi seul. C’est du vrai luxe, – inaperçu ! / S’offrir un pareil coup pour n’éblouir personne, / Mais pour se dire, à soi tout seul : "Elle est bien bonne !" » (Edmond Rostand, L’Aiglon (1900), acte III, scène 7 ; Folio n°1764, 1986, p. 214).
. Le Duc : « C'est la règle ! / S'ils ne pouvaient entre eux dire du mal de l'aigle, / Que diraient le cloporte et le caméléon ? » (Edmond Rostand, L’Aiglon (1900), acte IV, scène 14 ; Folio n° 1764, 1986, p. 307).
. Le Duc : « Ah ! c’est dur tout-de-même, / D’être – lorsqu’on rêva la louange suprême / De l’Histoire, et qu’on fut une âme qui brûlait ! – / Loué pour la façon dont on prend bien son lait ! » (Edmond Rostand, L’Aiglon (1900), acte VI, scène 1 ; Folio n°1764, 1986, p. 367).
. Dors. Ce n’est pas toujours la Légende qui ment. / Un rêve est moins trompeur, parfois, qu’un document. (Edmond Rostand, L’Aiglon (1900), postface ; Folio n°1764, 1986, p. 388).
. Chantecler : « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ! » (Edmond Rostand, Chantecler (1910), acte II, scène 3 ; dans Théâtre, Omnibus, 2006, p. 533).
PAUL CLAUDEL (1868-1955) : [voir page en préparation dévolue aux poètes français modernes]
 . Richard : « J’ai un autres principe, très net… » — Louis : « Prends garde. Quand on a trop de principes, c’est comme si on n’en avait pas du tout. » — Richard : « Celui-ci : que l'humanité ne vaut pas la corde pour la pendre… et qu’il faut traiter les gens à coups de pied dans le derrière. Une bonne gifle dans la vie est une réponse à tout. » (Henry Bataille, Maman Colibri (1904), acte I, scène 2 ; Théâtre complet, tome 3, Flammarion, 1924, p. 211).
. Richard : « J’ai un autres principe, très net… » — Louis : « Prends garde. Quand on a trop de principes, c’est comme si on n’en avait pas du tout. » — Richard : « Celui-ci : que l'humanité ne vaut pas la corde pour la pendre… et qu’il faut traiter les gens à coups de pied dans le derrière. Une bonne gifle dans la vie est une réponse à tout. » (Henry Bataille, Maman Colibri (1904), acte I, scène 2 ; Théâtre complet, tome 3, Flammarion, 1924, p. 211).
. Soubrian : « La Belgique est une petite France. » — Rysbergue : « Vous êtes bien aimable, mais un grand Belge n'est jamais qu'un petit Français. » (Henry Bataille, Maman Colibri (1904), acte I, scène 5 ; Théâtre complet, tome 3, Flammarion, 1924, p. 224).
. Irène : « Toute cette ennuyeuse mise en scène dont se compose la jeunesse de nos filles, jusqu’à leur délivrance… » — Colette : « Seigneur !… Qu’entends-tu par la délivrance d’une jeune fille ? » — Irène : « Mais cette cérémonie de Zoulous qu'on appelle la journée du mariage. » (Henry Bataille, Maman Colibri (1904), acte I, scène 8 ; Théâtre complet, tome 3, Flammarion, 1924, p. 239).
. Lechatelier : « Les meilleurs généraux ont essuyé pas mal de défaites… Il faut les supporter vaillamment quand elles se présentent… C'est une affaire d'entraînement. Je me souviens que, tout petit garçon, à l’âge des premiers désirs, je faisais déjà des propositions aux statues de femmes du jardin des Tuileries… pour m'habituer aux refus. Chaque âge a ses déplaisirs. » (Henry Bataille, La Marche nuptiale (1905), acte II, scène 7 ; Théâtre complet, tome 4, Flammarion, 1925, p. 85).
. Saint-Vast : « Il y a deux manières de prendre les femmes… par la taille ou par le sentiment. […] Dailleurs, on peut les prendre par les deux à la fois !… » (Henry Bataille, Poliche (1906), acte I, scène 11 ; Théâtre complet, tome 4, Flammarion, 1925, p. 226-227).
. Saint-Vast : « Les femmes qui n’ont pas d’amant ou de mari, j’ai toujours envie de les conduire à la fourrière… » (Henry Bataille, Poliche (1906), acte I, scène 11 ; Théâtre complet, tome 4, Flammarion, 1925, p. 227).
. Rosine : « La franchise est le moyen le plus déguisé d'être malveillant à coup sûr… » (Henry Bataille, Poliche (1906), acte II, scène 6 ; Théâtre complet, tome 4, Flammarion, 1925, p. 272).
. Don Juan : « Quand une femme annonce sa franchise à la porte, c'est qu'on va entendre siffler quelques balles à ses oreilles ! » (Henry Bataille, L’Homme à la rose (1920), acte III, scène 6 ; Théâtre complet, tome 11, Flammarion, 1929, p. 127).
. Jessie : « Il y a beaucoup d'idiots dans les affaires, ce qui explique bien des choses. » (Henry Bataille, La Possession (1921), acte I, scène 5 ; Théâtre complet, tome 12, Flammarion, 1929, p. 24).
. C'est toujours par ce qu'elle contient de vérité qu'une œuvre nouvelle choque ses contemporains. (Henry Bataille, « À propos d’art dramatique » (juillet 1907), dans Écrits sur le théâtre, G. Crès et Cie, 1917, p. 121).
ROBERT de FLERS (1872-1927) et GASTON de CAILLAVET (1869-1915) [6]
 . Gerbier : « On m'estime pour la modération et la franchise de mes convictions. Je suis très loyalement réactionnaire, ce qui ne m'empêche pas d'être fermement républicain. Je respecte les lois de mon pays, tout en les considérant généralement comme stupides. En un mot, je réalise le type très rare de l'homme du monde intelligent. » (Robert de Flers et Gaston de Caillavet, Les Sentiers de la vertu (1903), acte I, scène 1, Librairie théâtrale, 1904, p. 5).
. Gerbier : « On m'estime pour la modération et la franchise de mes convictions. Je suis très loyalement réactionnaire, ce qui ne m'empêche pas d'être fermement républicain. Je respecte les lois de mon pays, tout en les considérant généralement comme stupides. En un mot, je réalise le type très rare de l'homme du monde intelligent. » (Robert de Flers et Gaston de Caillavet, Les Sentiers de la vertu (1903), acte I, scène 1, Librairie théâtrale, 1904, p. 5).
. La marquise : « Vous m’ennuyez. Dabord, si vertueuse que soit une femme, sachez que c’est sur sa vertu qu’un compliment lui fait le moins de plaisir. Rappelez-vous ça ! » (Robert de Flers et Gaston de Caillavet, L’Amour veille (1907), acte II, scène 1, Librairie théâtrale, 1908, p. 105).
. André : « Je l’adorais… eh bien, maintenant qu'elle a pleuré pour moi… par moi… il me semble que je l'aime cent fois plus encore… Nos femmes ne se doutent pas combien le chagrin que nous leur faisons peut nous les faire aimer davantage. Si elles le savaient, elles nous diraient : "Trompe-moi encore !… mon chéri ! trompe-moi encore !…" Seulement elles ne le savent pas, alors elles ne nous le disent pas. » (Robert de Flers et Gaston de Caillavet, L’Amour veille (1907) acte IV, scène 10, Librairie théâtrale, 1908, p. 289).
. Blond : « Ignores-tu donc que les rois n’ont plus maintenant pour mission que d’être des motifs de publicité ? Ils servent de réclame aux automobiles où ils montent, aux restaurants où ils dînent, aux théâtres où ils vont, aux femmes où ils aiment ! S'ils proféraient encore des choses historiques, s'ils criaient : "Ralliez-vous à mon panache blanc !", ils diraient chez quel plumassier ils l'ont acheté. S'ils clamaient : "Je veux que mon peuple mange tous les dimanches la poule au pot !", ils donneraient l'adresse du restaurant où on la fait le mieux. À cette heure, vois-tu, ma petite, les champs de bataille… c'est les étalages !… » (Robert de Flers et Gaston de Caillavet, Le Roi (1908), acte I, scène 9 ; Julliard, collection Littérature n°10, 1964, p. 46).
. Bourdier : « Vous vous considérez, vous, comme le propriétaire de vos biens, tandis que je me considère, moi et mes descendants, comme le dépositaire des miens. Voilà pourquoi votre fortune est une fortune capitaliste, tandis que la mienne est une fortune socialiste ! » — Le Marquis : « Mais, alors, c'est exactement la même chose, ce n'est qu'une question de mots ? » — Bourdier : « Il n'y en a jamais eu d'autres en France ! » (Robert de Flers et Gaston de Caillavet, Le Roi (1908), acte I, scène 11 ; Julliard, collection Littérature n°10, 1964, p. 62).
. Le roi : « Maintenant, la reine et moi nous faisons trône à part. Je ne songe jamais à elle. » — Thérèse : « Vous avez peut-être raison, Sire. C’est la meilleure façon de faire bon ménage. » — Le roi : « N’est-ce pas ? Je crois. Quand on ne pense pas à sa femme, on ne l’en aime que mieux. » (Robert de Flers et Gaston de Caillavet, Le Roi (1908), acte II, scène 9 ; Julliard, collection Littérature n°10, 1964, p. 109).
. Thérèse : « Que voulez-vous, Sire, c’est pour vous faire honneur qu’on a composé un programme ennuyeux. Les choses ennuyeuses ont toujours un prestige que les choses amusantes n’ont pas… » (Robert de Flers et Gaston de Caillavet, Le Roi (1908), acte II, scène 9 ; Julliard, collection Littérature n°10, 1964, p. 110). 
. Bourdier : « Et puis, quoi, des rois, il en faut ! S'il n'y avait pas de rois, il n'y aurait pas de révolutions ; s'il n'y avait pas de révolutions, il n'y aurait pas de républiques… » — Rivelot : « S'il n'y avait pas de républiques, il n'y aurait pas de socialistes… » — Bourdier : « Et s'il n'y avait pas de socialistes, je serais conservateur ! Vous voyez où nous allons ? » (Robert de Flers et Gaston de Caillavet, Le Roi (1908), acte III, scène 3 ; Julliard, collection Littérature n°10, 1964, p. 131).
. Thérèse : « Il faut éviter la politique, la diplomatie, les affaires, la littérature, les femmes et les potins. » — Marthe : « Qu’est-ce qu’il reste, alors ? La botanique ? » — Thérèse : « Mais non, il reste la politesse, c’est-à-dire toutes les phrases qui ne signifient rien. » (Robert de Flers et Gaston de Caillavet, Le Roi (1908), acte III, scène 4 ; Julliard, collection Littérature n°10, 1964, p. 135).
. Le marquis : « Vous étiez alors le bourgeois gentilhomme. Vous êtes, aujourdhui, le bourgeois socialiste. C'est exactement la même chose. L'épithète change, le caractère reste : ambitieux, riche, piqué de l'envie de se pousser dans le monde. M. Jourdain courtisait la noblesse, monsieur Bourdier courtise le peuple. C'est toujours courtiser le pouvoir. » (Robert de Flers et Gaston de Caillavet, Le Roi (1908), acte III, scène 6 ; Julliard, collection Littérature n°10, 1964, p. 142).
. Le roi : « Sachez, pauvre petite dame, ce n'est plus rien du tout, aujourdhui, que d'être roi ! Pensez-vous que c'est une carrière que l'on choisirait ? On la prend parce que c'était celle de votre père, parce qu'il y a un trône dans la famille. On devient souverain comme on devient notaire ! Et cela est aussi peu gai. » (Robert de Flers et Gaston de Caillavet, Le Roi (1908), acte III, scène 7 ; Julliard, collection Littérature n°10, 1964, p. 170).
. Lelorrain : « Sacrebleu, si vous ne le répétiez pas tout le temps, vous l’auriez déjà oublié ! » (Robert de Flers et Gaston de Caillavet, Le Roi (1908), acte IV, scène 3 ; Julliard, collection Littérature n°10, 1964, p. 184).
. Lelorrain : « Quand on est sincère comme ça, mon cher, on n’accepte pas d’être ministre ! » (Robert de Flers et Gaston de Caillavet, Le Roi (1908), acte IV, scène 3 ; Julliard, collection Littérature n°10, 1964, p. 188).
. Bourdier : « Mes nouvelles fonctions font de moi un autre homme ! […] Je reste fidèle à mon devoir, seulement, mon devoir a changé. » — Lelorrain : « En politique, le devoir change tout le temps ! » (Robert de Flers et Gaston de Caillavet, Le Roi (1908), acte IV, scène 4 ; Julliard, collection Littérature n°10, 1964, p. 194).
. Champmorel : « Messieurs, ne l'oubliez pas, en France, les Beaux-Arts, ce n'est pas la peinture, la sculpture, la musique… les Beaux-Arts, c'est de l'administration. J'ajoute que nous avons à nous défendre… Nous sommes guettés… Quoi que nous fassions, ce mot de Beaux-Arts a en lui je ne sais quoi de réactionnaire… L'esthétique, le goût, ça n'est pas démocratique, et, dailleurs, avouons-le, le fait pour un peintre de peindre mieux qu'un autre, c'est contraire à l'égalité et, par conséquent, à la fraternité qui doit être notre but, notre foi, et notre idéal. » (Robert de Flers et Gaston de Caillavet, Le Bois sacré (1910), acte II, scène 5, Librairie théâtrale, 1911, p. 93).
. Mme Jeanvré : « Tout de même, je n’en reviens pas. » — Bénin : « C’est sans doute que vous ignoriez combien nos mœurs ont changé. » — Mme Jeanvré : « À ce point-là ? » — Bénin : « À ce point-là. La liaison a remplacé le mariage qui, lui, est devenu une sorte de parenté. » (Robert de Flers et Gaston de Caillavet, L’Habit vert (1912), acte I, scène 4 ; Julliard, collection Littérature n°10, 1964, p. 220-221).
. Durand : « La démocratie est le nom que nous donnons au peuple toutes les fois que nous avons besoin de lui. » (Robert de Flers et Gaston de Caillavet, L’Habit vert (1912), acte I, scène 12 ; Julliard, collection Littérature n°10, 1964, p. 261).
. Hubert de Latour-Latour : « Qu’est-ce que je lui dirai à l’Académicien ?… » — La duchesse : « Rien du tout… […] Vous ne lui direz aucune chose… aucun mot… Alors, il parlera constamment de lui, et quand vous [vous] quitterez, il pensera : "Quel charmant causeur !" » (Robert de Flers et Gaston de Caillavet, L’Habit vert (1912), acte II, scène 10 ; Julliard, collection Littérature n°10, 1964, p. 315).
. Hubert de Latour-Latour : « Ah ! la critique, messieurs. Jamais nous ne ferons assez son éloge ! Combien d’écrivains qui ne trouveraient rien à écrire s’ils n’avaient pu se donner à la critique ? » (Robert de Flers et Gaston de Caillavet, L’Habit vert (1912), acte III, scène 1 ; Julliard, collection Littérature n°10, 1964, p. 336).
. La duchesse : « Qu’est-ce que c’est, "congrès" ? » — Le président Durand : « Ce sont des réunions que les gouvernements organisent pour faire voyager gratuitement leurs amis et pour éloigner leurs adversaires. C’est très utile. » (Robert de Flers et Gaston de Caillavet, L’Habit vert (1912), acte IV, scène 4 ; Julliard, collection Littérature n°10, 1964, p. 361).
ROBERT de FLERS (1872-1927) et FRANCIS de CROISSET (1877-1937)
 . Hubert : « On a beau s’attendre à certaines choses, on n’aime pas qu’elles arrivent. » (Robert de Flers et Francis de Croisset, Les Vignes du seigneur (1923), acte I, scène 3 ; Livre de poche n°4745, 1976, p. 30).
. Hubert : « On a beau s’attendre à certaines choses, on n’aime pas qu’elles arrivent. » (Robert de Flers et Francis de Croisset, Les Vignes du seigneur (1923), acte I, scène 3 ; Livre de poche n°4745, 1976, p. 30).
. Hubert : « Quand une femme trompe son amant, c’est infiniment plus pénible et plus choquant – voire plus immoral – que quand une femme trompe son mari. » (Robert de Flers et Francis de Croisset, Les Vignes du seigneur (1923), acte I, scène 3 ; Livre de poche n°4745, 1976, p. 32).
. Henri : « Pour les femmes, les remords, c’est une espèce de volupté… Pour les hommes, c’est beaucoup plus grave, c’est une espèce d’embêtement !… » (Robert de Flers et Francis de Croisset, Les Vignes du seigneur (1923), acte II, scène 1 ; Livre de poche n°4745, 1976, p. 98).
. Gisèle : « Vous décidez tout… Moi, je n’existe plus ! Je n’ai même plus l’occasion de mentir ! Si vous croyez que c’est drôle pour une femme ! Si vous croyez que tout ça est amusant !… » (Robert de Flers et Francis de Croisset, Les Vignes du seigneur (1923), acte II, scène 4 ; Livre de poche n°4745, 1976, p. 118).
. Mme Bourjeon : « En amour, toutes les femmes sont des oies ! » (Robert de Flers et Francis de Croisset, Les Vignes du seigneur (1923), II, 6 ; Livre de poche n°4745, 1976, p. 130).
 . Mère Ubu : « Voilà qui est beau, mais il est encore plus beau d’être rois. » (Alfred Jarry et Charles Morin, Ubu roi ou les Polonais (1896), acte III, scène 1 ; Pléiade, tome 1, 1972, p. 369).
. Mère Ubu : « Voilà qui est beau, mais il est encore plus beau d’être rois. » (Alfred Jarry et Charles Morin, Ubu roi ou les Polonais (1896), acte III, scène 1 ; Pléiade, tome 1, 1972, p. 369).
. Père Ubu : « S’il n’y avait pas de Pologne il n’y aurait pas de Polonais ! » (Alfred Jarry et Charles Morin, Ubu roi ou les Polonais (1896), acte V, scène 4 ; Pléiade, tome 1, 1972, p. 398).
. Nous ne voyons pas la France dans un territoire inanimé mais dans une langue, et Maeterlinck est aussi justement à nous que nous répudions Mistral. (Alfred Jarry, « Réponses à un questionnaire sur l’art dramatique » (1896) ; Pléiade, tome 1, 1972, p. 410-411).
. Pourquoi le public, illettré par définition, s’essaye-t-il à des citations et comparaisons ? (Alfred Jarry, « Questions de théâtre » (1896) ; Pléiade, tome 1, 1972, p. 415).
. La foule, qui s’exclame avec un dédain simulé : « Dans tout celà, pas un mot d’esprit », comprend bien moins encore une phrase profonde. […] Si l’on tient absolument à ce que la foule entrevoie quelque chose, il faut préalablement le lui expliquer. / La foule ne comprend pas Peer Gynt, qui est une des pièces les plus claires qui soient ; elle ne comprend pas davantage la prose de Baudelaire, la précise syntaxe de Mallarmé. Elle ignore Rimbaud, sait que Verlaine existe depuis qu’il est mort. […] Elle affecte de considérer littérateurs et artistes comme un petit groupe de bons toqués, et il faudrait d’après certains élaguer de l’œuvre d’art tout ce qui est l’accident et la quintessence, l’âme du supérieur, et la châtrer telle que l’eût pu écrire une foule en collaboration. […] L’art et la compréhension de la foule [sont] incompatibles. […] C’est parce que la foule est une masse inerte et incompréhensive et passive qu’il faut la frapper de temps en temps, pour qu’on connaisse à ses grognements d’ours où elle est – et où elle en est. (Alfred Jarry, « Questions de théâtre » (1896) ; Pléiade, tome 1, 1972, p. 416-417).
. Pissedoux : « Il y a donc des gens que celà embête d'être libres. » (Alfred Jarry, Ubu enchaîné (1899), acte III, scène 2 ; Pléiade, tome 1, 1972, p. 446).
. Pissedoux : « Nous sommes libres de faire ce que nous voulons, même d’obéir ; d’aller partout où il nous plaît, même en prison ! La liberté, c’est l’esclavage ! » (Alfred Jarry, Ubu enchaîné (1899), acte V, scène 1 ; Pléiade, tome 1, 1972, p. 457).
. Le consentement universel est déjà un préjugé bien miraculeux et incompréhensible. (Alfred Jarry, Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien (1898), livre II, chap. VIII ; Pléiade, tome 1, 1972, p. 669).
. « Ha ha ! », dit-il compendieusement ; et il ne se perdit point dans des considérations plus amples. (Alfred Jarry, Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien (1898), livre III, chap. XIII ; Pléiade, tome 1, 1972, p. 678).
. Faustroll : « La mort n'est que pour les médiocres. » (Alfred Jarry, Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien (1898), livre VIII, chap. XXXVII ; Pléiade, tome 1, 1972, p. 724).
. Dieu est le plus court chemin de zéro à l'infini, dans un sens ou dans l'autre. (Alfred Jarry, Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien (1898), livre VIII, chap. XLI ; Pléiade, tome 1, 1972, p. 733). 
. Si longue que soit la vie, elle n'est qu'un long retard de la mort. (Alfred Jarry, L'Autre Alceste (1896), récit IV ; Pléiade, tome 1, 1972, p. 913).
. Ô le désespoir de Pygmalion […], qui aurait pu créer une statue et qui ne fit qu'une femme ! (Alfred Jarry, L'Amour absolu (1899), chap. XI ; Pléiade, tome 1, 1972, p. 947).
. Sider : « Moi, je ne crois qu'à ce qui est croyable. » (Alfred Jarry, Le Surmâle (1902), chap. I ; Pléiade, tome 2, 1987, p. 200).
. Puisque la communion du prêtre renouvelle réellement la passion et la mort du Christ, on peut imaginer que cette mort doive être précédée d’une vie, et qu’il naisse de par le monde autant de Christs que l’on compte d’hosties consacrées. (Alfred Jarry, « Saint-Georges de Bouhélier : La Tragédie du nouveau Christ » (article dans La Revue blanche, n°190, 1er mai 1901), repris dans Textes critiques et divers ; Pléiade, tome 2, 1987, p. 614).
. Le courage est un état de calme et de tranquillité en présence d'un danger, état rigoureusement pareil à celui où l'on se trouve quand il n'y a pas de danger. (Alfred Jarry, « Essai de définition du courage » (article dans La Revue blanche, 15 mai 1901), repris dans La Chandelle verte ; Pléiade, tome 2, 1987, p. 296).
. On lira avec plus de fruit le Code en rétablissant en toute son ampleur une expression écrite partout en abrégé : la loi. On doit bien lire : la loi <du plus fort >. Le contexte en fait foi. [7] (Alfred Jarry, « De quelques viols légaux » (article dans La Revue blanche, 1er juillet 1902), repris dans La Chandelle verte ; Pléiade, tome 2, 1987, p. 362).
HENRI-RENÉ LENORMAND (1882-1951)
 . Elle : « Je ne sais pas si une femme peut aimer un être heureux. Celle qui n'a jamais eu un peu pitié de celui qu'elle aime n'a probablement pas connu l'amour. » (Henri-René Lenormand, Les Ratés (1920), tableau 3 ; Théâtre complet, tome I, G. Crès et Cie, 1921, p. 46).
. Elle : « Je ne sais pas si une femme peut aimer un être heureux. Celle qui n'a jamais eu un peu pitié de celui qu'elle aime n'a probablement pas connu l'amour. » (Henri-René Lenormand, Les Ratés (1920), tableau 3 ; Théâtre complet, tome I, G. Crès et Cie, 1921, p. 46).
. Romée : « J’ai tellement poursuivi le bonheur de mes pensées ! Ce n’est pas en vain. Si les passions et les rêves ne pouvaient pas créer des avenirs nouveaux, la vie ne serait qu’une duperie insensée. Autant nous enfermer dans une cage de fer garnie de pointes et nous dire : "Dansez, vous êtes libres !"… La vie ce n’est pas ça !… » — Riemke : « Tu espères, parce que tu es saine. Moi qui rumine sans cesse dans mon coin des pensées ambigües, j’ai moins confiance… […] Destinée, fatalité, n’ont plus de sens pour moi. Je crois que le mot de toutes les énigmes est en nous-mêmes. » (Henri-René Lenormand, Le Temps est un songe (1919), tableau 4 ; Théâtre complet, tome I, G. Crès et Cie, 1921, p. 204).
. Nico : « Nous ne pourrons jamais rien connaître de ce que voient nos yeux, de ce qu'entendent nos oreilles, de ce qui traverse nos cerveaux… […] Rêver n'est rien. L'affreux, c'est de savoir que l'on rêve… C'est de marcher et de savoir qu'il n'y a pas de sol sous nos pas… C'est d'étendre les bras et de savoir qu'ils ne peuvent rien étreindre… car tout est fantômes et reflets de fantômes… » (Henri-René Lenormand, Le Temps est un songe (1919), tableau 5 ; Théâtre complet, tome I, G. Crès et Cie, 1921, p. 214).
. Luc : « La conscience est à la fois scrupuleuse et hypocrite. Elle s'accuse, mais elle fuit devant la vérité, parce qu'elle veut ignorer la cause réelle de ses tourments… » (Henri-René Lenormand, Le Mangeur de rêves (1922), scène 3 ; Théâtre complet, tome II, G. Crès et Cie, 1922, p. 228).
. Belkaçem : « Chacun tire son plaisir de l'instrument dont il joue le mieux. » (Henri-René Lenormand, Le Mangeur de rêves (1922), scène 9 ; Théâtre complet, tome II, G. Crès et Cie, 1922, p. 287).
. Albert : « Je ne crois pas aux monstres. Là où il cesse de se connaître, le plus pur d'entre nous devient un monstre… Mais un monstre mené par l'amour, par une telle fureur d'exister, par une telle soif de bonheur, qu'il crée des mondes pour résister à la mort, qu'il nargue les morts eux-mêmes ou les appelle à la rescousse pour assurer sa joie. Oui, l'amour, en nous, se sert de toutes les armes. Il peut ressusciter les cadavres par magie et les renvoyer au tombeau chargés de fautes. » (Henri-René Lenormand, L'Amour magicien (1926), acte III, tableau 6, scène 1 ; Théâtre complet, tome VI, G. Crès et Cie, 1929, p. 101).
JEAN GIRAUDOUX (1882-1945) : Voir page spéciale
CHARLES MÉRÉ (1883-1970)
[citation en attente de vérification]
SACHA GUITRY (1885-1957) : [page spéciale en préparation]
JULES ROMAINS (1885-1972) : Voir page dévolue aux romanciers français de la première moitié du XXe siècle
FERNAND CROMMELYNCK (1886-1970)
. Bruno : « Il y a plus d’héroïsme à souffrir longtemps qu’à mourir vite. » (Fernand Crommelynck, Le Cocu magnifique (1921), acte II ; dans Théâtre, tome I, Gallimard, 1967, p. 71).
 . Françoise : « Quand une femme s’engage à vous aimer, il ne faut pas toujours la croire. Mais quand elle s’engage à ne pas vous aimer, eh bien ! il ne faut pas trop la croire non plus. » (Édouard Bourdet, La Prisonnière (1926), acte II ; dans Théâtre complet, tome I bis, Stock, 1960, p. 258).
. Françoise : « Quand une femme s’engage à vous aimer, il ne faut pas toujours la croire. Mais quand elle s’engage à ne pas vous aimer, eh bien ! il ne faut pas trop la croire non plus. » (Édouard Bourdet, La Prisonnière (1926), acte II ; dans Théâtre complet, tome I bis, Stock, 1960, p. 258).
. Jacqueline : « Quand on peut se regarder souffrir et raconter ensuite ce qu’on a vu, c’est qu’on est né pour la littérature !… » (Édouard Bourdet, Vient de paraître (1927), acte IV ; dans Théâtre complet, tome II, Stock, 1954, p. 216-217).
. Jérôme : « L’argent, c’est comme les femmes : pour le garder, il faut s’en occuper un peu ou alors… il va faire le bonheur de quelqu’un d’autre ! » (Édouard Bourdet, Les Temps difficiles (1934), acte IV ; dans Théâtre complet, tome III, Stock, 1949, p. 396).
. Jérôme : « La confiance ? Connais pas !… Je n’ai confiance dans les gens qu’autant que je sais et qu’autant qu’ils savent que je peux les contrôler ! » (Édouard Bourdet, Les Temps difficiles (1934), acte IV ; dans Théâtre complet, tome III, Stock, 1949, p. 401).
. Jérôme : « Il faut choisir dans la vie entre gagner de l’argent et le dépenser : on n’a pas le temps de faire les deux. » (Édouard Bourdet, Les Temps difficiles (1934), acte IV ; dans Théâtre, tome III, Stock, 1949, p. 406).
JEAN COCTEAU (1889-1963) : [page spéciale en préparation]
MAURICE ROSTAND (1891-1968) : [à compléter]
MARCEL PAGNOL (1895-1974) : voir page spéciale
HENRY de MONTHERLANT (1895-1972) : [page spéciale en préparation]
MICHEL de GHELDERODE (1898-1962)
. « Misère ! […] que les jours donnés par Dieu sont longs à traîner ! que la vie est insipide à qui n’a pas le tempérament du pécheur ! que l’éternité est insupportable sous une administration autre que celle du diable !… » (Michel de Ghelderode, Sortilèges et autres contes crépusculaires (1941), « Le diable à Londres » ; éd. Gérard & Cie, coll. Marabout Géant n°234, 1962, p. 41).
. Ce que nous avons intensément désiré finit presque toujours par advenir une fois ; mais telle est l'insatisfaction perpétuelle du cœur que nous ne le reconnaissons pas, ou que ce qui advient ne paraît plus correspondre au rêve qu'on en fit. (Michel de Ghelderode, Sortilèges et autres contes crépusculaires (1941), « Le jardin malade », incipit ; éd. Gérard & Cie, coll. Marabout Géant n°234, 1962, p. 61).
ROGER-FERDINAND (1898-1967)
[à compléter]
. La gouvernante : « Même puceau, un homme est un homme, même puceau, même tout seul. Mais une femme n'est entière qu'autant qu'elle est une moitié. » (Jacques Audiberti, Le Mal court (1947), acte I ; Folio-théâtre n°35, 1996, p. 38 ; ou Théâtre, tome I, Gallimard, 1948, p. 136).
. Blaise : « La vie est faite d'illusions. Parmi ces illusions, certaines réussissent. Ce sont celles qui constituent la réalité. » (Jacques Audiberti, L'Effet Glapion (1959), acte I ; Livre de poche n°911 Le Mal court, 1962, p. 141).
 . Marceline : « L'amour, c'est être toujours inquiet de l'autre ; c’est se dire : "Où est-il ?", "Que fait-il ?", "Pourquoi était-il en retard au rendez-vous ?" […] L’amour […], c’est se dire : "Qu’est-ce qu’il va penser de cette robe ?", "Pourvu qu’il ne se fâche pas de cette réflexion que j’ai faite ?" » (Marcel Achard, Jean de la Lune (1929), acte III, scène 4 ; Livre de poche n°2458, 1968, p. 174).
. Marceline : « L'amour, c'est être toujours inquiet de l'autre ; c’est se dire : "Où est-il ?", "Que fait-il ?", "Pourquoi était-il en retard au rendez-vous ?" […] L’amour […], c’est se dire : "Qu’est-ce qu’il va penser de cette robe ?", "Pourvu qu’il ne se fâche pas de cette réflexion que j’ai faite ?" » (Marcel Achard, Jean de la Lune (1929), acte III, scène 4 ; Livre de poche n°2458, 1968, p. 174).
. Marceline : « Quelle explication donnes-tu à ma conduite ? » — Jef : « Aucune. Avec les femmes, il ne faut pas chercher à comprendre. » (Marcel Achard, Jean de la Lune (1929), acte III, scène 4 ; Livre de poche n°2458, 1968, p. 176).
. Corcoran : « Vois-tu, il n’y a que deux armes contre les femmes : la foi et la mauvaise foi. » (Marcel Achard, Pétrus (1935), acte II, scène 3 ; dans Théâtre I, Gallimard, 1942, p. 237).
. Georgia : « Je suis égoïste. » — Frank : « Moi aussi. Mais l'amour, c'est peut-être d'être égoïstes ensemble. » (Marcel Achard, Le Corsaire (1938), acte II, tableau 2 ; dans Théâtre I, Gallimard, 1942, p. 162).
. Rollo : « Les malheureux sont ingrats. Si j'acceptais ma malchance, je la justifierais. » (Marcel Achard, Patate (1957), acte I ; Livre de poche n°2648, 1969, p. 23).
 . Ulysse : « Pas même Dieu ne réalise ses désirs. Du moins, il faut l’espérer, pour lui pardonner la vie qu’il nous fait mener. » (Armand Salacrou, L’Inconnue d’Arras (1935), acte III ; Livre de poche n°2321, 1968, p. 156).
. Ulysse : « Pas même Dieu ne réalise ses désirs. Du moins, il faut l’espérer, pour lui pardonner la vie qu’il nous fait mener. » (Armand Salacrou, L’Inconnue d’Arras (1935), acte III ; Livre de poche n°2321, 1968, p. 156).
. Bartholomeo : « Notre existence est l'addition de journées qui s'appellent toutes aujourdhui. Pour se présenter à nous, demain change de nom et se nomme aujourdhui. Une seule journée s'appelle demain : celle que nous ne connaîtrons pas. » (Armand Salacrou, La Terre est ronde (1938), acte I, scène 1 ; dans Théâtre, tome IV, Gallimard, 1945, p. 19).
. Luc : « Pourquoi pleurer les morts ? Ils ne sont plus en danger. C’est pour les vivants qu’il faut trembler. » (Armand Salacrou, Boulevard Durand (1960), acte I, scène 2 ; Folio n°779, 1972, p. 43).
. Luc : « L’avenir ? Mais l’avenir n’existe pas. L’avenir, c’est déjà le passé de nos enfants. » (Armand Salacrou, Boulevard Durand (1960), acte I, scène 2 ; Folio n°779, 1972, p. 51).
. C’est jusqu’au mystère dont s’entoure la divinité qui m’éloigne d’elle. Cherchez et vous trouverez. Mieux : si vous cherchez c’est que vous avez déjà trouvé. Ce jeu de cache-tampon m’a toujours soulevé le cœur. Dieu jouant aux dés avec le salut éternel de ses créatures ! L'existence d'une création sans Dieu, sans but, me paraît moins absurde que la présence d'un Dieu existant dans sa perfection et créant un homme imparfait afin de lui faire courir les risques d'une punition infernale. (Armand Salacrou, Note sur mes certitudes et incertitudes morales et politiques (1953), dans Théâtre, tome VI, Gallimard, 1954, p. 209).
STÈVE PASSEUR (1899-1966)
[citation en attente de vérification]
ROGER VITRAC (1899-1952)
[à compléter]
MARCEL AYMÉ (1902-1967) : Voir page dévolue aux romanciers français de la première moitié du XXe siècle
JEAN TARDIEU (1903-1995)
[citation en attente de vérification]
JEAN-PAUL SARTRE (1905-1980) : [page spéciale en préparation]
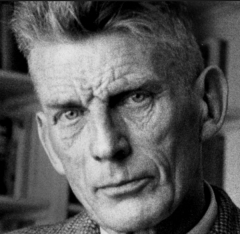 . Ma vie, ma vie, tantôt j'en parle comme d'une chose finie, tantôt comme d'une plaisanterie qui dure encore, et j'ai tort, car elle est finie et elle dure à la fois, mais par quel temps du verbe exprimer celà ? (Samuel Beckett, Molloy (1951), I ; 10/18 n°81-82, 1971, p. 46).
. Ma vie, ma vie, tantôt j'en parle comme d'une chose finie, tantôt comme d'une plaisanterie qui dure encore, et j'ai tort, car elle est finie et elle dure à la fois, mais par quel temps du verbe exprimer celà ? (Samuel Beckett, Molloy (1951), I ; 10/18 n°81-82, 1971, p. 46).
. Hamm : « Quelle heure est-il ? » — Clov : « La même que d’habitude ». (Samuel Beckett, Fin de partie, éd. Minuit, 1957, p. 18).
. Nell : « Rien n’est plus drôle que le malheur. » (Samuel Beckett, Fin de partie, éd. Minuit, 1957, p. 33).
. Hamm : « Vous n’avez pas fini ? Vous n’allez donc jamais finir ? Ça ne va donc jamais finir ? Mais de quoi peuvent-ils parler, de quoi peut-on parler encore ? » (Samuel Beckett, Fin de partie, éd. Minuit, 1957, p. 38).
. Le vieux : « L’anglais parle à l’imagination. On comprend et on ne comprend pas. […] Pensez un peu à la messe. Est-ce qu’elle est dite en français, la messe ? Et l’Église sait ce qu’elle fait. L'Église, voilà l'homme d'affaires, des grandes affaires durables !… » (Arthur Adamov, Le Ping-pong (1955), partie I, tableau 2 ; dans Théâtre, tome II, 1955, p. 115).
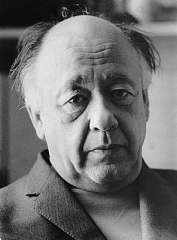 . Bérenger : « Vous avez certainement de l'amour-propre, le culte de votre intelligence. Rien n'est plus gênant que d'être sot. C'est beaucoup plus compromettant que d'être criminel, même la folie a une auréole. Mais être sot ? Être bête, qui peut accepter ça ? » (Eugène Ionesco, Tueur sans gages (1957) ; Pléiade, 1991, p. 534).
. Bérenger : « Vous avez certainement de l'amour-propre, le culte de votre intelligence. Rien n'est plus gênant que d'être sot. C'est beaucoup plus compromettant que d'être criminel, même la folie a une auréole. Mais être sot ? Être bête, qui peut accepter ça ? » (Eugène Ionesco, Tueur sans gages (1957) ; Pléiade, 1991, p. 534).
. Édouard : « N’y allez pas. Penser contre son temps c'est de l'héroïsme. Mais le dire, c'est de la folie. » (Eugène Ionesco, Tueur sans gages, acte III, version de 1957 ; Pléiade, 1991, p. 1655).
. Dudard : « Malheur à celui qui voit le vice partout. C’est le propre des inquisiteurs. » (Eugène Ionesco, Rhinocéros (1959), acte III ; Pléiade, 1991, p. 616).
. Dudard : « Vous me semblez bien sûr de vous. Peut-on savoir où s’arrête le normal, où commence l’anormal ? Vous pouvez définir ces notions, vous, normalité, anormalité ? Philosophiquement et médicalement, personne n’a pu résoudre le problème. » (Eugène Ionesco, Rhinocéros (1959), acte III ; Pléiade, 1991, p. 616).
. Daisy : « J’en ai un peu honte, de ce que tu appelles l’amour, ce sentiment morbide, cette faiblesse de l’homme. Et de la femme. » (Eugène Ionesco, Rhinocéros (1959), acte III ; Pléiade, 1991, p. 635).
. Bérenger : « Malheur à celui qui veut conserver son originalité ! Eh bien tant pis ! Je me défendrai contre tout-le-monde ! » (Eugène Ionesco, Rhinocéros (1959), acte III ; Pléiade, 1991, p. 638).
. Marguerite : « Il s’imagine qu’il est le premier à mourir. » — Marie : « Tout-le-monde est le premier à mourir. » (Eugène Ionesco, Le Roi se meurt (1962) ; Pléiade, 1991, p. 761).
. Le roi : « Pourquoi suis-je né si ce n'était pas pour toujours ? […] Je suis venu au monde il y a cinq minutes, je me suis marié il y a trois minutes. […] Pas eu le temps de dire "ouf !" Je n’ai pas eu le temps de connaître la vie. » (Eugène Ionesco, Le Roi se meurt (1962) ; Pléiade, 1991, p. 764).
. Le roi : « Que tous meurent pourvu que je vive éternellement même tout seul dans le désert sans frontières. Je m'arrangerai avec la solitude. Je garderai les souvenirs des autres, je le regretterai sincèrement. Je peux vivre dans l'immensité transparente du vide. Il vaut mieux regretter que d'être regretté. Dailleurs on ne l’est pas. » (Eugène Ionesco, Le Roi se meurt (1962) ; Pléiade, 1991, p. 768).
. Le roi : « Ils sont tous des étrangers. Je croyais qu’ils étaient ma famille. J’ai peur, je m’enfonce, je m’engloutis, je ne sais plus rien, je n’ai pas été. Je meurs. » (Eugène Ionesco, Le Roi se meurt (1962) ; Pléiade, 1991, p. 769).
. Le médecin : « Tant qu'on est vivant, tout est prétexte à littérature. » (Eugène Ionesco, Le Roi se meurt (1962) ; Pléiade, 1991, p. 769).
. « Quelle est votre conception de la vie et de la mort ? » me demandait un journaliste sud-américain lorsque je descendais la passerelle du bateau avec mes valises à la main. Je posai mes valises, essuyai la sueur de mon front et le priai de m’accorder vingt ans pour réfléchir à la question, sans toutefois pouvoir l’assurer qu’il aura[it] la réponse. « C’est bien ce que je me demande, lui dis-je, et j’écris pour me le demander. » (Eugène Ionesco, Notes et contre-notes, « L’auteur et ses problèmes » (1962) ; Folio-essais n°163, 1991, p. 14).
. La moindre chose que l’on puisse attendre de la part des critiques serait l’objectivité dans la subjectivité, c’est-à-dire la bonne foi. (Eugène Ionesco, Notes et contre-notes, « Propos sur mon théâtre et sur les propos des autres » (1960) ; Folio-essais n°163, 1991, p. 107). 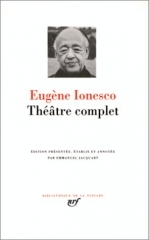
. Le succès est souvent un malentendu, un échec masqué. (Eugène Ionesco, Notes et contre-notes (1966), « Bouts de réponse à une enquête » ; Folio-essais n°163, 1991, p. 181).
. Vouloir être de son temps c'est déjà être dépassé. (Eugène Ionesco, Notes et contre-notes (1966), titre de la quatrième partie ; Folio-essais n°163, 1991, p. 289).
. Ce n’est que pour les faibles d’esprit que l’Histoire a toujours raison. Dès qu’une idéologie devient dominante, c’est qu’elle a tort. (Eugène Ionesco, Notes et contre-notes, « Notes sur le théâtre » (1960) ; Folio-essais n°163, 1991, p. 309).
. Mes contemporains m’agacent. Je déteste mon voisin de droite, je déteste celui qui est à ma gauche. Je déteste surtout celui de l’étage du dessus. Autant, dailleurs, que celui du rez-de-chaussée. (Tiens, c’est moi qui habite au rez-de-chaussée.) Tout le monde a tort. J’envie les contemporains des gens qui vivaient il y a deux siècles… Non : ils sont encore trop près de nous. Je ne pardonne qu’à ceux qui vivaient bien avant Jésus-Christ. / Et pourtant, lorsque mes contemporains meurent, j’en ressens une peine énorme. Une peine ? Une peur plutôt, une frayeur immense. C’est compréhensible. Je me sens de plus en plus seul. Que puis-je faire sans eux ? Que vais-je faire parmi « les autres » ? Pourquoi « les autres » ne sont-ils pas morts à leur place ? Je voudrais décider moi-même ; Choisir ceux qui doivent rester. (Eugène Ionesco, Notes et contre-notes, « Notes sur le théâtre » (1960) ; Folio-essais n°163, 1991, p. 309-310).
. L’histoire me paraît être une suite ininterrompue d’aberrations. Elle est ce qui s’oppose aux « vérités ». Dès qu’une idée, une intention consciente veut se réaliser historiquement, elle s’incarne en son contraire, elle est monstrueuse. (Eugène Ionesco, Notes et contre-notes, « Notes sur le théâtre » (1960) ; Folio-essais n°163, 1991, p. 311).
. Parfois, la vie semble tellement belle. On est tenté de dire merci à la Providence. Il ne faut pas. Il vaut mieux bouder. La Providence aime peut-être les boudeurs : elle essaie de les amadouer. (Eugène Ionesco, Journal en miettes, Mercure de France, 1967, p. 79).
. Envie de tuer des vieillards. Les vieillards sont immondes. Les jeunes sont médiocres et stupides. J’ai toujours détesté les jeunes, surtout quand j’étais jeune. La cour que les maîtres à penser, en quête de clientèle, font à la jeunesse, est une des choses les plus pénibles que je connaisse. Quel manque de dignité, quelle lâcheté, quel non-sens ! (Eugène Ionesco, Journal en miettes, Mercure de France, 1967, p. 126).
. Tout-le-monde veut diriger tout-le-monde. Tout-le-monde s’oppose à être dirigé par tout-le-monde. Ainsi s’établit un équilibre pour le moins dynamique. (Eugène Ionesco, Présent passé Passé présent, II, Mercure de France, 1968, p. 83).
. Le seul souci qui élève l'homme au-dessus de lui-même, c'est le souci de l'absolu, je veux dire la hantise, le désir essentiel de l'absolu. Notre époque est une époque déchue, parce que, à la préoccupation de l'absolu s'est substitué le problème politique, la fureur politique ; lorsque l'homme ne se préoccupe plus des problèmes des fins dernières, lorsque seul l'intéresse le destin d'une nation politique, de l'économie, lorsque les grands problèmes métaphysiques ne font plus souffrir, laissent indifférent, l'humanité est dégradée, elle devient bestiale. (Eugène Ionesco, Présent passé Passé présent, II, Mercure de France, 1968, p. 64).
. 1941. […] Il faut mettre l’accent sur ce qui nous identifie, non pas sur ce qui nous sépare. 1967. Celà dépend : quelquefois c’est la différence qui est plus intéressante que la ressemblance. Il en est ainsi, par exemple, pour les œuvres d’art. (Eugène Ionesco, Présent passé Passé présent, IV, Mercure de France, 1968, p. 153).
. On peut formuler ce qui n’est pas encore formulé, mais on ne peut pas arriver à dire ce qui est indicible. Si la littérature ne peut le dire, si la mort ne peut pas être interprétée, si l’indicible ne peut pas être dit, à quoi bon, alors, la littérature ? (Eugène Ionesco, « Notes retrouvées », article paru dans Les Nouvelles littéraires le 25 février 1971 ; repris dans Antidotes, IV, Gallimard, 1977, p. 258).
. Longtemps j’ai cru que les hommes se détestaient eux-mêmes à travers les autres, je crois à présent que chaque homme n’aime que soi-même et déteste tout le reste de l’humanité. (Eugène Ionesco, « La chasse à l’homme », article paru dans Le Figaro littéraire le 6 mai 1972 ; repris dans Antidotes, I, Gallimard, 1977, p. 43-44).
. Toute bonne littérature est antilittéraire, elle ne devient littéraire qu’à partir du moment où elle est épuisée, où le nouveau style vieillit, où le langage demande à être renouvelé. À ce moment, une autre antilittérature, un anti-art nouveau nous restitueront l’art et la littérature. (Eugène Ionesco, « Toute la culture a été faite par les ennemis de la culture », article paru dans Le Figaro littéraire le 19 mai 1973 ; repris dans Antidotes, II, Gallimard, 1977, p. 159). 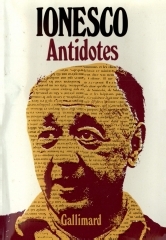
. Avez-vous remarqué, dans la critique littéraire, que les critiques « linguistiques » ou plus ou moins ou soi-disant « structuralistes » qui voulaient une approche plus pure, plus objective et scientifique d’un texte littéraire sont, bien souvent, les critiques les plus aberrants, les plus subjectifs, les moins scientifiques parce qu’ils sont les plus passionnés et les plus politisés. C’est aussi le cas de la critique psychanalytique ou marxiste, plutôt fanatiques l’une et l’autre. La critique humaniste ou impressionniste arrivait à mieux cerner l’œuvre. La critique nouvelle fausse tout. Ses « idées », ses opinions ne sont en fait que les reflets de ses passions, aurait dit Julien Benda. Elle a rendu la compréhension de l’œuvre tout-à-fait impossible. L’œuvre est une construction. Cette critique devient une construction à côté de la construction. Sans compter que le plus souvent […] elle n’est pas un langage, elle est un jargon. (Eugène Ionesco, « S’expliquer dans l’inexplicable », interviou avec Jean-Jacques Brochier parue dans Le Magazine littéraire n°81 en octobre 1973 ; repris dans Antidotes, III, Gallimard, 1977, p. 224).
. Les herbes, les plantes ont tendance à vouloir occuper le domaine vital des autres, à les suffoquer, à les supprimer. […] S’étendre au détriment des autres, c’est un impérialisme instinctif et profond, biologique, qui habite les plantes, les créatures, les hommes, les nations. (Eugène Ionesco, « La culture n’est pas l’affaire de l’État », article paru dans Le Figaro littéraire le 3 août 1974 ; repris dans Antidotes, II, Gallimard, 1977, p. 155).
. Certains de mes critiques me traitent souvent de fumiste, d’imposteur. C’est parce que je suis d’une sincérité totale. Dans leur médiocrité, ils ne peuvent imaginer que je sois si préoccupé, absorbé, par le problème du mal et du bien, par celui de l’impossibilité de la connaissance, par celui de l’existence, par le malaise existentiel, par celui des fins dernières de l’homme, etc. en effet, pour eux, tout n’est que combines. Je me livre à eux, je prête le flanc à leurs critiques, je me présente à eux avec mon vrai visage. C’est pour cette raison qu’ils m’accusent de mentir. Ils ne parlent que de succès ou d’insuccès, de réussite, de « ma carrière théâtrale », de la place que je mérite ou ne mérite pas d’avoir dans les Lettres. (Eugène Ionesco, « Bribes d’idées », article paru dans Il Giornale le 6 janvier 1975 ; repris dans Antidotes, III, Gallimard, 1977, p. 187-188).
. Ne pas penser comme les autres vous met dans une situation bien désagréable. Ne pas penser comme les autres, celà veut dire simplement que l’on pense. Les autres, qui croient penser, adoptent, en fait, sans réfléchir, les slogans qui circulent, ou bien, ils sont la proie de passions dévorantes qu’ils se refusent d’analyser. Pourquoi refusent-ils, ces autres, de démonter les systèmes de clichés, les cristallisations de clichés qui constituent leur philosophie toute faite, comme des vêtements de confection ? En premier lieu, évidemment, parce que les idées reçues servent leurs intérêts ou leurs impulsions, parce que celà donne bonne conscience et justifie leurs agissements. Nous savons tous que l’on peut commettre les crimes les plus abominables au nom d’une cause « noble et généreuse ». Il y a aussi le cas de ceux, nombreux, qui n’ont pas le courage de ne pas avoir « des idées comme tout-le-monde, ou des réactions communes ». Celà est d’autant plus ennuyeux que c’est, presque toujours, le solitaire qui a raison. C’est une poignée de quelques hommes, méconnus, isolés au départ, qui change la face du monde. La minorité devient la majorité. Lorsque les « quelques-uns » sont devenus les plus nombreux et les plus écoutés, c’est à ce moment-là que la vérité est faussée. (Eugène Ionesco, « Oser ne pas penser comme les autres », article paru dans Il Giornale en janvier 1975 ; repris dans Antidotes, introduction, Gallimard, 1977, p. 11-12).
. Sans Dieu la littérature n’a aucun sens, aucune importance. Et s’il y a Dieu, il vaut quand même mieux faire autre chose que de la littérature. (Eugène Ionesco, « Témoignage sur l’Église d’aujourdhui », interviou avec le père Lendger, parue dans Les Quatre saisons du théâtre et de la musique le 10 novembre 1975 ; reprise dans Antidotes, III, Gallimard, 1977, p. 244).
. Je ne veux pas dire que le théâtre doit déplaire au public, mais il ne doit pas tenir compte du fait de lui plaire ou de lui déplaire. Le public, même averti, est enclin à la facilité et à la paresse. (Eugène Ionesco, « Sauver la culture », article paru dans Le Figaro le 28 juillet 1976 ; repris dans Antidotes, II, Gallimard, 1977, p. 174).
. Pour moi, les deux plus grands hommes de l’histoire moderne, plus grands que Mao, furent Churchill […], et Charles de Gaulle, qui ne s’aplatissait pas non plus, qui ne prit pas Hitler pour un surhomme, et qui refit de la France un grand pays, qui n’est plus un grand pays depuis qu’il a disparu. Je dirai un jour pourquoi il est nécessaire que la France soit un grand pays. (Eugène Ionesco, « Agenouillés devant Mao », article paru dans Le Figaro le 30 septembre 1976 ; repris dans Antidotes, I, Gallimard, 1977, p. 115).
. Bien que le travail soit ennuyeux, c’est encore plus ennuyeux de ne pas travailler du tout. (Eugène Ionesco, « Quelques nouvelles raisons de désespérer », article paru dans la N.R.F. en avril 1978 ; repris dans Un homme en question, Gallimard, 1979, p. 99).
. Un dictionnaire de la littérature française contemporaine vient de paraître. Quelle pauvreté ! Aucun des écrivains de notre temps, moi inclus, bien entendu, ne présente une valeur spirituelle, sauf les négateurs comme Cioran. […] Toute la littérature contemporaine : des mots, des idées reçues, des clichés. Aucune raison d’exister ne nous est proposée. Ils vagissent dans les ténèbres ou dans le brouillard. C’est le désarroi. […] Je me demande, je me le demande contre moi-même, si finalement les États autoritaires n'ont pas raison de faire fi de la littérature. (Eugène Ionesco, « Quelques nouvelles raisons de désespérer », article paru dans la N.R.F. en avril 1978 ; repris dans Un homme en question, Gallimard, 1979, p. 106).
. On ne peut être heureux que si on se désintéresse de tout. Heureux ou, au moins, calmes. De toute façon la loi biologique vous punira. […] / Pour pouvoir supporter l’insupportable, je m’accroche désespérément à l’idée que tout ce qui m’entoure n’est pas vrai, le monde n’est pas vrai. (Eugène Ionesco, « Un mois plus tard », article paru dans la N.R.F. en août 1978 ; repris dans Un homme en question, Gallimard, 1979, p. 117).
JEAN ANOUILH (1910-1987) : [page spéciale en préparation]
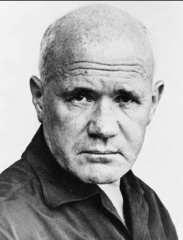 . Le jardinier est la plus belle rose de son jardin. (Jean Genet, Pompes funèbres (1947) ; Œuvres complètes, tome III, Gallimard, 1953, p. 36).
. Le jardinier est la plus belle rose de son jardin. (Jean Genet, Pompes funèbres (1947) ; Œuvres complètes, tome III, Gallimard, 1953, p. 36).
. Heureusement, elles ne sont pas énoncées à haute voix, et, quand au fond de vous des mots très précis ne les formulent pas, de certaines pensées la cruauté est terrible. Que de morts j’ai pu souhaiter ! En moi-même je garde un charnier dont la poésie aurait à répondre. Que de cœurs dévorés, de gorges traversées, tranchées, de poitrines ouvertes, que de mensonges, d’armes empoisonnées, de baisers ! Je suis surpris par le jour, surpris par mon jeu cruel et ridicule. On me dit que l'officier allemand qui commanda le carnage d'Oradour avait un visage assez doux, plutôt sympathique. Il a fait ce qu'il a pu – beaucoup – pour la poésie. Il a bien mérité d'elle. Mes morts rarement osent exprimer ma cruauté. J'aime et respecte cet officier. (Jean Genet, Pompes funèbres (1947) ; Œuvres complètes, tome III, Gallimard, 1953, p. 137).
. Je désire un instant porter une attention aigüe sur la réalité du suprême bonheur dans le désespoir : quand on est seul, soudain, en face de sa perte soudaine, lorsqu’on assiste à l’irrémédiable destruction de son œuvre et de soi-même. Je donnerais tous les biens de ce monde – il faut en effet les donner – pour connaître l’état désespéré – et secret – que personne ne sait que je sais. Hitler seul, dans les caves de son palais, aux dernières minutes de la défaite de l’Allemagne, connut sûrement cet instant de pure lumière – lucidité fragile et solide – la conscience de sa chute. (Jean Genet, Journal du voleur (1949) ; Folio n°493, 1982, p. 236-237).
. Les révolutionnaires risquent de s’égarer dans trop de miroirs. Il faut pourtant des moments saccageurs et pillards, côtoyant le fascisme, y tombant quelquefois momentanément, s’en arrachant, y revenant avec plus d’ivresse. (Jean Genet, Un captif amoureux, II, Gallimard, 1986, p. 350).
. Je ne croyais pas en Dieu. L’idée de hasard, combinaison aléatoire de faits, combine même d’évènements, d’astres, d’êtres, devant à eux-mêmes ce qu’ils sont, cette idée me paraissait plus élégante et rigolote que celle d’un Dieu-Un [8]. Le poids de la foi écrase quand le hasard allège et rit. Il rend joyeux et curieux, donc souriant. (Jean Genet, Un captif amoureux, II, Gallimard, 1986, p. 426).
. Mais si Dieu était mort pour de bon ? Personnellement, je n’ai pas de lumières à ce sujet, mais on dirait vraiment qu’il se cache en ce moment. / Et si Dieu était mort pour de bon ? (Jean Genet, « Un salut aux cent-milles étoiles » (septembre 1968), article paru dans Evergreen Review, décembre 1968 ; repris dans L’Ennemi déclaré. Textes et entretiens, Gallimard, 1991, p. 328).
. Tous les actes révolutionnaires ont une fraîcheur de commencement du monde. Mais un geste ou un ensemble de gestes symboliques sont idéalistes en ce sens qu’ils comblent les hommes qui les accomplissent ou qui adoptent le symbole, les empêchent de réaliser des actes réels, au pouvoir irréversible. Je crois qu’une attitude symbolique est, à la fois, la bonne conscience libérale et une situation qui fait croire que tout a été tenté pour la révolution. Il vaut mieux accomplir des actes réels et apparemment de peu d'envergure que des manifestations théâtrales et vaines. (Jean Genet, interviou avec Michèle Manceaux, parue dans Le Nouvel observateur n°289, 25 mai 1970 ; reprise dans De Sartre à Foucault. Vingt ans de grands entretiens dans Le Nouvel observateur, Hachette, 1984, p. 38 ; puis dans Jean Genet, L’Ennemi déclaré. Textes et entretiens, Gallimard, 1991, p. 57).
. Je crois que Brecht n’a rien fait pour le communisme, que la révolution n’a pas été provoquée par Le Mariage de Figaro de Beaumarchais. Que plus une œuvre est proche de la perfection, plus elle se referme sur elle-même. Pis que ça, elle suscite la nostalgie ! (Jean Genet, interviou avec Michèle Manceaux, parue dans Le Nouvel observateur n°289, 25 mai 1970 ; reprise dans De Sartre à Foucault. Vingt ans de grands entretiens dans Le Nouvel observateur, Hachette, 1984, p. 40 ; puis dans Jean Genet, L’Ennemi déclaré. Textes et entretiens, Gallimard, 1991, p. 62).
. Il ne faut jamais l’oublier : la droite est triviale. Elle a besoin de plastrons, d’amidon, de dorure, de ripolin, comme l’a dit Chaban-Delmas qui sait de qui il parle. Autant d’esbroufes qui n’ont d’autre but que celui de dissimuler la vulgarité des moyens. Jamais la droite n’utilise un mot nu. Si l’une de ses grandes ruses c’est l’habillage, la mascarade, l’empesage des mots et des pensées, l’extrême-gauche devrait trembler. (Jean Genet, « Quand le pire est toujours sûr » (début mai 1974), article inédit repris dans L’Ennemi déclaré. Textes et entretiens, Gallimard, 1991, p. 127). 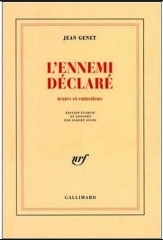
. La mort transforme tout, les perspectives changent ; tant qu’un homme est vivant, tant qu’il peut infléchir sa pensée, tant qu’il peut, vivant, donner le change, tant qu’il peut essayer de dissimuler sa véritable personnalité, par des négations ou des affirmations, on ne sait pas très bien de qui il s’agit. Une fois mort, tout se dégonfle. L’homme est fixé et on voit autrement son image. (Jean Genet, Entretien avec Hubert Fichte (19-21 décembre 1975), paru dans Die Zeit le 13 février 1976 ; repris dans L’Ennemi déclaré. Textes et entretiens, Gallimard, 1991, p. 154).
. Si nous réfléchissons à n’importe quel phénomène vital, selon même sa plus étroite signification qui est : biologique, nous comprenons que violence et vie sont à peu près synonymes. Le grain de blé qui germe et fend la terre gelée, le bec du poussin qui brise la coquille de l’œuf, la fécondation de la femme, la naissance d’un enfant relèvent d’accusation de violence. Et personne ne met en cause l’enfant, la femme, le poussin, le bourgeon, le grain de blé. (Jean Genet, « Violence et brutalité », préface à Textes des prisonniers de la Fraction Armée Rouge, parue dans Le Monde le 2 septembre 1977 ; repris dans L’Ennemi déclaré. Textes et entretiens, Gallimard, 1991, p. 199).
. Comme les exemples de violence nécessaire sont incalculables, les faits de brutalité le sont aussi puisque la brutalité vient s’opposer toujours à la violence. Je veux dire encore à une dynamique ininterrompue qui est la vie même. La brutalité prend donc les formes les plus inattendues, pas décelables immédiatement comme brutalité : l’architecture des H.L.M., la bureaucratie, le remplacement du mot – propre ou connu – par le chiffre, la priorité, dans la circulation, donnée à la vitesse sur la lenteur des piétons, l’autorité de la machine sur l’homme qui la sert, la codification des lois prévalant sur la coutume, la progression numérique des peines, l’usage du secret empêchant une connaissance d’intérêt général, l’inutilité [9] de la gifle dans les commissariats, le tutoiement policier envers qui a la peau brune, la courbette obséquieuse devant le pourboire et l’ironie ou la grossièreté s’il n’y a pas de pourboire, la marche au pas de l’oie, le bombardement d’Haïphong, la Rolls-Royce de quarante millions… Bien sûr, aucune énumération ne saurait épuiser les faits, qui sont comme les avatars multiples par lesquels la brutalité s’impose. (Jean Genet, « Violence et brutalité », préface à Textes des prisonniers de la Fraction Armée Rouge, parue dans Le Monde le 2 septembre 1977 ; repris dans L’Ennemi déclaré. Textes et entretiens, Gallimard, 1991, p. 200).
. Un gosse qui va en prison, il y retourne parce qu’il se dit : après tout, pourquoi pas ? Tant qu’il n’a pas connu la prison, il en a peur. Quand il y retourne, il se dit : c’est pas grave, je peux y retourner. On a bien moins peur de la prison quand on l’a connue que quand on ne l’a pas connue. (Jean Genet, Entretien avec Antoine Bourseiller (été 1981) ; repris dans L’Ennemi déclaré. Textes et entretiens, Gallimard, 1991, p. 224).
. Nous acceptions très volontiers cette morale médiévale qui fait qu’un vassal obéit au suzerain, donc une hiérarchie très, très nette et basée sur la force, sur l’honneur, sur ce qu’on appelle encore l’honneur et sur la parole donnée, qui était très importante. Tandis que, maintenant, tout repose sur l’écrit au contraire, sur le contrat signé, daté devant le notaire, devant les syndicats etc. (Jean Genet, Entretien avec Antoine Bourseiller (été 1981) ; repris dans L’Ennemi déclaré. Textes et entretiens, Gallimard, 1991, p. 225).
. Je hasarde une explication : écrire, c’est le dernier recours qu’on a quand on a trahi. […] Écrire, c’est peut-être ce qui vous reste quand on est chassé du domaine de la parole donnée. (Jean Genet, Entretien avec Antoine Bourseiller (été 1981) ; repris dans L’Ennemi déclaré. Textes et entretiens, Gallimard, 1991, p. 225-226).
. Une révolution en est-elle une quand elle n’a pas fait tomber des visages et des corps la peau morte qui les avachissait. Je ne parle pas d’une beauté académique, mais de l’impalpable – innommable – joie des corps, des visages, des cris, des paroles qui cessent d’être mortes, je veux dire une joie sensuelle et si forte qu’elle veut chasser tout érotisme. (Jean Genet, « Quatre heures à Chatila » (octobre 1982), article paru dans la Revue d’études palestiniennes, janvier 1983 ; repris dans L’Ennemi déclaré. Textes et entretiens, Gallimard, 1991, p. 261-262).
. Le combat pour un pays peut remplir une vie très riche, mais courte. C’est le choix, on s’en souvient, d’Achille dans L’Iliade. (Jean Genet, « Quatre heures à Chatila » (octobre 1982), article paru dans la Revue d’études palestiniennes, janvier 1983 ; repris dans L’Ennemi déclaré. Textes et entretiens, Gallimard, 1991, p. 264).
ANDRÉ ROUSSIN (1911-1987) [10]
 . Edgar : « Les phrases définitives sont quelquefois celles sur lesquelles on revient le plus vite. » (André Roussin, Bobosse (1950), acte I ; Livre de poche n°334,1965, p. 39).
. Edgar : « Les phrases définitives sont quelquefois celles sur lesquelles on revient le plus vite. » (André Roussin, Bobosse (1950), acte I ; Livre de poche n°334,1965, p. 39).
. Tony : « Il n'y a que deux circonstances où l'on est soi-même : quand on dort et quand on est soûl. Tout le reste du temps, c'est du chiqué. » (André Roussin, Bobosse (1950), acte III ; Livre de poche n°334,1965, p. 134-135).
. Ménélas : « Quand on a fini de jouer soi-même les premiers rôles, on veut donner des leçons et diriger les jeunes acteurs ! C'est le geste des adieux ! » (André Roussin et Madeleine Gray, Hélène ou la joie de vivre (1952), acte I ; Livre de poche n°1691-1692, 1966, p. 68).
. Ménélas : « Il vient un jour pour chacun de nous où les jeux sont faits. Il ne s'agit plus ce jour-là de songer à de nouveaux départs, mais de considérer plutôt où l'on est arrivé. » (André Roussin et Madeleine Gray, Hélène ou la joie de vivre (1952), acte III ; Livre de poche n°1691-1692, 1966, p. 160).
. Ménélas : « Qu’est-ce qu’un amant, Hélène ? Un dompteur, un maître. Avez-vous jamais trouvé votre maître ? Non, car en votre présence les hommes se sont toujours sentis diminués par votre beauté. Du coup ils ont cessé de vous plaire. Conclusion : vous n’avez […] jamais aimé. […] Alors je pense qu’avec cette certitude […] de ne jamais rencontrer l’homme de vos rêves, le mieux serait désormais de ne plus songer à lui, autrement dit à ce que vous appelez "la joie de vivre" ou "l’amour de la vie", pour vous donner entièrement à ce que j’appellerai "la douceur de vivre" ou "l’agrément de la vie" ». (André Roussin et Madeleine Gray, Hélène ou la joie de vivre (1952), acte III ; Livre de poche n°1691-1692, 1966, p. 160-161).
. Karma : « La seule chose qui compte pour une femme, c'est de savoir si on la quitte ou si c'est elle qui s'en va. » (André Roussin, La Voyante (1963), acte I ; Livre de poche n°2370, 1968, p. 16).
. Karma : « Le véritable amour, c’est une force tellement formidable qu’il n’y a pas un être humain qui puisse la supporter tout seul. Il est tout-de-suite écrasé. C’est pour ça qu’il n’y a jamais que du malheur dans l’amour des hommes et des femmes. » (André Roussin, La Voyante (1963), acte I ; Livre de poche n°2370, 1968, p. 17).
ALBERT CAMUS (1913-1960) : [page spéciale en préparation]
MARGUERITE DURAS (1914-1996) : [Voir page en préparation dévolue aux écrivains féminins]
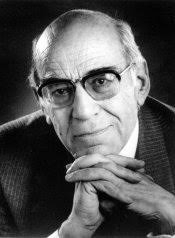 . Izquierdo : « Mon cher, tu ne vas pas t'imaginer aussi que, parce que tu as fait cinq enfants à ta femme, tu as droit à l'immortalité, non ? » — Le potier : « Mais quel crime ai-je commis ? Que me reprochez-vous ? Pour condamner à mort quelqu'un, il faut qu'il ait commis un forfait ? Monsieur l'officier, je vous jure… » — Izquierdo : « Tu m'agaces. […] Pour mourir, ce n'est pas vrai, il n'est pas nécessaire d'avoir commis un crime. Tu en as la preuve. Dailleurs, quand un brave homme meurt bêtement d'une maladie, personne ne songe à protester contre la volonté de Dieu. On se résigne… » (Emmanuel Roblès, Montserrat (1948), acte II, scène 3 ; Livre de poche n°2570, 1990, p. 80).
. Izquierdo : « Mon cher, tu ne vas pas t'imaginer aussi que, parce que tu as fait cinq enfants à ta femme, tu as droit à l'immortalité, non ? » — Le potier : « Mais quel crime ai-je commis ? Que me reprochez-vous ? Pour condamner à mort quelqu'un, il faut qu'il ait commis un forfait ? Monsieur l'officier, je vous jure… » — Izquierdo : « Tu m'agaces. […] Pour mourir, ce n'est pas vrai, il n'est pas nécessaire d'avoir commis un crime. Tu en as la preuve. Dailleurs, quand un brave homme meurt bêtement d'une maladie, personne ne songe à protester contre la volonté de Dieu. On se résigne… » (Emmanuel Roblès, Montserrat (1948), acte II, scène 3 ; Livre de poche n°2570, 1990, p. 80).
. Izquierdo : « Montserrat ! tu crois que Dieu, un jour, refera des hommes de ces misérables paquets de chairs qui sont jetés là-bas et qui commenceront dès ce soir à pourrir ? Mais ne comprends-tu pas que tout finit devant ce mur, qu'il n'y a plus rien après ce mur et que, s'il y a quelque chose, c'est l'éternelle indifférence des pierres, le silence infini des espaces ! » (Emmanuel Roblès, Montserrat (1948), acte III, scène 3 ; Livre de poche n°2570, 1990, p. 106).
. Izquierdo : « Les grands principes sont comme les grands cataclysmes. Ils font toujours une effroyable consommation de créatures !… » (Emmanuel Roblès, Montserrat (1948), acte III, scène 4 ; Livre de poche n°2570, 1990, p. 108).
. Izquierdo : « Crois-tu que ce soit vraiment si important, la liberté, pour quelques millions d’Indiens à demi abrutis et de Nègres pouilleux ? Pour ce qu’ils en feraient, de leur liberté !… » (Emmanuel Roblès, Montserrat (1948), acte III, scène 8 ; Livre de poche n°2570, 1990, p. 124).
. Montserrat : « Il faut sauver cet espoir. » […] — Izquierdo : « Ce n’était pas l’avis de la plupart des otages de tout-à-l’heure. Ils étaient presque tous bien convaincus qu’on les assassinait gratuitement ! Que veux-tu ? Il y a des gens sans orgueil qui se résignent à végéter sous notre domination plutôt que de recevoir douze balles dans la poitrine. Ils préfèrent vivre avilis sous notre botte que mourir glorieusement pour la Liberté… » (Emmanuel Roblès, Montserrat (1948), acte III, scène 8 ; Livre de poche n°2570, 1990, p. 129).
. Le domestique : « Se dégager des influences nécessite une longue patience. La vie n'y suffit pas : il y faut la mort. Et encore ! Beaucoup trop d'hommes copient la mort des autres. » (René de Obaldia, Genousie (1960), acte II, scène 8 ; Théâtre complet, Grasset, 2001, p. 59).
JEAN-CLAUDE BRISVILLE (1922-2014)
 . Descartes : « J’aime plus que tout ne rien faire – apparemment à tout le moins. Car le loisir, vous le découvrirez peut-être avec les ans, est un atelier souterrain où la pensée travaille à notre insu. Que l’on morde sur ma retraite, je ne puis donc le supporter. » (Jean-Claude Brisville, L’Entretien de M. Descartes avec M. Pascal le jeune (1985) ; Babel n°114 Le Souper, 1994, p. 83).
. Descartes : « J’aime plus que tout ne rien faire – apparemment à tout le moins. Car le loisir, vous le découvrirez peut-être avec les ans, est un atelier souterrain où la pensée travaille à notre insu. Que l’on morde sur ma retraite, je ne puis donc le supporter. » (Jean-Claude Brisville, L’Entretien de M. Descartes avec M. Pascal le jeune (1985) ; Babel n°114 Le Souper, 1994, p. 83).
. Descartes : « Le récit des rêves d’autrui est toujours d’un ennui mortel. » (Jean-Claude Brisville, L’Entretien de M. Descartes avec M. Pascal le jeune (1985) ; Babel n°114 Le Souper, 1994, p. 97).
. Descartes : « Savoir qu’on doit mourir doit-il nous empêcher de vivre et de penser ? » (Jean-Claude Brisville, L’Entretien de M. Descartes avec M. Pascal le jeune (1985) ; Babel n°114 Le Souper, 1994, p. 99).
. Descartes : « Pour moi, réfléchir à la mort, à l’infini et à l’éternité est un travail qui passe mon intelligence. Je ne voudrais pas abuser du peu de temps et de loisir qui me reste en l’employant à démêler de semblables difficultés. » (Jean-Claude Brisville, L’Entretien de M. Descartes avec M. Pascal le jeune (1985) ; Babel n°114 Le Souper, 1994, p. 99).
. Descartes : « Dieu est en nous. Chacun lui prête son visage. Et alors que nous acceptons la dissemblance de nos traits, nous sommes toujours prêts à nous entretuer parce que nous ne voyons pas, n’entendons pas le même Dieu. » (Jean-Claude Brisville, L’Entretien de M. Descartes avec M. Pascal le jeune (1985) ; Babel n°114 Le Souper, 1994, p. 107).
. Fouché : « En tranchant sans façon la tête du roi, nous avons démontré qu’il n’était qu’un homme ordinaire – et en effet le ciel ne nous est pas tombé pour celà sur la tête. » (Jean-Claude Brisville, Le Souper (1989) ; Babel n°114, 1994, p. 29).
. Talleyrand : « Quel gouvernement a envie de faire tirer sur le peuple […] ? Aucun. Disons plutôt que tout gouvernement, conscient de sa responsabilité envers le peuple, est parfois obligé de faire disperser des attroupements de factieux… dans l’intérêt même du peuple. » (Jean-Claude Brisville, Le Souper (1989) ; Babel n°114, 1994, p. 29).
. Talleyrand : « On a toujours besoin d’un grand ministre à la Police. Avec une bonne police, il ne peut y avoir qu’un bon gouvernement puisque personne n’ira dire qu’il est mauvais. » — Fouché : « Sauf tous ceux qui sont en prison pour avoir dit qu’il n’est pas bon. Mais les gens qui sont en prison ne sont pas de bons citoyens. Donc leur avis ne compte pas. » — Talleyrand : « Qu’ils en aient un est même une insolence à l’égard du pouvoir. » (Jean-Claude Brisville, Le Souper (1989) ; Babel n°114, 1994, p. 34-35).
. Talleyrand : « Savez-vous ce qu’est un mécontent […] ? C’est un pauvre qui réfléchit. » — Fouché : « Une bonne police est là pour l’empêcher de réfléchir. » (Jean-Claude Brisville, Le Souper (1989) ; Babel n°114, 1994, p. 53).
. Fouché : « On n’a qu’une parole, il faut donc la reprendre. » (Jean-Claude Brisville, Le Souper (1989) ; Babel n°114, 1994, p. 57).
. Fouché : « On commence par faire de la politique pour avoir le pouvoir, et puis, quand on a le pouvoir, on joue à faire de la politique… […] Le pouvoir n’épuise que ceux qui ne l’exercent pas. » (Jean-Claude Brisville, Le Souper (1989) ; Babel n°114, 1994, p. 66).
. Talleyrand : « Cultivez la mélancolie. Elle vous fait tout doucement à l’idée de la mort. » (Jean-Claude Brisville, Le Souper (1989) ; Babel n°114, 1994, p. 73). 
. Marie Du Deffand : « Si [Dieu] parle parfois, avez-vous remarqué qu’Il ne répond jamais ? […] Il monologue par essence. On ne le supporterait pas dans un salon. » (Jean-Claude Brisville, L’Antichambre (1991), 1 ; Babel n°114 Le Souper, 1994, p. 137).
. Marie Du Deffand : « Les hommes craignent en secret d’avoir à décider d’eux-mêmes. Ils ont besoin d’un dieu, d’un souverain, d’un système de lois. » (Jean-Claude Brisville, L’Antichambre (1991), 3 ; Babel n°114 Le Souper, 1994, p. 148).
. Marie Du Deffand : « J’apprécie [la] compagnie [des philosophes] parce qu’ils sont intelligents jusque dans leurs illusions, et que l’intelligence est bien le dernier trait dont on se lasse chez un homme. » (Jean-Claude Brisville, L’Antichambre (1991), 3 ; Babel n°114 Le Souper, 1994, p. 149).
. Hénault : « C’est dans la Bible. » — Marie Du Deffand : « Un excellent roman. Il est à regretter que le personnage central ne soit pas plus plausible » (Jean-Claude Brisville, L’Antichambre (1991), 4 ; Babel n°114 Le Souper, 1994, p. 159).
. Marie Du Deffand : « Où allons-nous si les prêtres se mettent à écrire des romans d’amour et les amants à invoquer le Ciel en faveur de leurs turpitudes ! Il faut de l’ordre en tout […], et nul besoin de croire en Dieu pour en être persuadé. Que deviendrait notre société si l’on ne respectait plus l’ordre ? […] Une jungle. Et encore les animaux ont-ils pour eux de ne point pouvoir s’exprimer. ». » (Jean-Claude Brisville, L’Antichambre (1991), 5 ; Babel n°114 Le Souper, 1994, p. 167).
. Marie Du Deffand : « J’en ai assez d’écouter sans broncher les divagations de ces rêveurs qui me serinent leurs sottises à longueur de journée… assez de ces penseurs qui font la roue au nom de leur belle âme et de leur vain savoir. Où allons-nous si la tradition, la justice et la monarchie sont sans cesse battues en brèche par le moindre grimaud de collège ? » (Jean-Claude Brisville, L’Antichambre (1991), 6 ; Babel n°114 Le Souper, 1994, p. 188).
. Hénault : « On ne ferait plus rien si l’on s’interrogeait sans cesse. » (Jean-Claude Brisville, L’Antichambre (1991), 7 ; Babel n°114 Le Souper, 1994, p. 194).
. Marie Du Deffand : « J’ai beau me répéter que lorsqu’on n’a pas de talent et qu’on n’a plus de passion, on n’a plus rien à faire ici-bas, je ne puis me résoudre à m’en aller, et cette absurde envie de vivre encore ajoute à mon ennui. » (Jean-Claude Brisville, L’Antichambre (1991), 8 ; Babel n°114 Le Souper, 1994, p. 201).
. Julie de Lespinasse : « Ils sont comme tous les hommes : ils ont besoin qu’on croie en eux pour croire vraiment en eux-mêmes. » (Jean-Claude Brisville, L’Antichambre (1991), 9 ; Babel n°114 Le Souper, 1994, p. 212).
. Marie Du Deffand : « On obtient ce qu’on veut des gens de lettres en mignotant leur vanité. […] Il n’est pas de meilleure façon pour conquérir les gens de lettres : une admiration muette. Ils ne demandent que celà. Surtout, pas de réserve. Une réserve, même la plus légère, peut vous coûter une amitié. » (Jean-Claude Brisville, L’Antichambre (1991), 9 ; Babel n°114 Le Souper, 1994, p. 213).
. Marie Du Deffand : « À voir l’usage qu’on fait du mot "amour", je n’ai aucun regret de l’avoir de tout temps exclu de mon vocabulaire. » (Jean-Claude Brisville, L’Antichambre (1991), 9 ; Babel n°114 Le Souper, 1994, p. 214).
ROLAND DUBILLARD (1923-2011)
. Deux : « C'est ce que je reproche à la vérité, moi. C'est qu'il faut la connaître pour ne pas se tromper, et que c'est pas toujours commode. La vérité, pourtant, ça devrait s'imposer avec plus d'évidence que l'erreur, ou alors quoi, pas moyen de savoir si on se trompe. » (Roland Dubillard, Autres inventions à deux voix (1975), « En attendant Grouchy », dans Les Diablogues, Folio n°3177, 1998, p.140).
MICHEL VINAVER (1927-…)
[à compléter]
FRANÇOISE DORIN (1928-2018) : [Voir page en préparation dévolue aux écrivains féminins]
LOUIS CALAFERTE (1928-1994) : [Voir page en préparation dévolue aux romanciers français de la seconde moitié du XXe siècle]
FERNANDO ARRABAL (1932-…)
[à compléter]
ANDRÉ LE GALL (1936-…)
[à compléter]
MICHEL TREMBLAY (1942-…)
[citations en attente de vérification]
BERNARD-MARIE KOLTÈS (1948-1989)
[citations en attente de vérification]
JEAN-LUC LAGARCE (1957-1995)
[à compléter]
YASMINA REZA (1959-…) : [Voir page en préparation dévolue aux écrivains féminins]
ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT (1960-…)
 . Don Juan : « Voilà, le mot est prononcé, tu as tout dit : l’amour ! Pauvre fille, à soixante ans tu diras "Dieu" comme tu as dit "l’amour" à vingt, avec les mêmes yeux, avec la même foi, le même enthousiasme. C’est bien une femme qui parle. » (Éric-Emmanuel Schmitt, La Nuit de Valognes (1991), acte II, scène 3 ; Magnard Classiques et contemporains n°61, 2004, p. 64).
. Don Juan : « Voilà, le mot est prononcé, tu as tout dit : l’amour ! Pauvre fille, à soixante ans tu diras "Dieu" comme tu as dit "l’amour" à vingt, avec les mêmes yeux, avec la même foi, le même enthousiasme. C’est bien une femme qui parle. » (Éric-Emmanuel Schmitt, La Nuit de Valognes (1991), acte II, scène 3 ; Magnard Classiques et contemporains n°61, 2004, p. 64).
. Don Juan : « Trahison ! trahison ! Vous avez toutes cette écume à la bouche. Mais c’est vous, femmes, qui vous montrez les plus fausses. Il faut que l’on vous jure des engagements éternels pour que vous nous rendiez cinq minutes de plaisir. Or ce n’est qu’un code, tout le monde le sait : des paroles pour quelques actes. Il n’y a pas traîtrise, il y a marché : le traître, c’est celui qui fait semblant de l’ignorer. » (Éric-Emmanuel Schmitt, La Nuit de Valognes (1991), acte II, scène 3 ; Magnard Classiques et contemporains n°61, 2004, p. 69-70).
. La comtesse : « Heureuse, Duchesse, heureuse ! Voilà bien de ces idées à la mode ! […] Un idéal d’arrière-boutique, le bonheur, ça vous a des relents de pantoufle et de pot-au-feu. » (Éric-Emmanuel Schmitt, La Nuit de Valognes (1991), acte III, scène 3 ; Magnard Classiques et contemporains n°61, 2004, p. 86).
. La comtesse : « J’ai appris qu’en amour il n’y avait pas d’amour, mais des vainqueurs et des vaincus… J’ai appris que la victoire n’avait d’autre but que la victoire, qu’il n’y avait pas d’après… J’ai appris que le plaisir est fade s’il n’a le goût du mal, que la caresse toujours préfigure la gifle et le baiser ébauche la morsure… J’ai appris qu’on attrape les hommes par la queue mais qu’on les saigne au cœur… » (Éric-Emmanuel Schmitt, La Nuit de Valognes (1991), acte III, scène 12 ; Magnard Classiques et contemporains n°61, 2004, p. 109-110).
__________________________________
[1] On trouve aussi ces deux formules de Scribe ici et là : « Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Le premier qui a dit celà voulait se faire donner quelque chose. » ; « On crie beaucoup contre la censure ; elle nous oblige souvent à avoir de l'esprit. » – mais je n’ai pas réussi à en localiser la source.
[2] Même plaisanterie à la scène suivante. Marthe : « Nous appartenons au groupe Lalubize. […] Il vote selon sa conscience. » — Alcide : « Très bien, celà ! » — Marthe : « Sa conscience du moment. » (p. 403).
[3] Réminiscence de La Rochefoucauld : « Nous promettons selon nos espérances, et nous tenons selon nos craintes. » (Maximes, n°38 ; Pléiade, 1964, p. 408 ; Pochothèque, 2001, p. 121).
[4] On attribue à Alfred Capus ces sentences : « Le pardon vient souvent de la générosité, mais souvent aussi du manque de mémoire » ; « Si l’on ne pardonnait jamais, on ne verrait bientôt plus personne » ; « L'amour, c'est quand on n'obtient pas tout-de-suite ce qu'on désire » ; « Pindare nous rapporte que les Hyperboréens sacrifiaient à Apollon des ânes. Ne serait-ce que pour faire de la place, voilà un bon usage à regretter ». Je n’ai pas réussi à les localiser et je tiens ces attributions pour suspectes. On attribue parfois aussi à Capus : « La vie est un long souci d'argent », quoique le mot soit plus souvent tenu comme venant de Paul Adam.
[5] On attribue à Georges Feydeau ces sentences : « Le mariage est l’art difficile, pour deux personnes, de vivre ensemble aussi heureuses qu’elles auraient vécu seules chacune de leur côté » ; « Un monsieur tire et tue un homme. On le traite de maladroit. Un monsieur tire et manque un lapin. On le traite de maladroit. L'adresse change donc suivant le gibier ». Je n’ai pas réussi à les localiser et je tiens ces deux attributions pour douteuses.
[6] On (notamment Maurice G. Dantec) attribue aussi à Robert de Flers ce joli mot : « N'apprenez jamais l'Histoire de France à un jeune esprit : il pourrait aisément devenir réactionnaire ». Je ne l’ai trouvé nulle part et dois donc le tenir pour suspect.
[7] J’ai remplacé les crochets, qui encadrent « du plus fort » dans le texte de Jarry, par des chevrons, afin qu’on ne croie pas que ces crochets signalent un ajout de ma part. Cette plaisanterie est souvent citée de façon assez déformée : « Il faudrait, dans le Code Civil, ajouter partout "du plus fort" au mot loi. »
[8] J’ai supprimé la conjonction « et » qui précède « cette idée » dans le texte publié en 1986 : étant donné que « combine » n’est pas un verbe mais un substantif, la conjonction rend la phrase syntaxiquement incorrecte. Un captif amoureux est un texte posthume et n’a pas dû être relu par un œil infaillible.
[9] Ce mot est encore le plus renversant de ce texte étonnant. Ce que Genet considère comme un exemple de brutalité, ce n’est pas la gifle dont usent et abusent les policiers envers les gens qu’ils ont arrêtés, mais l’inutilité de la gifle !...
[10] On attribue aussi à André Roussin deux jolis mots : « Un intellectuel, c'est quelqu'un qui entre dans les bibliothèques publiques même quand il ne pleut pas » et « La femme idéale est celle qui, tout en étant fidèle, est aussi gentille que si elle vous trompait », mais je ne les ai localisés nulle part et tiens cette attribution pour douteuse. (Michel Azama situe le premier dans Lorsque l’enfant paraît : je ne l’y ai pas trouvé). On lui attribue aussi (ainsi qu’à Armand Salacrou et Errol Flynn) ce mot exceptionnel : « On se marie par manque de jugement. Puis on divorce par manque de patience. Enfin on se remarie par manque de mémoire ». Mais pas moyen d’en repérer une source première !

Écrire un commentaire