LES MEILLEURS APHORISMES DES /CARACTÈRES/ DE LA BRUYÈRE
16.06.2013
 Il n'y a pas si longtemps que cela, La Bruyère faisait partie de la culture de base du bachelier moyen. Avoir suivi une scolarité secondaire, c'était, parmi bien d'autres choses, avoir été frappé par plusieurs maximes de ce grand moraliste du grand siècle, et s'être amusé des portraits d'Arrias, de Ménalque et d'Onuphre. Mais aujourd'hui, le bagage littéraire du bachelier se réduit à Candide, Dom Juan et quelques poèmes des Fleurs du mal. Le nom même de La Bruyère lui est inconnu (sauf s'il a passé le bac L en 2005 ou 2006, années où les Caractères furent inscrits au programme, mais seulement les chapitres VIII (« De la Cour ») et IX (« Des Grands »), choix très réduit et dailleurs assez saugrenu, mais pensez donc, on ne peut pas leur demander de beaucoup lire dans cette filière, il ne s'agit que de L). C'est tout un pan de la culture classique qui s'est effondré.
Il n'y a pas si longtemps que cela, La Bruyère faisait partie de la culture de base du bachelier moyen. Avoir suivi une scolarité secondaire, c'était, parmi bien d'autres choses, avoir été frappé par plusieurs maximes de ce grand moraliste du grand siècle, et s'être amusé des portraits d'Arrias, de Ménalque et d'Onuphre. Mais aujourd'hui, le bagage littéraire du bachelier se réduit à Candide, Dom Juan et quelques poèmes des Fleurs du mal. Le nom même de La Bruyère lui est inconnu (sauf s'il a passé le bac L en 2005 ou 2006, années où les Caractères furent inscrits au programme, mais seulement les chapitres VIII (« De la Cour ») et IX (« Des Grands »), choix très réduit et dailleurs assez saugrenu, mais pensez donc, on ne peut pas leur demander de beaucoup lire dans cette filière, il ne s'agit que de L). C'est tout un pan de la culture classique qui s'est effondré.
Pour ma part, j'ai toujours eu beaucoup de goût pour Les Caractères (sauf son très consternant dernier chapitre, où l'auteur tente de défendre la religion chrétienne contre les esprits forts avec des arguments dont la faiblesse fait pitié). Plus subtil que Gracian, moins obsessionnel que La Rochefoucauld, moins borné que Pascal, plus aigu que Vauvenargues, plus artiste que Montesquieu, plus styliste que Chamfort, plus dense que Rivarol, plus percutant que Joseph Joubert, moins desséchant qu'Ambrose Bierce, plus vaste que Valéry, plus divers que Jean Rostand, plus civilisé que Cioran, moins inégal que Gomez Davila et beaucoup d'autres, sachant à l'occasion se contredire comme tout aphoriste, son recueil reste sans doute le meilleur recueil de pensées et d'observations morales jamais publié. Jules Renard allait jusqu'à dire de La Bruyère qu'il était « le seul [écrivain] dont dix lignes lues au hasard ne déçoivent jamais » (Journal, 28 août 1908). C'est exagéré (le chapitre XVI…) mais il reste qu'aucun honnête homme de culture française ne saurait se dispenser de se replonger périodiquement dans cette source à la fois claire et profonde. Voici ma sélection de ses meilleures sentences.
J'ai repris les chapitres des Caractères : Des ouvrages de l'esprit ; Du mérite personnel ; Des femmes ; Du cœur ; De la société et de la conversation ; Des biens de fortune ; De la ville ; De la cour ; Des grands ; Du souverain ou de la République ; De l'homme ; Des jugements ; De la mode ; De quelques usages ; Des esprits forts ; Sur son livre.
. Tout est dit, et l’on vient trop tard depuis plus de sept mille ans qu’il y a des hommes, et qui pensent. Sur ce qui concerne les mœurs, le plus beau et le meilleur est enlevé ; l’on ne fait que glaner après les anciens et les habiles d’entre les modernes. (La Bruyère, Les Caractères, I, 1 ; Pléiade, 1951, p. 65).
. Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir amener les autres à notre goût et à nos sentiments ; c’est une trop grande entreprise. (La Bruyère, Les Caractères, I, 2 ; Pléiade, 1951, p. 65). 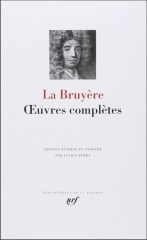
. Il n’est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage parfait, que d’en faire valoir un médiocre par le nom qu’on s’est déjà fait. (La Bruyère, Les Caractères, I, 4 ; Pléiade, 1951, p. 64).
. La même justesse d’esprit qui nous fait écrire de bonnes choses nous fait appréhender qu’elles ne le soient pas assez pour mériter d’être lues. (La Bruyère, Les Caractères, I, 18 ; Pléiade, 1951, p. 69).
. Le plaisir de la critique nous ôte celui d’être vivement touchés de très belles choses. (La Bruyère, Les Caractères, I, 20 ; Pléiade, 1951, p. 70).
. Il n’y a point d’ouvrage si accompli qui ne fondît tout entier au milieu de la critique, si son auteur voulait en croire tous les censeurs qui ôtent chacun l’endroit qui leur plaît le moins. (La Bruyère, Les Caractères, I, 26 ; Pléiade, 1951, p. 72).
. Un auteur cherche vainement à se faire admirer par son ouvrage. Les sots admirent quelquefois, mais ce sont des sots. Les personnes d’esprit ont en eux les semences de toutes les vérités et de tous les sentiments, rien ne leur est nouveau ; ils admirent peu, ils approuvent. (La Bruyère, Les Caractères, I, 36 ; Pléiade, 1951, p. 76).
. Horace ou Despréaux l'a dit avant vous. — Je le crois sur votre parole ; mais je l'ai dit comme mien. Ne puis-je pas penser après eux une chose vraie, et que d'autres encore penseront après moi ? (La Bruyère, Les Caractères, I, 69 ; Pléiade, 1951, p. 90).
. Qui peut, avec les plus rares talents et le plus excellent mérite, n’être pas convaincu de son inutilité, quand il considère qu’il laisse en mourant un monde qui ne se sent pas de sa perte, et où tant de gens se trouvent pour le remplacer ? (La Bruyère, Les Caractères, II, 1 ; Pléiade, 1951, p. 91).
. De bien des gens il n'y a que le nom qui vaille quelque chose. Quand vous les voyez de fort près, c'est moins que rien ; de loin ils imposent. (La Bruyère, Les Caractères, II, 2 ; Pléiade, 1951, p. 91).
. Il n'y a point au monde un si pénible métier que celui de se faire un grand nom : la vie s'achève que l'on a à peine ébauché son ouvrage. (La Bruyère, Les Caractères, II, 9 ; Pléiade, 1951, p. 92).
. Il faut en France beaucoup de fermeté et une grande étendue d'esprit pour se passer des charges et des emplois, et consentir ainsi à demeurer chez soi, et à ne rien faire. Personne presque n'a assez de mérite pour jouer ce rôle avec dignité, ni assez de fond pour remplir le vide du temps, sans ce que le vulgaire appelle des affaires. Il ne manque cependant à l'oisiveté du sage qu'un meilleur nom, et que méditer, parler, lire, et être tranquille s'appelât travailler. (La Bruyère, Les Caractères, II, 12 ; Pléiade, 1951, p. 94).
. S'il est ordinaire d'être vivement touché des choses rares, pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu ? (La Bruyère, Les Caractères, II, 20 ; Pléiade, 1951, p. 97).
. Il n’y a guère d’homme si accompli et si nécessaire aux siens, qu’il n’ait de quoi se faire moins regretter. (La Bruyère, Les Caractères, II, 35 ; Pléiade, 1951, p. 102).
. Il n’y a rien de si délié, de si simple et de si imperceptible, où il n’entre des manières qui nous décèlent. Un sot ni n’entre, ni ne sort, ni ne s’assied, ni ne se lève, ni ne se tait, ni n’est sur ses jambes, comme un homme d’esprit. (La Bruyère, Les Caractères, II, 37 ; Pléiade, 1951, p. 102).
. Le sage guérit de l’ambition par l’ambition même ; il tend à de si grandes choses, qu'il ne peut se borner à ce qu'on appelle des trésors, des postes, la fortune et la faveur : il ne voit rien dans de si faibles avantages qui soit assez bon et assez solide pour remplir son cœur, et pour mériter ses soins et ses désirs ; il a même besoin d’efforts pour ne les pas trop dédaigner. Le seul bien capable de le tenter est cette sorte de gloire qui devrait naître de la vertu toute pure et toute simple ; mais les hommes ne l’accordent guère, et il s’en passe. (La Bruyère, Les Caractères, II, 43 ; Pléiade, 1951, p. 105).
. Une femme oublie d'un homme qu'elle n'aime plus jusques aux faveurs qu'il a reçues d'elle. (La Bruyère, Les Caractères, III, 17 ; Pléiade, 1951, p. 111).
. À juger de cette femme par sa beauté, sa jeunesse, sa fierté et ses dédains, il n’y a personne qui doute que ce ne soit un héros qui doive un jour la charmer. Son choix est fait : c’est un petit monstre qui manque d’esprit. (La Bruyère, Les Caractères, III, 27 ; Pléiade, 1951, p. 113).
. Pour les femmes du monde, un jardinier est un jardinier, et un maçon est un maçon ; pour quelques autres plus retirées, un maçon est un homme, un jardinier est un homme. Tout est tentation à qui la craint. (La Bruyère, Les Caractères, III, 34 ; Pléiade, 1951, p. 115).
. La plupart des femmes n'ont guère de principes ; elles se conduisent par le cœur, et dépendent pour leurs mœurs de ceux qu'elles aiment. (La Bruyère, Les Caractères, III, 54 ; Pléiade, 1951, p. 123).
. Combien de filles à qui une grande beauté n'a jamais servi qu'à leur faire espérer une grande fortune ! (La Bruyère, Les Caractères, III, 62 ; Pléiade, 1951, p. 124).
. Il arrive quelquefois qu’une femme cache à un homme toute la passion qu’elle sent pour lui, pendant que de son côté il feint pour elle toute celle qu’il ne sent pas. (La Bruyère, Les Caractères, III, 67 ; Pléiade, 1951, p. 125).
. L’on n’aime bien qu’une seule fois : c’est la première ; les amours qui suivent sont moins involontaires. (La Bruyère, Les Caractères, IV, 11 ; Pléiade, 1951, p. 133). 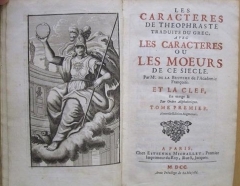
. L'on ne voit dans l'amitié que les défauts qui peuvent nuire à nos amis. L'on ne voit en amour de défauts dans ce qu'on aime que ceux dont on souffre soi-même. (La Bruyère, Les Caractères, IV, 27 ; Pléiade, 1951, p. 136).
. L'on n'est pas plus maître de toujours aimer qu'on l'a été de ne pas aimer. (La Bruyère, Les Caractères, IV, 31 ; Pléiade, 1951, p. 137).
. Cesser d’aimer, preuve sensible que l’homme est borné, et que le cœur a ses limites. / C’est faiblesse que d’aimer ; c’est souvent une autre faiblesse que de guérir. / On guérit comme on se console : on n’a pas dans le cœur de quoi toujours pleurer et toujours aimer. (La Bruyère, Les Caractères, IV, 34 ; Pléiade, 1951, p. 137).
. Vivre avec ses ennemis comme s’ils devaient un jour être nos amis, et vivre avec nos amis comme s’ils pouvaient devenir nos ennemis, n’est ni selon la nature de la haine, si selon les règles de l’amitié ; ce n’est point une maxime morale, mais politique. (La Bruyère, Les Caractères, IV, 55 ; Pléiade, 1951, p. 141).
. On ne vole point des mêmes ailes pour sa fortune que l'on fait pour des choses frivoles et de fantaisie. Il y a un sentiment de liberté à suivre ses caprices, et tout au contraire de servitude à courir pour son établissement : il est naturel de le souhaiter beaucoup et d'y travailler peu, de se croire digne de le trouver sans l'avoir cherché. (La Bruyère, Les Caractères, IV, 59 ; Pléiade, 1951, p. 142).
. Les choses les plus souhaitées n'arrivent point ; ou si elles arrivent, ce n'est ni dans le temps ni dans les circonstances où elles auraient fait un extrême plaisir. (La Bruyère, Les Caractères, IV, 62 ; Pléiade, 1951, p. 142).
. Il faut rire avant que d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. (La Bruyère, Les Caractères, IV, 63 ; Pléiade, 1951, p. 142).
. Qu'il est difficile d'être content de quelqu'un ! (La Bruyère, Les Caractères, IV, 65 ; Pléiade, 1951, p. 143).
. Il est également difficile d’étouffer dans les commencements le sentiment des injures et de le conserver après un certain nombre d’années. (La Bruyère, Les Caractères, IV, 69 ; Pléiade, 1951, p. 143).
. C'est par faiblesse que l'on hait un ennemi, et que l'on songe à s'en venger ; et c'est par paresse que l'on s'apaise, et qu'on ne se venge point. (La Bruyère, Les Caractères, IV, 70 ; Pléiade, 1951, p. 143-144).
. Pour gouverner quelqu’un longtemps et absolument, il faut avoir la main légère, et ne lui faire sentir que le moins qu’il se peut sa dépendance. […] Il se trouve des hommes qui n'écoutent ni la raison ni les bons conseils, et qui s'égarent volontairement par la crainte qu'ils ont d'être gouvernés. (La Bruyère, Les Caractères, IV, 71 ; Pléiade, 1951, p. 144).
. Toutes les passions sont menteuses : elles se déguisent autant qu'elles le peuvent aux yeux des autres ; elles se cachent à elles-mêmes. Il n'y a point de vice qui n'ait une fausse ressemblance avec quelque vertu, et qui ne s'en aide. (La Bruyère, Les Caractères, IV, 72 ; Pléiade, 1951, p. 145).
. Les hommes rougissent moins de leurs crimes que de leurs faiblesses et de leur vanité. Tel est ouvertement injuste, violent, perfide, calomniateur, qui cache son amour ou son ambition, sans autre vue que de la cacher. (La Bruyère, Les Caractères, IV, 74 ; Pléiade, 1951, p. 145-146).
. Le cas n’arrive guère où l’on puisse dire : « J’étais ambitieux » ; ou on ne l’est point, ou on l’est toujours ; mais le temps vient où l’on avoue que l’on a aimé. (La Bruyère, Les Caractères, IV, 75 ; Pléiade, 1951, p. 146).
DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CONVERSATION
. Un caractère bien fade est de n’en avoir aucun. (La Bruyère, Les Caractères, V, 1 ; Pléiade, 1951, p. 148).
. C'est le rôle d'un sot d'être importun : un homme habile sent s'il convient ou s'il ennuie ; il sait disparaître le moment qui précède celui où il serait de trop quelque part. (La Bruyère, Les Caractères, V, 2 ; Pléiade, 1951, p. 148).
. Si l'on faisait une sérieuse attention à tout ce qui se dit de froid, de vain et de puéril dans les entretiens ordinaires, l'on aurait honte de parler ou d'écouter, et l’on se condamnerait peut-être à un silence perpétuel, qui serait une chose pire dans le commerce que les discours inutiles. Il faut donc s’accommoder à tous les esprits, permettre comme un mal nécessaire le récit des fausses nouvelles, les vagues réflexions sur le gouvernement présent ou sur l’intérêt des princes, le débit des beaux sentiments, et qui reviennent toujours les mêmes ; il faut laisser Aronce parler proverbe, et Mélinde parler de soi, de ses vapeurs, de ses migraines et de ses insomnies. (La Bruyère, Les Caractères, V, 5 ; Pléiade, 1951, p. 149).
. L'esprit de la conversation consiste bien moins à en montrer beaucoup qu'à en faire trouver aux autres : celui qui sort de votre entretien content de soi et de son esprit, l'est de vous parfaitement. Les hommes n'aiment point à vous admirer, ils veulent plaire ; ils cherchent moins à être instruits, et même réjouis, qu'à être goûtés et applaudis ; et le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui. (La Bruyère, Les Caractères, V, 16 ; Pléiade, 1951, p. 155).
. C'est une grande misère que de n'avoir pas assez d'esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. Voilà le principe de toute impertinence. (La Bruyère, Les Caractères, V, 18 ; Pléiade, 1951, p. 156).
. Avec de la vertu, de la capacité et une bonne conduite, l’on peut être insupportable. Les manières, que l’on néglige comme de petites choses, sont souvent ce qui fait que les hommes décident de vous en bien ou en mal : une légère attention à les avoir douces et polies prévient leurs mauvais jugements. Il ne faut presque rien pour être cru fier, incivil, méprisant, désobligeant ; il faut encore moins pour être estimé tout le contraire. (La Bruyère, Les Caractères, V, 31 ; Pléiade, 1951, p. 160).
. Ne pouvoir supporter tous les mauvais caractères dont le monde est plein n'est pas un fort bon caractère : il faut dans le commerce des pièces d'or, et de la monnaie. (La Bruyère, Les Caractères, V, 37 ; Pléiade, 1951, p. 161).
. Il est souvent plus court et plus utile de cadrer aux autres que de faire que les autres s’ajustent à vous. (La Bruyère, Les Caractères, V, 48 ; Pléiade, 1951, p. 164).
. Tout ce qui est mérite se sent, se discerne, se devine réciproquement : si l'on voulait être estimé, il faudrait vivre avec des personnes estimables. (La Bruyère, Les Caractères, V, 53 ; Pléiade, 1951, p. 166).
. C’est la profonde ignorance qui inspire le ton dogmatique. Celui qui ne sait rien croit enseigner aux autres ce qu’il vient d’apprendre lui-même ; celui qui sait beaucoup pense à peine que ce qu’il dit puisse être ignoré, et parle plus indifféremment. (La Bruyère, Les Caractères, V, 76 ; Pléiade, 1951, p. 173).
. Toute confiance est dangereuse si elle n'est entière : il y a peu de conjectures où il ne faille tout dire, ou tout cacher. On a déjà trop dit de son secret à celui à qui l'on croit devoir en dérober une circonstance. (La Bruyère, Les Caractères, V, 80 ; Pléiade, 1951, p. 174).
. Toute révélation d'un secret est la faute de celui qui l'a confié. (La Bruyère, Les Caractères, V, 81 ; Pléiade, 1951, p. 174).
. Le sage quelquefois évite le monde, de peur d'être ennuyé. (La Bruyère, Les Caractères, V, 83 ; Pléiade, 1951, p. 175).
. À mesure que la faveur et les grands biens se retirent d’un homme, ils laissent voir en lui le ridicule qu’ils couvraient, et qui y était sans que personne s’en aperçût. (La Bruyère, Les Caractères, VI, 4 ; Pléiade, 1951, p. 176). 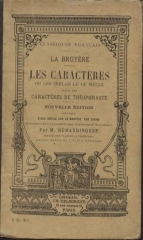
. Si le financier manque son coup, les courtisans disent de lui : « C’est un bourgeois, un homme de rien, un malotru » ; s’il réussit, ils lui demandent sa fille. (La Bruyère, Les Caractères, VI, 7 ; Pléiade, 1951, p. 177).
. Si certains morts revenaient au monde, et s’ils voyaient leurs grands noms portés, et leurs terres les mieux titrées, avec leurs châteaux et leurs maisons antiques, possédées par des gens dont les pères étaient peut-être leurs métayers, quelle opinion pourraient-ils avoir de notre siècle ? (La Bruyère, Les Caractères, VI, 22 ; Pléiade, 1951, p. 182).
. Rien ne fait mieux comprendre le peu de chose que Dieu croit donner aux hommes, en leur abandonnant les richesses, l'argent, les grands établissements et les autres biens, que la dispensation qu'il en fait, et le genre d'hommes qui en sont le mieux pourvus. (La Bruyère, Les Caractères, VI, 24 ; Pléiade, 1951, p. 182).
. Le peuple souvent a le plaisir de la tragédie : il voit périr sur le théâtre du monde les personnages les plus odieux, qui ont fait le plus de mal dans diverses scènes, et qu’il a le plus haïs. (La Bruyère, Les Caractères, VI, 31 ; Pléiade, 1951, p. 185).
. À force de faire de nouveaux contrats, ou de sentir son argent grossir dans ses coffres, on se croit enfin une bonne tête, et presque capable de gouverner. (La Bruyère, Les Caractères, VI, 37 ; Pléiade, 1951, p. 186).
. Il faut avoir trente ans pour songer à sa fortune ; elle n’est pas faite à cinquante ; l’on bâtit dans sa vieillesse, et l’on meurt quand on est aux peintres et aux vitriers. (La Bruyère, Les Caractères, VI, 40 ; Pléiade, 1951, p. 188).
. Dans toutes les conditions, le pauvre est bien proche de l'homme de bien, et l'opulent n'est guère éloigné de la friponnerie. Le savoir-faire et l'habileté ne mènent pas jusques aux énormes richesses. (La Bruyère, Les Caractères, VI, 44 ; Pléiade, 1951, p. 188).
. De tous les moyens de faire sa fortune, le plus court et le meilleur est de mettre les gens à voir clairement leurs intérêts à vous faire du bien. (La Bruyère, Les Caractères, VI, 45 ; Pléiade, 1951, p. 189).
. Les passions tyrannisent l’homme ; et l’ambition suspend en lui les autres passions, et lui donne pour un temps les apparences de toutes les vertus. Ce Tryphon qui a tous les vices, je l’ai cru sobre, chaste, libéral, humble et même dévot : je le croirais encore, s’il n’eût enfin fait sa fortune. (La Bruyère, Les Caractères, VI, 50 ; Pléiade, 1951, p. 190).
. Il n’y a au monde que deux manières de s’élever, ou par sa propre industrie, ou par l’imbécilité des autres. (La Bruyère, Les Caractères, VI, 52 ; Pléiade, 1951, p. 191).
. Ce que l’on prodigue, on l’ôte à son héritier ; ce que l’on épargne sordidement, on se l’ôte à soi-même. Le milieu est justice pour soi et pour les autres. (La Bruyère, Les Caractères, VI, 66 ; Pléiade, 1951, p. 194).
. Les enfants peut-être seraient plus chers à leurs pères, et réciproquement les pères à leurs enfants, sans le titre d'héritiers. (La Bruyère, Les Caractères, VI, 67 ; Pléiade, 1951, p. 194).
. Il n’y a qu’une affliction qui dure, qui est celle qui vient de la perte des biens : le temps, qui adoucit toutes les autres, aigrit celle-ci. Nous sentons à tous moments, pendant le cours de notre vie, où le bien que nous avons perdu nous manque. (La Bruyère, Les Caractères, VI, 76 ; Pléiade, 1951, p. 198).
. Ce palais, ces meubles, ces jardins, ces belles eaux vous enchantent et vous font récrier d'une première vue sur une maison si délicieuse, et sur l'extrême bonheur du maître qui la possède. Il n'est plus ; il n'en a pas joui si agréablement ni si tranquillement que vous : il n'y a jamais eu un jour serein, ni une nuit tranquille ; il s'est noyé de dettes pour la porter à ce degré de beauté où elle vous ravit. Ses créanciers l'en ont chassé : il a tourné la tête, et il l'a regardée de loin une dernière fois ; et il est mort de saisissement. (La Bruyère, Les Caractères, VI, 79 ; Pléiade, 1951, p. 199).
. Si vous n'avez rien oublié pour votre fortune, quel travail ! Si vous avez négligé la moindre chose, quel repentir ! (La Bruyère, Les Caractères, VI, 82 ; Pléiade, 1951, p. 200).
. Pénible coutume, asservissement incommode ! se chercher incessamment les unes les autres avec l’impatience de ne se point rencontrer ; ne se rencontrer que pour se dire des riens, que pour s’apprendre réciproquement des choses dont on est également instruite, et dont il importe peu que l’on soit instruite ; n’entrer dans une chambre précisément que pour en sortir ; ne sortir de chez soi l’après-dînée que pour y rentrer le soir, fort satisfaite d’avoir vu en cinq petites heures trois suisses, une femme que l’on connaît à peine, et une autre que l’on n’aime guère. Qui considérerait bien le prix du temps, et combien sa perte est irréparable, pleurerait amèrement sur de si grandes misères. (La Bruyère, Les Caractères, VII, 20 ; Pléiade, 1951, p. 212).
. L'on blâme les gens qui font une grand fortune pendant qu'ils en ont les occasions, parce que l'on désespère, par la médiocrité de la sienne, d’être jamais en état de faire comme eux, et de s’attirer ce reproche. Si l’on était à portée de leur succéder, l’on commencerait à sentir qu’ils ont moins de tort, et l’on serait plus retenu, de peur de prononcer d’avance sa condamnation. (La Bruyère, Les Caractères, VIII, 26 ; Pléiade, 1951, p. 222-223).
. Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et délicat qu’on y monte plus aisément qu’on ne s’y conserve. (La Bruyère, Les Caractères, VIII, 33 ; Pléiade, 1951, p. 225).
. L'on voit des hommes tomber d'une haute fortune par les mêmes défauts qui les y avaient fait monter. (La Bruyère, Les Caractères, VIII, 34 ; Pléiade, 1951, p. 225).
. Un homme qui vient d’être placé ne se sert plus de sa raison et de son esprit pour régler sa conduite et ses dehors à l’égard des autres ; il emprunte sa règle de son poste et de son état : de là l’oubli, la fierté, l’arrogance, la dureté, l’ingratitude. (La Bruyère, Les Caractères, VIII, 51 ; Pléiade, 1951, p. 230-231).
. Il faut des fripons à la cour auprès des grands et des ministres, même les mieux intentionnés ; mais l’usage en est délicat, et il faut savoir les mettre en œuvre. Il y a des temps et des occasions où ils ne peuvent être suppléés par d’autres. Honneur, vertu, conscience, qualités toujours respectables, souvent inutiles : que voulez-vous quelquefois que l’on fasse d’un homme de bien ? (La Bruyère, Les Caractères, VIII, 53 ; Pléiade, 1951, p. 231).
. L'esclave n'a qu'un maître ; l'ambitieux en a autant qu'il y a de gens utiles à sa fortune. (La Bruyère, Les Caractères, VIII, 70 ; Pléiade, 1951, p. 238).
. Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de plus, l’on se donne pour connaisseur en musique, en tableaux, en bâtiments, et en bonne chère ; l’on croit avoir plus de plaisir qu’un autre à entendre, à voir et à manger ; l’on impose à ses semblables, et l’on se trompe soi-même. (La Bruyère, Les Caractères, VIII, 82 ; Pléiade, 1951, p. 242).
. Dans cent ans le monde subsistera encore en son entier : ce sera le même théâtre et les mêmes décorations, ce ne seront plus les mêmes acteurs. Tout ce qui se réjouit sur une grâce reçue, ou ce qui s'attriste et se désespère sur un refus, tous auront disparu de dessus la scène. Il s'avance déjà sur le théâtre d'autres hommes qui vont jouer dans une même pièce les mêmes rôles ; ils s'évanouiront à leur tour ; et ceux qui ne sont pas encore, un jour ne seront plus : de nouveaux acteurs ont pris leur place. Quel fond à faire sur un personnage de comédie ! (La Bruyère, Les Caractères, VIII, 99 ; Pléiade, 1951, p. 246).
. La ville dégoûte de la province ; la cour détrompe de la ville, et guérit de la cour. / Un esprit sain puise à la cour le goût de la solitude et de la retraite. (La Bruyère, Les Caractères, VIII, 101 ; Pléiade, 1951, p. 247).
. La prévention du peuple en faveur des grands est si aveugle, et l’entêtement pour leur geste, leur visage, leur ton de voix et leurs manières, si général, que, s'ils s'avisaient d'être bons, cela irait à l'idolâtrie. (La Bruyère, Les Caractères, IX, 1 ; Pléiade, 1951, p. 248). 
. Il ne laisse pas d’y avoir comme un charme attaché à chacune des différentes conditions, et qui y demeure jusques à ce que la misère l’en ait ôté. Ainsi les grands se plaisent dans l’excès, et les petits aiment la modération ; ceux-là ont le goût de dominer et de commander, et ceux-ci sentent du plaisir et même de la vanité à les servir et à leur obéir ; les grands sont entourés, salués, respectés ; les petits entourent, saluent, se prosternent ; et tous sont contents. (La Bruyère, Les Caractères, IX, 5 ; Pléiade, 1951, p. 249).
. Il coûte si peu aux grands à ne donner que des paroles, et leur condition les dispense si fort de tenir les belles promesses qu’ils vous ont faites, que c'est modestie à eux de ne promettre pas encore plus largement. (La Bruyère, Les Caractères, IX, 6 ; Pléiade, 1951, p. 249).
. Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux qui sont au-dessus de nous, nous les fait haïr ; mais un salut ou un sourire nous les réconcilie. (La Bruyère, Les Caractères, IX, 16 ; Pléiade, 1951, p. 252).
. S’il y a peu d’excellents orateurs, y a-t-il bien des gens qui puissent les entendre ? S'il n'y a pas assez de bons écrivains, où sont ceux qui savent lire ? (La Bruyère, Les Caractères, IX, 22 ; Pléiade, 1951, p. 254).
. Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs des princes un peu de celui d’incommoder les autres. Mais non, les princes ressemblent aux hommes ; ils songent à eux-mêmes ; suivent leur goût, leurs passions, leur commodité : cela est naturel. (La Bruyère, Les Caractères, IX, 29 ; Pléiade, 1951, p. 257).
. S’il est périlleux de tremper dans une affaire suspecte, il l’est encore davantage de s’y trouver complice d’un grand : il s’en tire, et vous laisse payer doublement, pour lui et pour vous. (La Bruyère, Les Caractères, IX, 38 ; Pléiade, 1951, p. 260).
. Jetez-moi dans les troupes comme un simple soldat, je suis Thersite ; mettez-moi à la tête d'une armée dont j'aie à répondre à toute l'Europe, je suis Achille. (La Bruyère, Les Caractères, IX, 41 ; Pléiade, 1951, p. 261).
. L'on doit se taire sur les puissants : il y a presque toujours de la flatterie à en dire du bien ; il y a du péril à en dire du mal pendant qu'ils vivent, et de la lâcheté quand ils sont morts. (La Bruyère, Les Caractères, IX, 56 ; Pléiade, 1951, p. 268).
DU SOUVERAIN OU DE LA RÉPUBLIQUE
. Quand l'on parcourt, sans la prévention de son pays, toutes les formes de son pays, toutes les formes de gouvernement, l'on ne sait à laquelle se tenir : il y a dans toutes le moins bon, et le moins mauvais. Ce qu'il y a de plus raisonnable et de plus sûr, c'est d'estimer celle où l'on est né la meilleur de toutes, et de s'y soumettre. (La Bruyère, Les Caractères, X, 1 ; Pléiade, 1951, p. 269).
. C'est une politique sûre et ancienne dans les républiques que d'y laisser le peuple s'endormir dans les fêtes, dans les spectacles, dans le luxe, dans le faste, dans les plaisirs, dans la vanité et la mollesse ; le laisser se remplir du vide et savourer la bagatelle : quelles grandes démarches ne fait-on pas au despotique par cette indulgence ! (La Bruyère, Les Caractères, X, 3 ; Pléiade, 1951, p. 269).
. Quand le peuple est en mouvement, on ne comprend pas par où le calme peut y rentrer ; et quand il est paisible, on ne voit pas par où le calme peut en sortir. (La Bruyère, Les Caractères, X, 6 ; Pléiade, 1951, p. 270).
. Il y a de certains maux dans la république qui y sont soufferts, parce qu’ils préviennent ou empêchent de plus grands maux. Il y a d’autres maux qui sont tels seulement par leur établissement, et qui étant dans leur origine un abus ou un mauvais usage, sont moins pernicieux dans leurs suites et dans la pratique qu’une loi plus juste ou une coutume plus raisonnable. L’on voit une espèce de maux que l’on peut corriger par le changement ou la nouveauté, qui est un mal, et fort dangereux. Il y en a d’autres cachés et enfoncés comme des ordures dans un cloaque, je veux dire ensevelis sous la honte, sous le secret et dans l’obscurité : on ne peut les fouiller et les remuer qu’ils n’exhalent le poison et l’infamie ; les plus sages doutent quelquefois s’il est mieux de connaître ces maux que de les ignorer. L’on tolère quelquefois dans un État un assez grand mal, mais qui détourne un million de petits maux ou d’inconvénients, qui tous seraient inévitables et irrémédiables. Il se trouve des maux dont chaque particulier gémit, et qui deviennent néanmoins un bien public, quoique le public ne soit autre chose que tous les particuliers. Il y a des maux personnels qui concourent au bien et à l’avantage de chaque famille. Il y en a qui affligent, ruinent ou déshonorent les familles, mais qui tendent au bien et à la conservation de la machine de l’État et du gouvernement. (La Bruyère, Les Caractères, X, 7 ; Pléiade, 1951, p. 270-1).
. Le caractère des Français demande du sérieux dans le souverain. (La Bruyère, Les Caractères, X, 13 ; Pléiade, 1951, p. 279).
. Les hommes en un sens ne sont point légers, ou ne le sont que dans les petites choses : ils changent leurs habits, leur langage, les dehors, les bienséances ; ils changent de goût quelquefois : ils gardent leurs mœurs toujours mauvaises ; fermes et constants dans le mal, ou dans l’indifférence pour la vertu. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 2 ; Pléiade, 1951, p. 289).
. L'incivilité n'est pas un vice de l'âme, elle est l'effet de plusieurs vices : de la sotte vanité, de l'ignorance de ses devoirs, de la paresse, de la stupidité, de la distraction, du mépris des autres, de la jalousie. Pour ne se répandre que sur les dehors, elle n'en est que plus haïssable, parce que c'est toujours un défaut visible et manifeste. Il est vrai cependant qu'il offense plus ou moins, selon la cause qui le produit. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 8 ; Pléiade, 1951, p. 297). 
. Dire d’un homme colère, inégal, querelleux, chagrin, pointilleux, capricieux : « c’est son humeur » n’est pas l’excuser, comme on le croit, mais avouer sans y penser que de si grands défauts sont irrémédiables. / Ce qu’on appelle humeur est une chose trop négligée parmi les hommes ; ils devraient comprendre qu’il ne leur suffit pas d’être bons, mais qu’ils doivent encore paraître tels, du moins s’ils tendent à être sociables, capables d’union et de commerce, c’est-à-dire à être des hommes. L’on n’exige pas des âmes malignes qu’elles aient de la douceur et de la souplesse ; elle ne leur manque jamais, et elle leur sert de piège pour surprendre les simples, et pour faire valoir leurs artifices : l’on désirerait de ceux qui ont un bon cœur qu’ils fussent toujours pliants, faciles, complaisants ; et qu’il fût moins vrai quelquefois que ce sont les méchants qui nuisent, et les bons qui font souffrir. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 9 ; Pléiade, 1951, p. 297-298).
. L'on demande pourquoi tous les hommes ensemble ne composent pas comme une seule nation, et n'ont point voulu parler une même langue, vivre sous les mêmes lois, convenir entre eux des mêmes usages et d'un même culte. Et moi, pensant à la contrariété des esprits, des goûts et des sentiments, je suis étonné de voir jusques à sept ou huit personnes se rassembler sous un même toit, dans une même enceinte, et composer une seule famille. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 16 ; Pléiade, 1951, p. 299).
. Tout est étranger dans l'humeur, les mœurs et les manières de la plupart des hommes. Tel a vécu pendant toute sa vie chagrin, emporté, avare, rampant, soumis, laborieux, intéressé, qui était né gai, paisible, paresseux, magnifique, d'un courage fier et éloigné de toute bassesse : les besoins de la vie, la situation où l'on se trouve, la loi de la nécessité forcent la nature et y causent ces grands changements. Ainsi tel homme au fond et en lui-même ne se peut définir : trop de choses qui sont hors de lui l'altèrent, le changent, le bouleversent ; il n'est point précisément ce qu'il est ou ce qu'il paraît être. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 18 ; Pléiade, 1951, p. 300).
. La vie est courte et ennuyeuse : elle se passe toute à désirer. L'on remet à l'avenir son repos et ses joies, à cet âge souvent où les meilleurs biens ont déjà disparu, la santé et la jeunesse. Ce temps arrive, qui nous surprend encore dans les désirs ; on en est là, quand la fièvre nous saisit et nous éteint : si l'on eût guéri, ce n'était que pour désirer plus longtemps. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 19 ; Pléiade, 1951, p. 300).
. Il est si ordinaire à l'homme de n'être pas heureux, et si essentiel à tout ce qui est un bien d'être acheté par mille peines, qu'une affaire qui se rend facile devient suspecte. L'on comprend à peine, ou que ce qui coûte si peu puisse nous être fort avantageux, ou qu'avec des mesures justes l'on doive si aisément parvenir à la fin que l'on se propose. L'on croit mériter les bons succès, mais n'y devoir compter que fort rarement. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 21 ; Pléiade, 1951, p. 300-301).
. L'homme qui dit qu'il n'est pas né heureux pourrait du moins le devenir par le bonheur de ses amis ou de ses proches. L'envie lui ôte cette dernière ressource. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 22 ; Pléiade, 1951, p. 301).
. Les hommes ont tant de peine à s'approcher sur les affaires, sont si épineux sur les moindres intérêts, si hérissés de difficultés, veulent si fort tromper et si peu être trompés, mettent si haut ce qui leur appartient, et si bas ce qui appartient aux autres, que j'avoue que je ne sais par où et comment se peuvent conclure les mariages, les contrats, les acquisitions, la paix, la trêve, les traités, les alliances. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 24 ; Pléiade, 1951, p. 301).
. Il y a de certains biens que l'on désire avec emportement, et dont l'idée seule nous enlève et nous transporte : s'il nous arrive de les obtenir, on les sent plus tranquillement qu'on ne l'eût pensé, on en jouit moins que l'on n'aspire encore à de plus grands. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 29 ; Pléiade, 1951, p. 303).
. Si la vie est misérable, elle est pénible à supporter ; si elle est heureuse, il est horrible de la perdre. L'un revient à l'autre. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 33 ; Pléiade, 1951, p. 304).
. Il n'y a rien que les hommes aiment mieux à conserver et qu'ils ménagent moins que leur propre vie. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 34 ; Pléiade, 1951, p. 304).
. La mort n'arrive qu'une fois, et se fait sentir à tous les instants de la vie ; il est plus dur de l'appréhender que de la souffrir. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 36 ; Pléiade, 1951, p. 305).
. L’on craint la vieillesse, que l’on n’est pas sûr de pouvoir atteindre.(La Bruyère, Les Caractères, XI, 40 ; Pléiade, 1951, p. 305).
. Si de tous les hommes les uns mouraient, les autres non, ce serait une désolante affliction que de mourir. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 43 ; Pléiade, 1951, p. 306).
. Le regret qu'ont les hommes du mauvais emploi du temps qu'ils ont déjà vécu, ne les conduit pas toujours à faire de celui qui leur reste à vivre un meilleur usage. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 46 ; Pléiade, 1951, p. 306).
. Il n'y a pour l'homme que trois événements : naître, vivre et mourir. Il ne se sent pas naître, il souffre à mourir, et il oublie de vivre. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 48 ; Pléiade, 1951, p. 307).
. Il y a un temps où la raison n'est pas encore, où l'on ne vit que par instinct, à la manière des animaux, et dont il ne reste dans la mémoire aucun vestige. Il y a un second temps où la raison se développe, où elle est formée, et où elle pourrait agir, si elle n'était pas obscurcie et comme éteinte par les vices de la complexion, et par un enchaînement de passions qui se succèdent les unes aux autres, et conduisent jusques au troisième et dernier âge. La raison, alors dans sa force, devrait produire ; mais elle est refroidie et ralentie par les années, par la maladie et la douleur, déconcertée ensuite par le désordre de la machine, qui est dans son déclin : et ces temps néanmoins sont la vie de l'homme. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 49 ; Pléiade, 1951, p. 307).
. Les enfants sont hautains, dédaigneux, colères, envieux, curieux, intéressés, paresseux, volages, timides, intempérants, menteurs, dissimulés ; ils rient et pleurent facilement ; ils ont des joies immodérées et des afflictions amères sur de très petits sujets ; ils ne veulent point souffrir de mal, et aiment à en faire : ils sont déjà des hommes. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 50 ; Pléiade, 1951, p. 307).
. Nous faisons par vanité ou par bienséance les mêmes choses, et avec les mêmes dehors, que nous les ferions par inclination ou par devoir. Tel [=Louis-Armand de Bourbon-Conti, 1661-1685] vient de mourir à Paris de la fièvre qu’il a gagnée à veiller sa femme qu’il n’aimait point. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 64 ; Pléiade, 1951, p. 311).
. Le monde est plein de gens qui faisant intérieurement et par habitude la comparaison d'eux-mêmes avec les autres, décident toujours en faveur de leur propre mérite, et agissent conséquemment. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 70 ; Pléiade, 1951, p. 314).
. Nous cherchons notre bonheur hors de nous-mêmes, et dans l'opinion des hommes, que nous connaissons flatteurs, peu sincères, sans équité, pleins d'envie, de caprices et de préventions. Quelle bizarrerie ! (La Bruyère, Les Caractères, XI, 76 ; Pléiade, 1951, p. 315).
. Ceux qui nous ravissent les biens par la violence ou par l’injustice, et qui nous ôtent l’honneur par la calomnie, nous marquent assez leur haine pour nous ; mais ils ne nous prouvent pas également qu’ils aient perdu à notre égard toute sorte d’estime : aussi ne sommes-nous pas incapables de quelque retour pour eux, et de leur rendre un jour notre amitié. La moquerie au contraire est de toutes les injures celle qui se pardonne le moins ; elle est le langage du mépris, et l’une des manières dont il se fait le mieux entendre ; elle attaque l’homme dans son dernier retranchement, qui est l’opinion qu’il a de soi-même ; elle veut le rendre ridicule à ses propres yeux ; et ainsi elle le convainc de la plus mauvaise disposition où l’on puisse être pour lui, et le rend irréconciliable. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 78 ; Pléiade, 1951, p. 316). 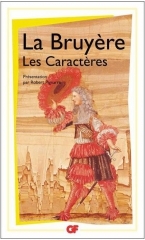
. On est prompt à connaître ses plus petits avantages, et lent à pénétrer ses défauts. On n’ignore point qu’on a de beaux sourcils, les ongles bien faits ; on sait à peine que l’on est borgne ; on ne sait point du tout que l’on manque d’esprit. / Argyre tire son gant pour montrer une belle main, et elle ne néglige pas de découvrir un petit soulier qui suppose qu’elle a le pied petit ; elle rit des choses plaisantes ou sérieuses pour faire voir de belles dents ; si elle montre son oreille, c’est qu’elle l’a bien faite ; et si elle ne danse jamais, c’est qu’elle est peu contente de sa taille, qu’elle a épaisse. Elle entend tous ses intérêts, à l’exception d’un seul : elle parle toujours, et n’a point d’esprit. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 83 ; Pléiade, 1951, p. 317).
. Les hommes comptent presque pour rien toutes les vertus du cœur, et idolâtrent les talents du corps et de l’esprit. Celui qui dit froidement de soi, et sans croire blesser la modestie, qu’il est bon, qu’il est constant, fidèle, sincère, équitable, reconnaissant, n’ose dire qu’il est vif, qu’il a les dents belles et la peau douce : cela est trop fort. / Il est vrai qu’il y a deux vertus que les hommes admirent, la bravoure et la libéralité, parce qu’il y a deux choses qu’ils estiment beaucoup, et que ces vertus font négliger, la vie et l’argent : aussi personne n’avance de soi qu’il est brave ou libéral. / Personne ne dit de soi, et surtout sans fondement, qu’il est beau, qu’il est généreux, qu’il est sublime : on a mis ces qualités à un trop haut prix ; on se contente de le penser. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 84 ; Pléiade, 1951, p. 317-318).
. L'on voit peu d'esprits entièrement lourds et stupides ; l'on en voit encore moins qui soient sublimes et transcendants. Le commun des hommes nage entre ces deux extrémités. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 86 ; Pléiade, 1951, p. 319).
. Tout l'esprit qui est au monde est inutile à celui qui n'en a point : il n'a nulles vues, et il est incapable de profiter de celles d'autrui. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 87 ; Pléiade, 1951, p. 320).
. Quelle mésintelligence entre l'esprit et le cœur ! Le philosophe vit mal avec tous ses préceptes, et le politique rempli de vues et de réflexions ne sait pas se gouverner. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 91 ; Pléiade, 1951, p. 320).
. Un homme haut et robuste, qui a une poitrine large et de larges épaules, porte légèrement et de bonne grâce un lourd fardeau ; il lui reste encore un bras de libre : un nain serait écrasé de la moitié de sa charge. Ainsi les postes éminents rendent les grands hommes encore plus grands, et les petits beaucoup plus petits. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 95 ; Pléiade, 1951, p. 321).
. Il coûte moins à certains hommes de s'enrichir de mille vertus, que de se corriger d'un seul défaut. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 98 ; Pléiade, 1951, p. 322).
. Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls : de là le jeu, le luxe, la dissipation, le vin, les femmes, l’ignorance, la médisance, l’envie, l’oubli de soi-même et de Dieu. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 99 ; Pléiade, 1951, p. 323).
. La plupart des hommes emploient la première partie de leur vie à rendre l’autre misérable. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 102 ; Pléiade, 1951, p. 324).
. Les haines sont si longues et si opiniâtrées, que le plus grand signe de mort dans un homme malade, c'est la réconciliation. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 1088 ; Pléiade, 1951, p. 325-326).
. L’on s’insinue auprès de tous les hommes, ou en les flattant dans les passions qui occupent leur âme, ou en compatissant aux infirmités qui affligent leur corps ; en cela seul consistent les soins que l’on peut leur rendre : de là vient que celui qui se porte bien, et qui désire peu de choses, est moins facile à gouverner. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 109 ; Pléiade, 1951, p. 326).
. Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les vieillards : ils aiment les lieux où ils l’ont passée ; les personnes qu’ils ont commencé de connaître dans ce temps leur sont chères ; ils affectent quelques mots du premier langage qu’ils ont parlé ; ils tiennent pour l’ancienne manière de chanter, et pour la vieille danse ; ils vantent les modes qui régnaient alors dans les habits, les meubles et les équipages ; ils ne peuvent encore désapprouver des choses qui servaient à leurs passions, qui étaient si utiles à leurs plaisirs, et qui en rappellent la mémoire : comment pourraient-ils leur préférer de nouveaux usages et des modes toutes récentes où ils n’ont nulle part, dont ils n’espèrent rien, que les jeunes gens ont faites, et dont ils tirent à leur tour de si grands avantages contre la vieillesse ? (La Bruyère, Les Caractères, XI, 115 ; Pléiade, 1951, p. 327-328).
. Les hommes en un même jour ouvrent leur âme à de petites joies, et se laissent dominer par de petits chagrins ; rien n’est plus inégal et moins suivi que ce qui se passe en si peu de temps dans leur cœur et dans leur esprit. Le remède à ce mal est de n’estimer les choses du monde précisément que ce qu’elles valent. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 133 ; Pléiade, 1951, p. 335).
. La plupart des hommes, pour arriver à leurs fins, sont plus capables d’un grand effort que d’une longue persévérance : leur paresse ou leur inconstance leur fait perdre le fruit des meilleurs commencements ; ils se laissent souvent devancer par d’autres qui sont partis après eux, et qui marchent lentement, mais constamment. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 137 ; Pléiade, 1951, p. 336).
. Les hommes agissent mollement dans les choses qui sont de leur devoir, pendant qu'ils se font un mérite, ou plutôt une vanité, de s'empresser pour celles qui leur sont étrangères, et qui ne conviennent ni à leur état ni à leur caractère. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 139 ; Pléiade, 1951, p. 336).
. Les hommes s'ennuient enfin des mêmes choses qui les ont charmés dans leurs commencements : ils déserteraient la table des Dieux, et le nectar avec le temps leur devient insipide : ils n’hésitent pas de critiquer des choses qui sont parfaites. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 145 ; Pléiade, 1951, p. 339).
. L'on se repent rarement de parler peu, très souvent de trop parler : maxime usée et triviale que tout le monde sait, et que tout le monde ne pratique pas. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 149 ; Pléiade, 1951, p. 340).
. Il y a dans quelques hommes une certaine médiocrité d'esprit qui contribue à les rendre sages. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 153 ; Pléiade, 1951, p. 341).
. Il faut aux enfants les verges et la férule ; il faut aux hommes faits une couronne, un sceptre, un mortier, des fourrures, des faisceaux, des timbales, des hoquetons. La raison et la justice dénuées de tous leurs ornements ni ne persuadent ni n'intimident. L'homme, qui est esprit, se mène par les yeux et les oreilles. (La Bruyère, Les Caractères, XI, 154 ; Pléiade, 1951, p. 341).
. Rien ne ressemble mieux à la vive persuasion que le mauvais entêtement : de là les partis, les cabales, les hérésies. (La Bruyère, Les Caractères, XII, 1 ; Pléiade, 1951, p. 343).
. Il est étonnant qu'avec tout l'orgueil dont nous sommes gonflés, et la haute opinion que nous avons de nous-mêmes et de la bonté de notre jugement, nous négligions de nous en servir pour prononcer sur le mérite des autres. La vogue, la faveur populaire, celle du Prince, nous entraînent comme un torrent : nous louons ce qui est loué, bien plus que ce qui est louable. (La Bruyère, Les Caractères, XII, 7 ; Pléiade, 1951, p. 343-344).
. Je ne sais s’il y a rien au monde qui coûte davantage à approuver et à louer que ce qui est plus digne d’approbation et de louange, et si la vertu, le mérite, la beauté, les bonnes actions, les beaux ouvrages, ont un effet plus naturel et plus sûr que l’envie, la jalousie et l’antipathie. Ce n’est pas d’un saint [qu’]un dévot sait dire du bien, mais d’un autre dévot. Si une belle femme approuve la beauté d’une autre femme, on peut conclure qu’elle a mieux que ce qu’elle approuve. Si un poète loue les vers d’un autre poète, il y a à parier qu’ils sont mauvais et sans conséquence. (La Bruyère, Les Caractères, XII, 8 ; Pléiade, 1951, p. 344).
. Si nous entendions dire des Orientaux qu’ils boivent ordinairement d’une liqueur qui leur monte à la tête, leur fait perdre la raison, et les fait vomir, nous dirions : « Cela est bien barbare ». (La Bruyère, Les Caractères, XII, 24 ; Pléiade, 1951, p. 352). 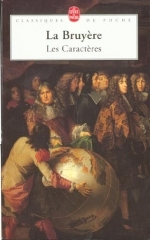
. Ceux qui, sans nous connaître assez, pensent mal de nous, ne nous font pas de tort : ce n’est pas nous qu’ils attaquent, c’est le fantôme de leur imagination. (La Bruyère, Les Caractères, XII, 35 ; Pléiade, 1951, p. 356).
. Rien ne nous venge mieux des mauvais jugements que les hommes font de notre esprit, de nos mœurs et de nos manières, que l'indignité et le mauvais caractère de ceux qu'ils approuvent. Du même fonds dont on néglige un homme de mérite, l'on sait encore admirer un sot. (La Bruyère, Les Caractères, XII, 43 ; Pléiade, 1951, p. 358).
. Un sot est celui qui n'a pas même ce qu'il faut d'esprit pour être fat. (La Bruyère, Les Caractères, XII, 44 ; Pléiade, 1951, p. 358).
. Le stupide est un sot qui ne parle point, en cela plus supportable que le sot qui parle. (La Bruyère, Les Caractères, XII, 49 ; Pléiade, 1951, p. 359).
. La même chose souvent est, dans la bouche d'un homme d'esprit, une naïveté ou un bon mot, et dans celle d'un sot, une sottise. (La Bruyère, Les Caractères, XII, 50 ; Pléiade, 1951, p. 359).
. Nous affectons souvent de louer avec exagération des hommes assez médiocres, et de les élever, s’il se pouvait, jusques à la hauteur de ceux qui excellent, ou parce que nous somme las d’admirer toujours les mêmes personnes, ou parce que leur gloire, ainsi partagée, offense moins notre vue, et nous devient plus douce et plus supportable. (La Bruyère, Les Caractères, XII, 60 ; Pléiade, 1951, p. 363).
. Il est ordinaire et comme naturel de juger du travail d’autrui seulement par rapport à celui qui nous occupe. Ainsi le poète, rempli de grandes et sublimes idées, estime peu le discours de l’orateur, qui ne s’exerce souvent que sur de simples faits ; et celui qui écrit l’histoire de son pays ne peut comprendre qu’un esprit raisonnable emploie sa vie à imaginer des fictions et à trouver une rime ; de même le bachelier plongé dans les quatre premiers siècles traite toute autre doctrine de science triste, vaine et inutile, pendant qu’il est peut-être méprisé du géomètre. (La Bruyère, Les Caractères, XII, 62 ; Pléiade, 1951, p. 364).
. C'est abréger et s'épargner mille discussions, que de penser de certaines gens qu'ils sont incapables de parler juste, et de condamner ce qu'ils disent, ce qu'ils ont dit, et ce qu'ils diront. (La Bruyère, Les Caractères, XII, 70 ; Pléiade, 1951, p. 367).
. Nous n’approuvons les autres que par les rapports que nous sentons qu’ils ont avec nous-mêmes ; et il semble qu’estimer quelqu’un, c’est l’égaler à soi. (La Bruyère, Les Caractères, XII, 71 ; Pléiade, 1951, p. 367).
. Je ne mets au-dessus d'un grand politique que celui qui néglige de le devenir, et qui se persuade de plus en plus que le monde ne mérite point qu'on s'en occupe. (La Bruyère, Les Caractères, XII, 75 ; Pléiade, 1951, p. 368).
. C'est un excès de confiance dans les parents d'espérer tout de la bonne éducation de leurs enfants, et une grande erreur de n'en attendre rien et de la négliger. (La Bruyère, Les Caractères, XII, 84 ; Pléiade, 1951, p. 370).
. Il n’y a que de l’avantage pour celui qui parle peu : la présomption est qu’il a de l’esprit ; et s’il est vrai qu’il n’en manque pas, la présomption est qu’il l’a excellent. (La Bruyère, Les Caractères, XII, 86 ; Pléiade, 1951, p. 370).
. Un homme est fidèle à de certaines pratiques de religion, on le voit s’en acquitter avec exactitude : personne ne le loue ni ne le désapprouve, on n’y pense pas. Tel autre y revient après les avoir négligées dix années entières : on se récrie, on l’exalte ; cela est libre : moi, je le blâme d’un si long oubli de ses devoirs, et je le trouve heureux d’y être rentré. (La Bruyère, Les Caractères, XII, 89 ; Pléiade, 1951, p. 371).
. Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de soi, ni des autres. (La Bruyère, Les Caractères, XII, 90 ; Pléiade, 1951, p. 371).
. Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté : comme ils le consument à s’habiller, à manger, à dormir, à de sots discours, à se résoudre sur ce qu’ils doivent faire, et souvent à ne rien faire, ils en manquent pour leurs affaires ou pour leurs plaisirs ; ceux au contraire qui en font un meilleur usage en ont de reste. / Il n’y a point de ministre si occupé qui ne sache perdre chaque jour deux heures de temps : cela va loin à la fin d’une longue vie ; et si le mal est encore plus grand dans les autres conditions des hommes, quelle perte infinie ne se fait pas dans le monde d’une chose si précieuse, et dont l’on se plaint qu’on n’a point assez !(La Bruyère, Les Caractères, XII, 101 ; Pléiade, 1951, p. 375).
. Il y a des créatures de Dieu qu’on appelle des hommes, qui ont une âme qui est esprit, dont toute la vie est occupée et toute l’attention est réunie à scier du marbre ; cela est bien simple, c’est bien peu de chose. Il y en a d’autres qui s’en étonnent, mais qui sont entièrement inutiles, et qui passent les jours à ne rien faire : c’est encore moins que de scier du marbre. (La Bruyère, Les Caractères, XII, 102 ; Pléiade, 1951, p. 375-376).
. La plupart des hommes oublient si fort qu’ils ont une âme, et se répandent en tant d’actions et d’exercices où il semble qu’elle est inutile, que l’on croit parler avantageusement de quelqu’un en disant qu’il pense ; cet éloge même est devenu vulgaire, qui pourtant ne met cet homme qu’au-dessus du chien ou du cheval. (La Bruyère, Les Caractères, XII, 103 ; Pléiade, 1951, p. 376).
. « À quoi vous divertissez-vous ? à quoi passez-vous le temps ? » vous demandent les sots et les gens d’esprit. Si je réplique que c’est à ouvrir les yeux et à voir, à prêter l’oreille et à entendre, à voir la santé, le repos, la liberté, ce n’est rien dire. Les solides biens, les grands biens, les seuls biens ne sont pas comptés, ne se font pas sentir : jouez-vous ? masquez-vous ? il faut répondre. / Est-ce un bien pour l’homme que la liberté, si elle peut être trop grande et trop étendue, telle enfin qu’elle ne serve qu’à lui faire désirer quelque chose, qui est d’avoir moins de liberté ? / La liberté n’est pas oisiveté ; c’est un usage libre du temps ; c’est le choix du travail et de l’exercice. Être libre en un mot n’est pas ne rien faire, c’est être seul arbitre de ce qu’on fait ou de ce qu’on ne fait point. Quel bien en ce sens que la liberté ! (La Bruyère, Les Caractères, XII, 104 ; Pléiade, 1951, p. 376).
. Si le monde dure seulement cent millions d’années, il est encore dans toute sa fraîcheur, et ne fait presque que commencer ; nous-mêmes nous touchons aux premiers hommes et aux patriarches, et qui pourra ne nous pas confondre avec eux dans des siècles si reculés ? Mais si l’on juge par le passé de l’avenir, quelles choses nouvelles nous sont inconnues dans les arts, dans les sciences, dans la nature, et j’ose dire dans l’histoire ! quelles découvertes ne fera-t-on point ! quelles différentes révolutions ne doivent pas arriver sur toute la face de la terre, dans les États et dans les empires ! quelle ignorance est la nôtre ! et quelle légère expérience que celle de six ou sept mille ans ! (La Bruyère, Les Caractères, XII, 107 ; Pléiade, 1951, p. 377).
. Les hommes, séduits par de belles apparences et de spécieux prétextes, goûtent aisément un projet d'ambition que quelques grands ont médité ; ils en parlent avec intérêt ; il leur plaît même par la hardiesse ou par la nouveauté que l'on lui impute ; ils y sont déjà accoutumés, et n'en attendent que le succès, lorsque, venant au contraire à avorter, ils décident avec confiance, et sans nulle crainte de se tromper, qu'il était téméraire et ne pouvait réussir. (La Bruyère, Les Caractères, XII, 114 ; Pléiade, 1951, p. 379).
. Un homme fat et ridicule porte un long chapeau, un pourpoint à ailerons, des chausses à aiguillettes et des bottines ; il rêve la veille par où et comment il pourra se faire remarquer le jour qui suit. Un philosophe se laisse habiller par son tailleur ; il y a autant de faiblesse à fuir la mode qu’à l’affecter. (La Bruyère, Les Caractères, XIII, 11 ; Pléiade, 1951, p. 394).
. Le courtisan autrefois avait ses cheveux, était en chausses et en pourpoint, portait de larges canons, et il était libertin ; cela ne sied plus : il porte une perruque, l’habit serré, le bas uni, et il est dévot : tout se règle par la mode. (La Bruyère, Les Caractères, XIII, 16 ; Pléiade, 1951, p. 397).
. Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout ce qui n’est pas vertueux ; et si elle n’est pas vertu, c’est peu de chose. (La Bruyère, Les Caractères, XIV, 15 ; Pléiade, 1951, p. 410).
. Combien d’hommes qui sont forts contre les faibles, fermes et inflexibles aux sollicitations du simple peuple, sans nuls égards pour les petits, rigides et sévères dans les minuties, qui refusent les petits présents, qui n’écoutent ni leurs parents ni leurs amis, et que les femmes seules peuvent corrompre ! (La Bruyère, Les Caractères, XIV, 54 ; Pléiade, 1951, p. 422).
. L'on doute de Dieu dans une pleine santé, comme l'on doute que ce soit pécher que d'avoir un commerce avec une personne libre. Quand l'on devient malade, et que l'hydropisie est formée, l'on quitte sa concubine, et l'on croit en Dieu. (La Bruyère, Les Caractères, XVI, 6 ; Pléiade, 1951, p. 451).
. Qui a vécu un seul jour a vécu un siècle : même soleil, même terre, même monde, mêmes sensations ; rien ne ressemble mieux à aujourd’hui que demain. Il y aurait quelque curiosité à mourir, c’est-à-dire à n’être plus un corps, mais à être seulement esprit : l’homme cependant, impatient de la nouveauté, n’est point curieux sur ce seul article ; né inquiet et qui s’ennuie de tout, il ne s’ennuie point de vivre ; il consentirait peut-être à vivre toujours. Ce qu’il voit de la mort le frappe plus violemment que ce qu’il en sait : la maladie, la douleur, le cadavre le dégoûtent de la connaissance d’un autre monde. Il faut tout le sérieux de la religion pour le réduire. (La Bruyère, Les Caractères, XVI, 32 ; Pléiade, 1951, p. 460).
. Comme les hommes ne se dégoûtent point du vice, il ne faut pas se lasser de leur reprocher : ils seraient peut-être pires, s’ils venaient à manquer de censeurs ou de critiques ; c’est ce qui fait que l’on prêche et que l’on écrit. (La Bruyère, Les Caractères, préface ; Pléiade, 1951, p. 61).
. Si on ne goûte point ces Caractères, je m’en étonne ; et si on les goûte, je m’en étonne de même. (La Bruyère, Les Caractères, épilogue ; Pléiade, 1951, p. 478).
. Je dis en effet ce que je dis, et nullement ce qu’on assure que j’ai voulu dire, et je réponds encore moins de ce qu’on me fait dire, et que je ne dis point. (La Bruyère, Discours prononcé dans l’Académie française, préface ; Pléiade, 1951, p. 489).
Autres pages de citations en rapport avec celle-ci sur ce blogue : Auteurs grecs [en préparation] ; Auteurs latins [en préparation] ; Penseurs politiques classiques [en préparation] ; Montaigne ; Balthasar Gracian [en préparation] ; Penseurs religieux du Grand Siècle : Pascal, Bossuet, Fénelon et les autres [en préparation] ; Dramaturges classiques : Corneille, Molière, Racine et les autres ; Écrivains divers du XVIIe siècle [en préparation] ; Cardinal de Richelieu et Cardinal de Retz [en préparation] ; La Rochefoucauld ; Écrivains divers du XVIIIe siècle [en préparation] ; Libertins du XVIIIe siècle [en préparation] ; Vauvenargues [en préparation] ; Montesquieu [en préparation] ; Voltaire [en préparation] ; Diderot [en préparation] ; Jean-Jacques Rousseau [en préparation] ; Chamfort ; Joseph Joubert [en préparation] ; Jules Renard ; Georges Courteline ; Paul Léautaud ; Raymond Radiguet ; Cioran [en préparation] ; Hubert Monteilhet, – et la page générale : citations choisies et dûment vérifiées.
Lire aussi Tartuffe et les metteurs en scène, une triple imposture.

1 commentaire
Il y a des esprits, si je l'ose dire, inférieurs et subalternes, qui ne semblent faits que pour être le recueil, le registre, ou le magasin de toutes les productions des autres génies : ils sont plagiaires, traducteurs, compilateurs ; ils ne pensent point, ils disent ce que les auteurs ont pensé ; et comme le choix des pensées est invention, ils l'ont mauvais, peu juste, et qui les détermine plutôt à rapporter beaucoup de choses, que d'excellentes choses ; ils n'ont rien d'original et qui soit à eux ; ils ne savent que ce qu'ils ont appris, et ils n'apprennent que ce que tout le monde veut bien ignorer, une science aride, dénuée d'agrément et d'utilité, qui ne tombe point dans la conversation, qui est hors de commerce, semblable à une monnaie qui n'a point de cours : on est tout à la fois étonné de leur lecture et ennuyé de leur entretien ou de leurs ouvrages. Ce sont ceux que les grands et le vulgaire confondent avec les savants, et que les sages renvoient au pédantisme. » (Caractères, I, § 62).
Écrire un commentaire