NOTE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES ÉDITIONS DES /ESSAIS/ DE MONTAIGNE
01.03.2013
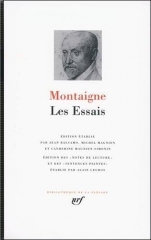 Dans mon florilège de pensées de Montaigne, j’ai donné les pages de ce qui me semble désormais et pour longtemps l’édition de référence : la nouvelle édition de la Pléiade, monument d’érudition montaigniste, parue en 2007 et due à Jean Balsamo, Michel Magnien et Catherine Magnien-Simonin ; toutefois j’en ai modernisé l’orthographe et la ponctuation [1]. En effet, elle respecte scrupuleusement la graphie du XVIe [2], mais aussi sa ponctuation souvent incohérente et pénible : il n’y a presque jamais de paragraphe ! Cette édition, dont l’appareil critique est très copieux (en bas de page : équivalences lexicales et traduction des citations ; en fin de volume : relevé intégral des variantes, référence détaillée de toutes les citations, notice pour chaque chapitre, bibliographie copieuse, index, etc), suit non pas le texte du fameux « exemplaire de Bordeaux » complété par la main de Montaigne, mais le texte de l’édition posthume de 1595, préparée par Marie de Gournay.
Dans mon florilège de pensées de Montaigne, j’ai donné les pages de ce qui me semble désormais et pour longtemps l’édition de référence : la nouvelle édition de la Pléiade, monument d’érudition montaigniste, parue en 2007 et due à Jean Balsamo, Michel Magnien et Catherine Magnien-Simonin ; toutefois j’en ai modernisé l’orthographe et la ponctuation [1]. En effet, elle respecte scrupuleusement la graphie du XVIe [2], mais aussi sa ponctuation souvent incohérente et pénible : il n’y a presque jamais de paragraphe ! Cette édition, dont l’appareil critique est très copieux (en bas de page : équivalences lexicales et traduction des citations ; en fin de volume : relevé intégral des variantes, référence détaillée de toutes les citations, notice pour chaque chapitre, bibliographie copieuse, index, etc), suit non pas le texte du fameux « exemplaire de Bordeaux » complété par la main de Montaigne, mais le texte de l’édition posthume de 1595, préparée par Marie de Gournay.
Quelques années avant, ç'avait déjà été le choix[3] de l’édition Pochothèque,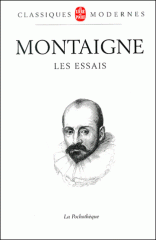 parue en 2001 sous la direction de Jean Céard. Son appareil critique est plus réduit, quoique substantiel néanmoins. Les abondantes notes sont toutes placées en bas de page (équivalences lexicales, précisions documentaires et explications sont appelées pareillement) ; la traduction des citations étrangères est donnée directement dans le texte ; la typographie est aérée et l’orthographe modernisée (pas la ponctuation, hélas) : c’est une édition très lisible, qu’on a plaisir à ouvrir n’importe où, alors que la précieuse Pléiade, à manipuler soigneusement, est réservée au bureau. À la fin, on trouve un appendice grammatical et surtout une sorte d’index des notions qui est très utile (en plus de l’indispensable index des noms propres). Au lecteur qui ne saurait pas dans quel livre lire Montaigne (et qui, voulant goûter la saveur de la langue du seizième siècle – mais sans l'écran d'une orthographe barbare –, rejetterait les versions traduites en français contemporain, appelées à se substituer au texte original dans deux ou trois générations, comme celle d'André Lanly reprise en Quarto Gallimard), je recommande vivement ce volume, parfait compromis entre l'édition savante (ou pédantesque) et l'édition populaire (ou vulgaire) : une édition pour l'honnête homme. Elle a été reprise, dès 2002, en trois volumes du Livre de poche.
parue en 2001 sous la direction de Jean Céard. Son appareil critique est plus réduit, quoique substantiel néanmoins. Les abondantes notes sont toutes placées en bas de page (équivalences lexicales, précisions documentaires et explications sont appelées pareillement) ; la traduction des citations étrangères est donnée directement dans le texte ; la typographie est aérée et l’orthographe modernisée (pas la ponctuation, hélas) : c’est une édition très lisible, qu’on a plaisir à ouvrir n’importe où, alors que la précieuse Pléiade, à manipuler soigneusement, est réservée au bureau. À la fin, on trouve un appendice grammatical et surtout une sorte d’index des notions qui est très utile (en plus de l’indispensable index des noms propres). Au lecteur qui ne saurait pas dans quel livre lire Montaigne (et qui, voulant goûter la saveur de la langue du seizième siècle – mais sans l'écran d'une orthographe barbare –, rejetterait les versions traduites en français contemporain, appelées à se substituer au texte original dans deux ou trois générations, comme celle d'André Lanly reprise en Quarto Gallimard), je recommande vivement ce volume, parfait compromis entre l'édition savante (ou pédantesque) et l'édition populaire (ou vulgaire) : une édition pour l'honnête homme. Elle a été reprise, dès 2002, en trois volumes du Livre de poche.
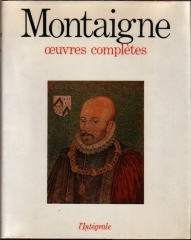 J’ai longtemps utilisé l’édition de la collection « L’Intégrale » au Seuil, faite par Robert Barral et Pierre Michel en 1967, à l’orthographe modernisée et au texte très serré sur deux colonnes. La lecture n'en est pas très commode, mais en compensation, quand le volume est ouvert, l’œil balaye une vaste portion de texte, ce qui peut être utile pour chercher un fragment (une page de ce volume contient quatre pages de la Pochothèque). Les notes (en bas de page) sont réduites au minimum (ce sont surtout les traductions des citations), cependant c’est la seule édition que j’aie pour le Journal de voyage en Italie et les lettres, expulsés de la nouvelle Pléiade [4] (la précédente, qui datait de 1963, avait un appareil critique indigent, mais au moins proposait-elle des œuvres complètes en un volume : L’Intégrale reste donc la seule à offrir tout Montaigne en un seul bloc). Après un glossaire et un index des noms (principaux), la table des matières y est mêlée à une « table des citations-clés » qui peut rendre des services.
J’ai longtemps utilisé l’édition de la collection « L’Intégrale » au Seuil, faite par Robert Barral et Pierre Michel en 1967, à l’orthographe modernisée et au texte très serré sur deux colonnes. La lecture n'en est pas très commode, mais en compensation, quand le volume est ouvert, l’œil balaye une vaste portion de texte, ce qui peut être utile pour chercher un fragment (une page de ce volume contient quatre pages de la Pochothèque). Les notes (en bas de page) sont réduites au minimum (ce sont surtout les traductions des citations), cependant c’est la seule édition que j’aie pour le Journal de voyage en Italie et les lettres, expulsés de la nouvelle Pléiade [4] (la précédente, qui datait de 1963, avait un appareil critique indigent, mais au moins proposait-elle des œuvres complètes en un volume : L’Intégrale reste donc la seule à offrir tout Montaigne en un seul bloc). Après un glossaire et un index des noms (principaux), la table des matières y est mêlée à une « table des citations-clés » qui peut rendre des services.
J’ai aussi, par héritage, l’édition des Essais au Club français du Livre (par Samuel Silvestre de Sacy, 1962) 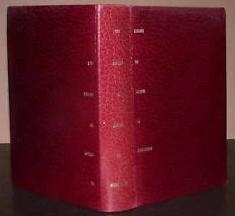
Enfin, comment pourrait manquer à ma bibliothèque celle qui fut l’édition de référence 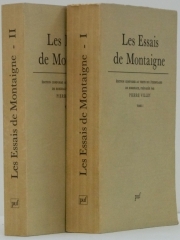 pendant presque tout le XXe siècle ? : l’édition de Pierre Villey, qui date de 1922-23 et qu’il faut lire dans l’édition révisée par V.-L. Saulnier en 1965, aux P.U.F. Elle a été rééditée en deux volumes en 1978 (que j’ai), en trois volumes de la collection Quadrige en 1990, puis à nouveau en un volume en 2004. De façon discutable, elle a imposé « l’exemplaire de Bordeaux » (un volume des Essais de 1588 couvert d’additions autographes) comme texte de base [5] et elle reproduit l’orthographe de l’époque, tout en adaptant la ponctuation et en découpant le texte en paragraphes (deux libertés bien agréables, que s'est fâcheusement interdites la Pochothèque). Son appareil critique est très riche : catalogue des livres de Montaigne, notice pour chaque chapitre, référence des citations, index des noms mêlé de quelques notions, mais aussi notes sur « la fortune des Essais » (p. 1119-1200) recensant de très nombreuses réflexions faites sur des passages de Montaigne par les auteurs des XVIIe et XVIIIe siècles (et parfois postérieurs). En outre, elle se signale par le repérage systématique de trois étapes d’écriture, désignées par A (1ère édition de 1580), B (2ème édition de 1588), C (ajouts manuscrits sur l’exemplaire de Bordeaux), repérage génétique que les montaignologues contemporains rejettent, d’une part parce que cela fige abusivement trois strates privilégiées, alors qu’il y en a eu cinq voire plus, d’autre part parce que cela trahit le dessein d’unité et de cohésion de l’œuvre.
pendant presque tout le XXe siècle ? : l’édition de Pierre Villey, qui date de 1922-23 et qu’il faut lire dans l’édition révisée par V.-L. Saulnier en 1965, aux P.U.F. Elle a été rééditée en deux volumes en 1978 (que j’ai), en trois volumes de la collection Quadrige en 1990, puis à nouveau en un volume en 2004. De façon discutable, elle a imposé « l’exemplaire de Bordeaux » (un volume des Essais de 1588 couvert d’additions autographes) comme texte de base [5] et elle reproduit l’orthographe de l’époque, tout en adaptant la ponctuation et en découpant le texte en paragraphes (deux libertés bien agréables, que s'est fâcheusement interdites la Pochothèque). Son appareil critique est très riche : catalogue des livres de Montaigne, notice pour chaque chapitre, référence des citations, index des noms mêlé de quelques notions, mais aussi notes sur « la fortune des Essais » (p. 1119-1200) recensant de très nombreuses réflexions faites sur des passages de Montaigne par les auteurs des XVIIe et XVIIIe siècles (et parfois postérieurs). En outre, elle se signale par le repérage systématique de trois étapes d’écriture, désignées par A (1ère édition de 1580), B (2ème édition de 1588), C (ajouts manuscrits sur l’exemplaire de Bordeaux), repérage génétique que les montaignologues contemporains rejettent, d’une part parce que cela fige abusivement trois strates privilégiées, alors qu’il y en a eu cinq voire plus, d’autre part parce que cela trahit le dessein d’unité et de cohésion de l’œuvre.
Finalement, j’ai aussi indiqué dans ma collection les pages de l’édition de Jean Céard (Pochothèque, 2001) et de l’édition de Pierre Villey (P.U.F., 1965, mais les rééditions suivantes reprennent la même pagination).
Au fait, le titre est-il Essais ou Les Essais ? Toutes les éditions parues du vivant de Montaigne s’intitulent Essais. L’article apparaît dans l’édition posthume de 1595 : a-t-il vraiment été ajouté par l’auteur ? On peut se demander si le titre n’aurait pas été modifié d’autorité par l’éditeur, Abel L’Angelier, afin de souligner qu’il s’agissait d’un livre déjà parvenu à une certaine notoriété. Il me semble que la version sans article a quelque chose de plus modeste et plus personnel.
[1] Selon un principe avoué ici, j’ai aussi pu détacher une sentence d’une phrase plus complète, en coupant le début ou la fin (mais pas en déformant la sentence détachée, bien sûr, – sauf, de façon exceptionnelle et signalée par des crochets, pour des raisons de pure modernisation de la langue). J’assume le léger gauchissement qui peut parfois résulter de cette segmentation, par rapport à la pensée plus nuancée de Montaigne. Par ailleurs, certains allèguent que tout prélèvement de citations chez Montaigne le trahit, car chez lui c’est la coulée qui est essentielle, et il n’est rien de moins qu’un donneur de leçons proposant une liste de vérités définitives, détachables et transposables de façon universelle. Certes. Mais Montaigne lui-même est le plus grand citateur de notre littérature, et du reste, s’il y a un auteur qui nous autorise à l’accommoder à notre façon et faire de lui l’usage qu’il nous plaira, c’est bien lui. Comme Nietzsche, Montaigne fait partie de ces hommes libres qu’on respecte d’autant mieux qu’on ne les suit pas à la lettre.
[2] Je ne comprends pas la politique de la Pléiade : sa règle est de moderniser systématiquement l’orthographe des auteurs qu’elle publie (à la curieuse exception de Rousseau). Mais elle enfreint sa propre règle là où elle serait le plus utile : pour le XVIe siècle, époque où la graphie était encore très anarchique et où l’écart avec l’orthographe fixée au début du XIXe est très sensible. Ainsi, en plus des volumes plus anciens déjà publiés avec la rebutante graphie d’époque (d’Aubigné, Montluc, les conteurs français et une anthologie des poètes français, auxquels il faut ajouter le Plutarque d’Amyot parmi les auteurs de l’Antiquité), nous a-t-elle offert depuis vingt ans un Brantôme (1991), un nouveau Ronsard (1993-94), un nouveau Rabelais (1994), un nouveau Montaigne (2007), qui découragent la bonne volonté de l’honnête homme. Cependant, pour le Calvin de 2009, elle a eu la bonne idée de moderniser l’orthographe. Tardif changement de politique pour le XVIe, enfin ? Mais pourquoi a-t-elle si longtemps confondu son rôle avec celui de Champion, de Klincksieck et de Droz, maisons qui ont vocation à publier des éditions critiques à la seule destination du monde universitaire, et pourquoi seulement pour le XVIe, ô aberration ? À vrai dire, il y a aussi quelques volumes du XVIIe où l’orthographe n’est pas modernisée : celui des romanciers du XVIIe (Sorel, Scarron, Furetière, La Fayette) paru en 1958, les deux de Tallemant des Réaux en 1960-61, celui de Boileau en 1966. Mais ce sont des volumes qui datent d’une époque où la règle était peut-être encore un peu flottante, et dailleurs épuisés sur le catalogue de 2012. Celà pourrait-il expliquer aussi l’exception de Rousseau ? les trois premiers volumes de celui-ci, dans leur nouvelle édition, datent de 1959, 1961 et 1964. Notons aussi que les volumes de Bossuet et La Rochefoucauld, parus dans leur état actuel en 1961 et 1964, présentent une orthographe modernisée : sans doute parce qu’ils ne faisaient que compléter une édition de 1936 et de 1935, époque où la règle aurait été de moderniser l’orthographe du XVIIe (comme le montrent le La Fontaine de Groos, Schiffrin et Clarac (1933 et 1943), le La Bruyère de Benda (1935) et encore le Racine de Raymond Picard (1950 et 1952)), règle abandonnée dans les années 60 puis rétablie ensuite ? Tout celà est bien mystérieux…
[3] Pour la Pléiade, voir la seconde introduction, due à Jean Balsamo, « Le destin éditorial des Essais », p. XXXIX-LV ; pour la Pochothèque, voir la « Note sur l’édition », due à Isabelle Pantin, p. XXIII-XXVI : deux bilans philologiques qu’on opposera à la « Note de l’éditeur » de Pierre Villey (p. XI-XV). Tous deux concluent, à la suite de David Maskell et de Michel Simonin, que contrairement à ce qu’on a cru pendant près d’un siècle sous l’influence de Pierre Villey, l’édition posthume de 1595, loin d’avoir été trafiquée par Pierre de Brach et Marie de Gournay, constitue la version la plus fidèle à la dernière intention de Montaigne. Elle contient de nombreux passages qui ne figurent pas dans l’exemplaire de Bordeaux, où la marque de Montaigne est incontestable (P. Villey reconnaît que la plupart doivent être authentiques et les reproduit tous en notes) ; dans les rares cas inverses, la suppression est légitime et doit probablement être due à l’auteur ; quand l’expression diffère, la leçon de l’édition de 1595 est très souvent meilleure. Il faut donc conclure que l’auteur avait fait établir une copie de travail qui a disparu (ce que P. Villey jugeait invraisemblable), texte hypothétique appelé désormais « copie de Montaigne », que Marie de Gournay aurait recopié pour le transmettre à l’imprimeur, car l’état trop peu lisible de l’exemplaire de Bordeaux le rendait impropre à cette mission (P. Villey pensait exactement l’inverse – mais est-il permis de rappeler qu'il était aveugle ?). Ce volume n'aurait donc pas joué le rôle central que lui attribuait le grand montaignologue : il n'aurait été qu'une simple copie de sauvegarde, et pas la plus tardive ni la plus soignée.
[4] Passe encore que la taille occupée par le nouvel appareil critique ne laissât plus de place au Journal de voyage en Italie. Mais on s’explique mal l’absence des lettres, alors qu’on a préféré consacrer 120 pages à l’édition des notes de lecture : un document d’un intérêt bien mince, qui avait mieux sa place dans une collection universitaire. Seules les annotations faites à Nicole Gille (un chroniqueur médiéval qui fut secrétaire de Louis XI) relèvent du commentaire personnel et méritent qu’on y aille voir. Les notes prises sur Lucrèce, César et Quinte-Curce sont pour l’essentiel de simples relevés de citations, listes de mots ou de noms, paraphrases ou résumés sommaires : le commentaire proprement dit y est rare et stérile. Le montaignologue y trouvera quelques indications marginales (aux deux sens du mot !) sur son objet d’étude, mais l’honnête homme se désolera que la Pléiade ait accueilli ces rognures textuelles.
[5] Attention, ces deux versions concurrentes entraînent une légère distorsion dans la numérotation des chapitres. En effet, dans l’édition de 1595, le long chapitre XIV, « Que le goût des biens et des maux dépend en bonne partie de l’opinion que nous en avons », a été déplacé pour devenir le chapitre XL. Les montaignologues contemporains tiennent ce transfert pour le fruit d’une intention authentique de Montaigne (voir la notice de la Pléiade p. 1450-1451). Il en résulte une double numérotation des chapitres 14 à 40 du livre I : le premier chiffre que je donne correspond aux éditions reproduisant la version posthume de 1595 (c’est-à-dire toutes les éditions antérieures au XXe siècle – sauf l’édition Naigeon de 1802 –, la Pochothèque de 2001 et la Pléiade de 2007), le second chiffre (décalé d’une unité, sauf pour le n°40 qui prend le n°14) correspond aux éditions reproduisant la version de l’exemplaire de Bordeaux (c’est-à-dire l’édition Naigeon de 1802 et toutes les éditions du XXe siècle, qui reprennent la vulgate établie par Fortunat Strowski et Pierre Villey à partir de 1906), ainsi que quelques rares éditions savantes qui reprennent les versions de 1580, 1582 et 1588.

Écrire un commentaire