LES DERNIERS JOURS DE POMPÉI, par EDWARD BULWER-LYTTON (revue critique)
26.02.2014
La sortie en salles du film Pompéi de Paul W.S. Anderson invite à lire le roman qui, le tout premier, installa la cité romaine recouverte par les cendres du Vésuve au cœur de l’imaginaire européen : Les Derniers jours de Pompéi de l’écrivain et homme politique anglais Edward Bulwer-Lytton (1803-1873). Par ce livre paru en 1834, Bulwer-Lytton est l’un des inventeurs du « péplum » romanesque, même si Chateaubriand l’avait précédé avec Les Martyrs dès 1809. Il s'inscrit pleinement dans le romantisme européen, et pas seulement par cette fascination pour les ruines et cette aspiration insensée à ressusciter le passé, dont on sait qu'elles sont l'un des schèmes de l'esprit romantique : pensons au Roman de la momie de Théophile Gautier, ou plus encore à Arria Marcella du même, sans parler de tous les autres romans historiques apparus à cette époque si féconde.
Il y a quelques années, j’avais vu l’un des quelque quinze films inspirés par le roman [1], celui de 1959, le plus connu car réalisé par Sergio Leone (et Mario Bonnard) et interprété par Steve Reeves dans le rôle principal. Ce film m’avait paru exécrable. L’intrigue était stupide par son manichéisme puéril. Elle montrait une bande de malfrats introduits parmi les autorités, qui, masqués, signaient leurs exactions d’une croix, de façon à discréditer la communauté chrétienne, laquelle était en vérité pure comme l’agneau. Les héros, bien entendu, ne tombaient pas dans cette feinte grossière, échappaient aux griffes des affreux comploteurs agressifs et fourbes, et parvenaient progressivement à les démasquer et les désarmer. Là-dessus, l’éruption du Vésuve engloutissait les méchants qui vivaient encore, tandis que les bons parvenaient bien sûr à échapper au cataclysme. Ce film m’avait tellement scandalisé que j’étais resté insensible aux décors, assez réussis paraît-il. Je ne supporte pas ce parti-pris caricatural en faveur des chrétiens qui ont sapé la civilisation romaine. Mais plus encore, le caractère totalement imprévisible et totalement gratuit de la catastrophe finale m’avait révolté. Ce n’était pas seulement le deus ex machina le plus artificiel qui descend faire la justice, c’était surtout un appendice absurde qui vient se greffer sur une intrigue qui se passe complètement de lui : une sorte de court-métrage pour compléter le film, un titre-bonus pour ceux qui ont tenu jusqu’à la fin.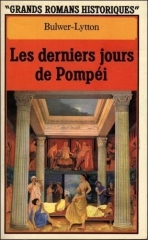 Ces deux vices rédhibitoires s’accusent de façon moins aigüe dans le roman, mais il faut avouer qu’ils sont bien là. Je l’ai lu dans l’édition Presses-Pocket n°2237, parue en février 1984, qui reprend, corrigée et complétée, la traduction intégrale d'Hippolyte Lucas qui date de 1859. On se rend vite compte que le film de Leone a totalement transformé l’intrigue de Bulwer-Lytton. Celle-ci est beaucoup plus simple. Les amours de deux jeunes riches oisifs, Glaucus et Ione, sont contrariées par les menées d’un sombre magicien égyptien, Arbacès, tuteur de Ione et amoureux d’elle. Aux deux tiers du livre, il tue le frère d’Ione, Apæcides, prêtre d’Isis tout frais passé aux chrétiens, et fait accuser Glaucus de ce meurtre. Le plus pénible dans cette œuvre est le caractère mélodramatique de l’intrigue. Les bons ne subissent des malheurs que pour en être miraculeusement secourus. À la fin du livre II (sur cinq), Arbacès est en position de tuer Glaucus et Apæcides et de violer Ione ; mais un tremblement de terre survient, et la chute d’une statue l’assomme, ce qui permet aux trois gentils de se sauver. Ensuite, Arbacès a fait en sorte que Glaucus absorbe un philtre qui le rendra fou. Mais ce philtre est détourné par Nydia, jeune esclave aveugle amoureuse de Glaucus. Elle le lui fait boire (croyant que cela le rendra amoureux d’elle), mais se montre tellement troublée que Glaucus en est alerté et repose la coupe en n’en ayant bu qu’un quart, si bien qu’il ne subira qu’un délire passager et non une irrémédiable aliénation (livre IV, chapitre 5). Enfin, après bien des vicissitudes qui ont donné à croire que tout était perdu, Nydia parvient à faire parvenir au préteur un témoignage qui innocente Glaucus et accâble Arbacès. La sottise épaisse avec laquelle l’esclave nommé Sosie, chargé de surveiller Nydia prisonnière d’Arbacès, se fait deux fois berner par elle, est particulièrement exaspérante. De toute façon, Glaucus était en train d’échapper au supplice car, dans l’amphithéâtre, le lion, sentant instinctivement venir l’éruption imminente, se montrait nerveux et sans appétit. Je déteste ces feuilletons naïfs où le suspense n’est entretenu que pour déboucher sur un dénouement bienheureux, et où le génie infernal des méchants est toujours contrecarré par un grain de sable imprévisible. C’est admissible dans les romans d’aventures centrés sur un super-héros, parce que ceux-ci reposent sur un "contrat de lecture" qui exclut la vraisemblance et qu’on sait donc d’emblée que le personnage central fera des prodiges ; c’est insupportable dans un roman à visée réaliste, qui se propose de reconstituer un monde authentique.
Ces deux vices rédhibitoires s’accusent de façon moins aigüe dans le roman, mais il faut avouer qu’ils sont bien là. Je l’ai lu dans l’édition Presses-Pocket n°2237, parue en février 1984, qui reprend, corrigée et complétée, la traduction intégrale d'Hippolyte Lucas qui date de 1859. On se rend vite compte que le film de Leone a totalement transformé l’intrigue de Bulwer-Lytton. Celle-ci est beaucoup plus simple. Les amours de deux jeunes riches oisifs, Glaucus et Ione, sont contrariées par les menées d’un sombre magicien égyptien, Arbacès, tuteur de Ione et amoureux d’elle. Aux deux tiers du livre, il tue le frère d’Ione, Apæcides, prêtre d’Isis tout frais passé aux chrétiens, et fait accuser Glaucus de ce meurtre. Le plus pénible dans cette œuvre est le caractère mélodramatique de l’intrigue. Les bons ne subissent des malheurs que pour en être miraculeusement secourus. À la fin du livre II (sur cinq), Arbacès est en position de tuer Glaucus et Apæcides et de violer Ione ; mais un tremblement de terre survient, et la chute d’une statue l’assomme, ce qui permet aux trois gentils de se sauver. Ensuite, Arbacès a fait en sorte que Glaucus absorbe un philtre qui le rendra fou. Mais ce philtre est détourné par Nydia, jeune esclave aveugle amoureuse de Glaucus. Elle le lui fait boire (croyant que cela le rendra amoureux d’elle), mais se montre tellement troublée que Glaucus en est alerté et repose la coupe en n’en ayant bu qu’un quart, si bien qu’il ne subira qu’un délire passager et non une irrémédiable aliénation (livre IV, chapitre 5). Enfin, après bien des vicissitudes qui ont donné à croire que tout était perdu, Nydia parvient à faire parvenir au préteur un témoignage qui innocente Glaucus et accâble Arbacès. La sottise épaisse avec laquelle l’esclave nommé Sosie, chargé de surveiller Nydia prisonnière d’Arbacès, se fait deux fois berner par elle, est particulièrement exaspérante. De toute façon, Glaucus était en train d’échapper au supplice car, dans l’amphithéâtre, le lion, sentant instinctivement venir l’éruption imminente, se montrait nerveux et sans appétit. Je déteste ces feuilletons naïfs où le suspense n’est entretenu que pour déboucher sur un dénouement bienheureux, et où le génie infernal des méchants est toujours contrecarré par un grain de sable imprévisible. C’est admissible dans les romans d’aventures centrés sur un super-héros, parce que ceux-ci reposent sur un "contrat de lecture" qui exclut la vraisemblance et qu’on sait donc d’emblée que le personnage central fera des prodiges ; c’est insupportable dans un roman à visée réaliste, qui se propose de reconstituer un monde authentique.
Bulwer-Lytton s’est efforcé de contourner l’erreur stupide dans lequel tombe le film, celle de déclencher inopinément une catastrophe que rien ne préparait [2]. Il l’a anticipée de deux façons : par les interventions d’auteur (très nombreuses, comme souvent dans les romans de cette époque), qui signalent de temps en temps ce qui attend la ville à brève échéance. Et d’autre part au moyen d’éléments internes au récit, tels qu’un refrain à double sens qui clôture un livre (p. 377), un oracle ambivalent (p. 48), le tremblement de terre (p. 165), les prédictions astrales d’Arbacès (p. 146, 156, 220) ou ses propres malédictions (p. 147-148), les mouvements internes du Vésuve relevés par la sorcière qui vit sur son flanc (p. 244 et 383-384), etc. Mais tout cela, ce sont des annonces, pas des causes. Ces anticipations dessinent un horizon d’attente, qui permet au lecteur d’accepter la catastrophe finale ; cependant, il n’y a aucun lien déterminant entre l’intrigue des personnages et cet évènement extérieur, sans rapport avec elle. Évidemment, on me répondra que s’il n’y en a pas, c’est qu’il ne saurait y en avoir, puisqu’un volcan n’est pas le produit de l’activité humaine. On eût pu imaginer néanmoins un prêtre de Vulcain qui fût persuadé de pouvoir commander à la montagne de cracher du feu, ou bien, comme dans bon nombre de films-catastrophe, un conflit entre un savant qui, ayant su décrypter les signes avant-coureurs de l’éruption, préconiserait l’évacuation générale immédiate de la ville, et des autorités aveugles, soucieuses avant tout de ne pas paniquer la population. Je ne vois guère d’autre moyen de faire du Vésuve une partie intégrante de l’action, et j’incline à penser qu’un roman sur les derniers jours avant l’éruption de 79 était, dans sa donnée constitutive, une absurdité foncière. Bulwer-Lytton a au moins le mérite d’avoir respecté son titre : il a bien cherché à peindre la vie à Pompéi avant sa destruction, et non pas cette destruction. Celle-ci ne l’intéresse que fort peu [3] : elle n’arrive qu’à la page 411 sur 440, c’est-à-dire qu’elle occupe 30 pages, soit même pas 7% du roman [4] ! Malgré de belles évocations apocalyptiques et des observations excellemment bien venues sur l’abolition de l’ordre social et le déchaînement des passions, on peut dire que cette fin est bâclée. C’est paradoxal, car on peut parier que c’est pourtant à cette catastrophe même que le roman doit son succès et sa renommée. Transplantés dans n’importe quelle autre cité de l’empire romain, les mêmes fades personnages et leur banale intrigue n’auraient sans doute pas eu de fortune durable. En somme, Bulwer-Lytton a eu une idée publicitaire géniale, mais il est passé à côté du sujet littéraire. Je note que le téléfilm de Peter Nicholson (2003), qui appartient au genre du "docu-fiction", affronte enfin le sujet : il s’intitule Le Dernier jour de Pompéi (ce titre, avec sa modification décisive, est son seul lien avec Bulwer-Lytton) et ne s’intéresse qu’à l’attitude d’une poignée de personnages pendant les quelques heures fatales qui ont vu l’engloutissement de la cité sous les cendres. Ce roman-là, le roman du 24 octobre 79 [5], le seul intrinsèquement lié à Pompéi, reste à faire, à moins que le Pompéi de Robert Harris (2003), que je n’ai pas encore lu, soit celui-ci.
Bulwer-Lytton, disais-je, a cherché à présenter un tableau de la vie de Pompéi : se présentant comme un disciple de Walter Scott, il insiste dans sa préface et ses notes sur son souci de véracité dans la reconstitution historique. Il a placé ce tableau immédiatement avant sa destruction, mais il aurait pu le placer aussi, sans quasiment rien changer, à n’importe quelle autre année de l’empire romain (antérieure à 79), voire dans le dernier siècle de la République. Cependant il ne serait pas honnête de dire qu’il aurait pu le placer dans n’importe quelle autre cité romaine, car il ne cesse d’établir des rapports entre la ville vivante qu’il nous décrit, et la ville en ruines exhumée depuis quelque temps, qu’il a attentivement visitée. Les lieux-clefs du roman sont les plus remarquables du site archéologique : la maison dite du poète tragique, qu’il attribue à son héros Glaucus (p. 26-31), le temple d’Isis (p. 46), le temple de la fortune (p. 73), les thermes (p. 76-80), le forum (p. 166-168), la maison de Diomède (p. 270-271), etc. L’auteur invente très peu, il se contente de décrire des vestiges réels en les restaurant par l’imagination [6]. Ainsi, parce qu’on a découvert une carapace de tortue dans le jardin de la maison du poète tragique, Bulwer-Lytton consacre deux pages à la tortue qui vit chez Glaucus (p. 129-130). Mais cela va même plus loin, puisqu’il faut que ses personnages qui meurent dans le cataclysme coïncident exactement avec les squelettes découverts à tel endroit et dans telle position, ainsi qu’il tient lui-même à nous le préciser dans l’espèce de postface de deux pages qui clôture le roman. Or je crains que l’effet produit soit l’inverse de celui voulu par le romancier, et dont lui fait généreusement crédit le préfacier Claude Aziza (pages IX-X) : un effet de réel qui attesterait que l’histoire est vraie. Tout au contraire, j’ai ressenti cela comme totalement artificiel. Une bonne partie du livre perd de sa vie romanesque pour tomber dans le guide de visite archéologique sous forme romancée. C’est déjà l’ineptie profonde du roman zolien : l’auteur s’est rendu sur le terrain, il a pris des notes abondantes dans ses carnets, et il injecte directement ces notes dans son roman en croyant faire un « roman expérimental ». Or la vraie vie, c’est ce qui n’arrive qu’une fois, c’est ce qui donne l’impression de l’invention et de la singularité. Ici, on dirait que l’auteur n’a fait que suivre un cahier des charges qui lui était imposé par le site. Loin d’avoir été libres de faire ce qu’ils voulaient, les personnages avaient un destin programmé qui leur imposait dès le début de finir en un lieu et dans une attitude déjà connus, puisque révélés par les fouilles. Le moyen d’échapper à cette étouffante sensation de détermination extra-romanesque eût peut-être été de l’assumer franchement : en rappelant constamment, dans les interventions d’auteur, ce qui attendait chaque personnage. Peut-être même, pari audacieux, en commençant par la description de la catastrophe, et en présentant, ensuite, toute l’intrigue comme un retour en arrière. Après tout, cette entorse à la chronologie diégétique aurait été aussi une façon de respecter la logique de la conception romanesque dans l’esprit de l’auteur. Mon idée est qu’il fallait tenter de transformer un vice littéraire en parti-pris métaphysique. La fin est déjà écrite, on sait comment les personnages vont mourir, le choix des lieux est dicté par l’archéologie ? eh bien oui, proclamons ouvertement que nous sommes tous destinés à mourir, et que nous sommes tous regardés depuis l’avenir par un historien invisible aux yeux de qui nous avons aussi peu de liberté que les squelettes enfouis sous les cendres du Vésuve. L’invention littéraire et la nécessité historique eussent été confondues au lieu d’être tant bien que mal juxtaposées. Si le narrateur nous avait avertis d’entrée que Diomède et sa fille Julia mourraient réfugiés dans sa cave, Burbo tentant d’ouvrir un mur avec une hache, Calénus transportant de l’or et Arbacès écrasé par une colonne, il ne serait pas passé pour un romancier maladroit qui veut à tout prix amener ses personnages à une fin choisie par sa documentation, mais pour un metteur en scène de la fatalité. Il aurait rendu pleine justice au caractère tragique d’une catastrophe extérieure à son roman mais qui le gouverne tout entier.
Claude Aziza pense le contraire de moi et semble goûter la discordance entre l’intrigue mélodramatique et son épilogue volcanique : « Curieusement, le roman semble immobile. En fait, il se passe fort peu de choses : des rencontres, une visite à la sorcière, un philtre d’amour, un crime, un procès [7], un amphithéâtre, c’est peu pour remplir tant de pages. Et c’est bien là que réside, selon nous, le charme secret du livre : la description minutieuse, la reconstitution de l’intérieur des derniers moments d’une cité, destinée à périr. Dans ce sursis, dans ce temps suspendu, le lecteur aurait envie de crier : "Hâtez-vous !" Mais, imperturbables, les personnages prennent leur temps, de conversations en banquets, de fêtes en promenades. » (p. XI). C’est là un effet qui semble avoir échappé à l’auteur, lequel ne cherche jamais à le suggérer. Il est passé à côté de cette leçon philosophique que son préfacier tire pour lui. Pour pouvoir en faire crédit à Bulwer-Lytton, il eût fallu qu’il fît périr tous ses personnages, et non pas seulement les méchants. Là on aurait pu parler de parabole sur la précarité de la vie humaine, soumise quel que soit son contenu moral à la même fin inopinée. Alors que ce deus ex machina (ou plutôt diluvium ex terra) qui épargne à dessein les gentils est à la fois un artifice puéril et un vice de construction narrative.
Le même Aziza (lequel n’est pas un préfacier neutre mais le directeur de la série "Les grands romans historiques" qui réédita une huitaine de titres chez Pocket, et donc soucieux de vendre son produit) tente aussi, mais mollement, de réhabiliter les personnages (page X). La cause est désespérée : ce sont des pantins. Le personnage principal, Glaucus, n’est qu’un jeune viveur qui, malgré sa douleur d’amoureux et ses malheurs judiciaires à la fin, n’acquiert jamais de consistance individuelle. Ce Grec est fatiguant avec son hellénomanie : pourquoi attend-il l’épilogue pour retourner dans sa patrie, puisqu’il en chante la gloire à tout instant ! Pendant la majeure partie du roman, il file le parfait amour avec sa fiancée Ione : tous deux sont ennuyeux comme des amoureux heureux. Parmi les personnages de premier plan, celle-ci est le plus raté : sauf dans quelques chapitres du début où elle se demande si son amour pour Glaucus est partagé, elle est toujours vue de l’extérieur. Aucun trait spécifique ne vient lui donner de la personnalité ni en faire autre chose que l’idole froide adorée par Glaucus et Arbacès. Nydia, la jeune esclave aveugle, est beaucoup plus touchante que les deux tourtereaux : elle aime follement Glaucus (lequel ne s’en rend jamais compte !) et cherche donc à faire son bonheur, mais faire le bonheur de Glaucus, c’est favoriser l’union de celui-ci avec Ione, donc faire son propre malheur. Une fois les deux amants sauvés, elle préfèrera se suicider : une figure finalement bien simplette, qui explique à elle seule que le roman ait fait une longue carrière dans la littérature enfantine. Son passé un peu trouble aux mains de maîtres brutaux voire pervers, les débauches auxquelles elle a dû assister chez Arbacès, auraient pu lui donner un peu de relief, mais l’auteur excipe du serment de silence qu’elle a prononcé pour jeter un voile pudique sur ces mystères (p. 109, 248). Arbacès est donc le seul personnage intéressant (ce qu’Aziza ne peut que reconnaître : « c’est le véritable héros du roman »). Il m’a rapidement fait songer au Claude Frollo de Notre-Dame de Paris : c’est un homme supérieur victime d’un amour non réciproque, qui s’abaisse lui-même en s’entichant d’une femme dont il n’arrive pas à se faire aimer et qui ne le mérite pas. Arbacès est un descendant des anciens rois d’Égypte qui rêve de restaurer la grandeur de sa patrie. Il est fabuleusement riche, mais c’est aussi un dirigeant occulte, qui gouverne en sous-main les prêtres d’Isis et qui est révéré comme le maître des magiciens du monde entier sous le nom d’ « Hermès, seigneur de la ceinture flamboyante » (p. 151-153 et 238-239). Il y a dans ce révolté misanthrope un Vautrin, pour la façon dont il tente de faire l’éducation d’Apæcides en lui révélant cyniquement les arcanes de l’imposture religieuse, et aussi une Tullia Fabriana (héroïne d’Isis de Villiers de l’Isle-Adam), pour la puissance mystérieuse, nimbée d’occultisme [8]. Ce personnage redoutable, aux ressources immenses, capable d’animer une statue à distance (p. 164), pourrait être la tête d’une puissante conspiration destinée à le hisser sur le trône du monde. Malheureusement cela ne reste qu’une velléité chez lui, et Bulwer-Lytton a préféré le rendre obsédé par la conquête sentimentale et physique d’une jeune fille falote. Ce qui interdit de l’admirer, ce n’est pas son côté retors et manipulateur, ce n’est pas son amoralité qui lui fait commettre des crimes sans mauvaise conscience, c’est l’aliénation qu’il s’inflige à lui-même en se laissant posséder par le désir de posséder Ione, au détriment des vastes ambitions dont il était capable. Quelle consternation ! Faust égaré dans un vaudeville… Ah, qui dira le nombre de romans sabotés par la prédominance de l’amour, cette passion femelle !… On croirait que l’auteur s’est pris d’intérêt pour son personnage (c’est celui sur l’esprit duquel il s’étend le plus souvent et le plus longuement), mais qu’il n’a pas osé en faire le héros de son roman : à l’arrivée, c’est un être maléfique, voué à l’échec, et le dernier mot reste à l’amour et au bonheur : cette vision cucul-la-prâline, hollywoodienne avant la lettre, est une preuve de la médiocrité d’esprit de l’auteur. Elle a peut-être assuré le succès populaire du livre, mais elle en fait une œuvre surfaite, malgré le charme des descriptions et la vivacité de la peinture de la vie pompéienne.
C’est un fait que Les Derniers jours de Pompéi forment avec Quo vadis ? (1895) et Ben-Hur (1880) la triade des péplums qui ont atteint une vaste notoriété dans le grand-public, par eux-mêmes et par les multiples adaptations cinématographiques qu’ils ont engendrées. Or je note que deux d’entre eux incluent une catastrophe (la destruction de Pompéi et l’incendie de Rome), que tous les trois exploitent le goût morbide pour les jeux du cirque (combats de gladiateurs, bêtes fauves ou course de chars), et que tous trois prennent le parti des chrétiens, leur accordant une précoce place disproportionnée, au mépris de la vérité historique.
Il faut en effet s’attarder sur la place de la secte galiléenne dans le roman. Elle est animée par le personnage d’Olynthus, sorte de saint Paul local, apôtre ardent dont la foi vigoureuse subjugue ses auditeurs, et zélé jusqu’au martyre. L’image des chrétiens est finalement assez ambivalente. En apparence, elle est toute positive. Le narrateur rappelle incidemment que « la foi d’Olynthus, qui est la nôtre, a triomphé » (p. 171) [9] et s’autorise une petite digression en fin de chapitre pour déclarer que « c’était dans les cabanes de la pauvreté et du travail que ce vaste fleuve, qui devait baigner les cités et les palais de la terre, prit sa source méprisée alors » (p. 172). Olynthus n’a de cesse de dénoncer à raison les inconséquences du paganisme (p. 84) ainsi que « les momeries et les impostures du temple d’Isis » (p. 302), dont le narrateur souligne lui aussi systématiquement le charlatanisme. L’élévation morale du petit groupe de chrétiens contraste avec la fourberie d’Arbacès comme avec la bassesse morale de Calénus, le prêtre isiaque. Le romancier nous montre le jeune Apæcides, dont la ferveur mystique n’a pas été satisfaite par l’idolâtrie trompeuse du culte d’Isis, se convertir au christianisme. Pages 206-207, Glaucus, rapportant le témoignage de son père, raconte la visite de Paul à Athènes. Or Bulwer-Lytton manipule curieusement le texte des Actes des Apôtres (17, 16-34). « Il ne se fit pas d’abord entendre un seul murmure dans cette multitude. Les plaisanteries, les rumeurs qui accueillent nos orateurs habituels lui furent épargnées », écrit le romancier anglais, ce qui colle mal avec Luc : « Les uns disaient : "Que peut bien vouloir ce perroquet ?". D’autres : "On dirait un prêcheur de divinités étrangères" ». Et quand la prédication est finie, il ajoute, pure invention non étayée par le texte biblique : « le cœur du peuple était touché et agité ; ce peuple trembla sans savoir pourquoi, car l’étranger avait la voix et la majesté d’un homme à qui le Dieu inconnu a donné mission de prêcher sa foi ». Enfin, dans le dernier chapitre, une lettre de Glaucus nous apprend que lui-même et Ione, rescapés du désastre, se sont convertis (« je l’écoutais, je crus, j’adorais », p. 436).
Et cependant, j’ai été frappé par un thème qui m’intéresse fort, le millénarisme des premiers chrétiens. Bulwer-Lytton rappelle bien que ceux-ci attendaient une fin du monde imminente, ce qui évidemment ne peut que nous faire sourire (p. 207, 210, 374-376). Et quand survient l’éruption du Vésuve, ils se vautrent dans le contresens absolu d’y voir l’Apocalypse attendue : p. 413, 414 (« Dieu s’est avancé sur les ailes des éléments. La nouvelle Gomorrhe subit sa destinée »), 431 (« oui, l’heure est arrivée ») et surtout 424 : « Ils avaient vécu dans la croyance, erreur des premiers chrétiens, que la fin du monde était proche. Ils croyaient ce jour venu. "Malheur ! Malheur ! […] Voyez ! Dieu s’avance pour le jugement ; il fait descendre le feu du ciel à la vue des hommes". » Dès lors, le lecteur s’interroge : l’auteur cherche-t-il vraiment à nous faire admirer ces sectaires, ou se contente-t-il de satisfaire mollement la demande d’empathie qu’il a présumée chez ses lecteurs ? Sa peinture des chrétiens ne devrait-elle pas être regardée comme une satire subtile signée par un héritier discret de Gibbon ? À y regarder de plus près, la façon dont le narrateur s’approprie le christianisme s’apparente plus à l’approbation banale d’une convention qu’à un éloge appuyé et motivé. Relevons quelques passages significatifs. Page 124, pour répondre à Arbacès qui signale les points communs entre la religion égyptienne et le christianisme, le narrateur ajoute une note en bas de page : « le croyant tirera de cette vague coïncidence des corollaires bien différents de ceux de l’Égyptien » : façon d’empêcher que son lecteur ne se laisse convaincre par un raisonneur païen, ou remarque ironique d’un sceptique qui constate que le même argument est réversible [10] ? De même, le passage qui entoure la brève citation que j’ai faite, dans laquelle l’adjectif possessif semble signaler l’appartenance de l’auteur au christianisme (p. 171), est en fait plus ambigü : « Ils regardaient le chrétien comme l’ennemi de l’humanité. Les épithètes qu’ils lui décochaient, et parmi lesquelles celle d’athée était la plus commune et la mieux reçue, peuvent servir à nous apprendre, maintenant que la foi d’Olynthus, qui est la nôtre, a triomphé, que nous aurions tort de nous livrer, à l’égard de ceux qui ne pensent pas aujourd’hui comme nous, aux injures dont on accablait les doctrines de notre religion » : voilà bien du relativisme [11] ! Ne faut-il pas en conclure que les autres croyances d’aujourd’hui sont aussi estimables que le christianisme antique ? Et voici maintenant une réplique qui est tout à l’avantage du paganisme. Bulwer-Lytton assume un anachronisme et une prophétie artificielle en faisant raisonner un personnage secondaire sur l’hypothèse extravagante que cette micro-secte pût un jour l’emporter : « Le sénat s’est montré si accommodant que, si cet homme avait seulement montré un peu de repentir et consenti à brûler un peu d’encens sur l’autel de Cybèle, on l’aurait acquitté. Je doute fort que les Nazaréens, s’ils venaient à établir leur religion, fussent aussi tolérants pour nous, en supposant que nous irions renverser l’image de leur dieu, blasphémer leurs cérémonies et nier leur foi » (p. 356). Par ailleurs le romancier n’a pu résister à la tentation d’introduire dans son histoire pompéienne un personnage néotestamentaire : c’est Lazare de Béthanie, le ressuscité, qui passait dans le coin (p. 190 et 286-289). Ce vieillard raconte à Apæcides le miracle dont il a été le bénéficiaire, la mort de Jésus dont il a été le témoin, et comment il est devenu prédicateur itinérant pour semer la bonne nouvelle partout dans le monde. Mais un passage de ce récit fait sursauter le lecteur. Quand Jésus mourut, « les ténèbres couvrirent la terre », puis les morts ressuscités se promenèrent dans la cité désertée par les vivants. Ce paragraphe (p. 288), qui développe une brève indication de l’évangile de Matthieu [12], semble directement importé d’un roman fantastique genre "la nuit des morts-vivants" [13]. Même un lecteur qui ne serait pas voltairien jusqu’au bout des ongles ne peut manquer de se demander si l’auteur ne serait pas en train de se moquer de lui : croit-il vraiment ce qu’il écrit ? croit-il sérieusement que les ressuscités ont sillonné Jérusalem aussitôt après la mort du prophète galiléen ? Ou alors… serait-ce le personnage qui se moque de son auditeur ? Après tout, il n’a pas osé se nommer, il s’est juste désigné par une périphrase [14]. Serait-ce un mythomane ? Qu’est-ce que l’auteur a voulu nous donner à penser par cet épisode incongru ? Tout cela est fort déconcertant.
Dans le chapitre 3 du livre III, « La réunion religieuse », Apæcides rencontre la petite communauté chrétienne (p. 184-190), guidé par Olynthus. Elle est décrite avec sympathie. Mais outre la ferveur et l’affection qui les animent, Bulwer-Lytton signale avec une insistance frappante qu’ils sont le rebut de la société : « parmi les pères et les martyrs, beaucoup avaient connu l’amertume du vice » ; « il avait été brigand dans sa jeunesse » ; « tous, à part deux exceptions, appartenaient évidemment aux classes inférieures » ; « nous avons tous été pécheurs » ; « les réponses d’hommes grossiers, rudes et simples, dont toute l’instruction consistait à savoir qu’ils étaient plus grands qu’ils ne paraissaient l’être ». Plus grave, il tient à observer que la promesse de vie immortelle est exactement la consolation dont a besoin la créature malheureuse : « il n’y a rien de plus flatteur, pour l’orgueil et les espérances des hommes, que la foi dans un état à venir », ou : « toutes les espérances de cette foi bienfaisante invitaient au repentir. Elles étaient particulièrement faites pour guérir les esprits malades et brisés ». L’auteur veut-il suggérer par là au lecteur avisé que le discours chrétien n’est rien d’autre qu’une illusion nécessaire pour supporter la misère de notre condition, ou bien n’est-il même pas conscient de cette implication [15] ? Ceux qui voient dans le premier christianisme un mouvement anti-social trouveront leur content dans Les Derniers jours de Pompéi. Le livre IV s’ouvre par deux pages de digression (p. 254-255) qui développent l’idée que le fanatisme et l’intolérance étaient nécessaires aux premiers chrétiens : « il fallait mépriser, détester, abhorrer les croyance des autres hommes, pour surmonter les tentations qu’elles présentaient », éloge paradoxal qui laisse le lecteur mal à l’aise. L’idée que les chrétiens ont dû se séparer de la société, la haïr et se faire haïr d’elle, revient à plusieurs reprises : p. 205, 212, 264, 267, 302-304 et p. 261 surtout : « Il ne se dissimulait pas la haine et l’horreur qu’il inspirerait aux personnes pieuses […] Si les premiers chrétiens avaient été plus soumis à la solennelle autorité des coutumes […] le christianisme aurait péri dans son berceau ». On croirait même qu’il y a quelque complaisance dans la façon dont l’auteur restitue la haine générale de la population contre les chrétiens, p. 37-38, 170-171, 303, 355. Je relève enfin la récurrence avec laquelle est signalée la répugnante soif du martyre qui anime ces fanatiques, et en premier lieu leur chef Olynthus : p. 188, 288, 360, 405. D’ailleurs cet Olynthus, dont on pourrait juger sublimes l’énergie et la foi, quitte le livre sur une note paradoxalement ridicule : « Olynthus dominait cette foule, les bras étendus, et le front ceint de flammes, semblable à celui d’un prophète. La foule reconnaissait celui qu’elle avait condamné à être dévoré par les bêtes, alors sa victime, maintenant son prophète. Sa voix fatale répéta à travers le silence : "L’heure est arrivé." Les chrétiens répétèrent ce cri… la multitude le répéta elle-même… il y eut un écho de toutes parts… femmes et hommes, enfants et vieillards se mirent à murmurer d’une voix sourde et lamentable. L’heure est arrivée » (p. 431). Il semble que le narrateur veuille nous laisser de lui une image grandiose et auguste. Mais non, l’heure n’était pas arrivée ! Ce n’était qu’une éruption volcanique, comme il y en a à chaque siècle, un pur phénomène géologique qui n’est pas porteur de la plus petite once d’Apocalypse. L’heure du Jugement dernier n’était pas arrivée à Pompéi en 79, pas plus qu’elle n’est arrivée à Tambora en avril 1815, où eut lieu une éruption huit fois plus puissante, qui engendra de graves dérèglements climatiques. Comment Bulwer-Lytton, en 1834, peut-il imaginer que son lecteur adhère au millénarisme aveugle d’un faux prophète égaré par sa foi plutôt qu’éclairé par elle ? L’auto-aveuglement du faux prophète est d’ailleurs patent à la toute fin, quand Glaucus raconte sa conversion : « Dans la manière miraculeuse dont j’avais été préservé du lion, et dans ce tremblement de terre, il me fit voir la main d’un dieu inconnu » (p. 436). Ah bon ! Olynthus a survécu à l’Apocalypse, et ça ne lui pose pas un problème ? Il s’est forcément rendu compte que l’Heure n’était pas arrivée, donc qu’il s’était fourvoyé, et ça ne l’a pas amené à reconsidérer ses dogmes ? Bulwer-Lytton ne voudrait-il pas plutôt nous mettre en garde contre l’imposture religieuse dans son ensemble, et dévaloriser la superstition chrétienne ?
Pour autant, si tel était vraiment son dessein, alors je ne comprends guère pourquoi il n’aurait pas fait juger sévèrement ses chrétiens par une figure païenne positive, et je ne comprends pas du tout pourquoi il a tenu à terminer son roman par la conversion au christianisme des deux héros, ce à quoi ne l’obligeait nullement le respect des convictions de ses lecteurs.  Cette conversion après réflexion prend d’ailleurs d’autant plus de valeur que, à quelques instants d’être confronté au lion, Glaucus avait auparavant, dans un mouvement admirable de noblesse d’âme, refusé de céder aux objurgations d’Olynthus : « À cette dernière heure, ce serait de ma part une sorte de bassesse et de lâcheté, d’accorder à la terreur ce qui doit être le résultat de longues méditations. Si j’embrassais ta foi, si je renversais les dieux de mes pères, n’aurais-je pas été séduit par les promesses du ciel ou effrayé par les menaces de l’enfer ? » (p. 404). Les longues méditations ont eu lieu dans l’ellipse qui précède l’ultime chapitre, et elles ont bel et bien débouché sur la conversion. Je conclus donc que mon hypothèse est fausse, et que les éléments du livre qui permettent de regarder avec antipathie ces illuminés fanatiques, loin de procéder d’un dessein conscient de l’auteur, résultent de ses opinions flottantes et de la confusion de son esprit à la fois lucide et trop soumis aux préjugés pour tirer toutes les conséquences de ses réflexions. La lettre de Glaucus, dans le dernier chapitre, doit être une façon de faire du personnage principal son porte-voix, en lui donnant la parole. Glaucus avoue préférer la modération et la bienveillance au zèle intolérant de ses nouveaux coreligionnaires, qui les pousse à maudire tous ceux qui ne partagent pas leur foi (p. 438). Comme si tout ce qui précède ne démontrait pas que cette intolérance et cette foi étaient inséparables ! Décidément, Bulwer-Lytton ne devait pas vraiment savoir ce qu’il pensait.
Cette conversion après réflexion prend d’ailleurs d’autant plus de valeur que, à quelques instants d’être confronté au lion, Glaucus avait auparavant, dans un mouvement admirable de noblesse d’âme, refusé de céder aux objurgations d’Olynthus : « À cette dernière heure, ce serait de ma part une sorte de bassesse et de lâcheté, d’accorder à la terreur ce qui doit être le résultat de longues méditations. Si j’embrassais ta foi, si je renversais les dieux de mes pères, n’aurais-je pas été séduit par les promesses du ciel ou effrayé par les menaces de l’enfer ? » (p. 404). Les longues méditations ont eu lieu dans l’ellipse qui précède l’ultime chapitre, et elles ont bel et bien débouché sur la conversion. Je conclus donc que mon hypothèse est fausse, et que les éléments du livre qui permettent de regarder avec antipathie ces illuminés fanatiques, loin de procéder d’un dessein conscient de l’auteur, résultent de ses opinions flottantes et de la confusion de son esprit à la fois lucide et trop soumis aux préjugés pour tirer toutes les conséquences de ses réflexions. La lettre de Glaucus, dans le dernier chapitre, doit être une façon de faire du personnage principal son porte-voix, en lui donnant la parole. Glaucus avoue préférer la modération et la bienveillance au zèle intolérant de ses nouveaux coreligionnaires, qui les pousse à maudire tous ceux qui ne partagent pas leur foi (p. 438). Comme si tout ce qui précède ne démontrait pas que cette intolérance et cette foi étaient inséparables ! Décidément, Bulwer-Lytton ne devait pas vraiment savoir ce qu’il pensait.
Tout bien réfléchi, j’incline à croire que sa seule croyance solide, c’était celle de la survie de l’âme, que proclame Glaucus : « Nous savons que nous sommes frères, en âme aussi bien qu’en chair, pour toujours, toujours. Les siècles peuvent rouler, notre poussière peut se dissoudre, la terre peut se dessécher, mais la roue de la vie continuera de tourner dans le cercle de l’éternité ! La vie est impérissable, elle est sans fin » (p. 436). Une assertion métaphysique qui se veut en quelque sorte auto-démontrée, puisque le roman qui la contient a ressuscité les personnages… Sauf que ces personnages sont fictifs et que, n’en déplaise à la prétention de l’auteur, un roman, quelle que soit la sûreté de sa documentation, ne fait pas revivre une ville de 20 000 âmes. La « Cité de la Mort » (p. 147) démontre plus la précarité de la civilisation que l’immortalité de l’âme.
[1] En comptant une série télé de 1984 et un téléfilm de 2003.
[2] D’après la fiche technique du film, ils s’y étaient pourtant mis à cinq pour commettre le scénar : Sergio Corbucci, Ennio De Concini, Luigi Emmanuele, Sergio Leone, Duccio Tessari.
[3] Dans la préface (p. 3), il déclare que le personnage de Nydia procède d’une boutade d’un de ses amis, qui lui a fait remarquer que les aveugles avaient dû être favorisés pour retrouver leur chemin dans la ville, quand celle-ci fut plongée dans une obscurité totale. Or, alors qu’il aurait pu tirer de cela une ou deux pages saisissantes, il expédie cette trouvaille en une phrase plate et abstraite, page 429 : « Guidant sa marche à l’aide du bâton qu’elle portait toujours, elle continua d’éviter, avec une incroyable dextérité, les amas de ruines qui encombraient ses pas, de traverser les rues et, sans dévier son chemin (tant cette cécité, si effrayante dans le cours de la vie, était propice alors), elle arriva au rivage ». Au lieu d’adopter le point de non-vue de l’aveugle et de nous faire promener à tâtons dans les rues (une description non-visuelle, purement tactile ! beau défi pour un écrivain), le romancier explicite l’idée sans l’incarner. En plus il se répète, car il avait déjà écrit page 422 : « sa cécité rendait la route familière pour elle seule… Accoutumée dans sa nuit perpétuelle à traverser les détours de la cité, elle les avait conduits, sans se tromper, vers les rivages de la mer ». En somme, Bulwer-Lytton s’est intéressé à la vie d’une jeune esclave aveugle victime d’un amour sans espoir (et Nydia est l’un des personnages principaux du roman, peut-être le troisième par ordre d’importance), mais pas du tout au privilège de l’aveugle dans la nuit et la panique.
[4] Compte tenu des deux préfaces et de l’épigraphe, le roman commence à la page 11 et n’a donc que 430 pages.
[5] La date longtemps admise du 24 août, fondée sur la lettre de Pline le jeune qui, dans plusieurs manuscrits (mais pas tous), parle des calendes de septembre, est certainement fausse. De nombreux indices archéologiques montrent qu’on était plutôt en automne. Certaines monnaies sont même postérieures à début septembre 79. Voir L’Histoire, juin 2004, p. 49 et cet article.
[6] Par contre, la maison d’Ione existe à Pompéi… mais à un endroit non révélé ! : « La voyageur pourra chercher parmi les ruines de Pompéi la maison d’Ione. Elle est à peine visible ; je ne veux pas en indiquer les restes au touriste vulgaire. Celui qui aura plus de sensibilité que la foule, la découvrira aisément : quand il l’aura trouvée, qu’il garde comme moi le secret » (p. 264). Une ruse cousue d’un aussi gros fil blanc fait sourire de pitié.
[7] Aziza laisse ici son imagination se substituer à sa mémoire de lecteur : en fait le procès est élidé par Bulwer-Lytton, qui se contente d’en donner un résumé rétrospectif par le dialogue de deux personnages secondaires, page 355.
[8] Des rapprochements convergents ont pu établir que Villiers, dans Isis et dans Axël, s’était souvenu de Zanoni de Bulwer-Lytton (1842). Au cas où il ait lu aussi Les Derniers jours de Pompéi, il n’a pu manquer d’être frappé par le personnage d’Arbacès. Un tel passage, par exemple, a dû susciter en lui des résonances intimes : « Chez lui, fils d’une dynastie tombée, débris d’un peuple abattu, régnait cet esprit d’orgueil mécontent qui n’abandonne pas les êtres d’un ordre supérieur, lorsqu’ils se sentent bannis inexorablement de la sphère où leurs ancêtres ont brillé, et à laquelle la nature, non moins que la naissance leur donnaient des droits ; il est en lutte avec la société ! il ne voit que des ennemis dans l’espèce humaine. » (p. 150). On songe à la phrase qui clôt « Souvenirs occultes », l’avant-dernier des Contes cruels : « je porte dans mon âme le reflet des richesses stériles d'un grand nombre de rois oubliés ».
[9] Et aussi, dans la préface, pour expliquer que le Moyen Âge est plus proche de nous que l’Antiquité (donc plus facile à ressusciter pour un romancier) : « leur foi chevaleresque reste la nôtre, leurs tombes sanctifient encore nos églises » (p. 2).
[10] Page 204, il signale lui-même dans une note en bas de page que l’image du diable chrétien provient de Pluton et surtout de Pan !
[11] Page 189, il signale aussi que le crime d’infanticide rituel, que les Nazaréens « lorsqu’ils eurent triomphé, reprochèrent aux Juifs », était exactement la calomnie dont ils avaient eux-mêmes été victimes à l’origine dans le monde païen.
[12] Matthieu 27, 45-53. Marc (15, 33-38) et Luc (23, 44-46) parlent aussi de ténèbres couvrant la terre pendant trois heures, mais ignorent cette mythique résurrection des morts propre à Matthieu.
[13] Qu’on en juge : « Mais qui pourrait décrire l'horreur de cette nuit ? Je marchais à travers la cité, la terre vacillait de moments en moments ; les maisons tremblaient sur leurs fondements ; les vivants avaient déserté les rues, mais non pas les morts. Je les voyais se glisser dans l'ombre, sombres et terribles fantômes, avec les vêtements de la tombe ; l'horreur, l'angoisse, le mystère, se peignaient sur leurs lèvres immobiles et, dans leurs yeux sans éclat ; ils me touchaient en passant ; ils me regardaient ; j'avais été leur frère ; ils me saluaient comme une connaissance ; ils s'étaient relevés pour apprendre aux vivants que les morts peuvent ressusciter. »
[14] « Je suis celui dont tu as lu l’histoire dans l’Évangile de l’apôtre ». Il y a là une erreur historique, car l’épisode de la résurrection de Lazare est ignoré des trois synoptiques et n’est raconté que par Jean (11, 1-44). Or l’évangile de Jean est très tardif, et il est impossible qu’il ait pu être lu dans les communautés d’Italie (qui d’ailleurs existaient à peine, et certainement pas à Pompéi) en 79. Mais on peut admettre qu’en 1834, Bulwer-Lytton ne pouvait connaître ces découvertes de la recherche moderne.
[15] Cette notation incidente du narrateur ne permet guère d’en décider : Ione « n’avait pas encore eu le temps d’arriver à cette consolante idée qui nous persuade que nous ne restons pas seuls, que les morts restent avec nous » (p. 321). Cette consolante idée qui nous persuade… pour quelqu’un qui tiendrait la présence des morts parmi les vivants pour une certitude objective, il y a des formulations plus tranchantes. Notons quand même qu’Olynthus croit dur comme fer à cette survie de l’âme (p. 361). Quand on songe aux personnages du magicien Arbacès et de la « saga du Vésuve » (saga signifiant ici sorcière, magicienne), on se dit que le futur auteur de Zanoni et de La Race à venir était déjà empreint par sa fascination pour l’occultisme. Donc il devait réellement croire à cette idée de la présence des morts, chère aux occultistes ? Mais quand il parle de la magie antique, c’est pour prononcer contre elle un réquisitoire de deux pages (151-152) ! : « rêveries imaginaires », « crédule et superstitieux », « le plus remarquable de ces imposteurs », « du plus grossier et du plus physique matériel de terreur », etc. Une note de la page 375 met le comble à l’ambiguïté, pour ne pas dire à la confusion. Bulwer-Lytton commence par un éloge de la doctrine d’Épicure, « simple et limpide ». En s’appuyant sur Velleius (porte-parole de l’épicurisme dans De la nature des dieux de Cicéron), il affirme qu’Épicure croyait à l’existence de dieux étrangers aux troubles des humains : « philosophie hardie et sublime ». Mais le voilà qui relaye ensuite la réfutation de Cotta (autre personnage du même dialogue), selon qui Épicure était en réalité athée, sans rien opposer à ses forts arguments. Et conclut en brocardant « les élégants philosophes du Jardin qui, après avoir perverti complètement la limpide et pragmatique morale d’Épicure, trouvèrent tâche plus aisée de corrompre sa métaphysique visionnaire et pleine d’embûches ». Alors pourquoi avoir cité la thèse de Cotta ? et pourquoi ne lui avoir donné aucune réplique, ce qui ne peut qu’amener le lecteur à lui donner raison ??

2 commentaires
j ai ce roman plin de scupis et de chaleur
De « scupis » ??!?
Voudriez-vous dire : de soupirs ?
Écrire un commentaire